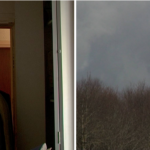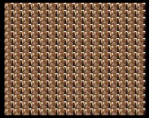Collectif COMET
Des plans pour le Comet
L’époque est aux équipes, de foot ou de campagne. Elle manque par contre de collectifs. Si les premières sont d’essence managériale, guerrière et conquérante, les seconds relèvent plus de l’autarcie et d’une logique de bric et de broc. Débordements prétend bien sûr faire partie de cette dernière catégorie et en veut pour preuve son évidente pénurie de moyens, qui lui permet parfois de se fantasmer en ZAD de la critique. Or, si les équipes fonctionnent à l’alliance, les collectifs, eux, s’associent par affinités, si bien qu’il est tout naturel qu’une revue comme celle-ci se soit acoquinée avec COMET.
Les réponses devraient amplement suffire à présenter le groupe, mais il n’est pas inutile de se reporter au préalable à son site. Précisons que seuls cinq des membres ont pu être présents ce jour-là, dont quatre réalisateurs : Benjamin Hameury (Les voisins, Return to Providence), Maxime Martinot (Trois contes de Borges, Return to Providence), Camille Polet (Gang), Léo Richard (Le voleur de Lisbonne) et Maxime Roy (qui a produit l’ensemble des films). Chacun parle bien sûr en son nom. Les autres membres du collectif sont Juliette Barrat, Fabio Caldironi, Lana Cheramy, Jeanne Cousseau, Lisa Merleau, Manon Messiant et Margaux Robin.
Débordements : La légende dit que le Collectif COMET est né sur les bancs de Ciné-Sup, la classe préparatoire aux écoles de cinéma située à Nantes. Pouvez-vous détailler son état civil ?
Maxime Roy : L’association a effectivement été créée en février 2010, par des élèves de ma promotion qui voulaient combler un désir de réalisation en partie insatisfait par notre cursus. Le nom vient d’ailleurs de là : COMET c’est, très prosaïquement, « COurt-METrage ». Mais depuis, la chose a beaucoup évolué. Aucun de nous cinq, par exemple, n’était là à la création, même si certains membres fondateurs font encore partie du collectif. Le groupe a peu à peu aggloméré des gens de différentes promotions, si bien qu’au bout du compte la plupart des gens passés par l’asso sont des anciens de Ciné-Sup, qui est un peu le ciment qui nous lie.
Camille Polet : Il n’y a jamais eu de réelle décision fondatrice, ou de désir de faire des films d’une manière spécifique. Le collectif a surtout été un outil modulable par chacun, afin que chacun s’essaie à faire des films à sa manière, autrement, même si on ne savait pas encore ce qu’était cet « autrement ».
Léo Richard : Les usages du collectif ont en effet été réinventés bien au-delà de sa naissance. À Nantes, c’était tout d’abord une structure qui devait aider à faire des films en dehors de Ciné-Sup. Ce n’est qu’une fois à Paris que le groupe s’est réellement cristallisé, justement lorsqu’on s’est retrouvés dispersés, à travers les différentes écoles, facs et expériences de travail. Ça a formé un réseau d’entraide, de conseil et de mimétisme, sans qu’il y ait vraiment d’intention préalable. Ça maintenait un désir de faire des films et surtout, on se prouvait mutuellement que les choses étaient possibles : certains ouvraient des portes dans lesquelles les autres s’engouffraient. On n’était pas obligés de croire ce qui peut parfois se dire dans les formations classiques ou sur les plateaux professionnels, puisqu’on avait vu des amis faire autrement. Par exemple, je ne pense pas que j’aurais osé tourner un film de trente minutes en quatre jours, comme Le voleur de Lisbonne, sans cette expérience commune.
Camille Polet : Autant on était plus ou moins compétents en termes de technique et de tournage, autant on ne savait pas comment produire un film. D’ailleurs, le producteur de tous les films, Maxime Roy ici présent, est ingénieur du son de formation. Cette ignorance a été libératrice, puisqu’au lieu de suivre des protocoles déjà établis, on a simplement inventé ensemble une manière de travailler qui nous soit propre.
Maxime Roy : Il y avait aussi l’idée que, à Paris, COMET serait le moyen de se créer une place plutôt que d’avoir à en trouver une dans le réseau existant.
Maxime Martinot : Et un moyen, aussi, de « dés-auteuriser » les films, ou du moins d’atténuer le sacre de l’auteur, dans un pays où son culte reste si fort. Il ne s’agit pas de films collectifs à proprement parler – tous sont signés individuellement – mais la dimension collective a un rôle central dans leur fabrication.
Léo Richard : Si on regarde un peu l’histoire de cette forme « collectif » au cinéma, on se rend assez vite compte que la plupart se sont cristallisés autour d’une figure forte de cinéaste – Cassavetes, Rohmer, etc. – se taillant une équipe à sa mesure. Il existe au fond assez peu de collectifs de cinéma semblables à ce que peuvent être, par exemple, des collectifs d’artistes, de graffeurs ou de rappeurs, dans lesquels chacun développe sa propre expression à l’intérieur d’une matrice collective. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tout marche très bien et qu’on arrive, dans nos vies, à contrer l’individualisme ambiant. Le milieu est ce qu’il est, et on est loin de se maintenir barricadés dans une utopie.
D : Et où en êtes-vous aujourd’hui, en termes de moyens et d’effectifs ?
Maxime Roy : C’est en fait à ses débuts que l’association a regroupé le plus de membres, près d’une quarantaine. Il y avait eu une politique d’adhésion « de masse » pour lever des fonds, mais ça a vite entraîné un embourbement administratif. On a fini par créer une distinction entre membres actifs et membres bienfaiteurs, et à force de dégraissages on est arrivé à un effectif stable comptant entre dix et quinze personnes, avec des entrées et sorties régulières. Quant à l’argent des cotisations, fixées à douze euros par an, il sert surtout à couvrir les besoins administratifs. Les moyens de production viennent plutôt, côté financier, de subventions pour les projets étudiants, et côté technique, des formations qu’on a suivies.
Maxime Martinot : Tout ça peut donner l’impression d’une certaine rigidité, mais en réalité le réseau est à la fois ouvert et fermé, en fonction des affinités de chacun. Beaucoup de gens gravitent autour de COMET sans en être officiellement membres. Pour moi, c’est un endroit où je suis passé, c’est un aimant à faire des films, un moyen de consolider une force fluctuante.
Benjamin Hameury : Un moyen aussi de renouer avec l’exigence qu’on avait connue à Nantes, de retrouver un certain rythme, une sorte de discipline d’équipe que l’université tend à diluer.
D : Justement, avez-vous le sentiment que l’enseignement reçu à Ciné-sup a imprimé une sorte de marque sur le cinéma que vous avez fait par la suite ? Comme l’histoire de COMET est liée à tout un ensemble de structures pédagogiques, c’est un bon moyen d’apprécier l’effet qu’elles peuvent avoir – ou pas – sur une signature esthétique.
Camille Polet : Disons que c’est assez circonstanciel : on a été initiés au cinéma ensemble, à un moment décisif dans la formation d’un regard, et sous l’impulsion des mêmes professeurs qui ont laissé une grande empreinte sur nous par le choix des films qu’il nous ont montrés. S’il y a une influence de la formation, c’est là, dans ce qu’on a appris à voir ensemble, mais aussi beaucoup dans la manière dont on la recevait collectivement, donc aussi dans l’influence mutuelle des élèves les uns sur les autres.
Léo Richard : Du côté des enseignants, Jérôme Baron par exemple, dont l’influence peut être revendiquée par certains réalisateurs du collectif, était à la fois le professeur d’histoire du cinéma et le programmateur du festival des Trois Continents. On suivait un enseignement hebdomadaire, qui allait de Boris Barnet à Pedro Costa, et, une fois l’an, les rétrospectives et les compétitions qu’il proposait dans le festival. Ce qui se dégageait de ce corpus, c’était un rapport très rigoureux au cinéma. Plus qu’une opinion sur les films, la formation nous a transmis une méthode, un certain sens de la précision du regard. Par ailleurs, le culte de la technique est étranger à Ciné-sup, même s’il y a bien des gens très pointus. Cette absence de dogme du « bien faire », croisée à l’absence de matériel professionnel dans la formation, a pu jouer dans notre manière de penser nos premières réalisations. On nous avait montré des films géniaux faits avec vraiment peu de choses, alors on ne fantasmait pas tellement ce saut qualitatif du « pro » et du « propre ».
Maxime Martinot : On voyait aussi beaucoup de cinéma classique. Le but des cours était clairement de mettre à égalité Douglas Sirk et Alain Cavalier, mais pour ma part c’est plutôt le second qui pouvait me désinhiber.
D : Vous étiez à peu près tous encore étudiants à l’époque des premiers films du collectif, dont plusieurs sont le fruit de cursus spécifiques, comme le Master Réalisation de Paris 8. Qu’est-ce que tout cela a pu impliquer, en termes de matériel disponible bien sûr, mais surtout de conseil, d’encadrement ou d’antagonisme ?
Maxime Roy : La fémis a co-produit à peu près tous les films que l’on a faits pendant cinq ans, non pas avec des finances mais en mettant à notre disposition des studios, du matériel ou des équipements de post-production, alors même que les réalisateurs n’y étaient pas étudiants. Il faut bien dire, contrairement à un certain mythe romantique, que les films ont en partie pris forme grâce aux institutions scolaires. Le collectif nous a donné le courage de faire ces films en-dehors de nos formations respectives, mais nous ne nous sommes pas complètement émancipés de ces dernières.
Léo Richard : Il faut se dire que le collectif est un hybride, un point de jonction entre des désirs individuels, des formations et un groupe. Les écoles et les facs sont aussi importantes que le reste. J’ai pu avoir tendance à dénigrer les institutions en valorisant ce qui s’en écarte ou s’y oppose, mais pour ce qui me concerne, j’ai plus l’impression que mon film à été fait grâce à Paris 8 que contre lui : des profs et des élèves m’ont conseillé, ça ouvrait la voie à certains financements, etc. Surtout, la temporalité universitaire, aussi étrange soit-elle, permet de rompre avec une temporalité solitaire de la réalisation, qui peut être totalement déprimante.
D : L’adieu à Ciné-Sup s’est traduit par une diaspora pédagogique, puisque chacun est parti suivre une formation spécialisée. Cela a-t-il aussi impliqué une diversification des spécialités, de sorte qu’un heureux pluralisme technicien règne sur les tournages ?
Léo Richard : Le collectif en tant que tel ne correspond pas à une équipe de tournage au complet. Par contre, certains collaborateurs extérieurs ont travaillé sur plusieurs de nos films. Et par ailleurs, on travaille souvent les uns sur les films des autres, en y occupant des postes loin différents de nos métiers habituels respectifs.
Camille Polet : Oui, de la liberté avant toute chose. Les gens font ce qu’on leur propose en fonction des besoins et envies, même si certains restent à des rôles fixes – Juliette Barrat à l’image, par exemple. Maxime, qui produit tous les films, est à la base mixeur. D’autres se retrouvent à faire des costumes ou, très souvent, à jouer. On n’est pas pour autant dans une logique mettant chacun hors de sa place attendue par principe : la technicité de certains métiers ne permet pas non plus une interdisciplinarité totale.
Maxime Martinot : Encore et toujours : c’est une question d’affinité. Il y a aussi le fait qu’on commence à savoir très précisément comment travaillent les autres, ce qui parfois peut aussi nous donner envie de leur proposer des positions encore inconnues, pour voir, parce qu’on s’imagine ce qu’ils pourraient y faire.
Benjamin Hameury : Maxime M. et moi, on a passé près de cinq ans à bosser ensemble sur Return to Providence, qu’on a réalisé à trois avec Pierre Desprats. J’ai eu largement le temps de voir comment il bossait, et ça me semblait naturel de lui demander de faire le cadre sur Les voisins. Pour revenir à ta question, on travaille surtout en équipe réduite. Pour Trois contes de Borges, c’était différent, ça se tournait en partie en studio et il y avait besoin de pas mal de monde, mais en général on est entre une demi-douzaine et une quinzaine de personnes dans l’équipe.
D : Comment vous vous débrouillez, niveau financements ? Et est-ce qu’une part de l’argent reçu vous permet de vous payer, de faire des heures d’intermittent ?
Maxime Roy : Non, on ne se paye pas, jusqu’à maintenant du moins, et la notion de recettes engrangées grâce aux films produits nous est encore inconnue. Cela nous apparaissait normal quand nous étions encore tous étudiants, mais le problème de la rémunération va de plus en plus se poser. Quant aux films, seuls les très petits budgets ont été réalisés avec des fonds propres, comme Toi mon toit ou Staub, qui ne devaient pas coûter plus de trois ou quatre cents euros. Les « gros » budgets varient entre dix et vingt-cinq mille euros, dont 80% vient du système universitaire – le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes et le CROUS. Le reste vient du financement participatif et du e-mécénat, sans compter les dons ou prêts en nature. Il faut noter qu’avec le nombre de films produits, il y a toujours plusieurs productions en cours, ce qui permet de garder une trésorerie à flot entre les films déficitaires et les économies réalisées sur d’autres, pour se donner du champ, c’est un autre avantage de cet esprit de coopérative. Par contre, on n’a pas investi à proprement parler, ou très peu, dans la structure même du collectif, dans du matériel pérenne ou autre. Le seul matériel qu’on a acheté, à des coûts dérisoires, c’est la caméra VHS pour Gang et la DV pour Le voleur de Lisbonne.
D : Que vous faites-vous, concrètement, pendant les réunions ? Avez-vous jamais, par exemple, essayé d’écrire un texte pour vous définir, pour cibler des positions communes, comme une sorte de manifeste ou de charte ?
Maxime Martinot : Il faut avouer que, bon, quand on a commencé à faire des films, on ne s’est jamais demandé « mais qui sommes-nous donc ? » Finalement, la question ne s’est posée que lorsque des gens extérieurs nous l’ont adressée, à force de voir circuler le nom en festivals et dans les génériques. Le regard public s’est d’abord cristallisé sur le collectif en postulant qu’il s’agissait d’une sorte de super-entité, cohérente et programmatique. Alors qu’en fait non.
Benjamin Hameury : C’est vrai qu’on s’est souvent demandé en réunion ce qu’on était, comment on pouvait se présenter. Mais au fond il n’y a pas d’essence de COMET, mais des circonstances. C’est drôle, d’ailleurs, parce que se retrouver pour cet entretien nous permet de vraiment formuler une fois pour toutes que nous n’avons pas une identité définie, mais plutôt une logique de groupe. Cela dit, je crois quand même qu’il y a un truc qui lie les films, les premiers du moins, c’est qu’il s’agit de films de vacances, du dehors, tournés dans les interstices qui s’offraient à nous et qui, parfois, nous permettaient de rêver des espaces vierges en-dehors de la capitale, comme des terrains de jeux.
Camille Polet : Pour ce qui concerne les réunions, disons que, très prosaïquement, elles traitent des affaires courantes – la production, la diffusion – et qu’au-delà du côté pratique, elles entretiennent l’amitié. On essaye de se retrouver environ une fois par mois, en s’arrangeant pour que tous ceux qui n’habitent pas Paris – et il y en a pas mal – puissent y venir à peu de frais. Quant au texte, à vrai dire, il y a eu à un moment le projet d’en écrire un, pour un site dont on avait l’envie, mais ça a vite été abandonné car nous avons eu énormément de mal à trouver des mots communs à tous les films, qui les englobait tous sans les appauvrir.
Léo Richard : Je ne pense pas que la définition doive forcément passer par des mots, puisque le discours est de toute façon toujours du côté de l’intention. Pour moi, une autre manière de se présenter serait de se référer aux deux événements qu’on a pu organiser, au Cinématographe à Nantes pour les cinq ans et, six mois avant, à Bruxelles, dans un lieu appelé le Rumsteek. L’idée était bien sûr de prendre en main la diffusion des films, mais aussi de faire la fête, ce qui est en soi un moyen de se définir : de se reconnaître, de se compter, de réunir tout ce qui orbite autour du collectif, bref, de se présenter sans un manifeste.
D : Est-ce qu’à défaut d’une définition, il y a des règles communes, ou un processus de travail auquel tout le monde se plie plus ou moins ?
Léo Richard : Lorsqu’on a commencé à songer à créer une société de production, il y a eu le désir de faire une charte d’éthique, venu des expériences assez dégoûtantes que chacun a pu faire sur des productions « classiques », où on trouve souvent une forme singulière de l’abjection salariale dans le milieu du cinéma, qui passe par le chantage aux heures ou au prochain travail à venir, par des abus divers liés à la précarité de nos métiers. On a réfléchi à une forme d’éthique pour le passage à une société de production. Ce sont des discussions en chantier, très passionnées, mais rien de définitif n’a été écrit.
Maxime Roy : En effet, on est en train de devenir une société de production, parce que c’est le seul moyen d’accéder à des guichets de financements nous permettant de produire des films dans une économie professionnelle (de rémunérer les gens, etc.). Et, dans cette charte dont parle Léo, on avait élaboré une règle stipulant que chaque film produit devait engager un quota minimum de membres de COMET – on avait simplement calculé combien de membres avaient travaillé sur les films antérieurs par rapport aux équipes complètes et ça avait donné une proportion sur laquelle on s’était basé. On a fini par faire marche arrière, parce que tout ça restait trop abstrait et contraignant pour la liberté de chaque réalisateur, donc incompatible avec certains projets.
D : J’imagine que vous y avez déjà réfléchi, mais, tout de même, quand on voit vos films, il y a un dénominateur commun qui frappe immédiatement, c’est les formats. Bien sûr, ils varient à chaque fois, mais la plupart partagent le fait d’être délaissés – la DV pour Le voleur de Lisbonne, la VHS pour Gang, le 16mm pour Trois contes de Borges, sans parler des textures très spécifiques de Return to Providence ou même des Voisins. La signature de COMET, à mes yeux, c’est un certain rapport à la basse définition et plus encore aux formats précaires, incertains, à l’enregistrement imparfait ou accidenté. L’opposition n’est pas tant entre pellicule et numérique qu’entre le noble (la HD, le 35mm) et autre chose – pas l’ignoble ou le pauvre, mais le rugueux.
Maxime Martinot : Il n’y a pas eu de concertation. On a tous eu envie, je pense – et c’est un phénomène qui va au-delà de COMET –, d’expérimenter quelque chose qu’on n’avait pas connu en pratique, alors qu’on a vu beaucoup de films en pellicule. Et puis, dans mon cas tout du moins, il y avait le désir de travailler avec quelque chose (le 16 mm) dont on ne sait pas trop combien de temps il va encore exister. Je crois que joue aussi un rejet de l’image propre au numérique, trop plate, trop régulière, quand la pellicule ou la DV travaillent avec une matière plus accidentelle et plus indistincte dans les traits. Avec le numérique, on voit les lignes dures des décors, alors que les anciens formats laissent plus transparaître le coloris, qui estompe les contours. C’est quelque chose de cet ordre-là qu’on cherchait…
Benjamin Hameury : …ou qu’on a trouvé en cours de route : au début, pour Return to Providence, la DV ne devait servir qu’aux essais et aux repérages, mais c’est en regardant ces rushes qu’on s’est rendu compte que c’était le meilleur format possible pour exprimer l’indistinction entre l’immense et le minuscule, qui est un peu le sujet du film : filmer en DV, ça voulait dire filmer avec du grain, et ce grouillement dans l’image créait de l’incertitude, surtout dans les plans sombres, ça devenait vite inquiétant. Ce qui se passait alors, on s’en rendait compte avec Maxime, c’est qu’un ciel normal devenait chétif, tout contenu dans cette image précaire, alors qu’un détail, comme une pierre ou une branche, pouvait suggérer des apparitions monstrueuses. Pour Les voisins, on a tourné avec une Red Scarlet et des objectifs 16 mm. Je voulais absolument faire des zooms et dézooms très longs, et Cyrille Hubert, le chef-opérateur, m’a expliqué que cela ne pouvait marcher qu’avec ce genre d’objectifs. Le dernier film de Lana Cheramy, Les couleurs de Camille, utilise également des objectifs 16 mm, mais pas pour les mêmes raisons. Elle a utilisé ces objectifs parce que son film parle de Monet et tente d’en reproduire les textures ou du moins de s’en approcher.
Léo Richard : En ce qui me concerne, me confronter à ces vieux formats, c’était questionner les représentations des époques qui leur étaient liées et les gestes qu’ils impliquaient. Dans Le voleur de Lisbonne, la DV, c’est le film de vacances. J’aimais l’idée d’une matérialité des souvenirs, le fait qu’enregistrés sur des cassettes, ils pouvaient être rembobinés. Dans Staub, ce qui m’a intéressé, c’est cette texture impure du film 35 passé sur VHS, dans laquelle on a chacun découvert beaucoup de très grands films. Cette texture crée une saute temporelle troublante, une désacralisation aussi, d’autant que Staub s’amuse à croiser ces plans de Dreyer ou de Lang en VHS avec des images de vidéo-surveillance.
Camille Polet : C’était ce même problème des représentations du passé à travers le format qui m’intéressait, sauf que, dans Gang, ça passe à travers la question du film d’époque puisque le film est scindé en deux et qu’il se passe à la fois dans les années 1980 et dans le présent. La VHS permettait de relier les deux époques. Je ne voulais pas tourner en deux formats séparés selon les époques, c’était justement ce qu’il reste esthétiquement d’une époque à l’autre qui m’intéressait. Une autre dimension a joué : le film se passe essentiellement dans des lits, avec des gens en pyjama, et j’avais la sensation que la VHS est au cinéma ce que le pyjama est aux habits.
D : Comment avez-vous récupéré ce type de matériel ? C’était vos premiers essais avec ?
Maxime Roy : Pour ce qui est de la pellicule, les étudiants de la fémis en image ont encore une formation au 16 mm et au 35 mm, donc le chef-opérateur de Trois contes de Borges, Raphaël Vandenbussche, était tout à fait compétent là-dessus. Et Kodak notamment continue de produire la pellicule Super 16 mm qu’on a utilisée. Pour la caméra VHS, on a dû la récupérer sur leboncoin, parce plus personne n’en fabrique. Par contre, très bizarrement, on n’a eu aucun mal à trouver auprès du fournisseur des bandes magnétiques pour enregistrer le son sur un Nagra IV, alors que le support magnétique n’est plus utilisé depuis longtemps.
Léo Richard : La spécificité de la DV ou de la VHS, de ce point de vue, c’est qu’il ne s’agit pas de formats nobles, et que donc, bien plus tardifs que la pellicule, ils ont tout de même disparu avant elle. Et c’est parce qu’ils étaient purement domestiques qu’ils sont d’autant plus intimement rattachés à une époque, en raison de tout un tas de contingences commerciales. D’où l’intérêt qu’il y a, aujourd’hui, à travailler avec de tels formats « ig-nobles ».
Camille Polet : Il y a aussi le fait que ces formats n’ont jamais réussi à devenir des formats professionnels. Un seul grand film a été tourné en VHS, c’est La pudeur ou l’impudeur de Guibert. Autrement, il y avait le HI8, qui en était l’équivalent pour les pros, mais dont le rendu est très différent. Or les formats domestiques poussent à plus de bidouillage. La caméra VHS que je voulais pour Gang, parce qu’elle avait les couleurs les plus douces, ne permettait pas de rembobiner les bandes. Du coup, au lieu de passer par des cassettes, on enregistrait directement sur un support numérique, sur un ordinateur portable relié à côté. J’étais de toute façon plus intéressée par les capteurs VHS que par la cassette en tant que telle. Le son, par contre, était sur bande, donc on a fait pas mal de répétitions pour ne pas gâcher ce qu’on avait ; on a d’ailleurs épuisé les stocks juste à la fin du tournage.
D : Autrement, est-ce que vous voyez d’autres points communs à vos films ?
Camille Polet : Il y a peut-être quelque chose dans le rapport à l’acteur et à la parole, dans le refus d’être dans un jeu vraisemblable, qui demande une forme de croyance de la part du spectateur. On joue à jouer, on n’est pas dans le naturalisme. Ça me met un peu mal à l’aise quand quelqu’un essaie de feindre une émotion, sur un tournage, et je trouve assez bizarre de faire comme si on ne savait pas qu’on fait semblant. Il y a peut-être plus de vérité à savoir qu’on fait semblant, et à le montrer.
Léo Richard : Je crois que cette opposition au modèle naturaliste vient aussi du fait que nos films se rapportent beaucoup plus à la littérature qu’au théâtre. On est donc resté étranger au culte de l’acteur et au mythe de la spontanéité ou, à l’inverse, du « faire vrai » (l’acteur comme spécialiste des apparences, etc.). D’où le fait que presque tous nos films ont été tournés avec des comédiens amateurs, qui n’ont jamais fait de cinéma et qui n’ont pas vraiment l’intention d’en faire par la suite. Cela ne veut pas dire qu’on n’accueille pas les accidents ou les improvisations mais il me semble qu’il y a une grande attention à l’écriture, au texte.
Benjamin Hameury : Oui c’est vrai ! Pour Les voisins j’ai tourné avec des gens de mon quartier d’enfance, et ils avaient tous une manière différente de fonctionner lorsqu’ils avaient des répliques. L’un d’eux, Dédé, voulait que je lui explique tout en détail avant qu’on tourne, mais d’autres improvisaient totalement à partir de deux ou trois mots que je leur donnais.
D : Quelle diffusion ont eu jusqu’à maintenant les films, dans et hors des festivals ? Est-ce que, parmi ces derniers, il y en a avec lesquels vous vous sentez plus en affinité ?
Maxime Roy : Sur la dizaine de films du catalogue, trois ont été pris au FIDMarseille, notre meilleur hôte aux côtés de Curtas Vila do Conde. Deux ont été montrés aux Entrevues de Belfort, deux aussi à Côté Court (Pantin), et Brive et Angers en ont aussi accueillis un chacun. C’est à la fois beaucoup et trop peu. Les festivals, aussi accueillants soient-ils, ne peuvent pas suffire, et il y a une certaine frustration à ne pas pouvoir garantir une seconde vie (voire parfois une vie tout court) aux films. Mais c’est le lot des formats courts. Jusqu’à maintenant, hors des événements qu’on a nous-mêmes organisés, il n’y a eu que quelques projections ponctuelles, grâce à des connaissances liées à tel ou tel lieu culturel. On continue à chercher des solutions pour donner plus de visibilité à ce qu’on fait.
D : Je me permets de platement conclure par une question sur vos projets en cours.
Maxime Roy : La grand chantier, c’est la transformation de l’association en société de production, qui est presque une nécessité de survie – on a besoin de s’inscrire dans une économie professionnelle pour pouvoir continuer à faire des films ; comprendre : on ne peut plus demander à des équipes de travailler bénévolement – mais cela demande un investissement de la part de tous les membres, or ils ne sont pas tous prêts à passer à cette étape avec le collectif. Il va donc évoluer une nouvelle fois vers une forme différente. Mais à part ça, on continue de faire les choses comme elles viennent, avec un programme toujours chargé : d’abord les finitions des films en cours – Les couleurs de Camille de Lana Cheramy et Un peu d’écume autour des Vagues de Jeanne Cousseau, une nouvelle adaptation littéraire – puis des nouveaux projets de Fabio Caldironi, Léo Richard et Benjamin Hameury en écriture déjà bien avancée !