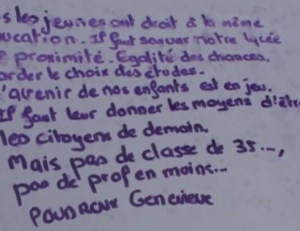Des spectres hantent l’Europe, Maria Kourkouta et Niki Giannari
Voir l'enfant
Raphaël Nieuwjaer : Peut-être faut-il, par souci de clarté, prendre Des spectres hantent l’Europe à rebours, et commencer par poser quelques faits. A l’instar des documentaires de Wang Bing, par exemple, le contexte de tournage n’est donné qu’à la fin, en un carton d’ailleurs assez succinct. Maria Kourkouta et Niki Giannari ont réalisé leur film en mars 2016 dans le camp de fortune de réfugiés d’Idomeni durant les jours où la Commission européenne a décidé la fermeture de la “route des Balkans”. Au fil des semaines et des mois, entre douze et quinze mille personnes, venues notamment de Syrie, s’étaient alors retrouvées bloquées à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Le film enregistre d’abord cela, un cheminement interrompu, et s’il impressionne, s’il touche, c’est pour moi dans sa façon obstinée, méticuleuse, de s’attacher aux mouvements, aux démarches peut-être, même et surtout lorsqu’il n’en reste que des piétinements.
Robert Bonamy: Si son contexte est énoncé en fin de film, plusieurs éléments, paroles, protestations et assignations le désignent tout de même plus ou moins : l’annonce par l’intermédiaire des hauts parleurs de la fermeture de la frontière, le drapeau allemand qui est brandi, une scène de réunion polémique lorsque les réfugiés décident d’arrêter le train et débattent avec un négociateur grec hors-champ, etc. Mais avant de t’emboîter le pas, je souhaite préciser que je me garderai bien d’exprimer un avis incisif ou tout à fait décidé à propos du film. Je ne sais pas à quel point il impressionne.
Des spectres hantent l’Europe comporte deux parties de durées très inégales : la première tournée en vidéo numérique, au format panoramique, la seconde, dans le dernier quart d’heure, en argentique, avec une Bolex 16 mm, le format étant alors « carré ». Tu parles des mouvements, des piétinements qui n’ont plus de direction (mais ces hommes, femmes et enfant marchent quand même, selon des lignes horizontales qui ne sont pas en direction de l’horizon), sans doute en pensant au premier plan fixe en grand angle, qui trouve ensuite ses répétitions et ses modifications, car je crois que le plan revient trois fois, en se rapprochant une fois des pas dans la boue. Ces plans me paraissent presque des études ; je me souviens des réalisations expérimentales de Maria Kourkouta intitulées 10 Subway Préludes (2008-2012), qui travaillent la décomposition du mouvement (en référence à Marey et à Muybridge), notamment de la marche démultipliée en plan rapprochée, à New York, pour l’une d’entre elles. Pour ce film, le contexte est bien différent, et il s’agit bien d’un autre trajet, à plusieurs égards contraint par d’autres choses qu’un jeu de formes. Je distingue ici deux parties, mais nous pourrions procéder à un autre découpage, en identifiant la scène du blocage de la voie ferrée comme une partie autonome.
R.N.: Si le contexte peut en effet se dévoiler par bribes, il me semble que la désorientation et l’absurdité l’emportent, comme en témoigne le propos d’un adolescent entendu au début du film : « Je te jure, j’en sais rien, dès que je vois une queue, je m’y mets ». Le spectateur non plus ne sait pas tout à fait ce qu’il voit, ni ce qui se passe. Et, de fait, les cinéastes ne cherchent pas à rendre compte, par ces plans de files interminables, de l’organisation du camp, mais d’une dépossession : l’attente est sans fin, de par sa durée mais surtout de par son absence de but identifiable. Le grand dessein qui consistait à vouloir se rendre en Allemagne se trouve nié par la fermeture de la frontière, bien sûr, mais surtout peut-être par la multiplication de ces « marches » dérisoires – parfois pour une boisson, parfois pour rien. Au contraire, le plan d’ouverture est rythmé par une multitude de démarches, d’allures, d’attitudes, et en cela il est bien différent des recherches de Marey et Muybridge, qui visent plutôt à établir le paradigme de chaque action ou geste. Certains passent indifférents, d’autres adressent un bref salut à la caméra. Certains se traînent péniblement, d’autres avancent à grandes enjambées. Certains sont encombrés de sacs, d’autres n’ont presque rien. Le fixité du plan ne fait que mieux ressortir cette diversité, qui passe aussi par le son, les bruits de pas ponctuant selon un rythme sans cesse changeant le souffle du vent. Pour résumer, il me semble que la première opération du film consiste à montrer comment des forces, des élans, se trouvent « tordus », comprimés, empêchés par l’encadrement du camp, là où le cadre cinématographique se laissait au début traverser, transpercer. Au moment où ce plan d’ouverture est tourné, le camp existe déjà mais symboliquement, il me semble que l’on est encore du côté de l’exode – personne ne semble se rendre là, à Idomeni, même provisoirement. Par la suite, la courbure d’une file sans début ni fin, l’écrasement des corps les uns contre les autres, l’absence même d’un quelconque principe de composition du plan, manifestent au contraire la rétention des êtres dans la glu anonyme d’un lieu qui tend à abolir tout mouvement, c’est-à-dire toute histoire.
R.B.: Oui, il y a bien cette façon, sans raison, de rejoindre la queue. C’est très marquant. Et l’anonymat comme règle, aussi. Comme si, ici, il ne devait pas y avoir quelqu’un. Cela ne rejoint peut-être qu’en partie cette question, mais, dans ces plans, je suis également très marqué par la gamme chromatique des images numériques, les couleurs engrisées. Elles impressionnent peu, justement. Sans doute faut-il être prudent et ne pas en conclure à une insistance de la décoloration, au sens de la flétrissure ; ce qui est certain, c’est que le vert gris de la terre, de l’herbe, ne brille jamais pour ceux du camp d’Idomeni. Je remarque aussi la (dé)teinte comparable des K-Way uniformes, des tentes. Le pays aux profondeurs grises, les rails, les cailloux. Les couleurs s’effacent. Les chaussures aux marques reconnaissables se défont. Mais dans leurs mauvaises pointures, leur usure, quelque chose paraît, qui est un peu plus qu’un signe de misère.
Très différent est le gris du grain pelliculaire, lorsque des hommes, des femmes et des enfants sont filmés en quelques plans, dans la seconde partie du film. Les individus s’avancent ou s’ouvrent en direction de la caméra 16 mm dans une relation différente aux autres appareils, aux autres caméras qui envahissent la frontière. Si le film touche, c’est peut-être dans sa structure et ce « retournement » final, avec ces archives qui ne sont pas celles d’un passé. Reste toutefois à questionner leur statut, ce qu’elles disent ou non de l’avenir.
R.N. : Plus qu’un signe de misère, en effet, ces chaussures sont la marque du déplacement, de sa violence. En cadrant le bas plutôt que le haut du corps, les cinéastes ne produisent pas une masse anonyme, au contraire de l’administration européenne, mais rattrapent l’histoire par les pieds. En cela, le film ne me semble jamais froid ou distant. Sans doute a-t-il besoin de temps pour que des visages se détachent, fassent irruption ou se faufilent jusqu’à nous – un gamin plus petit que les autres et dont la tête se glisse sous le bord du cadre ; une gamine qui joue à cache-cache avec l’objectif d’une caméra fixe, en apparence indifférente, mais en réalité profondément sensible à ces frôlements. De ce point de vue, il faut noter tous ces dos ou ces ventres qui viennent occuper l’écran, parfois une seconde, parfois un peu plus longtemps, et qui ne « bouchent » pas tant la vue qu’ils ne produisent un corps-à-corps, un frottement avec l’image. Cette volonté de ne pas nécessairement montrer les visages rejoint en outre un questionnement très fort, dicté sans doute par les circonstances (le tournage n’a duré que quinze jours), mais qui est plus profond, plus impérieux, pour Kourkouta et Niki Gianniri : qui sommes-nous pour choisir une personne plutôt qu’une autre, dans ce lieu où douze milles vies se croisent ? En baissant l’axe de la caméra, je crois aussi qu’ils « visagéifient » les chaussures – d’une façon nécessairement paradoxale, puisqu’une forme de singularité se découvre dans un produit industriel. Pourtant, il y a bien des histoires d’exil qui se racontent dans ces bottes trop grandes, ces baskets maculées de boue, ces mocassins de femme dans lesquels pataugent des pieds d’enfant…
Dans un essai intitulé Les godillots. Manifeste pour une histoire marchée, Antoine De Baecque écrit, à propos des Vieux souliers, que « la puissance du tableau de Van Gogh est de figurer [la] misère dans les godillots de la vie nue : avoir peint une misère de chaussure incarnant la misère du peuple. Voici de quel fantôme sont hantés ces godillots : le fantôme de la misère. » (Fantôme que l’on retrouve, au passage, dans une fameuse photographie de Walker Evans prise durant la Grande Dépression.). Ce n’est pas un hasard si aujourd’hui les chaussures de ceux que leur appellation générique semble condamner à une errance perpétuelle, les « migrants », nous font face. Leur déliquescence est en partie le signe de notre indignité.
Quant à savoir ce qui revient à la fin du film, on peut déjà donner une réponse simple : pour partie, des gens que nous avons vus dans la première. Les circonstances, cependant, sont différentes, et c’est un autre rapport à la caméra qui se noue.
R.B. : Je rejoins surtout tes propos au sujet de la présence indisciplinée des enfants dans le film, dans la manière dont ils se jouent du cadre. La fin de l’essai de Georges Didi-Huberman « Eux qui traversent les murs »[11][11] Dans Georges Didi-Huberman, Niki Giannari, Passer quoiqu’il en coûte, Les éditions de Minuit, Paris, 2017. est à ce titre très juste. C’est le moment de son essai qui touche vraiment quelque chose d’important pour le film réalisé, mais aussi pour ce qu’il pourrait être, en le ré-intitulant des enfants hantent l’Europe : « Ce sont eux les principaux “contrevenants”, les “indisciplinés” par excellence, qui savent traverser l’histoire. On dirait que, plus ils sont petits, plus ils sont tenaces. Ils savent, souvent mieux que leurs parents, faire le mur, c’est-à-dire passer par-dessus les murs qu’on oppose à leur désir d’avancer dans la vie. Ce sont donc bien des enfants qui hantent l’Europe, et non de simples fantômes venus d’ailleurs et d’autrefois » (p. 86).
Pour autant, la question complexe du temps et la présence de l’Histoire est cruciale dans le film, sans recours à un fantastique simplifié. Nous allons sans doute en venir au poème de Niki Giannari, mais je voulais évoquer deux choses. D’abord les paroles d’un réfugié syrien, qui rappelle au négociateur grec hors champ l’histoire des réfugiés Grecs à Alep en 1922. Je souhaite aussi souligner une phrase du générique de fin : les remerciements à Katina Tenta-Latifi « for her stories and for her memories of the muddy feet of fighters during the greek civil war, 1946 – 1949 ». J’avais été très intrigué par cette formule, en me disant qu’il me fallait assurément reconsidérer des passages du film sans en rester à son temps présent ou tout juste passé.
Le film hante depuis deux ans les festivals à travers le monde et il y a eu des écrits intéressants à son sujet, notamment un mémoire de M2 soutenu à l’EHESS par Lucie Leszez[22][22] Filmer les migrations contemporaines : Enjeux éthique, politique et esthétique d’un cinéma documentaire expérimental. Des spectres hantent l’Europe de Maria Kourkouta et Niki Giannari, Brûle la mer de Nathalie Nambot et Maki Berchache. Une avancée de son travail permet de rejoindre tes observations sur les chaussures de ceux qui passent de ne pas passer. Il s’agit de penser un montage invisible avec d’autres marches, celles des exilés et combattants de la guerre civile grecque de 1946-1949. Le travail de Lucie Leszez s’appuie notamment sur un dialogue avec les deux cinéastes qui évoquent Katina Tenta-Latifi : « Maria Kourkouta et Niki Giannari ont échangé avec Katina Tenta-Latifi dans le cadre d’un autre film sur lequel Maria Kourkouta travaille au moment du tournage de Des spectres hantent l’Europe, et qui porte sur la guerre civile en Grèce. Cette dame avec qui elle parle alors a été exilée pendant plus de 28 ans. Elle a dit aux cinéastes que si elle devait faire un film sur la guerre civile en Grèce, elle filmerait les pieds des combattants, “les pieds fatigués, leurs pieds dans la boue, ces pieds qui ont tout traversé ” » (p.60). Ces éléments appuient assez, je trouve, plusieurs de tes intuitions au sujet des repères incertains du film : sans doute le sont-ils pour mieux ouvrir le temps à de multiples traversées, sans passer par un exposé historique.
R.N.: Ces précisions sont très intéressantes. Étant peu versé dans l’histoire contemporaine de la Grèce, je ne m’aventurerai guère sur ce terrain, mais il me semble essentiel que les images actuelles ne soient pas entièrement surdéterminées par la destruction des Juifs d’Europe. Difficile de ne pas y songer, évidemment. Le texte de Niki Giannari débute de fait par un tel rapprochement, en évoquant les convois qui empruntaient ces mêmes rails que les exilés occupent (« Tu avais raison. Les hommes vont oublier ces trains-ci / comme ces trains-là. Mais la cendre / se souvient. »). La Shoah, pour prendre ce terme plus connoté[33][33] En témoigne par exemple ce propos de Claude Lanzmann : « Si j’avais pu ne pas nommer ce film, je l’aurais fait. Comment aurait-il pu y avoir un nom pour nommer un événement sans précédent dans l’histoire ? Je disais ‘la chose’. Ce sont des rabbins qui ont trouvé le nom de Shoah. Mais cela veut dire anéantissement, cataclysme, catastrophe naturelle. Shoah, c’est un mot hébreu que je ne comprends pas. Un mot opaque que personne ne comprendra. Un acte de nomination radicale. Un nom qui est passé dans la langue, sauf aux États-Unis. », a cependant ceci de particulier en tant qu’élaboration historiographique qu’elle force et annule toute comparaison. Tout s’y rapporte, mais rien ne s’y mesure. Si cela n’a rien à voir, on risque alors bien vite de ne plus rien voir. Placer la situation actuelle dans le sillage de la Guerre civile, ou du moins nouer ces deux situations à travers le motif des pieds, et convoquer la mémoire de l’exil des Grecs en Syrie, permet au contraire de brouiller la distinction entre « eux » et « nous » en faisant passer les lignes de tension et les points de discussion à l’intérieur d’une histoire partagée qui excède les frontières nationales, et qui semble toujours en cours, toujours agissante.
R.B. : J’aimerais terminer notre bref échange en revenant sur la transformation possible du titre et l’insistance de la question de l’enfance ; beaucoup d’enfants réapparaissent d’ailleurs lors des minutes argentiques de la fin. On reconnaît, avec Des Spectres hantent l’Europe, une citation transparente à l’ouverture du Manifeste du Parti communiste, selon un déplacement des tourments ; des spectres, des pays qui hantent le sommeil des Nations. J’aime toutefois assez l’hypothèse Des Enfants hantent l’Europe, pour deux raisons qui sont deux marques que le film m’a laissées depuis sa projection : un carton et un champ avec figure.
Par carton, je veux dire banderole cartonnée, tout en insistant sur un registre de parole qui n’est pas sans rapport avec le cinéma muet ou une certaine forme de surdité. A plusieurs reprises, parmi d’autres phrases exposées, un homme d’un certain âge tient celle-ci : « Bitte. Helfen Sie mir damit kann ich mein kind sehen. Bitteeee »[44][44] « S’il vous plaît, aidez-moi à voir mon enfant. S’il vous plaiiiiit. » Voir l’enfant, donc. Et, donc, le plan que je trouve le plus beau du film, à la fin de la première partie, juste avant les images en 16 mm. Pour une fois, il s’agit d’une remontée, selon une perspective en quelque sorte inversée par une petite figure en K-Way jaune et orange délavés (et pas vert-gris) qui remonte un champ très large, boueux, avec un campement à gauche et une sorte de chapiteau à droite, servant d’abri à deux trois personnes. Je vois quelque chose d’autre dans cette diagonale inversée. Sans doute est-ce la petite fille prénommée Abdo et que l’on voit sortir de dessous l’ensemble formé par les K-Way verts dans le plan précédent en plongée ; on lui demande d’aller chercher quelque chose et de remplir une bouteille d’eau. Mais, il y a quelque chose de plus important, je trouve, que cette action. Une voix de haut-parleur diffuse un appel à plusieurs reprises, évoquant une jeune fille perdue (qui « se trouve là où on distribue la bouffe, à Praksis…»). Cette jeune fille en K-Way ne fait pourtant pas du tout la queue dans l’ici et maintenant de ce plan, elle trace une ligne (pas vraiment de fuite), puis fait le point. On ne la voit d’abord pas, puis on ne voit qu’elle. Surtout elle, qui se tient droite, de trois quarts. Sans vaciller. Les images peuvent ensuite se transformer, portées par le poème final, que cette étonnante figure encapuchonnée – qui est à la fois une marche, une couleur, un corps, une position, un point, une ligne, un regard, une écoute – semble nous annoncer.
Image : Maria Kourkouta / Conception sonore : André Fèvre / Voix-off : Lena Platonos / Production : Maria Kourkouta & Carine Chichkowsky
Durée : 99 mn
Sortie le 16 mai 2018