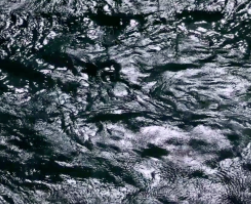Élise Domenach
Cinécologie, épisode 1 – Le cinéma de Fukushima
Une des conversions auxquelles invite la question écologique pourrait se formuler ainsi : comment transformer l’inquiétude en souci. Comment sortir de l’écartèlement dans lequel nous nous trouvons, entre les prédictions catastrophistes et les dénis fervents, entre les séductions du désastre et celles de l’aveuglement. Comment s’approcher d’un juste tracas qui, proche de l’alarme mais loin du pessimisme, découperait dans le visible tant la carte des périls que l’espace des possibles. Comment, loin de tout prométhéisme, inventer une manière de vivre qui soit en même temps une façon de perdurer. Tâche titanesque à laquelle le cinéma ne semble pouvoir servir que d’adjudant des plus auxiliaires. Que peut-il faire face à la destruction, lui fils d’une technique qu’on tient à juste titre responsable des périls contemporains ? Pas grand chose, sinon constater, pointer. Faire affleurer, d’une part, les traces d’un délabrement qui, n’en déplaise aux marchands d’apocalypse, est progressif, terrible dans sa patience même. D’autre part, exposer la palette des réactions et propositions qui ne cessent de croître suite à ce qu’il faut bien appeler une prise de conscience. Et tous les cinémas sont en droit convocables pour cet exercice radiographique, autant les blockbusters qui, de plus en plus, trament tous les scénarios possibles de la fin du monde tout en maintenant sur le plan esthétique cet idéal d’artillerie lourde définissant le capitalisme le plus ravageur qui soit, que des documentaires désargentés relevant ici ou là l’avancée du désert et l’implantation des oasis. Et ce ne sont là que deux pôles parmi l’éventail des possibles cinématographiques face à ce qui, de jour en jour, s’avère constituer l’horizon indépassable de notre temps.
Projet vaste et flou que d’interroger le cinéma à l’aune de l’écologie. Projet n’admettant que des réponses partielles, morceaux de pensée qui s’étaleront dans les pages de Débordements au gré des rencontres, des visionnages et des lectures. Élise Domenach a bien voulu répondre à nos questions pour ouvrir cette série qui, on l’espère, ne s’assèchera pas de sitôt. Maître de conférences à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, critique de cinéma (membre du comité de rédaction de Positif), spécialiste et traductrice de Stanley Cavell chez qui elle trouve les moyens d’une lecture renouvelée des problématiques morales et politiques du cinéma, elle est aujourd’hui détachée au CNRS et professeur invitée à l’Université de Meiji (Tokyo), où elle conduit des recherches sur les différents échos qu’a rencontré l’événement Fukushima au cinéma, japonais en premier lieu. Rien de tel, pour initier un chantier sur les probabilités du désastre, que de réfléchir sur une catastrophe qui n’est pas terminale, qui, ponctuelle, n’en est pas moins liée à un long héritage national, et qui cristallise une somme d’enjeux qu’Élise Domenach déplie dans les lignes qui suivent.
Débordements : Vous avez visionné quantité de films sur la catastrophe de Fukushima. De qui ces films sont-ils les œuvres, le plus souvent ? S’agit-il de jeunes cinéastes, de cinéastes ayant un passé militant, de cinéastes confirmés, ou bien l’ensemble est-il tout bonnement hétérogène ?
Elise Domenach : Tout dépend de ce qu’on entend par « cinéma de Fukushima ». Il y a différents niveaux de répercussion de l’événement. C’est aux documentaristes qu’on doit les premiers films (bons et moins bons) sur la triple catastrophe du 11 mars 2011, dite en France « de Fukushima » – le tremblement de terre, le tsunami et l’accident nucléaire. Il faut rappeler que Fukushima est le nom de la conurbation qui abrite la centrale nucléaire accidentée. Son territoire a été inégalement atteint (la côte, Hamadori, davantage que la partie intérieure de la région, Nakadori) et, bien sûr, la catastrophe n’est en rien limitée à cette conurbation. Le tremblement de terre et le tsunami ont été très violents dans des régions situées plus au nord (Miyagi, la côte du Sanriku et Miyako). Et les particules radioactives émanant de la centrale accidentée ont atteint des régions plus au sud (Tomioka, Tsukuba, Chiba,…), en suivant les vents et les pluies, parfois davantage que d’autres régions plus proches pourtant de la centrale accidentée mais protégées par les montagnes environnantes. Il faut donc se méfier d’une assignation trop rapide de la catastrophe à un territoire. Les anglophones l’appellent « 3.11 », ce qui présente l’autre inconvénient de rapporter une catastrophe nucléaire à l’expérience d’une attaque terroriste d’une toute autre nature. L’avantage cependant de cette dénomination est qu’elle rend compte de sa dimension d’« expérience nationale » pour les Japonais.
La catastrophe du 11 mars 2011 a été, dans un premier temps, filmée par des reporters envoyés par les télévisions (télévisions locales, et celle de Fukushima a été aux avants-postes, mais aussi nationales bien sûr) et par des documentaristes. Parmi ces derniers, beaucoup sont allés filmer sur place en réaction aux images diffusées par les chaînes de télévision, qu’ils jugeaient douteuses sur le plan éthique ou dénuées de recul historique et politique, trop émotionnelles. En outre, la presse ne pouvait pas pénétrer au-delà d’un certain périmètre « sécurisé », à distance de la centrale nucléaire. Certains de ces documentaristes, plus libres dans leur mouvement, plus rusés dans leurs méthodes aussi, sont parvenus à pénétrer dans la « zone » ou à enquêter sur les lieux de la contamination radioactive. Parmi eux, on compte de jeunes cinéastes (Tohi Fujiwara réalisateur de No Man’s Zone, Yojyu Matsubayashi réalisateur de Fukushima : Memories of a Lost Landscape) comme des cinéastes confirmés (à l’image de Tatsuya Mori, réalisateur de deux films sur la secte Aum, A (1998) et A2 (2001) et co-réalisateur avec Takeharu Watai, Yojyu Matsubayashi et Takaharu Yasuoka de 311, ou encore de Koichi Omiya, le réalisateur de The Sketch of Mujo). Pour certains, la catastrophe a été l’occasion d’un passage (ou d’un retour) au documentaire. C’est le cas de Ko Sakai et Ryusuke Hamaguchi, les deux réalisateurs d’une trilogie sur le tsunami dans le Tohoku (The Sound of the Waves, Voices from the Waves, Storytellers), mais aussi de Toshi Fujiwara (No Man’s Zone) ou encore d’Atsushi Funahashi (Nuclear Nation, qui a été le premier documentaire sur le 11 mars à faire le tour du monde des festivals, à partir de sa première à Berlin en 2012). Ils ont réalisé des fictions auparavant, et ont été conduits vers la forme documentaire par la dimension extravagante de la catastrophe ; pour prendre en quelque sorte la mesure de l’événement avec les moyens du cinéma. De nombreux cinéastes ont ressenti ce que Kiyoshi Kurosawa a exprimé dans ses entretiens à la presse : il est trop tôt pour faire des fictions. Même s’il a toujours aussi dit : « Il faudra en effet mener le procès de notre responsabilité dans Fukushima, notamment par le cinéma »[11][11] « Kiyoshi Kurosawa, «Il nous faudra faire le procès de notre responsabilité dans Fukushima» », Julien Gester, Libération, 30 mai 2013..
On a aussi constaté un phénomène intéressant de retour au pays de cinéastes qui vivaient et/ou travaillaient à l’étranger, comme Yojyu Matsubayashi et Kazuhiro Soda. D’autres cinéastes ont vu leur déjà longue carrière infléchie de manière décisive par l’événement. C’est le cas de Masahiro Kobayashi, originaire d’une ville qui a été littéralement effacée de la carte pas le tsunami (Kesennuma) et qui a tourné immédiatement après la catastrophe une fiction minimaliste sur les lieux (Women on the Edge), puis quelques temps après un second film, Japan’s Tragedy. Sono Sion avait décidé de ne plus faire de film. Et il est retourné derrière la caméra pour réaliser deux fictions sur la catastrophe : Himizu (adaptation d’un manga) et The Land of Hope (qui est sorti en salles en France). Makoto Shinozaki avait déjà une longue et riche carrière derrière lui depuis Okaeri (1995), le film qui l’a fait connaître en France à l’époque où il était rédacteur des Cahiers du cinéma Japon, et proche de Kiyoshi Kurosawa. La catastrophe l’a conduit à réaliser coup sur coup deux fictions sur l’accident nucléaire et ses répercutions sur la psychologie collective des Japonaise : Since Then, Sharing. Deux films nettement plus politiques et engagés que ses précédents opus.
Malgré la diversité des cas, on peut remarquer deux choses. D’abord, une certaine antécédence du documentaire sur les autres genres. Les fictions, les films d’animation, les films expérimentaux ne sont venus qu’après, sans que la veine documentaire ne se tarisse pour autant – peut-être parce que la crise elle-même se poursuit, et que la situation sur les lieux de la centrale n’est pas sous contrôle. Et puis, il faut reconnaître que, si de grands documentaires ont déjà été réalisés sur l’événement, en revanche on attend toujours « la grande fiction ». Peut-être est-il trop tôt. Kiyoshi Kurosawa a dit qu’il faudrait dix ans de digestion et de gestation pour qu’un tel film soit possible[22][22] Propos tenus au cinéma de Shibuya Image Forum, lors d’un débat avec les réalisateurs Ko Sakai et Ryusuke Hamaguchi, en novembre 2013.. Peut-être a-t-il raison… D’autant plus que le 11 mars 2011 est l’ouverture d’une nouvelle ère. En ce sens, le corpus du « cinéma de Fukushima » demeure essentiellement ouvert.
D. : Est-ce qu’on observe des récurrences thématiques, des configurations dramatiques insistantes, dans ces fictions ?
E.D. : J’en vois deux : la famille et la folie. Concernant la folie, la tendance est plutôt à concevoir la catastrophe non comme cause, mais plutôt comme le révélateur d’un processus à l’œuvre avant elle. Comme si elle avait mis en lumière une sorte de psychose collective auparavant voilée. Il y a eu un regain d’intérêt pour un ensemble de pathologies estampillées nippones, comme les disparitions volontaires qu’on peut par exemple observer dans L’Evaporation d’un homme (1967) de Shohei Imamura. Beaucoup de gens ont disparu dans la nature après le 11 mars, ou se sont enfermés dans un isolement mortifère après avoir perdu leurs proches. Au nombre des affections psychiques occasionnés par le deuil ou la peur des radiations, on compte aussi des phénomènes paranoïaques, schizophréniques ou des formes de visitation ; avec des gens qui se croient poursuivis par des fantômes, rattrapés par les morts du tsunami, etc. Beaucoup de films traitent de ce lien entre les deux dévastations, psychique et environnementale, la seconde opérant comme symptôme de la première. C’est le cas de Odayaka de Nobuteru Uchida, qui met en scène deux voisines vivant dans la banlieue de Tokyo, que la catastrophe nucléaire conduit aux limites de la folie. Toutes deux s’inquiètent de la radioactivité et se rebellent contre la tendance commune à se comporter comme si la situation était sous contrôle. L’actrice d’origine coréenne, Kiki Sugino (co-productrice du film) interprète avec sensibilité le rôle d’une jeune mère accusée par les parents d’élèves de l’école de sa fille de trahir les valeurs japonaises de persévérance et de dignité, et de répandre l’hystérie. Les intentions de ce jeune réalisateur de fictions, Nobuteru Uchida (Kazaana (2007), Love addiction (2010)), qu’il explique dans le dossier de presse du film, sont claires et courageuses : « Si nous, Japonais, choisissons de fermer les yeux devant la peur et l’anxiété que nous avons ressenties après le tremblement de terre et en raison de la situation actuelle à Fukushima, nous ne serons pas capable d’avancer et de les dépasser. Nous ne pouvons pas ignorer les événements du 11 mars 2011 ». Malheureusement, le film est assez maladroit.
La question des effets de la catastrophe sur la psychologie des japonais est au coeur des deux fictions de Makoto Shinozaki. Since Then la considère au sein d’un couple, et Sharing dans le contexte d’une université où une professeure de psychologie enquête sur des phénomènes de prémonition de la catastrophe. Dans cette thématique, il faudrait aussi intégrer les films récents de Kiyoshi Kurosawa : Shokuzai, qui traite du cheminement d’un trauma de l’enfance dans la vie de quatre jeunes femmes qui ont été témoins d’une agression qu’elles vont gérer à la fois par le transfert et par le déni, et Real qui prolonge l’exploration de la frontière entre réel et imaginaire, conscience et inconscience, et aussi des catastrophes intimes. Ce que Kiyoshi Kurosawa appelle non pas tant « représenter le désastre lui-même que de scruter dans nos vies comment il a pu advenir du fait d’un certain esprit japonais »[33][33] « Kiyoshi Kurosawa, «Il nous faudra faire le procès de notre responsabilité dans Fukushima» », Julien Gester, idem.. Car Real traite aussi de ces psychismes délabrés que la catastrophe a mis au jour. C’est également le sujet, assez angoissant, d’un blockbuster japonais qui a rencontré un franc succès populaire au Tokyo International Film Festival : Parasyte de Takashi Yamazaki. Il y est question d’une contamination censée punir les hommes qui ont souillé la nature. En somme, la catastrophe prend des figures nouvelles, connaît des métamorphoses. Sa mise en récit et en images en ouvre, en pluralise les significations. On pourrait presque dire qu’elle connaît autant de représentations indirectes, qu’il se fait de films d’angoisse (ou d’horreur) au Japon depuis 2011.
La famille est un thème autrement plus complexe. Il s’est trouvé au centre de tous les drames sur le 11 mars, car le rapport au nucléaire, au Japon, est très lié aux générations. Pour les plus jeunes, il n’existe de nucléaire que civil. Ils ont grandi dans le Japon nucléarisé et pacifique imaginairement produit par la campagne « Atom for Peace » de Eisenhower[44][44] Voir l’ouvrage de Yoshimi Shun’ya, Atoms for Dream (Genshiryoku no yume), Chikuma Shobō, Tokyo, 2012., portée par une croyance excessive en la sécurité de ses dispositifs. C’est dans les générations plus âgées qu’on trouve le gros du contingent d’activistes anti-nucléaire, surtout parmi les sexagénaires qui se sont mobilisés dans les années soixante et soixante-dix suite aux grands désastres environnementaux, et qui sont plus proches de la mémoire des bombes de 1945 : comme les documentaristes Hitomi Kamanaka (réalisatrice d’une trilogie sur le nucléaire et les radiations : Hibakusha (2003), The Rokkashomura Rhapsody (2006) et Ashes to Honey (2010)) et Akiko Kuraoka (réalisatrice avec Nobuki Yamamura de Live in Tokyochrome (1978) sur la pollution au chrome causée par des industries chimiques dans deux districts de Tokyo au début des années 1970, ainsi que de The People of Rokkasho (1985) et Summer Homework Left Undone: Living Next Door to Nuclear Reprocessing Facility (1989) sur la résistance des habitants de Aomori à la construction d’un complexe de retraitement des déchets nucléaires), toutes deux héritières de Noriako Tsuchimoto et de sa célèbre trilogie sur la pollution au mercure de Minamata (The Victims and Their World, 1971-1975). Même si beaucoup de jeunes parents, inquiets des radiations, ont rejoint les rangs des militants écologistes et anti-nucléaire depuis 2011. Ce qu’exprime Lullaby under a Nuclear Sky où la documentariste Tomoko Kana, qui travaillait à un film à Fukushima au moment de la catastrophe, apprend à quarante ans qu’elle est enceinte, et se décide à tourner la caméra vers elle pour filmer ses propres inquiétudes et interrogations. Beaucoup de films ont pour sujet la différence de réaction entre les générations. C’est la thématique de The Land of Hope de Sono Sion, et aussi des deux films de Masahiro Kobayashi, Japan’s Tragedy (sur un père et son fils, qui ont tout perdu et se retrouvent en tête à tête) et Women on the Edge (sur trois sœurs réunies dans la maison dévastée de leurs parents à Kesennuma). En cela, les films sur Fukushima ressemblent à ceux faits dans les années cinquante sur Hiroshima et Nagasaki, comme Vivre dans la peur de Akira Kurosawa.
La catastrophe est donc avant tout perçue au niveau de la cellule familiale, qu’elle fait exploser. Sono Sion a beau intituler son film The Land of Hope, le pays lui-même ou la nation y sont comme déréalisés. Le film est une dystopie et « The Family of Despair » lui conviendrait bien mieux comme titre. La quasi-absence d’enjeu véritablement collectif et politique a de quoi étonner. Que l’on songe à Odayaka ou à la trilogie de Ko Sakai et Ryusuke Hamaguchi (The Sound of the Waves, Voices from the Waves, Storytellers) qui traite essentiellement du tsunami en s’intéressant aux témoignages de victimes autant qu’à leur écoute réciproque et aux résonances de générations en générations des contes et légendes du Tohoku qui véhiculent la mémoire des grands tsunamis. Rares sont les fictions comme Since Then et Sharing, ou bien Fukushima. Human Drama de Hiroshi Kanno (qui monte en parallèle trois époques de la vie d’une famille de Fukushima déterminée par la centrale nucléaire voisine : 1945, 1966, 2012), fictions qui, elles, dénoncent vraiment l’engagement dans le nucléaire. Beaucoup en restent à un niveau superficiel, psychologique. Et la catastrophe ne semble faire sens qu’à l’échelon familial.
Car le nucléaire a presque valeur de pilier identitaire pour le Japon. La croissance, et la nation avec elle, s’identifient entièrement à l’atome. Peu de cinéastes osent attaquer de front ce consensus. Les films pratiquent peu la dénonciation, les autorités (Tepco comme le gouvernement) ne sont presque jamais directement mises en cause. On est plutôt dans le registre de l’implicite, comme si n’était donné à voir qu’un refus de voir, le déni dans lequel la société japonaise s’est enfoncée. C’est ce qu’on voit dans Campaign 2. Kazuhiro Soda a suivi une campagne électorale qui a débuté le 1er avril 2011 dans la ville de Kawasaki, à moins de cinquante kilomètres de la centrale accidentée, et durant laquelle aucun des quatorze candidats ne prononce le mot « nucléaire » ! Dans Nuclear Nation d’Atsushi Funahashi, il y a une scène de visite de l’empereur dans ce lycée de Saitama transformé en abri temporaire pour les personnes délogées où se déroule le film. La scène est filmée de manière très neutre, sans la moindre ironie. Même les films qui sont clairement critiques à l’égard de la politique nucléaire du gouvernement japonais ne dénoncent pas, n’accusent personne. À la fois parce que l’événement est entouré de non-dits, et parce que s’extraire de la communauté nationale demeure un geste très problématique. Les films ouvertement critiques sont diffusés dans des réseaux indépendants, de manière très confidentielle, dans un tout autre circuit que celui des reportages télévisés galvanisants qui célèbrent l’endurance des populations du Tohoku et prônent l’unité nationale, ou même des documentaires montrés au Tokyo International Film Festival, comme Chasing Santa Claus de Hiroki Iwabuchi, sur la ferveur des célébrations de Noël à Sendai un an après la catastrophe, ou bien Fukushima : a Record of Living Things de Masanori Iwasaki, sur les animaux et les plantes affectés par les radiations dans la zone…
D : On ne retrouve donc aucune trace de la tradition militante qu’ont représenté un Wakamatsu ou un Adachi ?
E.D. : Il y a bien des films franchement anti-nucléaire et militants, mais ils sont très minoritaires, et surtout le fait de générations plus âgées. Et ce n’est pas là qu’on trouve les meilleures œuvres. Disons qu’il faut repenser aussi ce que signifie, dans ce cas-là, l’idée de militantisme. Tous ces cinéastes partent d’une intention qui relève de l’activisme. Ils entendent réveiller une société japonaise qui s’est endormie dans l’illusion de pouvoir garantir une production d’énergie nucléaire sûre. Mais il s’agit d’une colère sans protestation. Vu l’énorme prix donné à la communauté, beaucoup évitent de briser ce qui constitue une des charpentes du collectif. Le désaccord ne peut prendre alors que très rarement la forme d’un geste public, même s’il y a eu des manifestations monstres autour de certaines centrales.
D. : Est-ce qu’on observe, dans l’ensemble de cette production, certaines constantes esthétiques comme l’usage de la voix-off, un penchant pour l’essai, un amour des entretiens, un certain type d’image ; bref, des récurrences formelles ?
E.D. : La tendance est plutôt à l’hétérogénéité. Même le recours régulier à l’entretien recouvre des démarches très différentes. Prenons quatre films, Nuclear Nation, Fukushima : Memories of a Lost Landscape, No Man’s Zone et l’assez mauvais 311. Ce dernier a été tourné immédiatement après la catastrophe (deux semaines, très exactement !) Il a été montré au festival de Yamagata la même année, en octobre 2011. Tatsuya Mori, documentariste chevronné, est parti au volant d’une camionnette avec une équipe de trois cinéastes pour collecter des images de la catastrophe dans un souci d’abord de documentation de l’événement, et sans envisager en faire immédiatement un film. À mesure qu’ils progressent vers la centrale accidentée, les cinéastes réalisent l’ampleur du danger. Leur dosimètre s’affole. Ils filment des paysages totalement dévastés, et rencontrent des survivants à la recherche des corps de leurs proches. Ce qui les conduit à cette scène qui a fait un véritable scandale au Festival de documentaire de Yamagata, où ils s’approchent d’un lieu où les cadavres sont alignés pour être identifiés par les familles, et se voient jeter des bâtons au visage. L’entretien est donc parfois radicalement manqué. À l’inverse, Yojyu Matsubayashi, qui faisait partie de l’équipe de tournage de 311 et semble avoir été lui-même très mal à l’aise pendant ce tournage, a tourné un film d’entretiens très personnel, Fukushima : Memories of a Lost Landscape, en optant pour une démarche opposée consistant non pas à observer de l’extérieur des victimes dans des moments de grande détresse, mais à instituer la caméra en interlocuteur participant de la lutte des sinistrés pour survivre. Le film s’ouvre sur une réflexion personnelle, en première personne, sur sa décision de partir avec sa caméra pour aider à sa manière les sinistrés, sur la base d’un sentiment de co-responsabilité dans la catastrophe, en tant que tokyoïte, consommateur de l’électricité produite à Fukushima, etc. Le film suit son dialogue étroit avec la famille Tanaka, réfugiés de Minamisoma dont il partage le quotidien dans un abri d’urgence.
Atsushi Funahashi a, quant a lui, tourné Nuclear Nation 1 & 2 plusieurs mois après l’événement, en interviewant durant en tout pas loin de deux ans les mêmes personnes, non pas sur les lieux de la catastrophe ou à proximité, mais dans un lycée devenu refuge dans la préfecture de Saitama, en s’inspirant beaucoup de Wiseman pour la peinture d’un espace institutionnel clos duquel le film ne nous fait pas sortir. Il a une façon très émotionnelle de conduire les entretiens, en mettant autant en scène sa propre empathie que la parole de l’autre, mais sans aucun débordement affectif racoleur qui occulterait la parole de son interlocuteur. Il s’agit plutôt d’une forme d’« observation participante ». Le dernier pôle serait représenté par Toshi Fujiwara et No Man’s Zone. Ses entretiens avec les habitants des environs de la centrale accidentée sont très analytiques. Ils se prétendent informels (je vous apporte du saké, vous me racontez comme vous vous sentez seul, etc), mais véhiculent un rapport très intellectuel à la catastrophe – sans doute également nécessaire. Ses entretiens avec les plus anciens permettent par exemple de reconstituer le contexte de la construction des réacteurs et de la centrale de Fukushima, de montrer comment l’économie locale a prospéré grâce au nucléaire. Plutôt qu’accueillir le réel et l’expérience de ses interlocuteurs, disons que le cinéaste, fort de sa position auteuriste, le déconstruit. Entre deux entretiens, Fujiwara construit à la perfection des plans larges embrassant des paysages dévastés, et monte sur ces images des musiques de jazz ou une voix off très articulée, qui fait résonner cette catastrophe avec notre fascination pour la destruction, avec le passé colonial du Japon, etc. Tout cela a quelque chose d’écrasant.
Le film qui porte le plus loin la réflexion sur l’entretien avec les « victimes » est sans nul doute la trilogie de Ko Sakai et Ryusuke Hamaguchi tournée dans le Tohoku (The Sound of the Waves, Voices from The Waves, Storytellers), dont l’unité repose sur un même dispositif d’écoute reconduit dans chaque film : deux personnes placées face à face. Témoigner/raconter et écouter deviennent un seul et même geste à la fois empathique et mémoriel.
D : Fukushima et le nucléaire en général sont pris dans une dialectique de l’invisible et de l’ultra-visible. D’un côté, on a le droit à des images comme celles de la bombe ou du tsunami, images de masses radicales qui rendent l’apocalypse sensible et fonctionnent sur des proportions dignes du cinéma d’action le plus argenté. Et en face de cela, il y a l’invisible des radiations que l’œil nu ne peut déceler. Ce qui rejoue et déplace la vieille question de l’infigurable au cœur de toute catastrophe. Est-ce qu’il existe des films qui prennent acte de cette antinomie visuelle, et tentent de l’approcher par un certain travail formel ?
E.D. : Je n’en connais qu’un réfléchissant réellement à ce problème, c’est Fovea Centralis de Philippe Rouy, le troisième film qu’il a consacré à Fukushima. Le premier, Quatre bâtiments face à la mer, montait des images de la centrale de Fukushima Daiichi enregistrées par les caméras de surveillance et à disposition en ligne sur le site de Tepco. Le second, Machine To Machine, utilisait des images ramenées par les robots envoyés à l’intérieur des réacteurs endommagés. Cela constituait un travail sur la perception non-humaine du désastre qui, d’une certaine façon, reprenait cette interrogation de Godard sur le lien du cinéma et des camps, sur les lieux historiques sur lesquels le cinéma n’a pas su se rendre, sur l’infigurable et le manque d’images. Mais le problème a changé : le mal est matériellement invisible et non plus moralement impensable.
Fovea Centralis suit une autre piste. Il mêle trois choses au moins, et trois niveaux : des textes de scientifiques et une réflexion sur les effets des radiations sur l’œil humain (perte des couleurs, aveuglement progressif), le montage d’images de visioconférences de Tepco en pleine crise (dans le mois suivant l’accident de Fukushima), et une méta-réflexion sur le médium cinématographique impressionné par la lumière d’une manière qui révèle et cache à la fois, et sur la rétine atteinte par les radiations. C’est donc un film profond sur le nucléaire qui aveugle, au sens physique comme psychologique et social ; sur la manière dont l’invisibilité de la radioactivité atteint notre capacité à voir toute entière et nous plonge dans le déni ou un refus de voir (des impulsions sceptiques, vieilles comme le monde), en un sens plus large. On retrouve à ce point des problématiques très classiques : l’inversion de l’ordre du visible dans les paysages de destruction, la souillure des paysages. C’est tout le travail de No Man’s Zone, qui, de ce point de vue, s’installe très nettement dans une tradition tarkovskienne de figuration de la dévastation selon les canons esthétiques du sublime. Ce film interroge comme aucun autre à ma connaissance notre fascination pour les images de destruction ; la beauté de ces paysages dévastés et son effet de sidération. Comment comprendre que notre capacité d’action collective soit tant empêchée, sinon en allant chercher des éléments d’explication dans les impulsions profondes qui nous animent, comme la tentation sceptique ?
D : Je profite du fait que vous soyez aussi philosophe pour poser une question un peu plus abstraite et élargie : ces réponses à l’événement écologique sont aussi en partie déterminées par un contexte culturel, un rapport à la nature à la fois théorique et sensible. Et ce rapport est, je suppose, différent au Japon, où il n’y a peut-être pas un même ancrage du cartésianisme et de la Naturphilosophie. Est-ce qu’on peut rattacher tous ces films à une sensibilité proprement nippone à la nature ?
E.D. : Il y a une certaine doxa – orientaliste, il faut bien le dire – voulant que les Japonais soient prétendument plus respectueux de la nature, plus sensibles à sa richesse, plus en phase avec son harmonie, etc. Fantasme d’un Japon écolo nourrit par quelques expériences rares, comme la réhabilitation de l’île industrielle de Naoshima, mais qui dans l’ensemble demeure trompeur. Par exemple, cette terrible pollution au mercure à Minamata mise en évidence en 1959 (qui durait depuis 1949[55][55] Date de la première description de la maladie. Les déversements de mercure par l’entreprise de pétro-chimie Chisso ont duré jusqu’en 1966.) n’a en rien infléchi les politiques environnementales. Et quand on voit le gaspillage, l’accumulation de déchets, les néons partout présents, le nombre de réacteurs nucléaires sur le territoire japonais (54 en fonctionnement avant le 11 mars 2011), on se met très vite à douter de l’image d’Epinal d’un pays plus soucieux des régulations naturelles.
Néanmoins, il y a clairement un écart dans les représentations de la nature. La destruction n’est pas conçue comme non-naturelle. La catastrophe n’est pas, comme elle l’est chez nous, le signe d’une sortie hors d’une tranquille homéostasie à laquelle nous avons l’habitude d’identifier l’ordre de la nature. Pour nous, puisque, selon la formule de Descartes, l’homme doit se rendre « comme maître et possesseur de la nature », si celle-ci fait des siennes, déborde un peu et prend des dimensions excessives, il y a scandale, révolte. C’est une chose impensable de voir une nature aussi explosive, hors de proportions. Au Japon, la destruction est admise d’emblée, comme dans l’ordre des choses « naturelles ». On voit cela clairement dans la trilogie réalisée par Sakai et Hamaguchi : The Sound of the Waves, The Voices of the Waves et Storytellers. Les trois films forment une sorte d’hommage aux forces de la nature, aussi bien destructrices que créatrices. Et que les habitants du Tohoku, qui vivent presque à chaque génération un énorme tsunami, connaissent cela mieux que quiconque.
On a beaucoup dit que les Japonais faisaient preuve d’une sorte d’acceptation résignée des catastrophes, sans trop se soucier de tout ce qu’il y a de raciste à leur supposer un tel degré de passivité qui les enfermerait dans une langueur orientale amoureuse du fatalisme. Il faudrait plutôt dire que pour eux être en colère contre un événement naturel relève de l’absurde. Et que la colère s’exprime chez eux selon des codes qui nous échappent en bonne partie. Ce qui produit de nombreux malentendus, et des glissements parfois à la limite de l’odieux, de la part des visiteurs occidentaux. Au Japon, la destruction est conçue comme étant au cœur de l’ordre des choses (Tokyo, construite et reconstruite sur ses incendies successifs, Kobe renaissant après le tremblement de terre de 1995, Hiroshima reconstruite de fond en comble). Le corollaire de cela, c’est l’idée dangereuse que la catastrophe n’a pas de réel ressort culturel, de cause humaine. La dimension artificielle, industrielle et politique en somme, du désastre risque de s’en trouver occultée.
D : Si Fukushima a catalysé les réflexions sur ces sujets, il faut tout de même noter qu’elles travaillaient déjà, même si de manière beaucoup plus minoritaire, le cinéma d’avant la catastrophe. Si l’on devait dessiner les contours rudimentaires de la présence de l’interrogation nucléaire au cinéma, de la fin du Trial d’Orson Welles à Dreams d’Akira Kurosawa, qu’est-ce que l’on retiendrait ?
E.D. : C’est là une question essentielle mais, à vrai dire, ce n’est pas la mienne. Et, hélas, je crois qu’aucun livre d’importance n’a encore été écrit sur le sujet – même s’il faut mentionner The Body at the Center: The Effects of the Atomic Bomb on Hiroshima and Nagasaki (1996) de Mick Broderick sur le « hibakusha cinema », Atomic Light : Shadow Optics (2005) de Akira Mizuta Lippit, et les travaux d’Abé Markus Nornes sur les représentations du nucléaire dans le documentaire japonais depuis 1945. Ce qui m’intéresse pour ma part, c’est, dans la lignée de Stanley Cavell et avec ses outils, de penser le scepticisme au cinéma. Je me demande surtout comment ces films sur le nucléaire, à travers toutes les questions de mise en scène qu’on vient d’évoquer, donnent à penser la manière dont le rapport de l’homme au monde, aux autres, à soi-même, est travaillé par le doute et par un sentiment d’inadéquation qui sont modifiés, remodelés par la crise nucléaire ouverte par la catastrophe du 11 mars 2011. C’est le cœur de mes recherches : quel rapport au monde cet événement induit-il, signale-t-il ? Et comment la communauté humaine, que ce soit à l’échelle locale, nationale, internationale ou « planétaire », est menacée et repensée à l’aune de cette expérience. Je tiens à ce mot d’expérience. Luc Dardenne a une très belle formule dans Au dos de nos images : il dit que les œuvres d’art nous redonnent de l’expérience humaine, là où on en manque. Au fond, nous manquons plus d’expérience que de concepts. C’est pourquoi les films sont si précieux pour penser. Les belles œuvres récréent de l’expérience humaine là où il n’y a plus que destruction, terreur et effroi, là où la catastrophe est telle que nous manquons de moyens pour la saisir, la comprendre.
La crise nucléaire reconfigure notre scepticisme ; elle met en jeu cette expérience fondamentale dont Cavell dit, après Hume, Kant et Wittgenstein, que c’est un « trait de la nature humaine » : notre difficulté à nous projeter dans un rapport de croyance, d’adhésion, de compréhension au monde extérieur, aux autres et à soi-même. Le nucléaire serait plutôt l’expression d’une déliaison, d’un repli, d’un désir d’en finir avec le monde qui est le revers d’un besoin de proximité, de présence, d’une passion pour l’existence du monde comme s’il s’agissait d’un autre, de l’Autre. « Si vous désirez éviter la tragédie, évitez l’amour ; si vous ne pouvez pas éviter l’amour, évitez l’intégrité ; si vous ne pouvez pas éviter l’intégrité, évitez le monde ; si vous ne pouvez pas éviter le monde, détruisez-le », dit Cavell dans l’admirable chapitre qu’il consacre au Roi Lear dans Dire et vouloir dire (p. 514).
Mon hypothèse est que la crise nucléaire serait l’une des manifestations contemporaines de notre scepticisme. Celle-ci est à la fois ancienne et nouvelle. Chaque époque connaît le scepticisme sous une forme qui lui est singulière. Cavell consacre de longs développements dans Les Voix de la raison à ce paradoxe, qui veut que le scepticisme soit à la fois historique et éternel ou « transcendantal » – Kant avait déjà fait du scepticisme une des composantes de la structure de la raison humaine. Cependant, la tentation sceptique connaît des formes historiquement variables. J’ai travaillé, par exemple, sur la libération de la voix dans le cinéma polonais entre 1980 et 1989, pendant la période de « démocratisation » entre les grandes grèves de Gdansk et les premières élections libres en Pologne. La crise sceptique, dans ce contexte, se formulait ainsi : comment avoir voix au chapitre, dans sa propre histoire ? Qu’est-ce cette parole politique démocratique, que l’on proclame (claim) au nom des autres et en son nom propre ? Et les films polonais qui mettaient en scène ces voix hésitantes, tâtonnantes, avaient mille manières de mettre le microphone au cœur du dispositif de mise en scène ; c’était leur manière de chercher à établir par le film un rapport au monde soustrait au mensonge politique, à la propagande, au dire dépourvu de vouloir dire, donc à une certaine forme de non-sens (par où on retrouve la philosophie du langage ordinaire de Cavell). La crise nucléaire permet aussi d’éclairer cet aspect singulier du scepticisme qu’est le nihilisme. Il est bien des films pour se pencher sur l’atome comme puissance d’annihilation plutôt que comme forme du doute. Cavell explique que nous sommes pris dans deux tentations simultanées, comme deux voix : la voix métaphysique et la voix sceptique. Et l’impulsion de destruction n’est qu’une forme extrême de doute.
D : Dans un article paru dans Positif (« Fukushima en cinéma : comment survivre à notre folie ? », n°631, sept 2013), vous parlez du regard fasciné autour duquel tournent certains des films que vous commentez. La catastrophe n’induit pas seulement le rejet, elle dévoile aussi certaines des ambivalences de la sidération que nous pouvons avoir pour ces somptueuses images du désastre, comme si la destruction n’allait pas sans un certain érotisme.
E.D. : C’est une chose que Cavell dit avec force : il y a un effet de miroir entre les dévastations extérieures, les catastrophes naturelles, sociales, politiques, et un sentiment de dévastation intérieure. C’est parce que nous connaissons ces ravages intérieurs, avec ce qu’ils comportent de sentiment d’exil vis-à-vis de soi-même, que nous sommes si réceptifs, dans la distance même, aux images de destruction que laissent les tsunamis, les tremblements de terre, les catastrophes écologiques ou nucléaires. Cavell raconte dans son autobiographie, Little Did I Know (p.18 sq.), le souvenir d’une violente dispute entre ses parents qui l’avait laissé en proie, enfant, à un sentiment de destruction, d’anéantissement. Et cette annihilation de soi a plus tard ressurgi dans sa vie chaque fois qu’il a été témoin ou victime de dévastations. Il y a une évidente dimension psychanalytique à cela, mais pas seulement. La manière dont une catastrophe se mire dans une autre, en rappelle une autre ; ce lien entre quelque chose qui est toujours déjà familier, intérieur, et une réalité extérieure catastrophique, est crucial dans nos vies. La catastrophe fait écho à une destruction qui nous a faits, qui nous constitue. Ce lien appartient aux structures mêmes de la raison et de l’expérience humaine. Il engage donc profondément tout à la fois la philosophie et l’art.
Filmographie sélective :
– No Man’s Zone, de Toshi Fujiwara
– Nuclear Nation et Nuclear Nation 2 de Atsushi Funahashi
– Women on the edge, Japan’s Tragedy de Masahiro Kobayashi
– Himizu, The Land of Hope de Sono Sion
– Somakanka : Memories of a Lost Landscape, Horses of Fukushima de Yojiu Matsubayashi
– The Sound of the Waves, Voices from the Wave, Storytellers de Ko Sakai et Ryusuke Hamaguchi
– Since Then, Sharing de Makoto Shinozaki
– Quatre bâtiments face à la mer, Machine to Machine, Fovea Centralis de Philippe Rouy.
Images : Nuclear Nation (Atsushi Funahashi, 2012) / No Man’s Zone (Toshi Fujiwara, 2012) et The Sound of the waves (2011) / Fovea Centralis (Philippe Rouy, 2014) / Quatre bâtiments face à la mer (Philippe Rouy, 2012) et The Land of Hope (Sono Sion, 2012) / Nuclear Nation.