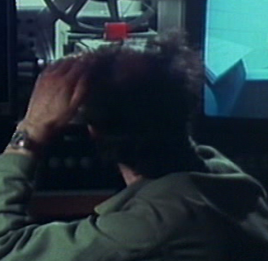J’veux du soleil !, Gilles Perret et François Ruffin
La visite au peuple
Les derniers films de François Ruffin et Gilles Perret[11][11] Voir également les entretiens avec Gilles Perret publiés sur Débordements : “Conséquences locales, désordre global” (2013) et “Pour un cinéma social incarné” (2016)., respectivement Merci patron ! et L’Insoumis, apportaient au même problème – comment figurer le peuple – deux solutions complémentaires : métonymique pour le premier, à travers la famille Klur que le journaliste de Fakir aidait à exiger réparation auprès de Bernard Arnault ; allégorique pour le second, qui articulait le corps du tribun Mélenchon à la foule des innombrables qu’il était censé incarner. Leur collaboration pour J’veux du soleil ! initie une troisième voie, sérielle, qui prend le chemin inverse de ces incorporations figuratives et va à ce peuple auquel il était auparavant demandé de se projeter dans une silhouette, qu’elle soit anonyme ou magistrale. L’occasion en est ce mouvement toujours actif au moment où sort le film, les Gilets jaunes, dont les panaches fluos justifient l’héliotropisme du titre : vouloir le soleil, c’est réclamer une vie échappant aux fatalités grises des fins de mois étranglées ; pour les cinéastes, c’est, d’une autre façon, capturer l’aurore splendide d’une insurrection qui s’est choisie la couleur la plus éclatante qui soit. La plus neuve aussi, c’est-à-dire la moins connotée – ni rouge, ni verte, ni brune – donc la plus à même d’incarner la variété d’un multiple désencarté. Celui-ci, la France Insoumise a pris l’habitude de s’y référer par un nom équivoque, « les gens » ; c’est par cette même appellation que, au début du film, Ruffin désigne ceux à la rencontre de qui il va, en insistant sur la candeur volontaire de son enquête.
Une semaine durant, en décembre, Perret et lui ont arpenté la France du Nord au Sud, de rond-point en rond-point, sans a priori déclaré et avec pour seul vœu de regarder d’en bas, selon une perspective inverse à celle du surplomb gouvernemental. Tourné sur un si court laps de temps, fini peu après le discours d’Emmanuel Macron ayant suivi l’acte IV et annoncé dès début janvier, J’veux du soleil ! n’oserait donc pas prétendre documenter l’ensemble d’un mouvement qui aura muté plus que tous ses prédécesseurs, Nuit Debout y compris. Il se veut simple éventail de visages, échantillonnage d’un peuple dont il se plaît à démontrer l’hétérogénéité – le montage prélève des cas « rares » sur lesquels Ruffin insiste sans mesure, écolos, végétariens ou enfants d’immigrés – et, surtout, la spontanéité sincère et généreuse, aux antipodes de la « foule haineuse » qu’a prétendu y voir Macron. C’est le premier enjeu du film : recoder la figure, démentir les accusations de fascisme larvaire. Le second est plus complexe : héroïser la modestie en restaurant le fantôme des fiertés ouvrières à l’âge des hontes privées. Un troisième, plus équilibriste, touche à la figure de Ruffin, à la fois journaliste et député, pris entre le désir affiché d’être un médiateur évanescent et la stratégie manifeste de l’émissaire officiel – ce qui le fait osciller entre la marge du plan et le centre de l’image.
Un quatrième enjeu serait d’articuler le réel et le symbolique, c’est-à-dire d’enregistrer la misère – les chiffres, omniprésents – tout en magnifiant l’aura. J’veux du soleil ! s’ouvre sur un Ruffin calculant des frais de réparation automobile, et, à sa suite, le reste du film est riche en comptes et décomptes, comme s’il fallait opposer une micro-économie domestique à la « macron-économie » libérale, tout en rappelant que l’avarice est du côté des milliards (d’où la scène répétée de l’accueil : Ruffin s’invite chez tel ou tel gilet jaune, qui lui présente la somme de ses soustractions mensuelles tout en ouvrant grand ses portes). L’intérêt du film tient à cette position à la croisée de l’expert-comptable et du démocrate. D’un côté, les gilets jaunes qui y figurent motivent un discours doloriste appuyé sur des faits d’une brutalité viscérale, qui, plus que de la pauvreté, relève souvent de la simple famine ; de l’autre, la magie des agoras surgies de nulle part transcende cette comptabilité et oppose à l’art officiel des ronds-points – ces œuvres coûteuses que la loi oblige à y installer – les cabanes abritant les débats, qui tiennent lieu d’authentique art populaire. Au volant de sa voiture, Ruffin ne manque pas de s’émerveiller de ces éveils politiques dont la beauté tient à ce qu’ils restent étrangers à toute forme de militantisme classique. C’est aussi là que se résument les paradoxes du populisme cher à la France Insoumise : la politique qu’elle en déduit ne vaut que comme antithèse de l’activité politique habituelle, à laquelle se substitue une morale qui, ici, prend forme dans le familialisme des ronds-points présentant à la République officielle quelque chose comme son double et son négatif, un grand corps fraternel et sororal arborant le visage d’une communauté ouverte face à la société des égoïsmes privés. Ruffin évite toute question idéologique et n’interroge les gilets jaunes que sur les dimensions les plus concrètes de leur quotidien, tout en donnant aux corps et aux affects une prééminence écartant les discours doctrinaux. Il y a là une revendication bien compréhensible d’une politique réelle défendant les liens sociaux et les biens de chacun contre l’abstraction des valeurs républicaines ; il est toutefois difficile de ne pas y voir le reflet de la dépolitisation inhérente à la pratique macroniste, de sorte que chacun des camps finit par incarner une facette du spectre de la politique française contemporaine, le rocardisme, discours de l’autonomie dans lequel se retrouvent les défenseurs du lien social et ceux de la libre entreprise. Structuré autour d’un conflit d’échelles – la cabane contre l’Elysée, le rond-point contre le hub –, J’veux du soleil ! est d’abord un duel entre un député et un président (d’où le fréquent « Si j’étais monsieur Macron, qu’est-ce que vous me diriez ? », qui répète le protocole de Merci patron ! tout en projetant une substitution des rôles).
Au-delà du portrait du peuple tel qu’en lui-même, le film s’inscrit donc dans une lutte plus large pour le monopole du « pays ». Le livre qu’a tiré Ruffin de ce même voyage s’intitule Ce pays que tu ne connais pas, le « tu » se référant à « Manu », ce président dont une séquence monte à grande vitesse quelques extraits des saillies les plus méprisantes à l’endroit des « gens » qu’illustre le film. Le procédé revient plusieurs fois, non sans mocheté (réalisé dans l’urgence, le film est dans l’ensemble plus brouillon que Merci patron ! ou L’Insoumis), ni sans amalgame médiatique – à la télévision systématiquement fallacieuse répond le réel des images tirées du web (parmi lesquelles brille l’absence des vidéos de manifestations, qui constituent l’angle mort du film). Qu’un tel partage structurait déjà L’Insoumis, construit autour de l’opposition entre le Mélenchon « authentique » et celui dépeint par l’éditocratie courtisane, rappelle que J’veux du soleil ! est, aussi et entre autre, une partie de campagne. Il ne s’y réduit certes pas, comme en témoigne son projet de réparation esthétique : à deux reprises, Ruffin se demande si l’un des plus grands torts subis par ces gens n’est pas la « dégradation esthétique » qu’accusent les paysages sans charme arpentés par le film, tous ces non-lieux que sont les péages, stations-essence ou supermarchés ; au film de sublimer ce peuple en trouvant dans son usure le motif d’une auréole, comme le montre le beau moment lors duquel, à Dions, les cinéastes ambulants croisent une immense effigie d’un anonyme – « Marcel » – transformé en totem par un peintre des ronds-points. L’autre horizon se présente officiellement comme une visée stratégique vaguement léniniste, rallier les classes intermédiaires à la cause du grand renversement (voir l’entretien figurant dans le dossier de presse). Mais sous ces honorables dehors d’agitateur et en marge de la destinée électorale de Ruffin se décèle une logique figurative peut-être plus décisive : préempter le visage du peuple, face à un macronisme ayant achevé de défaire le lien symbolique entre « les deux corps du président » (la chair de l’homme et l’effigie de la nation). Une telle opération demande de disqualifier les images du camp adverse, plus encore que ses discours. On sait que, depuis la campagne de 2017, la France Insoumise a beaucoup misé sur les véhicules audiovisuels du Net, qu’elle présente comme les seuls médias directement branchés au corps du peuple. Mais c’est aussi l’unique parti à avoir su trouver aujourd’hui une forme cinématographique qui lui soit propre, le documentaire populiste. Son impact est sûrement moins viral que les facetimes et autres live insoumis. Il n’en offre pas moins la façade la plus subtile de cet édifice propagandiste.
Durée : 76 minutes.
Sortie : 3 avril 2019.