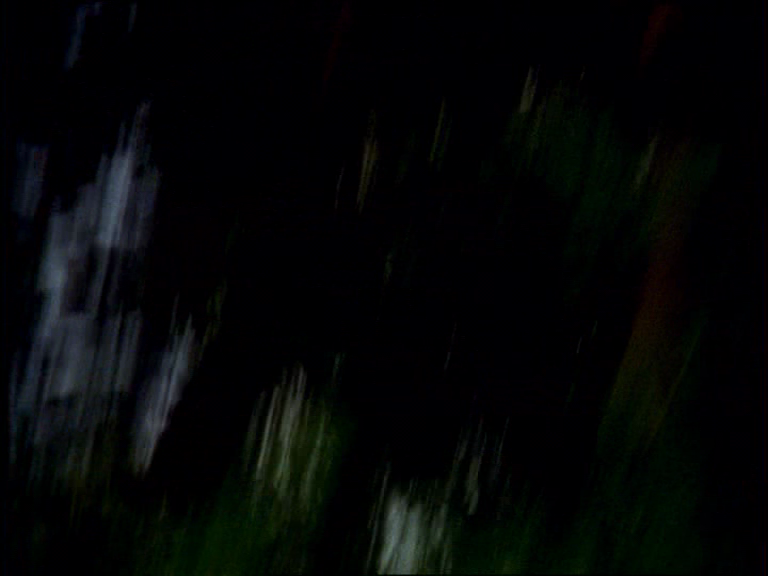La patience du médiateur
A propos de deux films de Henri-François Imbert
Les films de Henri-François Imbert, au-delà des écarts temporels et géographiques, ont ceci de commun d’être des enquêtes, dont le point de départ est, quelque soit le sens que l’on donne au terme, une image. A l’inverse de Citizen Kane, qui commençait sur un son sans image, l’auteur, car Imbert est à la fois le filmeur, le narrateur et l’enquêteur, se trouve en possession d’images abandonnées ou perdues et guettées par l’oubli, dont il s’empare pour partir en quête de leur propriétaire, incarnation ou référent, dans le but final de leur redonner du sens.
Doulaye, une saison des pluies (1999) raconte la recherche par l’auteur d’un ami de son père, perdu de vue depuis plus de vingt ans, et dont seules quelques petites sensations, ainsi que l’image fascinante d’une chasse au lion à la lance, ont impressionné sa mémoire d’enfant. No pasaran, album souvenir (2003) est également initié par un souvenir d’enfance : l’évocation d’un album de photographies feuilleté par l’auteur chez ses grands-parents. Et de même que le trajet qui mènera Imbert à Doulaye l’amènera à dresser un portrait du Mali sortant de deux décennies de dictature, la reconstitution de ce catalogue d’images conduira à la mise en question problématique du douloureux épisode historique qu’elles représentent.
Le Malien (qui, non seulement chasseur, est aussi député) comme les cartes des Républicains espagnols deviennent ainsi les « Rosebud » d’un homme qui ne dévie de sa démarche que pour apprécier le monde qu’il traverse. Ces déviations acceptées empêchent les films de virer à l’« obsession » : à la différence d’un Lanzmann ou d’un Leroux[11][11] Ce qui fait que Shoah (1985) et Reprise (1997) sont de grands films, c’est précisément qu’ils ont été réalisés avec un investissement maniaque de la part de leurs auteurs., le parcours du cinéaste parait beaucoup plus ouvert au hasard, plus fragile aussi, et reste susceptible de s’offrir en partage à ceux qu’ils rencontrent.
Sur la trace des images.
Depuis Sur la Plage de Belfast, un même geste guide l’auteur dans ses enquêtes : celui de retrouver une concordance perdue entre l’image et le réel. Dans No pasaran, il retourne sur les lieux, à Agde, Argelès-sur-Mer ou à Bram, à la recherche de vestiges des camps de réfugiés espagnols. Dans Doulaye, où l’image n’est qu’un lointain souvenir, enfoui dans l’intimité de l’enfance et partagé en voix-off avec le spectateur, Imbert cherche là encore la trace de cet homme qui a un jour disparu. À partir de quelques informations précaires (nom, âge, cursus), il part à la rencontre de ceux qui peut-être ont croisé sa route. Cette fois, l’auteur ne dispose pas de photo des lieux ou du disparu. C’est donc sur sa mémoire, et sur le savoir des témoins rencontrés par hasard, qu’il va appuyer sa recherche et son voyage. Cet acte liminaire rappelle qu’avant de douter des images (ce geste viendra après), il faut d’abord les prendre pour ce qu’elles sont : des empreintes du monde, des « inscriptions vraies ».[22][22] Notons à ce titre que l’image qui a « impressionné » la mémoire d’Imbert enfant (Doulaye tuant un lion à la lance) est le fruit de son imaginaire, et que le premier geste de l’auteur sur place sera de retrouver une photographie de Doulaye, qu’il va ensuite valider, via un rapide passage aux services administratifs officiels : encore une fois, il s’assure de la véracité d’une image en la confrontant à la réalité concrète. C’est bien en repartant d’elles qu’on s’assure du lieu aujourd’hui : « Si tel château apparaît au loin sur la photo, alors c’est qu’elle a été prise depuis le site où nous sommes ». Retrouver le point de vue du preneur d’image (dans No pasaran comme dans Sur les plages de Belfast, 1994), des années plus tard, permet de s’assurer de cette concordance première entre l’image et le monde, sans laquelle il n’y aurait pas de documentaire, pas de cinéma.
Avant d’être des films d’histoire, les films d’Imbert sont peut-être d’abord des films géographiques, localisés avec une grande précision dans un pays ou une région donnée (Irlande, Mali, Pyrénées-Orientales). Explicitement, à travers la reconstitution d’une série photographique (le catalogue APA), No pasaran nous fait suivre le trajet des Républicains, ville par ville (curieusement, c’est ainsi que les cartes ont été organisées). Il est aidé dans sa (dé)marche carte car dans certaines cartes, « le paysage est aussi important que l’histoire qu’elles représentent » (commentaire). Cela implique d’incessants voyages, poussant Imbert à arpenter un territoire, afin de dessiner une géographie de la mémoire. Cette géographie confère à l’histoire un lieu, une scène où elle a pu se jouer. Mais cette scène demeure problématique à plus d’un titre. D’abord, l’auteur ne retrouve pas les traces des camps qu’il croyait trouver : à Argelès ou Amélie-les-bains, les villes ont repris leur statut de stations balnéaires, et le tourisme a balayé l’histoire. Pire encore, dans un geste de refoulement historique odieux, à Agde, où le camp de réfugiés a par la suite servi à la concentration de Juifs et de Tziganes, un monument rend hommage aux réfugiés qui ont ici « cheminé vers la liberté ». En réalité, beaucoup d’entre eux ont été déportés. Les lieux n’offrent plus de prise sur l’histoire, et même ceux qui ont vécu l’exil et les camps ne peuvent pas raconter (voir le cas de Casimir Carbo). Les images sont donc, dans le film, les seules manifestations tangibles de cette histoire : elles seules montrent ce que l’on ne peut plus voir. A condition d’en faire usage.
Faire usage des images, c’est donc d’abord les rassembler afin qu’elles « s’éclairent les unes les autres » et, enfin, après plus de dix années de recherche « commencent à raconter une histoire ». Le geste de comparaison, de montage entre les images, se révélera fructueux : en comparant deux images d’un convoi de déplacés, prises au même endroit, le cinéaste montre, sur la remarque d’un ami, qu’un laps de temps suffisant sépare les prises pour que le chef de gare ait pu fermer les portes des wagons, visibles à l’arrière-plan. Ce temps renseigne sur le nombre de réfugiés, puisque plusieurs dizaines voire centaines de personnes ont pu défiler, le temps qu’on ferme les portes, sans qu’on arrive au bout du convoi : il fallait donc posséder les deux images et les mettre côte à côte pour avoir cette information.
Autre montage, polémique cette fois, le passage d’Argelès à Mauthausen opéré par l’auteur donne à voir, par le trait d’union entre deux catalogues, une continuité historique signifiante et tragique. D’abord liés par une même appellation, « camp de concentration » (c’est ainsi qu’on a appelé les camps de réfugiés du Sud de la France), ces deux carnets se rencontrent finalement, quand on apprend qu’un grand nombre de républicains ont été déportés : les deux séries ont été pour eux « le début et la fin d’une même histoire ». Le rapprochement entre les images rend ainsi lisible une autre version de l’histoire, plus juste mais aussi plus douloureuse que la mémoire consacrée et les monuments officiels (traces physiques laissées volontairement). Dans ces quelques visages des photos du camp autrichien, peut-être certains ont-ils séjourné à Bram ou au Boulou. Peut-être même l’un d’eux apparaît-il dans chacune des collections. Ce ne serait pas chez l’auteur la première coïncidence.
Faire usage de l’image, c’est aussi la donner en partage. Dans Doulaye, le mince fil qui relie l’auteur au disparu donnera matière aux témoins pour formuler des hypothèses, chacun composant sa version du passé de Doulaye : est-il arrivé au Mali ou est-il resté en Algérie, première étape de son retour ? Peut-être s’est-il marié là-bas ? Mais hypothèse aussi sur le lieu où il se trouve : untel connait des Danioko vivant à tel endroit, peut-être est-ce un cousin ? Le film laisse exister ces conjectures, en suit une puis l’autre, sans nous donner d’avance le résultat (alors que bien évidemment, celui-ci est connu du filmeur) jusqu’à retrouver finalement Doulaye. Entre temps, il est devenu une hypothèse collective, à travers laquelle chacun a pu repenser une période troublée du pays ou évoquer les mœurs de l’Afrique (a-t-il pris une ou quatre femmes ? quelle est sa religion ?). Cette recherche est ainsi l’élément qui parfois pousse les témoins, ici des jeunes, à confronter leurs visions du passé et de la culture. Ces hypothèses sont donc à la fois le centre du film et son fil conducteur, elles se suivent et se confrontent bien au-delà de l’objet de la recherche, en dessinant un portrait en creux du Mali de la fin des années 90. La coexistence des suppositions, on la trouve aussi devant les cartes de l’album souvenir, dont les pages se prêtent facilement aux lectures contradictoires. Images et souvenirs ne sont que la partie accessible d’un monde qui reste à reconstruire, par la confrontation des paroles et des regards.
Enfin, il faut noter que les œuvres d’Imbert contiennent leur part d’images abstraites, parfois difficilement identifiables, et à la signification incertaine. Images tremblantes d’un trajet en Afrique qui mènera peut-être à la rencontre de l’être perdu, plan fixe d’une mer au reflux saccadé ou reflets du soleil sur les vagues cadrés au plus serré : ces plans semblent porter la trace d’une intensité dramatique, voire d’une introspection dans laquelle plonge le filmeur, en nous entraînant à sa suite.
« Pourquoi, quelque fois, les images se mettent-elles à trembler ? », se demandait Chris Marker dans Le fond de l’air est rouge. Était-ce le signe d’une « capacité d’affection propre aux images », comme si elles avaient le pouvoir de ressentir l’intensité de l’évènement dont elles sont l’empreinte ?[33][33] Cf. sur ce point Cyril Béghin, « Des images en sursis, L’ambassade de Chris Marker », in Philippe Dubois (dir.), Théorème 6 – Recherches sur Chris Marker, Presses Sorbonne Nouvelle, 2006, pp. 158-165. La réponse était plus simple, plus pragmatique aussi : la main qui tenait la caméra tremblait face aux évènements filmés. Car, comme ces poings révoltés qui se lèvent pour protester contre un ordre mondial qui ne les respecte pas, la main qui tient la caméra est une « main fragile ». Cette fragilité, on ne peut pas ne pas la ressentir devant les œuvres d’Imbert, et sans doute ces images en sont un signe supplémentaire.
Fragile d’abord, l’image intime, le souvenir de Doulaye, qui se compose surtout de sensations : les mains d’un enfant qui se promènent sur un visage, dont les creux et les bosses le font rire. Image faussée aussi, sans doute mythifiée par les récits de chasse au lion, qui ont aussi contribué à fixer le personnage Doulaye dans l’esprit du jeune Henri-François. Fragile enfin, et l’on se rapproche du sens markérien quand, à travers la disparition de Doulaye, l’enfant fait l’expérience de la perte et de l’injustice. Ainsi, au début du film, le tremblement de l’image redouble cette remémoration hésitante, avant de s’accorder à l’effroi de l’enfant, quand son père lui apprend que Doulaye est peut-être en prison : découverte de l’impuissance individuelle face à un monde injuste (les dictatures africaines), première mise en branle de la représentation enfantine du monde. À l’image, un travelling en jeep sur la piste accidentée se poursuit en un zoom chaotique sur deux enfants en charrette.
Nouveau recours à l’abstraction, quand des images du bord de la route, d’abord accélérées, puis ralenties à l’extrême, à la fois déformées par la vitesse et rendues photogramme par photogramme, remplacent les retrouvailles avec Doulaye. La séquence, filmée, aurait-elle été forcément décevante ? N’aurait-elle pu rendre l’ampleur de cette rencontre, retardée depuis vingt-cinq ans ? Ou bien peut-être est-ce parce que ce rendez-vous arrive finalement « trop tôt » qu’Imbert décide de retarder l’apparition de Doulaye à l’écran ? La séquence en direct n’aurait pu que réduire le climax, que l’abstraction et la voix (on entend en off la rencontre, l’incrédulité puis l’étonnement de Doulaye) conservent en lui maintenant, un temps au moins, son « indécidabilité » : Est-ce vraiment lui ? Va-t-il se souvenir ? N’y aura-t-il pas aussi une certaine déception, chez l’un ou l’autre, si ce rendez-vous depuis longtemps reporté n’aboutit pas au miracle attendu ?
Dans Sans soleil de Marker, la « Zone » issue du synthétiseur de son ami Hayao Yameko modifiait les images en abstraction comme pour en ôter l’immédiateté. Ces images étaient alors « moins menteuses » que les images figuratives, car « au moins elles se donnent pour ce qu’elles sont, des images, pas la forme transportable et compacte d’une réalité déjà inaccessible. » En retardant l’apparition de la figure, Imbert entraîne avec lui le spectateur : non immédiatement partageables, ces plans exigent observation et réflexion, tandis que leur mouvement abstrait correspond à un double trajet : par-delà les quelques kilomètres qui lui restent à parcourir pour rejoindre Doulaye, c’est un quart de siècle de séparation qui est enjambé, d’où un temps qui, d’un coup, se resserre, s’accélère. Et puis, suspendu à la reconnaissance, à la mémoire de l’ami retrouvé, ce temps semble se cristalliser, jusqu’à cette expression incrédule : « Que tu as grandi ! »
Ces images semblent d’autant plus fragiles qu’elles sont souvent prises en super 8, là où l’avancement de l’enquête et les rencontres sont en 16 mm : « le super 8 était un microscope qui nous permettait de voir derrière la surface de la réalité et de rendre visible la vie interne des images. » (Peter Tscherkassky)[44][44] Cité par Cyril Béghin, “Des images en sursis, L’Ambassade de Chris Marker”, op. cit, p165, N8. Tirées d’une « zone » non plus électronique mais intime, d’un film en train de se faire et dont nous assistons à la genèse, ces images se détachent de la figuration pour rappeler le processus de création, et donner à voir moins le contenu mimétique, l’empreinte du réel, que l’émotion du filmeur lui-même, et ses allers-retours dans l’espace et les temps.
Aux travellings tremblés d’un Mali parcouru de long en large correspondent les plans fixes des rivages de No pasaran. Le film lui-même est pris entre deux rives : Argelès et Sangatte, le Sud et le Nord, deux migrations, deux temps qui ont buté sur les vagues, comme un obstacle, non vers la liberté, mais simplement vers la survie. Ces plans ralentis, où la mer semble chercher son rythme, comme s’il manquait au film des photogrammes pour lui rendre sa fluidité, paraissent donner à voir la perplexité de l’homme d’image, évoluant dans un continuum historique troué. Ce temps chaotique, comme bégayant, n’est-ce pas la conséquence d’une mémoire lacunaire, dont le cinéaste tente de réparer les accrocs ?
« Je » et les Autres.
Ces images sont donc d’abord le signe de la présence jamais cachée du filmeur. Celle-ci est mise en scène par de menus détails, laissés à notre attention : sa compagne apparaît dans certaines photos qu’il prend sur les lieux des camps frontaliers de No pasaran ; un film qu’il a tourné en famille est montré à Doulaye (et au spectateur). Et surtout, il est à tous les postes du film : il filme, commente et fait le lien pour nous avec le monde. Le cinéaste devient notre guide, mais un guide qui découvrirait en même temps que nous la visite qu’il nous propose. Un guide qui, plutôt que d’imposer un chemin, nous proposerait de l’accompagner dans sa découverte d’une histoire, racontée comme s’il ne savait pas où elle allait le mener : un guide modeste qui rend au hasard ce qui appartient au hasard. Concrètement, cela passe par une ouverture au monde et aux autres, une liberté d’écriture qui permet d’aérer le film et de lui donner une forme inattendue. No pasaran s’apparente ainsi à un parcours maintes fois mis en sommeil mais jamais abandonné, une quête souterraine étalée sur une décennie, avec ses pauses et ses regains : des années s’écoulent entre la découverte de deux cartes, mais l’obstination tranquille du cinéaste, sa patience, auront eu raison de la dispersion des images et de l’éparpillement de l’histoire.
Cette ouverture aux autres et au monde, avant d’y voir un acte politique (ce qu’elle est sans aucun doute), il faudrait lui donner le nom simple de générosité. Comment qualifier sinon les détours que se permet l’auteur, comme cette scène de Doulaye qui ne pouvait être prévue : parti au hasard vers la mer (encore), sur la piste reliant Bamako à Conakry, l’auteur s’arrête dans un minuscule village où personne ne parle français. Il y passera l’après-midi, et cette scène, sans lien direct avec l’intrigue, s’intégrera finalement dans le film, simplement parce qu’elle a « trouvé grâce » aux yeux de l’auteur, parce qu’il y a eu rencontre. On ne saura que peu de choses de cette famille : simplement quelques images, des portraits, des sourires. À défaut de rapporter une conversation (celle-ci était-elle d’ailleurs nécessaire ?), le cinéaste reviendra avec une poule, pour le remercier de s’être arrêté. Dans les cartes de la série APA, des zooms sur les visages semblent, simplement, rechercher l’humanité qu’ils portent, sans autre information que le fait de nous rappeler que ces images que nous regardons sont aussi des instants qui ont été vécus. Ces parenthèses dans l’enquête, comme le choix de conserver les hésitations, les latences, de rendre toute l’incertitude du projet documentaire, empêchent le film de tourner à l’obsession ou au nombrilisme – écueil récurrent des journaux filmés : on pourrait y voir un regard sur le monde qui s’attarde sur sa périphérie, un hommage à la marge – à la marge de la route (le village est en retrait de la piste) autant qu’à la marge du sujet.
Autre exemple, au début de Doulaye, quand l’auteur rencontre des étudiants et qu’il leur parle de l’ami disparu, chacun y va de son idée, et au lieu de les interroger (peu de dialogues dans ses films : les témoins parlent à la caméra plus qu’ils n’échangent avec le filmeur), l’auteur s’efface pour les laisser parler entre eux, sans intervenir. Il semblerait qu’il y ait une véritable séparation entre les scènes vécues et les scènes filmées : là encore, on s’écarte de la forme du journal intime. Peut-être est-ce la raison principale pour laquelle il n’a pas filmé la scène des retrouvailles : par respect pour Doulaye, il n’a pas voulu être ailleurs (derrière sa caméra) quand cette suite de hasards a fini par le mener à lui ; et surtout, il a refusé de lui enlever ce moment, de pervertir cette surprise par l’action de la caméra, afin de garder intact ce premier contact entre eux. Sans doute faut-il un certain sens moral pour faire passer la vie du sujet avant la réalisation du film.
Enfin, là où le geste du cinéaste va peut-être le plus loin, et là où il est peut-être le plus beau, c’est dans le partage de l’outil. Ce geste, qu’on pourrait dans le sillage de Serge Daney[55][55] Serge Daney, “La remise en scène”, La Rampe, Cahiers du cinéma, 1996, p67., appeler un geste de réversibilité, offre au filmé la possibilité de prendre part à la composition du film. Manier la caméra comme pour jouer (plans de coupe sur des dindons tournés par Drissa, un ami qui l’accompagne, tandis qu’ils attendent le retour d’un témoin) ; filmer le réalisateur, dans un juste retour des choses (il apparaît souvent discrètement dans ses films) ; faire une image de l’être aimé ou d’une chose désirée (Doulaye sa famille dans d’émouvants portraits en gros plans ; les Kurdes les côtes anglaises ou le ferry lointain qui les emmènera peut-être un jour) : autant de gestes qui changent le statut du filmé en le faisant non plus seulement acteur, mais actif : en prenant part au film, ce n’est plus simplement lui qui accorde sa confiance à l’auteur, qui lui confie son image, mais l’auteur qui lui confie une part de son œuvre. Et cette confiance est d’autant plus marquante que l’œuvre est, on l’a dit, extrêmement personnelle. Mais n’est-ce pas également la preuve d’une croyance dans le médium, qui accueille désormais le regard de l’autre ? En donnant à l’autre la capacité de faire image, Imbert lui permet de faire à la fois un acte d’amour (à plusieurs reprises, Doulaye et sa femme appellent leurs enfants pour qu’ils apparaissent dans le film), mais aussi de s’approprier le monde. Filmer, c’est choisir son cadre, faire une empreinte, enregistrer et donc posséder le monde (ici, dans le plan-séquence, on peut penser qu’il vise le ferry ou les côtes anglaises), et donc c’est, le temps d’un plan, et si peu que ce soit, reprendre prise sur un réel qui dépossède. C’est aussi, pour chacun, laisser son empreinte sur lui, laisser une trace de son passage.
Un homme, poussé par la curiosité, intrigué par une image, voyage dans le monde qu’il partage avec ses semblables et compose avec eux une « réalité seconde » (le film) qu’il partage ensuite avec nous. Paradoxe au centre de ce cinéma : partant du cercle le plus intime, le film s’élargit sans cesse de la sphère personnelle vers la communauté humaine, incluant dans sa spirale sujets filmés et spectateur. Imbert devient ainsi un médiateur : celui qui va nouer une relation « médiatique », imageante, entre deux parties. Par l’emploi de la première personne et son rapport aux autres, le cinéaste se fait tout à la fois leur égal et le nôtre, nous rapprochant ainsi, comme rarement auparavant, de l’humanité qui prend forme à l’écran, résolvant à sa manière cette équation politique du cinéma documentaire : qu’est-ce que j’ai à voir avec l’autre, par l’autre ?
Médiateur encore, Imbert l’est dans le trait d’union qu’il trace, par la mémoire qu’il transmet entre les membres de deux histoires qui n’en font finalement plus qu’une.[66][66] Selon l’Académie Française, au sens physiologique, un médiateur chimique est une “substance chimique élaborée par un neurone, qui, en atteignant une synapse, entraîne la réponse d’une autre cellule, nerveuse ou musculaire (on dit plutôt Neuromédiateur ou Neurotransmetteur).” Ces cartes postales non-envoyées qu’il met dans les mains et sous les yeux des Kurdes et des Afghans de Sangatte sont un message perdu que l’auteur fait voyager à travers les époques, comme la pièce de théâtre écrite en France par Doulaye qu’il fait lire aux jeunes adultes maliens trente ans après. Un passé qui ne leur appartient pas en propre, et qui pourtant les concerne, soudain leur échoit. Les réfugiés espagnols ne sont pas les Kurdes, les jeunes maliens n’ont pas failli mourir sous la dictature de Moussa Traoré, mais en leur transmettant ce passé transversal, indirect, en partageant avec eux son « héritage », il les inscrit dans une filiation, dans un temps long, plutôt que d’en faire des phénomènes éphémères, pris dans le flux de l’actualité (le propre des migrants, c’est d’être de passage ; les dictatures n’attirent l’attention des médias que dans leurs coups d’éclat : répression, assassinat). Peut-être au contraire faut-il ralentir le courant pour avoir le temps de regarder les vagues qu’il charrie sur le sable ? Et d’un autre côté, les cartes « non-voyagées »[77][77] Terme qu’emploient les collectionneurs dans le film pour parler des cartes qui n’ont pas été envoyées. sont finalement restituées à qui de droit, à ceux qui sont peut-être les plus à-mêmes de les comprendre ; et la pièce, jamais éditée ni jouée, trouve pour la première fois son public. L’image, l’œuvre, se devenant cette médiation entre les hommes, « répare le tissu du temps ».[88][88] On aura reconnu ici un emprunt à Chris Marker.
Autour du point aveugle.
Les images qui motivent la recherche de l’auteur ont été générées (ou absorbées) par une page sombre de l’histoire, une sorte de point aveugle qu’elles ne montrent jamais ouvertement. Elles ne font que graviter autour. Doulaye ne racontera pas la souffrance de la dictature, ni même le difficile apprentissage de la démocratie. Lors d’un long plan où la radio raconte des violences autour de bureaux de vote pour des élections auxquelles, en tant que député, il se présente et a voté, l’auteur et son ami n’évoqueront pas la situation et ce dernier se contentera de sourire. De même, les photos de No pasaran montrent l’exode mais jamais la vie dans les camps. C’est que le regard qui les a produites était celui d’un spectateur extérieur, pas même un reporter, seulement un free-lance vendant ses clichés au plus offrant, toujours du bon côté des barbelés.[99][99] Elles sont ainsi l’exact opposé de la série d’Augusti Centrelles, réalisée à l’intérieur des camps d’Argelès-sur-Mer et de Bram. Cf. sur cette série, Georges Didi-Huberman, « Quand l’humilié regarde l’humilié », Remontages du temps subi, L’œil de l’histoire, 2, Minuit, 2010, pp197-215. Cette série de photographies pose ainsi la question du regardant : qui a fait ces images et pour quel usage ? Autrement dit, derrière la trace qu’elles portent, quelle est la part de mise en scène ? Que cachent-elles derrière l’évidence de ce qu’elles montrent ?
La série de Mauthausen, alternant point de vue SS et prises de vue alliées, rend visible le changement de photographe : selon l’uniforme, les figures changent. Le sujet « joue » différemment devant son gardien et devant son libérateur. Et pour l’un et l’autre, les images n’ont pas la même utilité. Le nombre très restreint de photographies prises par les nazis dans l’enceinte des camps correspond essentiellement soit à des images de tourisme et de loisir (un officier fait visiter le camp à son fils, les officiers et les infirmières font la fête) ; soit à des photos commandées dans le but d’un rapport, visant donc à documenter les supérieurs. Quant aux Alliés, arrivés sur le tard, ils n’ont pu filmer que les conséquences sur les corps, vivants ou morts, affichant la même scandaleuse déshumanisation. Toutes ces images tournent autour d’un point aveugle, le processus d’extermination, qu’elles ne montrent pas, tout en nous renseignant sur son fonctionnement.
Autre série, les cartes postales des plages d’Argelès rappellent le tourisme de cette région. Imbert y cherche les traces de ces évènements douloureux au cours des décennies qui ont suivi, en vain. En mettant côte à côte (par le montage, toujours) deux cartes d’avant et après les camps, on pourrait croire que rien ne s’est passé sur ces côtes de la Méditerranée. Par ailleurs, au coeur même du visible, dans ce que montrent les cartes, tout n’est pas déchiffrable : certaines images « résistent ». « Celle-ci, je ne la comprends toujours pas », dit Imbert à propos d’une carte APA, où la légende parle de l’arrivée de prisonniers franquistes. Parfois, elles déjouent nos connaissances, en elles, deux représentations se font face, se confrontent. Plutôt que de la réduire, Imbert fait le choix de laisser exister cette résistance, de la souligner. Cela passe d’abord par le temps qu’il laisse au spectateur pour regarder l’image. Son commentaire prend le risque de ménager de longues pauses, pour nous laisser le temps, en silence, de contempler les cartes postales. Ensuite, Imbert s’adresse à nous non pour élucider, mais pour interroger : « S’il nous parle, c’est moins pour nous dire ce qu’il sait que ce qu’il cherche, moins pour nous informer de ce qu’il voit que du chemin qui permet de voir nous-mêmes au-delà. »[1010][1010] Patrick Leboutte, Le regard et la voix. Ce qu’il pointe des yeux dans l’image, c’est moins ce qui s’y passe que ce qui manque, cet invisible qui depuis toujours les lui rend si énigmatiques. Drame du médium : les seules traces encore visibles de cet exil sont ontologiquement incomplètes.
Cet invisible dans l’image dont la voix d’Imbert se charge, n’est-ce pas aussi la souffrance subie durant les évènements évoqués ? Ni les images ni les hommes ne semblent en mesure de transmettre cette souffrance au regardant. Casimir Carbo, le vieux Catalan de Bram, ne saura pas raconter ce qu’il a vécu à son arrivée en France. Mais cette humiliation l’a tant marqué qu’il a toujours refusé depuis de prendre la nationalité française. « Vous savez tout ! Un peu. […] Je n’en dirai pas plus. Mais vous comprendrez qu’il y a des choses qu’on ne peut pas dire. » Le film, se concentrant sur l’exil, n’évoquera pas non plus les conditions effroyables de ces prisons temporaires. Pourtant, à travers le spectre de Mauthausen, horizon d’une partie des exilés, on ne peut qu’être horrifié par les conditions d’accueil réservées, non à des soldats, mais à des familles étrangères cherchant asile sur le territoire français. Déjà, c’était Imbert qui racontait le témoignage de Doulaye, la peur de ses enfants lorsque sa femme et lui partaient manifester ensemble contre le pouvoir de Moussa Traoré, au risque d’être tous deux arrêtés et tués.
Paradoxalement, cette prise en charge du sentiment, de l’émotion de l’autre n’apparaît jamais comme une dépossession ou un affadissement de sa souffrance. Ce geste produit au contraire un surcroît d’intensité, ce qu’on pourrait appeler une intensité critique. En reprenant de sa voix calme les mots et les récits des témoins, et en nous montrant ceux-ci à l’image faisant tout autre chose, en ayant donc recours à la disjonction (au contraire, lors de la rencontre avec Doulaye, on entendait la voix et sans voir l’image), Imbert produit une distanciation suffisante pour que nous puissions tout à la fois entendre l’histoire et voir le corps qui a souffert (le passé est important) mais qui a surmonté. Le cinéaste fait montre ici d’une autre forme de patience : il recueille pour nous la souffrance de l’autre, et nous la rend, par le film, tout à la fois comme vidée de panique – le temps de la panique est doublement passé, historiquement et intimement – mais toujours apte à susciter un sentiment de révolte, devant cette histoire mal digérée par l’Etat français : révolte devant le sort des réfugiés revivant dans le présent de Sangatte les conditions de vie du passé ; révolte devant le mensonge officiel qui enfouit l’histoire honteuse sur les lieux où elle a été perpétrée.
« Comprendre : faire, paradoxalement, de la souffrance un “trésor”. »[1111][1111] Georges Didi-Huberman, Remontages du temps subi, op. cit., p186. Le geste est d’autant plus fort que, pour la plupart des collectionneurs, ces cartes ne valent que pour leur statut d’antiquité rare, et aucun n’aura chercher vraiment à les comprendre. Comprendre, ce n’est pas expliquer, ou chercher à représenter le passé dans sa globalité (et en cela Imbert se différencie du travail historiographique), mais c’est bien plutôt « remonter », « interpréter dans une forme mi-expressive, mi-conceptuelle », écrit encore Didi-Huberman : une expression alliant « la rigueur d’une forme et l’intensité d’une émotion. »[1212][1212] Ibid. pp190-191. C’est tout l’enjeu des films d’Imbert et de son patient travail de montage, par lequel il manie ensemble les temps et les souffrances, sans jamais tomber dans l’amalgame trompeur ni les reproches à peu de frais. Par leur subjectivité affirmée, leur refus de recréer la totalité de l’événement au profit d’une ouverture toujours offerte au spectateur, ses œuvres s’apparentent à des essais, qui parviennent à faire du regard un acte de connaissance : une expérience qui, une fois comprise, pourra à son tour être transmise, car elle aura été apprise et éprouvée.
Enfin, comment ne pas voir dans ce travail la volonté de rendre aux oubliés et aux humiliés la dignité que l’histoire leur a enlevé. Sauver les images, c’est les reprendre au commerce, pour préserver la mémoire de ceux qui y sont représentés, et par là « sauver l’orgueil de [leurs] fils »[1313][1313] Augusti Centrelles, cité par Georges Didi-Huberman, op. cit., p201.. Pour les jeunes Maliens, la pièce de Doulaye est source de fierté, car elle montre que des membres de leur peuple ont résisté à la dictature, par les manifestations, mais aussi en créant des formes pour sauver leur humanité. Et inversement, en arrachant à l’oubli les cartes APA, en leur trouvant des destinataires, Imbert invente une descendance aux réfugiés espagnols en cherchant ceux qui sont les plus concernés par cette histoire, ceux à qui elle sera utile. Dans cette transmission, c’est il est d’abord question de courage et d’espoir : en leur permettant un regard sur le passé, peut-être leur offre-t-il de voir non de futurs déportés, mais des réfugiés, des pères, qui, eux, ont trouvé refuge ailleurs, afin d’affirmer ainsi un peu plus leur croyance en l’avenir. A ces Robinson qui cherchent à atteindre une île, il offre des cartes au trésor.
Toutes les images proviennent de ces deux films.