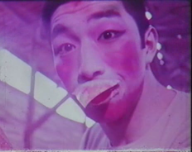28 ans plus tard, Danny Boyle
Monstres sacrés

L’une des visions les plus saisissantes de 28 ans plus tard survient dans sa première partie, lorsque Jamie (Aaron Taylor-Johnson) emmène chasser son fils Spike (Alfie Williams) à travers les ruines du continent britannique : un cadre baigné de lumière crue, un plan large en contre-plongée sur des silhouettes indistinctes en contre-jour, lentement rejointes par une figure deux fois plus massive. L’épure formelle du plan condense à elle seule les axes esthétiques et symboliques du film. Elle accompagne une double transformation : celle du virus – désormais disséminé en figures multiples (rampe-lents, infectés classiques, alphas) – et celle du regard post-apocalyptique, où la menace se déploie dans une mise en scène qui élève la désolation au rang d’expérience quasi rituelle.
En réactivant l’univers mis en place dans 28 jours plus tard (2002), Danny Boyle et Alex Garland ne se contentent pas d’en prolonger la mythologie virale : ils en redéploient les fondations dans une esthétique contemporaine marquée par une saturation des couleurs, des contrastes et des textures visuelles. Le retour en Grande-Bretagne, désormais archipel replié sur lui-même – la contamination mondiale annoncée à la fin 28 semaines plus tard (2007) est déjouée –, permet au cinéaste de déconstruire les conventions du film d’infectés. 28 ans plus tard épouse une structure tripartite étonnamment distendue, méditative, comme une traversée contrainte où chaque avancée suppose un chargement et un déchargement, un gain et une perte. Le premier acte, largement dénué de conflit explicite, relève de l’initiation : Jamie ne protège pas tant Spike qu’il l’accompagne dans une lente acclimatation à un monde post-humain. La transmission paternelle s’y fait silencieuse, physique, intuitive. Le second acte introduit un motif plus classique : celui de la quête. Il s’agit alors de sauver Isla (Jodie Comer), sa mère, de retrouver le Dr Kelson (Ralph Fiennes), de croire encore à une possibilité de soin. Mais ce trajet n’est pas seulement une progression dramatique : c’est une mise à l’épreuve du lien filial. Spike se retrouve entre deux figures paternelles possibles : Jamie, le père biologique, dur et fuyant ; et Kelson, figure de raison, de contrôle, d’autorité sacrificielle. Spike se retrouve lui-même père de sa mère, lorsque celle-ci divague et croise les fantômes de son propre passé. Le troisième acte opère une rupture radicale : le récit bascule dans une zone liminale, celle où la survie immédiate cède à la confrontation avec la mort et au sens que l’on choisit de lui donner. Spike n’est plus l’enfant accompagné, mais l’adolescent endeuillé, dépositaire d’une mémoire, d’un rite, d’un fardeau.
Le récit, déjà traversé par une logique rituelle, trouve dans sa forme un prolongement symbolique : la caméra elle-même devient outil de survivance, altérée, vacillante, saturée – comme si voir le monde impliquait déjà d’hériter de ses ruines. À rebours du réalisme terne du post-catastrophique, 28 ans plus tard revendique une esthétique de l’excès : bullet-time fragmenté, surexposition lumineuse, montage saccadé, grain lo-fi contaminé, usage intempestif d’archives chargées de visions terrifiantes, jamais systématiques – tout concourt à faire de l’image elle-même le vecteur de l’épidémie. Cette esthétique agressive provoque un heurt sensoriel : images dégradées, rythmes syncopés du groupe Young Fathers et pulsations tribales mêlées à des sons électroniques dissonants saturent l’espace sonore. Mais là où 28 jours plus tard s’appuyait sur la pénombre et la granulosité sale de la mini-DV pour instaurer une atmosphère poisseuse et nocturne, cette suite inverse la logique en ancrant son récit en plein jour dans des décors verdoyants. Dans cette cacophonie, les silences suspendus deviennent autant de haltes précieuses : des respirations fugitives, des éclats de grâce arrachés au chaos, qui introduisent une forme de spiritualité ténue au sein de l’apocalypse.
Cette esthétique de l’excès visuel n’est pourtant que la surface visible d’un effondrement plus intime : celui du sens, du lien, de la mémoire. Loin d’une fétichisation de la désagrégation architecturale, Boyle n’expose pas la ruine comme spectacle mais comme révélation symbolique. Les paysages urbains détruits sont entrevus ou rapidement parcourus (à peine Jamie et Spike se sont-ils reposés dans un grenier que le toit s’effondre et les pousse à évacuer), souvent filmés de loin ou réduits à de simples formes floues, presque fantomatiques, tandis que la forêt reprend ses droits sur le monde. Au sein de cet environnement dévasté, la communauté insulaire apparaît comme un refuge un peu ringard, un idéal de foyer et de solidarité qui promet sécurité et chaleur. Mais cette illusion est vite balayée : le raccord lumière entre la première chasse de l’alpha sur la jetée et la fête communautaire en l’honneur de Spike révèle la continuité cruelle entre menace et rituel. Aucun réconfort n’est offert par ce folklore : la fête, comme le reste du monde, reste traversée par la violence et l’épidémie. La forêt, symbole d’un retour au sauvage, n’est plus seulement un décor de décombres mais une matrice : un lieu où la mémoire humaine s’efface, où le rite assure la survie. La seule véritable déchéance matérielle mise en avant est celle du sanctuaire – architecture faite de crânes blanchis – qui concentre en un lieu unique toute la puissance symbolique, liturgique et mémorielle d’un monde effondré. Boyle déplace ainsi le concept de ruine du domaine architectural vers un registre anthropologique et affectif : ce ne sont plus les villes qui tombent, ce sont les corps, les filiations, les rituels.
Dans le dernier tiers du film, Spike fait ainsi la rencontre du Dr Kelson dans le sanctuaire d’ossements, qui lui révèle qu’Isla est atteinte d’un cancer métastasé. Dans un contexte mêlant memento mori et memento amoris – ces rappels philosophiques à la fois de la mort et de l’amour comme fondements de l’existence – Kelson transmet à Spike une vérité brute : certaines morts, plus sereines, sont en réalité des délivrances. Ce moment, à la frontière entre cérémonie et rite funéraire, suspend le tumulte environnant, instaure une pause contemplative. Mais la rapidité saisissante du processus le rend d’autant plus traumatisant : le docteur administre un sédatif à Spike, puis abrège la souffrance d’Isla. Son corps est immédiatement incinéré, le crâne soigneusement nettoyé, avec une matérialité brute. Spike dépose enfin le crâne de sa mère – geste rituel, poignant, païen, parachevant la logique liturgique du Dr Kelson. Cette scène rejoue les grands motifs du cinéma funéraire : elle sacralise la dépouille comme un acte à la fois artistique et de deuil. Les braises de la crémation flottant dans le ciel nocturne, irréelles et suspendues, ne signalent pas seulement la mort, mais une forme d’amour résiduel, un souvenir incandescent. Boyle ralentit alors le régime d’image, contredit la frénésie habituelle du film et instaure une contemplation endeuillée.
Cette logique de la ruine ne s’arrête pas aux lieux ou aux rites : elle gagne les corps eux-mêmes. Les alphas, incarnations hypertrophiées de virilité en décomposition, sont les nouveaux golems de ce monde malade. Cicatrisés, musculeux jusqu’à l’excès, ils évoquent à la fois les créatures sombres et tourmentées des Peintures noires de Francisco Goya et les boss imposants des jeux vidéo comme Dark Souls ou Resident Evil. Dans le contexte britannique, cette hyper-masculinité trouve un écho particulier dans l’imaginaire médiatique contemporain de la virilité spectaculaire : pour un adolescent comme Spike, ces figures cristallisent à la fois fascination et menace. Ni tout à fait humaines, ni véritablement autres, elles incarnent des masculinités terminales, en crise, en implosion.
Le retour de Jamie et Spike au village dans la première partie du film condense cette logique en une vision quasi mythologique. La mer, le ciel et la route se confondent dans une symétrie onirique, irisée. L’alpha qui surgit, hurlant, suivi d’un vol de corbeaux noirs, semble une émanation directe d’un inconscient primitif. L’alpha, s’il appartient encore à la lignée des infectés, dépasse leur simple fonction virale : il est devenu allégorie – du père dévorant, du totem archaïque. Il est une figure de l’Apocalypse, un ange noir accompagné de ses charognards, tandis que le ciel, surchargé d’étoiles artificielles, brouille les repères et fait basculer la scène dans un sacré halluciné. Jamie, à ce moment, n’est plus seulement un père en fuite, mais une entité de survivance mythique, presque biblique : le porteur d’enfant, le passeur. Sa silhouette fuyante reflète l’écho des grandes figures paternelles tragiques – Énée portant Anchise, Abraham et Isaac, ou encore Joseph fuyant en Égypte. Ce plan met en tension deux formes de masculinité : celle, résiduelle et – plus ou moins – protectrice, de Jamie, et celle, monstrueuse et ravageuse – au pénis gigantesque – de l’alpha.
Ce moment charnière clôt le premier cycle de Spike, désormais privé de toute figure paternelle stable – celui du deuil, de la transmission et du rite – et ouvre un nouveau chapitre, plus erratique, où la survie bascule dans l’absurde. Si Spike finit par fuir seul, c’est parce que l’héritage est devenu poison : survivre, ici, c’est rompre la lignée. Mais après la liturgie funéraire, le carnaval morbide ; après le sacré, le grotesque. Le surgissement de Sir Jimmy Crystal (Jack O’Connell), figure outrancière et théâtrale, déchire le voile mystique tissé jusque-là pour faire irruption dans un monde de simulacres, de fictions dégénérées et de paternités pastichées. Il est une référence à peine voilée à l’animateur britannique Jimmy Savile – autrefois figure paternelle de la télévision, incarnation d’un divertissement populaire empreint de bienveillance apparente, dont la pédocriminalité révélée après sa mort a exposé une monstruosité tapie sous le masque du spectacle. La filiation, déjà mise à mal dans le film par l’image du père dévorant, est ici détournée sur un mode grotesque. Là où Kelson, dans sa froideur clinique, préservait une forme de rituel et de dignité, Sir Jimmy incarne la déchéance spectaculaire du père : il parodie la guidance, transforme la filiation en soumission carnavalesque, insère la douleur dans un dispositif de mise en scène. Le mythe s’effondre dans la farce. Le film, jusque-là traversé par une gravité cosmique, glisse vers une démesure opératique, où l’errance n’est plus quête mais dérive. La caméra flotte encore, mais ce qu’elle capte n’est plus la lumière des braises – ce sont les éclats criards parmi les râles.

Scénario : Alex Garland / Image : Anthony Dod Mantle / Montage : Jon Harris / Musique : Young Fathers
Durée : 1h55.
Sortie française le 18 juin 2025.