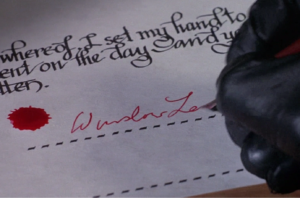La désintégration, Philippe Faucon
Ce message se désintégrera dans une heure dix-huit
À prendre, via les programmes des salles, quelques nouvelles du monde du cinéma (celui qui ressemble au nôtre sans se confondre avec lui), on y (re-)découvre que la jeunesse n’est pas le plus bel âge de la vie. On apprend en effet que le conflit israëlo-palestinien rend impossible l’amitié entre Eytan et Tak (Une bouteille à la mer), qu’Atafeh et Kathryn essaient de se soustraire à l’oppression du régime iranien (En secret), qu’au Maroc Badia tente énergiquement mais sans réussite de s’extirper de sa condition de « fille-crevette » (Sur la planche), et qu’en France, tandis que Juliette Binoche enquête sur la prostitution estudiantine (Elles), Ali se désintègre. L’alliance esthétique du cinéma et de la jeunesse, soutenue par les industries de la mode et de la cosmétique, a fait long feu. Alors, quand on découvre l’insolente gaieté de Jane Fonda [11][11] Même si Jane Fonda, du fait de sa collaboration avec l’industrie cosmétique, semble un peu suspecte. Mais admettons qu’il s’agit moins, dans son activité publicitaire, de jouer la jeunesse contre la vieillesse que de promouvoir l’image d’une vieillesse épanouie. (Et si on vivait tous ensemble ?), on s’empresse d’entrer dans une salle ; non pour oublier son âge, mais parce qu’il faut que jeunesse se passe, et que le cinéma, art du présent pour certains, art du passé pour d’autres, est avant tout un passe-temps.
En sortant de La désintégration, nous aurons au moins la satisfaction d’avoir vieilli d’une heure et dix-huit minutes. Par un archaïque réflexe de spectateur, nous pourrions même avoir mêlé à cette séance de vieillissement un peu d’activité cérébrale. Le film de Philippe Faucon invite évidemment à la réflexion. Son sujet, le basculement d’un jeune Français d’origine maghrébine (Ali – Rashid Debbouze) dans l’intégrisme religieux est, comme diraient les médias, « brûlant ». On ne se trouve pas en terrain vierge, et avant même d’avoir vu le film, des réactions sur la question sont facilement disponibles (discours social, historique, analyse du phénomène religieux, approche émotionnelle). Un tel film s’envisage donc dans son rapport à ce que l’on a vu, à ce que nous savons ou croyons savoir. Et il peut se justifier par une approche qui consiste soit à approfondir les images médiatiques et les discours qui les accompagnent, soit à en prendre le contre-pied. Face à l’information médiatique, soumise à une pression temporelle et structurelle constante, le cinéma aurait la possibilité de prendre son temps, de mettre l’information en rapport avec une subjectivité, et de nous faire ainsi accéder à une compréhension des événements. Ali pourrait être ce sujet que l’information n’a pas les moyens ou la volonté de faire apparaître.
Mais le film de Philippe Faucon n’est ni un approfondissement sociologique, ni un espace de subjectivation à vocation humaniste. Il a plutôt tendance à fermer le champ de ses personnages qu’à l’ouvrir – en les filmant de près, par exemple -, et l’émotion n’occupe qu’une place subsidiaire dans ce qui peut être considéré comme la mise en scène d’un implacable processus communicationnel. C’est ce qui justifie l’écriture programmatique du film, moins tournée vers les séquences que vers leur enchaînement. Ali passera d’un point A à un point B après avoir traversé quantité de points qui sont autant de messages. Ou, plus exactement, après avoir été traversé par ces messages. Car Ali est une figure de la vulnérabilité de l’humain aux messages qui, venant de l’extérieur, se plantent dans son mental et dans son corps, jusqu’à en faire leur objet. L’écriture du film met à jour «la communication comme processus technique, inhumain». [22][22] Serge Daney, L’exercice a été profitable, monsieur, Paris, POL, 1993, p 238. Le passage qui suit se situe dans une réflexion de Daney au sujet d’Allemagne, année zéro de Rossellini : «La communication d’une grande idée (même perverse, comme dans le cas de l’euthanasie) passe par-dessus ou à travers les individus (les « sujets »). C’est elle qui passe, c’est eux qui sont passés, dé-passés, qui deviennent ses agents. Au fond, pour Rossellini, la communication est une contamination : elle ne se fait pas avec le sujet, elle le transit en bloc, elle le fauche, le ravit, n’en laisse rien d’humain. Ce qui manque à Rossellini, c’est le minimum de croyance en l’individu qui rendrait celui-ci capable de résistance à la communication. C’est à cette restriction là que Rossellini est un cinéaste si important. Il est le premier à avoir filmé la communication comme un processus technique, inhumain. Le premier à avoir quitté le cinéma pour l’audiovisuel, lieu même de cette communication»
Ali apparaît le plus souvent en position de récepteur, d’écoute. Sa tentative émettrice vers la société française et le monde du travail se soldant par un échec, il cherchera dans les messages environnant une explication à celui-ci, et une manière d’y remédier. La place de chacun au sein de la société semble ainsi déterminée par sa capacité à émettre et à recevoir ou non certains types de messages, sans que l’on sache très bien ce qui, de la structure sociale ou des messages, vient conditionner l’autre. L’espace social est cloisonné, sorte de labyrinthe dont l’apparente ouverture au possible recouvre un profond déterminisme. Les messages sont nombreux à l’intérieur du film (“Liberté, égalité, fraternité ” / “On ne repond pas à la discrimination par la discrimination” / “Dieu est tout puissant” / “L’islam est le respect et le pardon, les violences commises en son nom le desservent” / “Les impies ne peuvent pas se mélanger avec les croyants” / “Les français n’accepteront jamais les arabes”), mais derrière ce foisonnement, il y a le fait que la situation d’Ali ne le rend réceptif qu’à un type de message.
Etre réceptif, cela veut dire entendre le message, mais aussi, après une phase d’assimilation, être entraîné, dans son corps, par celui-ci. Les messages déplacent les personnages et leur prescrivent des lieux à fréquenter ou à éviter. Un plan d’Ali, pensif, dans le métro – où son immobilité est prise dans un mouvement qui le dépasse – pourrait figurer ce rapport causal entre intégration du message et déplacement spatial. Mais c’est la reproduction mimétique des gestes et des attitudes qui atteste le plus clairement de la bonne réception : Ali reproduit les gestes de la prière, répète les paroles de Djamel, le recruteur-instructeur islamiste, et il foncera sur le siège belge de l’Otan pour commettre un attentat suicide.
Les messages tendent à s’incarner, effaçant au passage l’individualité de celui dans lequel ils s’inscrivent. Djamel est à cet égard significatif, puisqu’il s’agit à peine d’un personnage – nous ne saurons rien de son passé, il n’est pas là pour agir mais pour faire agir. Il est le simple relais du message intégriste et, s’il écoute parfois, ce n’est que pour mieux se transmettre. Yassin Azzouz, qui l’interprète, semble reproduire la même attitude de séquence en séquence. C’est qu’interpréter un message qui s’oppose au corps et à ses pulsions ne va pas sans réduction expressive. Le personnage se résume à quelques traits distinctifs (calme, voix grave et basse, regard noir), en une personnification sans corps.
D’où viennent les messages ? Celui de Djamel vient du Coran. Livre, Internet, téléphone, télévision. L’individu communicant (il faudrait dire « communiqué ») évolue au milieu de moyens de communication. D’eux, il reçoit une in-formation, et c’est par eux qu’il devient à son tour agent de communication, un maillon de la chaîne, où il ne trouve d’ailleurs que ce qu’il cherche. Nous voyons ainsi Djamel passer du journal télévisé à une image pornographique, puis à un documentaire animalier, avant de revenir à Laurence Ferrari. L’offre pléthorique de chaînes n’est qu’un moyen de refermer chacun sur le message qu’il choisit et/ou sur la manière dont il le reçoit. Un plan nous montre la mère d’Ali écoutant le journal évoquant des bombardements à Gaza. Puis nous voyons Ali sélectionnant la photo d’un enfant palestinien pour l’utiliser comme avatar sur un site de discussion. Il prendra plus tard une photo de son père sur son lit d’hôpital – cet homme à la santé ruinée par le travail devient le symbole potentiel de l’oppression exercée par la société française sur les immigrés. Cette transformation du père en symbole montre bien qu’Ali, s’il est apparemment en marge de la société française, est en pleine harmonie avec les procédés communicationnels. Après avoir trouvé la mort, il sera d’ailleurs intégré à ce ciel de la communication qu’est le journal télévisé. Le journal télévisé est une messe, il a aussi son origine divine.
Le monde de la communication ne laisse personne en dehors, les «exclus» y ont eux aussi leur place. Mais ce monde n’inclut que des agents, non des sujets. C’est peut-être ainsi qu’il faut lire le jeu qui est fait avec le titre (voir affiche et bande-annonce) sur la séparation, l’ajout ou la suppression, du préfixe (dés/intégration) : toute désintégration d’un espace, signifie l’intégration de facto à un autre espace. Il semble alors que le ressort du fonctionnement irrémédiable de cette structure soit l’absence de réel sujet au sein du film. Essentiellement récepteurs, en situation d’écoute et de reproduction, les personnages ne créent pas d’espace personnel. Le frère d’Ali dit bien à celui-ci, en vain, qu’il ne doit pas seulement écouter, mais aussi réfléchir. Résister serait s’affirmer en tant que sujet, et peut-être être attentif à ce qui en nous résiste. Dans les moments qui précèdent l’attentat, Nico vomit. Pris par le message qui lui a signifié que toute peur serait un doute envers Dieu, il affirme que ce n’est rien. La sueur recouvre le front d’Ali dans la voiture qui le mène à la mort. Les corps résistent ? C’est une hypothèse, un début.
Et, pendant ce temps-là, nous n’avons vieilli que d’une heure et dix-huit minutes.
Scénario : Eric Nebot / Photographie : Laurent Fénart / Montage : Sophie Mandonnet / Musique : Benoît Schlosberg
Durée : 1h18
Sortie : 15 février 2012