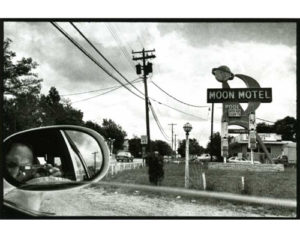La querelle des dispositifs, Raymond Bellour
Le cinéma et ses frontières poreuses
Questions retorses pour historiens et théoriciens : où commence le cinéma et où finit-il ? Avec le kinétoscope d’Edison ? Le Cinématographe Lumière ? Ou bien encore la forme achevée d’un cinéma représentationnel et narratif à partir des années 1910 ? Il est presque aussi difficile d’établir l’origine du cinéma que de décider où (et s’) il se termine, phagocyté ou évincé par des médiums plus immersifs et des technologies miniaturisées. Incidemment, la question des origines appelle aussi celle de l’épilogue, l’une et l’autre tombant sous le coup d’une troisième question, ontologique celle-là, et qui n’a cessé de tracer les frontières du cinéma. Depuis que la salle de projection, ce sanctuaire de cinéphiles, s’est trouvée menacée par l’invasion des postes de télévision dans les foyers, ces interrogations se sont cristallisées autour de positions oscillant entre deux tendances antagonistes, l’une nostalgique d’un cinéma marqué par sa nature analogique et son espace désigné, la salle de projection, l’autre partisane d’une définition élargie du cinéma sous l’égide des transformations technologiques et culturelles qui le traversent. Le débat prend néanmoins une dimension plus spéculative à mesure que les films se déclinent sur des écrans de plus en plus réduits et mobiles et sur des supports de plus en plus dématérialisés. Faut-il encore parler de cinéma quand l’expérience collective de la projection cède le pas aux consommations segmentées et individuelles d’images en mouvement ? Que reste-t-il du cinéma ?[11][11] Jacques Aumont, Que reste-t-il du cinéma ? Paris, Vrin, 2013. s’enquiert Jacques Aumont dans un ouvrage paru récemment, alors que chacun s’emploie, alarmiste ou euphorique, à en pointer la dissolution dans une déclinaison de nouvelles technologies isolant toujours plus le spectateur et requalifiant sans cesse son expérience des films ? Ne faut-il pas préférer à l’idée totalisante d’un cinéma « étendu » à toutes formes de supports, médias et lieux d’exposition, une conception plus tranchée d’un « autre cinéma »[22][22] Raymond Bellour, « Un autre cinéma », Trafic, 34, 2000, pp. 7-12. s’interroge Raymond Bellour ? Avec la publication de La Querelle des dispositifs. Cinéma – installations, expositions[33][33] Raymond Bellour, La querelle des dispositifs. Cinéma – installations, expositions, Paris, P.O.L. 2012., ce dernier réaffirme la spécificité du médium cinématographique face aux incursions de plus en plus nombreuses des images animées sur le terrain de l’art contemporain.
Si l’apparition de nouveaux supports vidéo et numérique, au même titre que le développement de nouveaux médias (la télévision, le jeu vidéo, la VOD, etc.), a pu faire redouter à certains la désertion du cinéma, une concurrence d’un autre type, plus inattendue, est venue des musées et de l’art contemporain. D’une part parce que le cinéma s’est trouvé exposé dans les premiers, au titre d’œuvre d’art sinon au seul motif d’illustration (on ne compte plus les extraits de films qui, dans une exposition, viennent baliser un parcours de visite), d’autre part parce qu’il a été investi par une nouvelle génération d’artistes nourris de références cinématographiques et plus enclins à renouveler les formats de l’art contemporain à travers ce médium qu’à travers l’image fixe ou picturale. Succédant au pessimisme d’une fin inéluctable du cinéma sous les coups de semonce de la télévision, l’enthousiasme d’une expansion de ses territoires à l’espace muséal et au champ artistique a gagné une part des historiens des médias et des théoriciens du cinéma. D’aucuns y ont vu le signe d’une bienheureuse convergence des médias, appelant la propagation d’un « modèle cinéma » dans tous les espaces désormais investis par les images en mouvement : non plus la seule salle de cinéma, mais la galerie, le théâtre, la rue et les murs de la ville. Cette thèse d’un cinéma étendu ou élargi a d’abord été formulée par l’Américain Gene Youngblood, en 1969, dans un ouvrage précurseur, et prophétique à bien des égards, Expanded Cinema, lequel donnait ainsi un nouveau champ d’application à une notion forgée par le cinéma expérimental, celui de Jonas Mekas, Paul Sharits et Kenneth Anger. S’il en détourne quelque peu le sens, Youngblood situe lui aussi cette notion aux marges d’un cinéma classique caractérisé par sa forme représentationnelle, linéaire et narrative. Alors qu’intermédialité et pratiques multimédias n’ont cessé depuis de brouiller les frontières entre les arts, il devient commode de confondre sous une même bannière l’ensemble de ces régimes d’images, dans une stimulante régénération du projet d’un « cinéma total ».
Publiés à quelques mois d’intervalle, les ouvrages de Jacques Aumont et Raymond Bellour entendent mettre un coup d’arrêt à un tel syncrétisme. Le premier, avec un bref opuscule[44][44] Jacques Aumont, op. cit., résume avec force et clarté des arguments développés ailleurs[55][55] Jacques Aumont, « Que reste-t-il du cinéma », Trafic n°79, 2011, pp. 95-106. pour défendre une conception du cinéma comme le seul « dispositif dans lequel on regarde ce qu’on voit »[66][66] Ibidem, p. 102. . Dans La querelle des dispositifs, le second s’attache plus spécifiquement aux rapports entre cinéma et art contemporain, le long de frontières poreuses parcourues sans relâche dans les deux tomes de L’Entre-images[77][77] Raymond Bellour, L’entre-images 1. Photo, cinéma, vidéo, Paris, La Différence, 1990, et L’entre-images 2. Mots, images, Paris, P.O.L. 1999.. Le ton pamphlétaire qu’adopte la première partie de l’ouvrage dans sa défense d’un dispositif inaliénable du cinéma pourrait, de prime abord, apparaître en contradiction avec l’entreprise qu’a jusqu’ici menée Raymond Bellour. Pionnier parmi les explorateurs de ces nouvelles formes filmiques hybrides, art vidéo, cinéma exposé et films d’installation, il s’est en effet intéressé depuis presque trente ans aux « passages de l’image » ainsi que le formulait l’intitulé de l’exposition qu’il consacra à ces régimes migratoires des images en mouvement. En ouvrant cette querelle par une défense du cinéma dans son dispositif singulier et spécifique, Bellour ne revient pourtant pas sur la proposition de l’« entre-images », il la précise. Si toutes les images, de l’art vidéo au jeu vidéo, valent qu’on s’y intéresse et qu’on en décèle la dimension transmédiale, il importe cependant de ne pas les confondre dans un même creuset théorique. Car si le cinéma n’a cessé pour Bellour de renouveler ses formes esthétiques et narratives et de créer des voies de passages avec d’autres médiums, son dispositif demeure inchangé à travers son histoire. « La projection vécue d’un film en salle, dans le noir, le temps prescrit d’une séance plus ou moins collective, est devenue et reste la condition d’une expérience unique de perception et de mémoire, définissant son spectateur et que toute situation autre de vision altère plus ou moins. Et cela seul vaut d’être appelé “cinéma” »[88][88] Raymond Bellour, La querelle des dispositifs. op. cit. p. 14. écrit-il dès l’entame de cette première partie.
Cette définition sans appel a l’avantage de clarifier la position de Bellour dans un débat qui, loin d’un concile œcuménique, revient peu ou prou à reformuler la question ontologique que posait Bazin dans Qu’est-ce que le cinéma ?. Il n’est pas anodin que celle-ci se trouve examinée dans les termes d’une nouvelle théorie du dispositif : cette notion d’abord alléguée par Baudry dans les années 1970, en dépit de son inscription dans un paradigme épistémologique propre aux années 1960 – et notamment la thèse althusserienne des « appareils idéologiques d’Etat » –, posait les fondations d’une configuration sensible entre un agencement technique et le statut du spectateur. Cette théorie critique de Baudry doit autant à la sociologie de Bourdieu qu’à la psychanalyse lacanienne, mais elle a l’heur d’intégrer à une pensée du spectateur la dimension technologique du dispositif cinématographique. Avec l’apport de Foucault puis de Deleuze[99][99] Gilles Deleuze, « Qu’est-ce qu’un dispositif ? », in Michel Foucault philosophe. Rencontre internationale, Paris, 9, 10, 11 janvier 1988, Paris, Seuil, 1989, pp. 185-195., le dispositif ne se confond plus avec une superstructure psychologique mais devient « un ensemble multilinéaire »[1010][1010] Ibidem, p. 185. instable et mouvant, traversé de « lignes de force » (pouvoir) et de « lignes de fracture »[1111][1111] Ibid, p. 186 et 187. (subjectivité). Dans les termes de Deleuze, les dispositifs foucaldiens sont donc des « machines à faire voir et à faire parler »[1212][1212] Ibid, p. 186., autrement dit des machines optiques et des agencements discursifs. Le dispositif se conçoit dorénavant comme expérience singulière et subjectivante (Foucault) et comme pensée (Deleuze) et engage à rejeter les jeux d’équivalence (comme l’allégorie de la caverne platonicienne qui fondait l’analogie de la thèse de Baudry) aussi bien que les couples d’opposition (réalité versus image).
Le point de départ de la réflexion de Bellour se situe néanmoins plutôt dans la proposition de Daney, « Le cinéma seul », à travers laquelle celui-ci semblait poursuivre une conversation entamée avec Godard dans l’une de ses Histoire(s) du cinéma, « Seul le cinéma ». Non qu’il s’agisse de fonder sur cette solitude une quelconque pureté du médium, mais de révéler au contraire « le sens de la singularité des expériences, en deçà et au-delà de leurs mélanges » écrit Bellour[1313][1313] Raymond Bellour, La querelle des dispositifs. op. cit. p. 20.. Sous sa plume, cette pensée du dispositif s’éclaire des apports des neuro-sciences et de l’hypnose. Si la notion d’idéologie ne fait plus partie du lexique d’une telle théorie, elle a cédé sa place à une réflexion autour du dispositif comme expérience, fondée sur l’interaction entre le corps du spectateur et celui des images, si bien qu’une théorie matérialiste du cinéma serait aujourd’hui non plus une critique des moyens techniques du cinéma en vertu de leur supposée indexation à une logique idéologique de représentation, mais une théorie du sensible, fondant la pensée du cinéma sur l’interaction de la projection des images et de l’expérience de mémoire et d’oubli du spectateur.
Qu’est-ce alors qu’un dispositif de cinéma ? Un agencement technique et une pratique culturelle ? Une forme artistique et une industrie ? Un rituel social autour d’un espace dédié ? Une forme sédimentée de récit empruntant aux arts visuels aussi bien qu’aux arts littéraires ? Sans doute un peu tout ça à la fois, le cinéma se qualifiant à la fois comme topos (la salle), tekne (le mécanisme d’enregistrement et de projection d’images en mouvement) et épistémè (le contexte institutionnel et socio-culturel dans lequel il émerge). Mais ce qui qualifie spécifiquement le dispositif du cinéma pour Raymond Bellour, c’est l’expérience du spectateur « et son inscription sur l’écran de la mémoire »[1414][1414] Raymond Bellour, « Le spectateur de cinéma : une mémoire unique », Trafic, 79, automne 2011, p. 37. qui qualifie ce qu’il a pu définir ailleurs comme une « hypnose-cinéma »[1515][1515] Raymond Bellour, Le corps du cinéma. Hypnose, émotions, animalités, Paris, éditions POL, 2009.. À partir d’une définition du dispositif comme machine d’hypnose et comme expérience, il devient possible de penser le cinéma en dehors d’une théorie de la représentation – sans qu’il y ait là pour l’auteur matière à fonder une phénoménologie de la perception – et d’interroger la circulation des images d’un dispositif à l’autre. Ce sont ces voies transversales qu’explore à nouveau Bellour entre image animée et image arrêtée, texte et image, et toute la gamme d’émotions d’un spectateur face à des œuvres de cinéma et des œuvres d’installation. En aucune façon ces pages ne nient le déploiement des films dans des dispositifs autres que celui de la salle, elles en actent au contraire la formidable inventivité, comme dans le cas d’Agnès Varda à laquelle Bellour consacre de très belles analyses. Selon la cinéaste, le dispositif de l’installation lui a donné « la permission de ne pas raconter une histoire »[1616][1616] Raymond Bellour, La querelle des dispositifs. op. cit. p. 401., et cette liberté prise par rapport à la linéarité du récit se manifeste dans l’éclatement spatio-temporel des voix et des histoires singulières des Veuves de Noirmoutier. L’installation se prête mieux à la forme essayiste des récits enchevêtrés que Varda a recueillis et qu’elle donne à voir et à entendre à travers quatorze petits écrans vidéo, tandis qu’est projeté un film en 35mm sur un écran central.
À la lecture des chapitres que l’auteur consacre aux dispositifs qu’inventent cinéastes et artistes dans leur mise en espace d’images mouvantes, on comprendra que le préalable théorique des frontières du cinéma esquissé en ouverture de La Querelle n’avait pour but que d’en révéler ensuite les porosités et les voies de passages. De la salle de projection à la galerie, il y aurait ainsi deux corps – Bellour suggère d’emprunter à Elie During l’idée d’un visiteur « somnambule »[1717][1717] Raymond Bellour, La querelle des dispositifs. op. cit. p. 58. en regard de l’hypnose qui qualifie, elle, plus exactement le spectateur de cinéma – répondant à un déplacement de l’expérience du film : celle-ci ne se confondant plus avec la durée de la projection et son voyage temporel, mais avec la spatialité de l’installation et la disposition des images invitant à la mobilité du visiteur dans l’espace. Signalant les polarités plutôt que les convergences, La Querelle des dispositifs retrouve néanmoins le projet de L’Entre-images puisque l’enjeu y est toujours de sonder les métamorphoses du corps des films qu’inventent les œuvres hybrides de James Coleman ou Chantal Akerman, Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi ou Michael Snow, Douglas Gordon ou Thierry Kuntzel, et qui se traduisent chaque fois en expériences singulières dont Bellour éprouve la variété à travers des analyses qui sont autant de témoignages de ses propres émotions de spectateur.