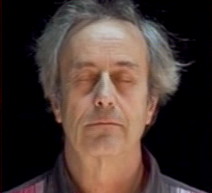Jean-Charles Hue
Portrait d’un Héros-Cinéaste
Dès la sortie de La BM du Seigneur en 2011, la figure de cinéaste de Jean-Charles Hue s’est distinguée comme une promesse rare de romanesque. On découvrait une œuvre, entamée au début des années 2000, d’une poignée de courts métrages et d’installations vidéo (L’œil de Fred), poétiques et documentaires, fruits de voyages au sein de communautés gitanes ou mexicaines et producteurs de visions où objets et personnages se font l’expression d’un sentiment de réalité autre au monde (citons Sunny Boy, Quoi de neuf docteur ?, Un Ange ou Y’a plus d’os). Mais aussi un cheminement artistique du stylisme à la photographie, jusqu’à un recueil de textes (Y’a pas de prévenance, Aux forges de Vulcain, 2012), essai langagier ressaisissant l’ensemble de cette production d’images. Alors que son premier, Carne Viva, n’a pas connu de distribution en salles, son troisième long métrage, Mange tes morts, a fait l’événement au dernier Festival de Cannes où il était présenté à la Quinzaine des Réalisateurs.
Attablé dans un café de la Croisette particulièrement bruyant à l’heure de pointe, et malgré une journée au pas de course, Jean-Charles Hue ne perdra de vue à aucun moment l’horizon mystique et la prédilection mythologique qui font la quête d’héroïsme par laquelle se définit son cinéma. À la question inaugurale « Qu’est-ce qui vous paraît si cinégénique dans cette communauté yéniche ? Qu’est-ce que vous y trouvez de particulier en termes de cinéma ? », il délivre dans un souffle une morale de cinéaste qui ne trouve que peu d’équivalents aujourd’hui.
Jean-Charles Hue : En réalité, je n’ai pas commencé par la dimension cinégénique. Ce qui est toujours premier pour moi, c’est le désir d’avoir une vie autre, de me transformer moi-même. Cela vient, de manière sans doute assez commune, du rejet de tout ce qui nous fait incliner vers la répétition, nous met dans des vies « en boîte », même si on y revient toujours.
Une de mes passions, que je tiens de ma famille, a toujours été l’histoire, de l’anthropologie à l’archéologie. Tout jeune enfant, j’ai été élevé quelques temps par mes grands-parents, et mon grand-père qui était maçon mais a été soldat-éclaireur pendant la Seconde Guerre Mondiale, a fait figure de première mythologie. Il conservait beaucoup d’objets de sa période militaire, contait toutes sortes d’histoires inscrites dans la culture populaire, le tout au milieu de grands meubles en bois qu’il sculptait, dans une maison qu’il avait bâtie de ses propres mains. Il y avait quelque chose d’enveloppant culturellement, l’enfant que j’étais s’y sentait très bien et cela a constitué le terreau à partir duquel je me suis construit. Après, j’ai été ramené, à juste titre, à une vie plus réglée avec l’école, mais c’est comme si j’avais eu une vie avant qui n’avait rien à voir avec celle qui s’imposait à moi. Je me traînais dans cette nouvelle vie qui ne pouvait pas être la mienne.
Ce qui m’a sauvé, c’est le dessin. Je me suis, en premier, passionné pour les peintres, comme Brueghel, Jérôme Bosch mais aussi Gauguin, tournés vers la croyance, l’artisanat, le peuple, le mystique. Quelque chose qui a à voir avec l’idée que l’on se fait du Moyen-Âge, aussi : des gueules cassées, un peuple qui s’étourdit de fatigue, de travail et de boisson, et le monde au-dessus de la tête. Des sentiments qui me venaient de mon enfance avec mes grands-parents, puisque j’entretenais une véritable mystique à l’égard de mon grand-père, mort durant les courtes années où j’ai vécu dans cette grande maison familiale. Cela passait beaucoup par les objets à travers lesquels il me semblait communiquer encore avec lui. Après, ça a été le réel, ou une autre forme de réalité en tout cas, difficile. Je n’accrochais pas aux jeux des autres, ni à leur façon de communiquer entre eux, toujours dans la vanne et l’ironie – je ne comprenais pas. À l’adolescence, j’ai eu un grand désir de revanche. J’étais très marqué par les figures de moines-chevaliers dans lesquelles je reconnaissais mon grand-père, entre idéal moral et force guerrière. En même temps, j’étais travaillé par les questions de l’ordre de la croyance : je n’ai jamais aimé les églises mais j’ai toujours eu un rapport à Dieu, à la Vierge Marie et à Sainte-Thérèse, surtout, dont la figurine faisait partie du trésor de guerre de mon grand-père.
À vingt ans, je me suis aperçu que presque tous les artistes que j’aimais avaient renoncé à la vie dont ils venaient et s’étaient réinventés. Les modèles étaient aussi bien Lawrence d’Arabie, à travers ses écrits, Gauguin, Jean Genet, Rimbaud ou, dans une certaine mesure, Céline. J’étais poussé par eux mais c’est plus tardivement que j’ai compris : tu n’es pas content de toi, alors invente-toi ! À partir de l’image de mon grand-père, je me suis fait ma guerre, je suis allé au front. Je n’aurais pas été soldat, je n’aurais pas fait la « preuve absolue ». Mais, chez les Gitans, j’ai retrouvé cet idéal. Très vite, j’ai été confronté à des situations de violence où, pour tenir, il faut être un combattant. J’ai été tout de suite dans une forme de croyance, quelque chose de très naturel, bien séparé de la vie quotidienne, à la différence de la religion catholique. Je me place dans le croisement précis où défendre une croyance fait toucher au miracle. Un peu comme l’image, tirée de mes lectures d’enfant, de ce chevalier dont la poitrine est perforée lors d’un combat, à Jérusalem, pendant les Croisades, et qui continue à marcher au grand dam de ses soldats, avant de finalement leur avouer qu’il est déjà mort.
Voilà ce que j’ai retrouvé dans la communauté des gens du voyage dont certaines aventures m’ont inspiré Mange tes morts. La poursuite par les motards, c’est une nuit que j’ai vraiment vécue il y a une dizaine d’années avec Fred [Dorkel]. Après avoir essuyé plusieurs coups de fusil de chasse, le pare-brise derrière moi est tombé – par je-ne-sais-quel miracle les plombs m’ont épargné… Je me souviens de Pierrot [l’oncle de Fred, à qui est dédié le film] qui me regarde avec un sourire énorme – j’étais un miraculé. Une heure ou deux après, tout le monde se couche de nouveau sous les balles qui fusent et on monte jusqu’à 250-300km/h sur une départementale, avec le risque de se prendre un arbre à la première sortie de route. Je vois alors Fred avec son puchka artisanal en contre-plongée, au-dessus de lui, le ciel étoilé et la lune à travers le pare-brise, et moi avec plein de bris de verre dans ma chemise qui se reflétaient sur le sol noir, sur le cuir des sièges. J’ai eu la sensation étrange d’être entre deux ciels et, comme le vent qui soufflait à l’intérieur de la bagnole la faisait valdinguer, j’ai cru flotter. On était entre la vie et la mort. Soit on percutait, soit on se prenait une balle, et il y avait un silence, suspendu. Tu n’es plus dans le réel mais déjà ailleurs. On s’est regardés avec Fred et on ressentait la même chose. Après, on s’en est tirés, on a trouvé les yeux de verre dans le coffre, mais c’est comme si on avait vu les esprits, qu’on était passés de l’autre côté mais qu’on était revenus. C’est la même chose dans mon court métrage Y’a plus d’os, quand le héros est ivre et qu’il tire vers la caméra, il y a une lumière : c’est comme s’il avait vu sa lumière, mais il n’en meurt pas pour autant. C’est se situer au croisement entre un endroit où on peut perdre la vie, où le spirituel est là de fait, sans qu’on ait à le provoquer.
Ce sentiment, j’ai l’impression de l’avoir eu à un moment dans ma vie puis de l’avoir perdu. Tout ça parce qu’on m’a mis sur les traces de mon grand-père. Pour ma grand-mère, je tenais vraiment de la réincarnation, jusqu’à en inquiéter ma mère qui a envoyé mon parrain me tirer de tout ça à la fin d’un été. Je n’ai pourtant jamais vécu ça comme un fardeau. Ce qui est difficile, en revanche, c’est une exigence, toujours renouvelée, le sentiment de ne pas être content de soi – parfois j’en oublie même tout ce que j’ai accompli, et c’est comme s’il fallait se re-sauver. Je navigue ainsi entre des écarts très grands. Voilà ce que je suis allé chercher auprès des Gitans et je pense qu’on peut utiliser ce mot : de l’héroïsme, parce que c’est ainsi que se fonde une foi. Sans cela, on ne peut être héroïque. Il faut quelque chose qui te dépasse. Je suis très touché par les personnages messianiques : il faut aller voir et rapporter la parole, comme Moïse avec le Buisson ardent. Mais cela ne concerne pas que les soldats, on pourrait l’étendre à Martin Luther King, Mohammed Ali, Yehudi Menuhin – des gens qui ont été touchés par quelque chose qui les dépasse et deviennent intouchables. Je recherche des gens comme ça, ou qui s’en rapprochent, avec, bien sûr, ce risque de se confronter à une grande violence.
En termes de cinéma, je dirais que j’ai cherché à me rapprocher de ce que j’appellerais les cinéastes de l’épiphanie : Pasolini avec Accattone, mais surtout John Ford avec La Prisonnière du désert. La colère du héros qui se retourne contre les Indiens puis le réel, avec des portes, des embrasures où pourrait apparaître, fantomatique, le grand-père – voilà ce que m’évoque le film, un sentiment de réalité qui me renvoie à mon enfance, où tout n’est pas toujours au même degré. Dans Mange tes morts, pour moi, cela correspond à l’arrivée de Fred dans la lumière. Chez Ford, c’est par l’ombre, sur les tombes, que l’Indien arrive – cela a donné un très beau texte de Patrice Rollet[11][11] “La ligne d’ombre”, dans Passages à vide. Ellipses, éclipses, exils du cinéma, P.O.L., Paris, 2002.. Le monde des ombres s’impose et délivre une autre dimension. En un faux raccord de lumière, miraculeusement, Fred est transposé cinquante mètres plus loin que lorsqu’il apparaît à Jason qui est aveuglé. Il y a de quoi douter. Dans Mange tes morts, je suis dans la position de Jason, j’attends le mythe qui va tout te donner, tout changer – tout peut lui arriver s’il monte dans la bagnole de son frère. Quand une telle chose apparaît, il faut y aller, monter dans le bateau, on n’a plus trop le choix. C’est comme Ulysse face aux Cyclopes ou aux Sirènes. Il faut faire ses preuves ; on a besoin de vérifier que l’on est digne de courage. En ce qui me concerne, ma seule preuve de courage est d’être resté quand cela tirait, quand le danger était au plus fort. Ce n’est pas moi qui donne le coup d’épée mais mon épée, c’est ma caméra. J’ai toujours été embêté, d’ailleurs, pour comprendre quelle était ma place dans une telle situation : soit je porte l’épée, et j’en ai envie ; soit je donne à voir. Ce que j’admire, c’est celui qui tient l’épée – je n’ai jamais rêvé d’être réalisateur. Je le suis devenu parce que l’aventure que j’allais mener pour faire ce film m’obligeait à fréquenter celui qui tient l’épée et à m’en approcher tellement près que, dans une certaine mesure, je pourrais me dire : ne l’ai-je pas tenue ? Le cinéma, dans ses problèmes de cinéma, ne s’impose à moi que dans un second temps.
Débordements : Il y a par exemple un travail remarquable sur la lumière.
JCH : Il faut toujours un point de lumière dans le plan. Ce sont les bouffeurs de patates de Van Gogh – Dieu est là. Notre sort est de bouffer des patates. Ce qui est beau, c’est un Jean Genet qui reconnaît dans un gueux une étincelle telle qu’il s’en trouve métamorphosé. C’est le pouvoir des mystiques. Sa tâche d’écrivain et de poète est de rendre cette illumination. La seule chose qu’il reste au bouffeur de patates consiste à s’approcher un tout petit peu de ça. Oui, il y a un peu de lumière mais c’est tout. Pour rendre cela, il faut participer un peu de cette grâce. Mais ceux qui sont touchés l’ignorent ; il faut venir comme un enfant, comme dans la Bible. La difficulté, c’est d’être conscient de cette beauté et croire que l’on sait – pour moi, c’est la destinée de l’homme blanc, de croire détenir un savoir, de croire tout savoir. C’est le problème des études, comment rattraper cet état d’enfance ? Le seul moyen, c’est de se mettre dans de telles situations que tu en perdes les peaux – là, on approche d’une lumière. C’est la difficulté de l’époque mais cela se posait aussi à Pasolini : il disait qu’à cinq ans près, il n’aurait pas pu tourner Accatone, cela avait déjà changé. Alors, bien sûr, cela se déplace. Aujourd’hui, il n’y a pas un gamin à Los Angeles qui ne sache que faire un film à Hollywood rapporte de l’argent – c’est mort comme vision. Ils n’y vont plus sur le seul pari d’une croyance. Les gens que je cherche sont, par exemple, à Tijuana : ce sont les « dames blanches », entre clochardisation et sainteté, qui se maquillent exagérément en blanc avec des touches bleu pâle, comme des Vierges. Parfois elles marchent même toutes nues. Ce qui est laid devient beau. Elles sont à un endroit mais elles sont ailleurs, elles sont entre deux mondes.
D : Ces gens ont trouvé la brèche.
JCH : Exactement, et moi je les cherche. Je ne rencontre que des gens qui l’ont trouvée parce que moi, ce n’est pas mon cas. Si je l’avais trouvée, je ne serais pas dans cette position-là. On trouve selon le pays, la culture, la religion desquels on vient. Je garderai sûrement cette posture d’entre-deux toute ma vie. Ma tâche consistera à reconnaître ces situations et, de temps en temps, y aller et revenir pour en faire éventuellement un film. Mais parfois, j’ai vraiment envie de me radicaliser à mort… !
D : Vos acteurs sont impressionnants de ce point de vue, même dans le contexte de Cannes, leur présence est saisissante de force apaisée. Ce sont de vraies apparitions.
JCH : Moïse porte bien son nom, par exemple, il se laisse porter. Fred, avec qui j’ai fait six films, a conscience que c’est autant son film que le mien, il relance les autres et la direction d’acteurs devient avec lui comme un sport d’équipe. C’est mon alter ego. Les autres, ou parce qu’ils veulent jouer leur mythologie, ou parfois par curiosité, ils y vont. Mais il n’y a pas de calcul d’acteurs. S’il y a mieux à faire, ils pivotent. C’est le cas de Mikhaël : il allait toujours au bout des scènes mais s’il y a une bière à terminer, une jolie fille qui passe, il s’en va. S’il avait rendez-vous avec Coppola, il serait à la bourre. C’est déconcertant, en réalité, il est à vingt-un ans ce que ne sont même pas des enfants de quatre ans à Los Angeles.
D : Comment se passait le travail ?
JCH : Il y avait un scénario dialogué, je leur lisais leur texte, leur expliquais scène après scène. Mikhaël avait, par exemple, besoin de réentendre plusieurs fois les dialogues ; pour Fred, une fois suffisait. Au bout de quatre, cinq prises, on tenait la scène. Ce qui peut impressionner, c’est qu’ils parvenaient à se placer eux-mêmes dans le cadre, ils trouvaient la logique tout seuls en suivant les courbes. Ils trouvaient les mots eux-mêmes – Mikhaël pouvait être presque laborieux au début puis, à la quatrième prise, il avait la fulgurance. Pour dire « le cul de ma négresse », il passait par tout un cheminement incroyable, avant de retrouver ses propres mots. C’est à mettre dans le bonus du DVD, il y a un comique incroyable là-dedans.
D : Pour en arriver à cet état de création, quel a été votre propre cheminement ?
JCH : Il a été long ! Je me suis perdu à croire que tout était dans le scénario – cela concerne deux années et demi. On ne m’y reprendra plus, mais ce fut une expérience. Le tournage est une folie avec eux, il faut voir tout ce qui s’y passe : les épouses qui font obstruction, des attaques de l’extérieur, que ce soit les flics, des bagarres, et même entre eux. Il a été question que je vive avec eux, c’était en projet mais j’y passe depuis toujours des périodes, d’une semaine, un mois, l’été entier… Ce sont des grandes plages de bonheur avec cette idée que, toujours, à un moment, cela va exploser. Il y a toujours de l’angoisse. Maintenant, il me faut faire de la fiction pour retransmettre ces émotions.
D : Quels sont vos projets ?
JCH : J’ai un projet de série avec eux. Je veux clore ce travail en un triptyque. J’adore ce qu’a fait Coppola avec Le Parrain, retrouver ses acteurs sur plusieurs années, c’est un idéal de cinéma. Mais j’ai aussi un projet avec les Stévenin, père et fils. C’est un croisement entre des souvenirs de famille de mon Oncle Raymond par qui je me suis découvert une descendance yéniche, Passe-Montagne et des événements historiques autour du cabinet érotique de Catherine de Russie. Et puis, je reste très hanté par les « dames blanches » de Tijuana.
Images, extraites des films de Jean-Charles Hue : La BM du Seigneur (2011) / Y'a plus d'os (2006) / Mange tes morts (2014).