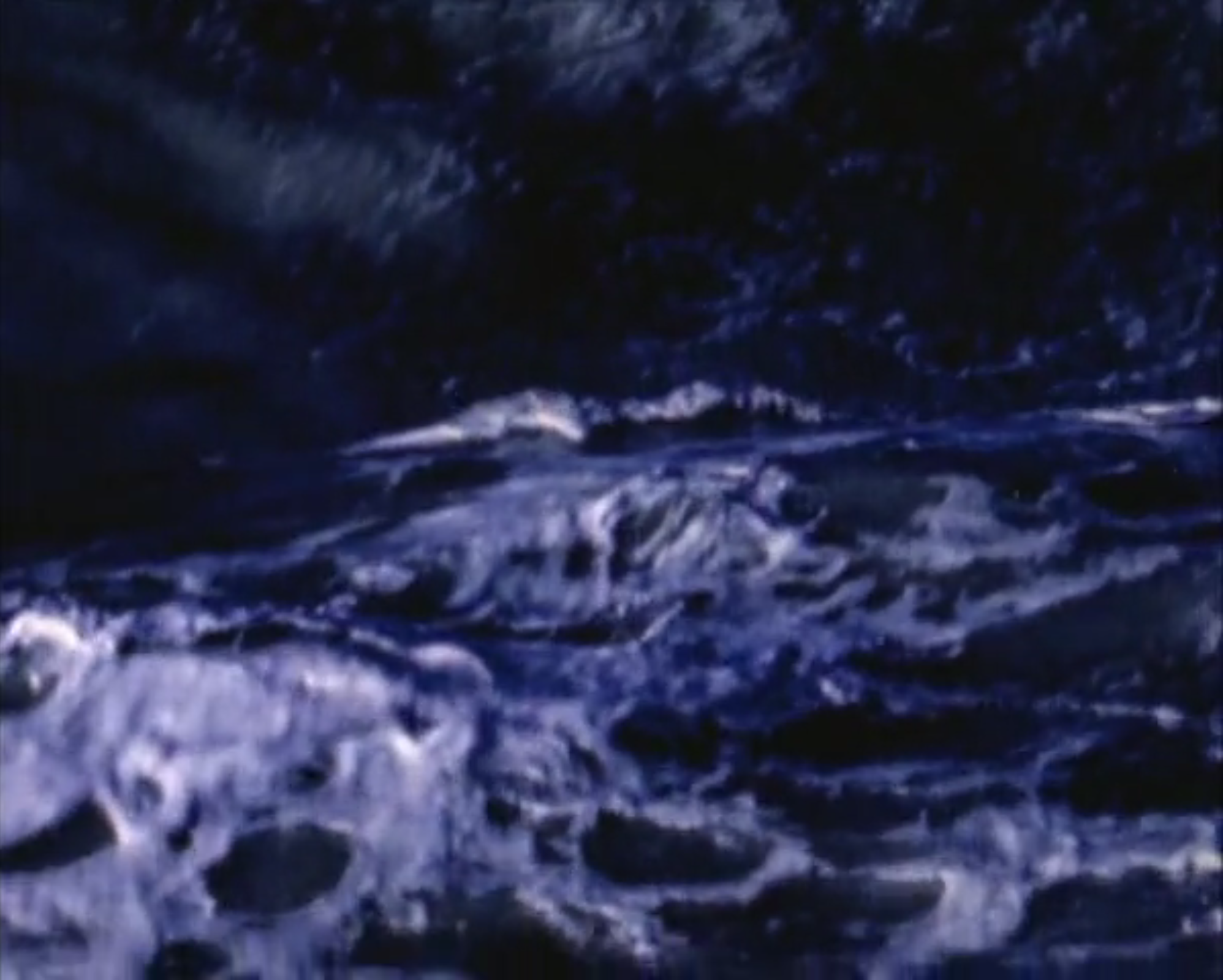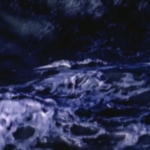Brûle la mer, Nathalie Nambot et Maki Berchache
Commune mer
Le titre du film s’affiche en double, en français et en arabe, pour faire coexister dès le générique de début deux destinations aux hospitalités pourtant bien divergentes. Ce serait d’ailleurs une façon de définir le sujet de Brûle la mer : l’hospitalité. La lecture ici proposée souligne la manière dont le film, tout en se concentrant sur les paroles et les trajets de quelques harraga, qui ont « brûlé les frontières » en franchissant La Méditerranée, contribue à définir un commun filmique.
Dès son ouverture, Brûle la mer expose à un état hypnagogique propice au mélange des perceptions et convoque à la fois l’apaisé et le volcanique. Le premier plan ne montre pas encore la mer houleuse, mais un jeune homme qui s’endort. Le cadre se resserre au niveau des épaules pour le présenter allongé de trois-quarts gauche. L’image n’est pas fixe, elle tangue, mais l’apparition de ce rêve de sommeil s’ancre bien à l’esprit pour tout le reste du film. Le regard et le sourire accueillant de cet homme sont les premiers gestes du film ; mais il se rendort, dans une position qui suggère toutefois qu’il ne dort pas sur ses deux oreilles. Un souffle puissant se fait entendre, cependant, dès l’apparition du titre du film.
Les craquements et l’égouttage peuvent d’abord faire penser que l’homme se trouve dans une embarcation, puis un bêlement semble le réveiller. En tout cas, le bruit de l’animal invisible concorde avec le retournement du personnage vers l’axe de la caméra. Le premier plan est ainsi hanté par deux sensations : celui d’un soulèvement (le souffle marin) et celui d’un attachement à la terre avec ces premières ponctuations sonores ovines… Le bruit animal revient plusieurs fois en ce début de film, notamment lorsque la voix off évoque l’insurrection du peuple tunisien et mentionne la ville de Zarzis, au Sud de la Tunisie. L’hypothèse se confirme : ces bêlements, sur fond de mer déchainée, renvoient au souvenir de la terre. Ils reviendront plus tard, lorsque Maki Berchache accompagne des plans du « bled », plus particulièrement de la maison à la construction de laquelle il a participé et où vivent ses proches, alors que sa parole est visiblement enregistrée en France, notamment parmi les immeubles d’une cité de Bagnolet.
Un pluriel
Dans Brûle la mer, les personnes, comme les lieux, sont à considérer au pluriel, voire dans leur division : le pluriel des harraga, pour commencer, « ceux qui brûlent » les frontières qui séparent les peuples entre territoires. Le film observe cette séparation en choisissant une certaine transversalité, entre la France et la Tunisie. Une voix identifiée, celle de Maki, se détache du collectif sans jamais opter pour le « nous » ou tracer une quelconque enclosure, sur un fond de mer agitée ou d’immeubles figés : « l’histoire, elle est déjà là bien avant que je parte, elle est là tous les jours ». Un homme, qui confesse regarder la mer tous les jours au point de se demander comment vivre dans une ville où elle est absente – Paris, par exemple -, lit un extrait du poème « Etat de Siège », écrit par le Palestinien Mahmoud Darwich lors de sa réclusion à Ramallah en 2002 :
« Ici, sur les pentes des collines, face au couchant
Et à la béance du temps,
Près des vergers à l’ombre coupée,
Tels les prisonniers,
Tels les chômeurs,
Nous cultivons l’espoir. »
Ici énoncé au bord du Canal de l’Ourcq, le poème de Darwich se prête aux déplacements géographiques et à l’évocation de la mer Méditerranée (avec l’espoir, les idées de départs qu’elle apporte) et s’offre à d’autres usages possibles, à mesure que le film tisse un lien politique, toujours plus explicite, entre plusieurs territoires arabes.
Un peu plus loin, en France, c’est justement la pente d’une colline qui permet de prendre un peu de recul sur la ville et de regarder autrement la cité. La mer n’est certes pas présente, mais « on a l’impression d’être ailleurs. Tu vois la terre, le ciel, ces petites maisons… ». Maki a ici une conversation avec un ami palestinien, Shadi Al Fawaghra. Ils ne viennent pas du même pays, cette amitié n’est d’aucun réflexe identitaire. Ils n’ont pas traversé la mer pour les mêmes raisons. Il y a mille raisons de le faire, mille invocations de ces raisons – entre oppression politique et désir de mobilité.
La mer, c’est aussi celle du petit port de pêche à proximité duquel vit la famille de Maki, au Sud de la Tunisie. Les images en super 8 qui prennent l’empreinte de ces lieux ont la matière d’archives familiales. Ces plans n’ont pas seulement la tonalité nostalgique de la terre natale, puisqu’elles sont déjà habitées par le départ. « L’ordre de partir m’a réveillé » : quelques mots issus d’Otages, le recueil du poète Salah Faik, résonnent aussi sur ces images tunisiennes.
De l’hospitalité
Les parcours de Maki Berchache et de Saidi Shaharedi, parmi d’autres « Tunisiens de Lampedusa », forment les premières trajectoires du film et décrivent un monde divisé à partir d’un critère : l’accueil des étrangers. Si la réflexion sur l’hospitalité élève le film à sa dimension politique, elle n’esquisse jamais une proposition convenue motivée par l’utopie d’une communauté humaine homogène, par exemple. C’est au contraire, en filmant la division, la pluralité, que Brûle la mer mène à l’idée de commun. « Commun parce que divisé », semble nous dire le film, évoquant ainsi l’essai de Sophie-Anne Bisiaux autour du concept de xénopolitique et d’une pensée de l’accueil, qui cherche à déterminer « comment le xénos du politique permet de déployer une cosmo-politique en participant à l’éclosion d’un monde commun. »
Une pensée d’une politique du commun passe ici par celle du commun filmique. Nathalie Nambot est notamment une des participantes du collectif Boris Barnet, qui a récemment terminé et projeté Salaud d’Argent (Que ma langue s’attache à mon palais). Ce film particulièrement marquant a été réalisé avec la Coordination des Intermittents et Précaires et propose une expérience filmique rare à partir d’un extrait de Si je t’oublie Jérusalem, en retravaillant, pour mieux la remobiliser, la structure en alternance et « divisée » du texte de Faulkner afin de filmer la destruction d’un lieu (le local de la CIP, quai de Charente à Paris) et les mots de la passion amoureuse aux prises avec la vie matérielle. Le local de la CIP est précisément un des premiers lieux à avoir accueilli Maki et ses amis, comme le rappellent quelques photographies qui passent entre les mains de Nathalie Nambot et de Maki Berchache dans Brûle la mer. La fabrication de Salaud d’argent repose sur un travail commun et des recherches sur une durée de 8 ans.
Depuis début 2011 (la chute de Ben Ali), en passant par mai 2011 (l’expulsion de Tunisiens de Lampedusa de leur local rue Bolivar) jusqu’en 2014 (la projection du film en festival, notamment au FID) et novembre 2016 (la distribution en salles), la temporalité de Brûle la mer n’est pas celle de la précipitation ou de l’événement d’actualité. Les images peuvent d’ailleurs parfois sembler éminemment inactuelles. Pour autant, l’hypothèse d’un retour nostalgique à la pellicule ne semble pas tenir la route. Pourquoi employer la pellicule ? Pourquoi ne pas ? En effet, l’espace et le temps du commun est aussi celui d’un laboratoire, L’Abominable, où Nicolas Rey et Nathalie Nambot savent partager et accueillir. Un des premiers sens de l’hospitalité filmique serait celui-ci, au sens d’accompagner dans la réalisation d’un film. Nathalie Nambot apparaît dans le champ, en train d’enregistrer la parole de Maki comme l’homme qui lit un poème de Darwich, avec qui elle échange d’ailleurs quelques mots. Brûle la mer est bien signé à deux, mais cherche le commun. La chose pourrait être formulée ainsi : le commun de la pellicule brûle la signature privée, pour donner sens à une ouverture, à un accueil. Le film s’intéresse beaucoup à la mer commune. Est-ce que le rôle de cette commune mer trouverait un prolongement dans l’attitude de la cinéaste, comme une mère ? Derrière cette fausse piste qui a la forme d’un jeu de langage un peu trop facile, se cache tout de même un appel à l’affection et à la tendresse. Un des premiers plans filmés en Tunisie montre la petite maison de la famille de Maki, à la porte et au toit ouverts. Quand Maki raconte son arrivée en France, il évoque les portes qui se ferment et les téléphones qui ne répondent plus.
Infatigables
Le départ qui mène à Paris, en passant par L’Italie, (Lampedusa, puis Vintimille), fait suite à un élan révolutionnaire. Le soulèvement est susceptible d’être pris dans le bouillonnement de la houle, enseveli sous les vagues et l’écume. Mais c’est peut-être d’abord la remontée d’un fond populaire commun que traduisent les images de la mer qui menace de déborder bruyamment. Les premiers mots de Maki arrivent ainsi après 1 minute 30 de film, sa voix commence avec calme : « C’est comme un volcan (…) qui brûle à l’intérieur. Qui n’a pas encore explosé. La révolution, c’est comme si on n’avait pas parlé depuis 23 ans, et qu’on se mettait tous à parler en même temps ». Des cinéastes et des plasticiens ont pu, ces dernières années, investir la tempête de pixels pour filmer la mer agitée. Brûle la mer choisit plutôt de faire remonter le grain pelliculaire en super 8 et du 16 mm, avec l’implication de Nicolas Rey. Le grain, la mer et la voix, donc.
Dans la troisième séquence du film, la mer est en apparence plus calme, éclairée par une lumière violette, celle du ciel crépusculaire qui la teinte en ses bords. Il s’agit du port de départ, celui d’Arcifet. Si la mer pouvait être dite fatiguée, elle ressemblerait à ce long plan cerné de taches de lumière, avec un mouvement d’appareil très lent qui décrit une plage, une digue et quelques barques. Après la mer, les mots sont dits avec une voie piétonne parisienne à l’écran. Le plan est fixe, les feux des véhicules, de la circulation sont rouges. L’éclairage nocturne est ponctué par cette couleur qui ne passe pas, s’incruste dans la nuit parisienne. La voix de Saidi Shaharedi est infatigable : son récit au présent et au passé composé, relate d’abord les trajets et les dépenses, physiques et financières, sans véritable interruption. Le témoignage demeure pudique, retenu, tout de douceur. Les villes, les horaires sont énumérés face aux images du petit port de départ. Les trajets de Lampedusa à Agrigente, de Milan à Vintimille, puis Nice et Paris sont racontés dans leur simple factualité. La poésie de la voix off est donc claire et concrète, énumérative. Les sommes reçues de Tunisie et leurs dépenses matérielles (les nuits d’hôtels, le paquet de cigarette à 6 euros…) se succèdent.
Un peu plus loin, on comprend que la voix de Maki peut être davantage dans l’interpellation, lorsqu’elle se donne pour la lutte du collectif des Tunisiens de Lampedusa en 2011. Cette étape parisienne prend parfois la forme d’archives, filmiques et photographiques. Le combat pour des papiers, un logement, est bel et bien momentanément représenté, mais ses conditions imposent une énumération sans fin d’obligations. Par temps de neige, la file d’attente nocturne est accompagnée par une liste épuisante de documents administratifs, dans laquelle se glissent, des évocations plus vivantes (mais noyées dans la logique du registre).
Le noir s’impose pour rompre ce vertige et revenir à des images communes.
Montage : Gilda Fine / Directeur de la photographie : Nicolas Rey
Durée : 75 mn
Sortie : 9 novembre 2016