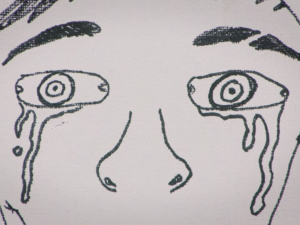Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma, Jean-Luc Godard
Au travail !
« Paris. Ça fait longtemps qu’j’suis pas v’nu.
C’est sale. On dirait qu’les gens s’lavent pas les idées. »
Jean-Luc Godard, dans Grandeur et décadence
« Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma… » : Jean Almereyda, glorieux producteur aujourd’hui fauché, s’affaire à récupérer de l’argent (des deutschemarks qu’il doit à des Italiens) en même temps qu’il tente de monter un film. Gaspard Bazin, régisseur, prépare les essais des acteurs, tous non-professionnels. Carol et Richard s’occupent de la technique en vue de ces auditions. Reynald et Marie-Christine font les comptes.
« …révélées par la recherche des acteurs… » : La femme d’Almereyda, Eurydice, souhaite auditionner, contre l’avis de son époux. Une vingtaine d’acteurs et chômeurs de l’A.N.P.E. vont passer les essais.
« …dans un film de télévision publique… » : Le film de Jean-Luc Godard est une commande de Hamster Productions, société dirigée par Pierre Grimblat, pour le compte d’une collection de films diffusés le samedi soir à 20h30 sur TF1. Le contrat est conclu peu après Noël 1985, le tournage débute en février 1986, le montage en mars et le film est diffusé le 24 mai. Entre temps, un nouveau gouvernement est nommé suite aux législatives du 16 mars et décide le 14 mai, sous l’autorité du premier ministre Jacques Chirac et du ministre de la culture François Léotard, d’organiser le rachat de TF1 par un consortium de sociétés privées. Celui mené par Francis Bouygues remportera la mise. TF1 est définitivement privatisée le 6 avril 1987.
«… d’après un vieux roman de J.H. Chase. » : Hamster Productions adapte les livres de la collection « Série noire » dirigée par Marcel Duhamel chez Gallimard. Est proposé à Jean-Luc Godard de tourner d’après The Soft Center (Chantons en chœur). De l’œuvre originale, il ne reste pas grand-chose si ce n’est que c’est ce même livre qu’Almereyda et Bazin cherchent à adapter ; et si Jean-Luc Godard honore bien la commande, c’est uniquement parce qu’il va être question d’une enquête et de morts (plus nombreux qu’on ne le croit).
Disparu des grilles des programmes, Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma était devenu l’une des nombreuses affaires classées par la télévision. En rouvrant l’enquête au cinéma, le distributeur Capricci nous permet de revenir sur les lieux du crime, celui où le cinéaste exposa son travail à une large audience (à l’heure où ses films n’attiraient plus grand monde dans les salles[11][11] « Moi, je souhaiterais que certains de mes films, qui seraient faits autrement, puissent passer à la télévision avant le cinéma. Parce que même 300 000 spectateurs à 2 heures du matin, c’est énorme. Jamais ils ne passeront un film de Bresson à 2 heures du matin, ils diront que l’audience est mauvaise et préféreront un film porno ». Télérama n°1982, 16 avril 1986 (propos recueillis par Marie Rambert).) ; celui également qu’il considérait comme un pouvoir à combattre. Se rendant dans les années 1980 de plateaux télé en duplex, moins pour promouvoir ses films que pour parler de la télévision, Jean-Luc Godard dresse le portrait d’un outil occupé par des personnes qui ne savent pas montrer, et qui faute de savoir pourquoi ni comment le faire, parlent[22][22] Cette opinion, Jean-Luc Godard l’énonce à plusieurs reprises. Dans « Antenne 2 midi », le 19 mai 1980 : « Si on voyait à la télévision plutôt que d’entendre, qu’on parlait moins et qu’on voyait plus, je pense que je pourrais retenir. Mais puisqu’on ne fait que parler, moi je n’ai rien vu du tout ». Dans « Antenne 2 midi » toujours, le 22 mai 1982 : « C’est difficile avec vous à la télé. Vous parlez beaucoup. Vous montrez quelques images pauvres qui ne peuvent pas dire grand-chose. ».
Rares sont, au contraire, les moments dans Grandeur et décadence où nous voyons des personnages parler. Gaspard Bazin hurle des passages de livres, et continue de hurler même lorsqu’il n’en lit pas. Jean Almereyda répond au téléphone, peste contre sa femme ou sa secrétaire, rumine ou tempête pour lui-même. Reynald répète en boucle la même question destinée aux acteurs venus récupérer leur cachet. Ces mêmes acteurs disent quelques mots, sans regarder personne. Carol et Richard sont le plus souvent silencieux.
Demeurent au moins deux scènes durant lesquelles les personnages parlent enfin. Dans la première, Eurydice (seul personnage véritablement parlant du film, et bientôt réduite au silence) parvient – mais difficilement – à échanger avec Gaspard, en lui parlant d’actrices de cinéma, lui posant des questions sur les « classiques » et les « modernes ». Dans la seconde, Jean Almereyda tombe sur Jean-Luc Godard en personne, et en vieux amis qui s’étaient perdus de vue, prennent des nouvelles l’un de l’autre. Celles-ci sont par ailleurs mauvaises quand bien même la discussion est joyeuse.
Ces deux moments sont des pauses et ont lieu hors des bureaux d’Albatros Films où se déroule la majorité de l’action. Le premier se passe dans un café, le second dans une voiture. Hormis cela, Grandeur et décadence consacre toute son énergie à travailler et à filmer le travail. Cela se ressent d’abord dans le jeu des acteurs, tous épuisés, à commencer par les deux Jean-Pierre, Léaud et Mocky. Le premier, prodigieux, joue un Gaspard Bazin harassé par son mécontentement. Sa silhouette s’affaisse, sa tête s’écroule sur un livre, et ses nerfs craquent tandis qu’il braille une de ses lectures, ne pouvant s’empêcher de rire. Le second joue un Jean Almereyda déjà abattu avant que d’autres se chargent de concrétiser ce funeste destin. Affaires d’argent, de couple, de direction, l’homme s’occupe de tout. C’est dans ses moments d’accalmie que l’on perçoit son étonnement retrouvé et son désespoir, symboles d’une usine à rêves qui cahote sérieusement. Étonnement quand Gaspard fait deviner le nombre de personnages présents dans un tableau : lui en voit un certain nombre, tous clairement peints ; Gaspard n’en voit qu’un seul. Il ne cherche pas à comprendre. Le fait d’être intrigué suffit à produire un film d’intrigues. Désespoir en revanche lorsque seul, empêtré dans ses dettes, Almereyda songe à l’origine en évoquant le caractère original d’une pause déjeuner prise strictement à l’heure, et l’original d’une facture qu’on lui réclame. Les temps ont changé, de mal en pis. Tout le monde semble s’accorder là-dessus. C’est Paris qui est devenue sale. C’est le cinéma des années 30 qui était une époque très belle. Ce sont les modernes qui ne sont jamais arrivés (à l’exception, « peut-être », de Rembrandt et Freud). Ainsi en est-il de la ligne de conduite d’Almereyda : « il faut revenir en arrière », à une époque où il pouvait financer ses films ; à une époque aussi où ses magouilles ne l’avaient pas encore rattrapé. C’est également un désaccord qu’il a avec les réalisateurs qu’il côtoie dans le film (Godard et Gaspard) : le premier constate, un rien résigné, que tout part en arrière (la mode, la politique, le cinéma). Le second n’en finit pas de chercher son film, incapable à l’évidence de se contenter d’adapter comme-cela-se-fait le roman de J.H. Chase. Le petit commerce de cinéma que documente Godard montre alors cela : producteurs et réalisateurs ne sont peut-être pas destinés à se comprendre. Travaillant ensemble, ils forment en définitive un partenariat étrange. Almereyda le regrettera au bout du compte, dans un témoignage vidéo post-mortem destiné à Gaspard, lui confiant que ceux qui tournent les films ont gardé les rêves pour eux et laissé à ceux qui les financent les seules clés de l’usine. Une question restera alors sans réponse : qui, dans cet enregistrement, a effectué un zoom sur son visage ? Qui a soudainement souhaité s’attacher au regard du producteur plutôt qu’à celui des acteurs, filmés à de nombreuses reprises dans le film ? Cette énigme en cache une autre. Si l’on sait à quoi producteurs et réalisateurs travaillent, à quoi rêvent-ils ensemble ?
Jean-Luc Godard a choisi la télévision, endroit privilégié des nouvelles, pour donner des nouvelles du cinéma. Il a choisi le prétexte d’une commande de polar pour filmer la mort de ses illustres producteurs, tous « morts au champs d’honneur » comme Almereyda bientôt. Une courte séquence du film réunit ces deux aspects. Les trompettes ridicules des actualités retentissent et un speaker annonce la mort du producteur assassiné par ses créanciers. Sa biographie est lue, la coupable désignée l’air de rien : Jean Almereyda a dû baisser les bras face à la télévision commerciale.
Dans Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma, Jean-Luc Godard ne se prive pas d’envoyer des coups au petit écran alors qu’il est, dans le même temps, en train de tourner Soigne ta droite avec Jacques Villeret, Michel Galabru ou encore les Rita Mitsouko. Il y filme aussi des personnes au travail. Il y muscle également son mode burlesque (l’énervement de Léaud ici, les errements de Godard et Villeret là). Grandeur et décadence est un film qui documente Soigne ta droite, le regarde en train de se faire. Albatros Films (la société de Almereyda) est un avatar de JLG Films (celle de Godard). Ce sont d’ailleurs dans ses bureaux qu’a été tourné le film. Tous les employés d’Albatros sont les réels collaborateurs du cinéaste (Caroline « Carol » Champetier, Serge Debuisne, Reynald Calcagni, Marie-Christine Barrière). Almereyda et Bazin sont quant à eux deux facettes de lui-même. Le premier (qui porte le vrai nom d’un réalisateur qui lui est cher, Jean Vigo) serait un fragment d’autoportrait en tant que patron de JLG Films. La chose est plus précise encore. Almereyda est très soigneux dans le film, inséparable de sa lingette avec laquelle il nettoie tout. Godard l’est semble-t-il tout autant, comme le raconte Caroline Champetier, employée-apprentie à JLG Films en 1985 pour Soigne ta droite[33][33] « Le matériel caméra ou électrique, c’est important pour Godard. Il faut que le matériel marche bien, soit propre, beau, qu’on ait envie de s’en servir. Il touche beaucoup les choses pendant un tournage. Là, c’est un manuel avant d’être un intellectuel. Je n’ai jamais vu des câbles plus propres et mieux roulés qu’à JLG Films. Jean-Luc dit qu’il faut respecter l’âme des câbles. » Cahiers du cinéma n° spécial « Godard, trente ans depuis », 1991, pp 54-57.. Sa seconde facette, Bazin, porte le nom du critique et co-fondateur des Cahiers du cinéma, revue pour laquelle il écrivit à partir de 1951 aux côtés de François Truffaut (qui révéla Léaud). Ce Gaspard là serait un autoportrait déformé de Godard au travail, cherchant parmi les fragments de livres, musiques et images à décocher une vérité à travers les écrans (« truth is an arrow and the gate is narrow»[44][44] When he returns, 1979. (trad. « La vérité est une flèche et la porte est étroite). chante Bob Dylan dans le film). Pas seulement d’ailleurs. Dans le film, Léaud commande un « œuf-saucisses » dans un café alors qu’il auditionne deux jeunes actrices. Le scène rappelle la rencontre entre Villeret et le réalisateur[55][55] « À l’origine de Soigne ta droite, il y a l’envie de parler de Beckett, un jour devant une saucisse de Strasbourg et deux œufs sur le plat (pour lui) et un jambon beurre (pour moi). » Jacques Villeret, cité par Philippe Durant. Jacques Villeret, Édition Favre, 2005, p.78.* (*propos cités par Antoine de Baecque dans Godard, biographie, Grasset, 2010, pp 657-658)..
André Bazin est l’auteur d’un célèbre article sur Le Dictateur de Charlie Chaplin : « Pastiche et postiche, ou le néant pour une moustache »[66][66] Revue Esprit, novembre 1945.. Gaspard « Léaud » Bazin en arbore une belle dans Grandeur et décadence, comme en référence plutôt qu’en ressemblance avec le critique. Il y a en effet, dans l’entrée des bureaux d’Albatros Films, une affiche de La ruée vers l’or. Après la mort d’Almereyda, elle a disparu, remplacée par des Unes du magazine « Marie-Claire ». Des jeunes personnes à la mode se sont alors emparées des locaux et paradent devant la caméra, proférant des slogans abrutis sur ce qu’est l’ « essentiel ». Une chose alors a été anéantie, qui est le travail, conjointement, de l’image et de sa critique. Fini le travail, fini le dur labeur, les prises de tête (Gaspard est physiquement un virtuose de la discipline). Chaplin et Almereyda partis, passer à l’écran suffit maintenant sans même se demander comment on y passe, comme si portes et fenêtres ouvertes sur le monde n’étaient plus étroites mais grandes ouvertes et qu’il n’était plus besoin de bien chercher à viser au travers. Lorsque Gaspard Bazin défile au milieu de tout ce petit monde branché, son regard, bien que cerné, est plus perçant que jamais. Sa tête qui lui tombait dans les mains si souvent reste droite face à la caméra. L’homme se prépare à disparaître, affrontant le néant qui commence à tout envahir. Derrière sa moustache, André Bazin, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Léaud. Ceux-là veillent, se tiennent prêt quoi qu’il advienne, même si le silence et l’oubli leurs semblent promis.
Plus tôt dans le film, Almereyda et Bazin s’inquiétaient de la volonté d’Eurydice de passer les essais. Pourquoi diable vouloir faire du cinéma ? La volonté de l’aspirante actrice devra passer l’épreuve d’un long travail, de reconstitution notamment ; celui d’un passage quelque peu rude de Sépulture sud, de William Faulkner, qu’elle doit remettre dans l’ordre. Essayer, c’est ce qu’il restera de ce petit commerce de cinéma qui ne réalisera jamais son film en cours. C’était pourtant déjà faire du cinéma que d’essayer, de chercher, de rembobiner, de passer en boucle. Dur labeur qui semble n’avancer à rien mais qui arrive à trouver pourtant.
La phrase de Faulkner justement[77][77] « […] eux tous, profilés sur le fond du vert luxuriant de l’été et l’embrasement royal de l’automne et la ruine de l’hiver, avant que ne fleurisse à nouveau le printemps, salis maintenant, un peu noircis par le temps et le climat et l’endurance mais toujours sereins, impénétrables, lointains, le regard vide, non comme des sentinelles, non comme s’ils défendaient de leurs énormes et monolithiques poids et masse les vivants contre les morts, mais plutôt les morts contre les vivants ; protégeant au contraire les ossements vides et pulvérisés, la poussière inoffensive et sans défense contre l’angoisse et la douleur et l’inhumanité de la race humaine. » (in Idylle au désert et autres nouvelles, Gallimard, coll. Folio, Paris, 1998)., qu’Eurydice doit recomposer : Gaspard lui donnant les mots en vrac, lui dit « Je vous donne les vagues. Essayez de retrouver la mer. ». Se met alors à défiler l’humanité devant la caméra. Chaque partie de l’ensemble lit à voix haute un mot de la phrase. Évidemment, tous se suivent à la chaîne, mais la phrase est décousue, et le sens de celle-ci tantôt incompréhensible, tantôt incertain. Eurydice essaye encore. On commence à comprendre doucement, progressivement. Elle régresse ensuite. Se rattrape. Cette recherche du sens n’est pas qu’un ordonnancement. Les figurants ne répètent pas le même mot. Ils en changent, comme s’il fallait trouver l’accord entre celui-ci, la voix, le corps, la stature, l’intonation, etc. Godard filme ce travail d’orfèvre dans la longueur, zoomant et dézoomant, la chef-opératrice Caroline Champetier penchée sur son moniteur comme une scientifique sur son microscope. Tant de dépense d’énergie se justifiait-il ? Sans doute que non. Peut-être que si. Bien sûr que oui. Allez savoir. Là n’est pas l’essentiel, comme finit par le dire Léaud, passant parmi les fanfarons devant la caméra « Marie-Claire » : l’essentiel, ce ne sont pas nos sentiments, mais la ténacité silencieuse avec laquelle nous les affrontons. Un plan alors dans le film illustre plus que tout cette ligne de conduite. Passant un de ses essais, Eurydice est filmée, accrochées aux grilles d’une fenêtre d’Albatros Films (grilles que Gaspard compare à celles du programme télé). Godard effectue un fondu, et nous voyons Almereyda et son chauffeur qui rentrent au bureau. Toujours aussi maniaque, le producteur lui demande de bien s’essuyer les pieds sur le paillasson. Le bruit que cela produit, juxtaposé au plan d’Eurydice derrière les barreaux, donne l’impression que ceux-ci sont en train d’être sciés. Au plan suivant, Dita Parlo, grande actrice de cinéma des années 30, apparaît à l’écran. Eurydice lui ressemble, dit-on. La ténacité silencieuse de celui qui tient son petit commerce de cinéma proprement est la condition première d’une réelle évasion.
Derniers mots : Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma est dédié « à Jack Lang », ancien ministre de la culture fraîchement démis de ses fonctions pour cause de cohabitation gouvernementale. Nul hommage je crois. Un salut peut-être, ou un « au fait ». Le film aurait pu être dédié « au travail », comme pour lui dire adieu (et bonjour) et inviter à s’y remettre. Le téléfilm terminé, Godard allait pouvoir se remettre à soigner sa droite. Quant à cette invitation/occupation d’une plage horaire dans la télévision honnie, il faut l’entendre à la lumière d’une citation de Victor Hugo[88][88] In Cromwell, Hernani, Librairie Ollendorff, Paris, 1912, p.17. que lit et déforme subtilement Gaspard, remplaçant le mot « localité » par « local » (ce qui fait sonner le mot comme « bocal », surnom donné au petit écran) : « on commence à comprendre de nos jours que local exact est l’un des premiers éléments de la réalité. Les personnages parlant ou agissant ne sont pas les seuls qui gravent dans la mémoire du spectateur la fidèle emprunte des faits. Les lieux où telle catastrophe s’est passée en devient un témoin terrible et inséparable. »
Nous serons un certain nombre à découvrir Grandeur et décadence dans une salle de cinéma. Il faudra aussi voir qu’il se déroulait dans le bocal exact où Godard vit la catastrophe advenir.
Images : Caroline Champetier et Serge Lefrançois / Sons : François Musy et Pierre Alain Besse.
Durée : 92 mn
Sortie en salles : 4 octobre 2017