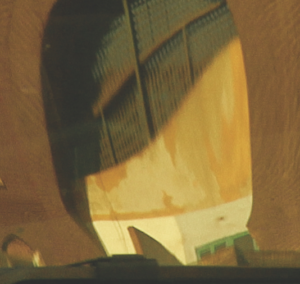Vers la lumière, Naomi Kawase
Contact movie
Misako est audiodescriptrice. Cette jeune femme, dont le métier consiste donc à donner à imaginer des films aux moyens de la parole, fait la rencontre de Nakamori, un photographe qu’une maladie dégénérative condamne à la cécité. L’exposé sommaire des données narratives de Vers la lumière a de quoi inspirer la crainte : ces personnages ne sont-ils pas voués à se rapprocher jusqu’à tomber dans les bras l’un de l’autre comme de simples pièces complémentaires dans une intrigue courue d’avance ? Et si l’on ajoute à ces éléments de base une esthétique que d’aucuns considéreront maniérée (les flare ou le jaune dévorant ponctuellement l’image), le film peut même prêter à sourire.
Pourtant, le fait que Vers la lumière semble pour ainsi dire appeler de lui-même un certain nombre de reproches ne suffit pas à lui ôter sa propre tenue ou justesse ; c’est peut-être même le contraire. Le travail de Naomi Kawase n’est certes pas adressé aux esprits cyniques et aux âmes chafouines, mais qui parvient à surpasser certaines préventions pourrait y trouver plus de finesse que le synopsis ne le laisse supposer : les éléments qui risquent d’alourdir le film sont en même temps l’émanation de l’expérience d’une réalisatrice venue au cinéma par le journal filmé, et l’expression d’une sensibilité indissociable de cette expérience.
La cinéaste, comme s’il y avait là une immodestie, confie qu’il lui a fallu du courage pour intituler son film « Lumière » (le titre d’exploitation française diffère du titre original, qui se contente de ce mot unique). La lumière constitue en effet un motif majeur à l’intérieur de l’œuvre de Kawase, qui lui confère depuis le début une double dimension poétique et théorique. Et il est clair ici que Vers la lumière ne se réduit pas à l’histoire de la rencontre de Misako et de Nakamori, mais associe plutôt cette histoire à une lutte plus générale de la lumière et de l’obscurité ainsi qu’à l’accession à un monde environnant. À suivre la diffusion du motif de la lumière, le film d’amour se révèle un film de lien ou de contact.
Alors qu’il est commun de parler de l’importance de la nature chez Kawase, on est ici frappé par la mise en absence du monde. Celle-ci trouve sans doute son comble à travers les plans tenant lieu de vues subjectives du personnage de Nakamori : des images jaunes presque entièrement opaques, à l’exception de quelques « percées ». Ces plans s’insèrent cependant dans une série plus étendue : en nous donnant dès le départ à voir les images d’un film dans le film doublées d’une description orale et en nous confinant dans l’espace d’une salle de projection, puis en recourant de manière appuyée aux gros plans ainsi qu’à de longues focales isolant les personnages, Vers la lumière semble pour une bonne part s’employer à recouvrir le monde par un ensemble de perceptions lacunaires ou divergentes. C’est que la mise en absence du monde n’est en rien pour Kawase l’apanage des malvoyants, qu’il s’agit au contraire d’une expérience commune que la menace d’une disparition complète de la vision vient tout à la fois révéler et accentuer.
Pour le dire autrement, l’atténuation de la présence de la nature met ici en évidence la condition d’audio-spectateurs ou d’être-sensibles des individus. Et alors que le film s’ouvre sur un séquence où Misako se livre à un exercice de description, essayant de nommer ce qui se passe autour d’elle, il peut être utile de rappeler une succession de plans d’Escargot (Katatsumori,1994), où la jeune Naomi Kawase pointait son objectif sur des objets du monde extérieur tout en les désignant systématiquement de leurs noms. L’audiodescription sommaire à laquelle se livrait déjà la cinéaste nous indique en effet la valeur que revêt chez elle la redondance de la voix et de l’image : loin d’être le signe d’une évidence, elle exprime une lutte. Naomi filmait sa vie pour accréditer son existence, la parole de l’audio-descriptrice Misako récupère en quelque sorte la fonction médiatrice de la caméra, sa capacité à faire advenir une portion de monde pour un spectateur-auditeur ou un audio-spectateur.
L’un des grands enjeux du cinéma de Naomi Kawase est la transmission d’un monde, mais un monde qui est perdu par avance ou qui va disparaître. Poser cela permet de comprendre en quoi des personnages comme Misako et Nakamori, qui ressemblent sur le papier à des archétypes tirés d’un roman de gare, prolongent en réalité les obsessions de la cinéaste. À travers la romance téléphonée, l’intérêt de la réalisatrice va à l’expérience de la perte partagée par les personnages, et Kawase n’hésite d’ailleurs pas à ce titre à ajouter des couches narratives : si Misako a une vue parfaite, elle est hantée par la mort de son père et affronte la perte de mémoire de sa mère vieillissante. Ces couches qui pourraient sembler venir charger inutilement le récit relèvent d’une ambition théorique et déclinent le motif de la lumière en liant la question de la vue et celle du temps : la lumière est chez Kawase autant moyen d’apparition du monde que moyen de conservation des souvenirs.
C’est ce que montre exemplairement – et d’une façon on ne peut plus littérale – un court moment du film Trace (Chiri, 2012) où la cinéaste filmait les derniers jours de sa grand-mère. Alors que la grand-mère ne reconnaît plus sa petite fille, Kawase intègre une série de photogrammes noirs, l’oubli étant ainsi traduit comme passage de la lumière à l’obscurité, conçu comme sa propre disparition à l’image et aux yeux des autres. À cette disparition de l’image et du souvenir dans Trace répond une séquence de Vers la lumière. Misako retrouve sa mère au sommet d’une montagne et, tandis qu’elles font face au soleil couchant, se souvient être déjà venue à cet endroit avec son père. Une image de Misako petite fille et de son père, qui la porte sur ses épaules, fait alors irruption dans le montage, image mouvante où parent et enfant se tiennent pourtant immobiles.
Kawase ne relie pas cette image au visage de Misako : avant d’être tirée de la mémoire du personnage, l’image est directement prélevée dans le temps. C’est le soleil qui la fait revenir au jour, le passé et les morts demeurant présents à travers les rayons lumineux. En permettant la conservation des images, le cinéma et la photographie se font eux-mêmes les relais de la lumière : comme art de lumière, le cinéma est avant tout moyen de contact[11][11] Pour être tout à fait précis, il faut signaler ici que le retour de l’image passée ou la mise à jour du souvenir s’opère d’abord sur le plan sonore, la bande son nous faisant préalablement entendre une conversation entre Misako et son père. Cela permet d’autant plus de rapprocher ce qui se passe dans la fiction Vers la lumière (l’association, autour de la lumière, d’un personnage avec une conversation et une image passées) et ce qui se passe dans le documentaire Trace, notamment si l’on songe au plan où Naomi Kawase tend une photographie d’elle et de sa grand-mère devant la caméra et devant le soleil, tout en évoquant la relation de sa grand-mère avec ce dernier. On retrouve à chaque fois un assemblage voix-image-lumière, l’image étant dans un cas une photographie (documentaire) et dans un autre cas une image animée (fiction)..
C’est dans cet ordre d’idée qu’il faut aborder une séquence qui rime à l’intérieur du film avec celle que nous venons d’évoquer. Au lieu d’avoir affaire à Misako et à sa mère au sommet d’une montagne, nous découvrons Misako et Nakamori au sommet d’une dune, le soleil également là, face à eux. Il n’est à ce moment pas question du retour d’une image, c’est même presque le contraire puisque Nakamori, dans un mouvement inattendu, jette au loin son appareil photo Rolleiflex auquel il était particulièrement attaché. Mais si ce geste semble parachever une perte irrémédiable (la perte de l’appareil venant seconder celle de la vue), celle-ci est immédiatement contrebalancée. Dans un enchaînement brusque, l’élan du photographe est en effet suivi par celui de l’audio-descriptrice, qui se rapproche pour l’embrasser. Les personnages se tiennent alors devant le soleil, et l’image, tandis qu’ils se séparent, s’emplit de jaune, elle et lui n’étant plus que des silhouettes uniquement démarquées par une teinte plus sombre.
Ce baiser coïncidant avec une absorption des personnages est à la fois un sommet de kitsch et un aboutissement poético-théorique. Face à la perte et à l’éloignement, l’envahissement de l’image par la lumière signe en effet le contact des personnages entre eux et entre eux et le monde. Toute la construction du film tend à projeter leur relation sur un plan plus abstrait : c’est évident si l’on pense à la manière dont Misako et Nakamori n’arrêtent pas de se croiser l’un l’autre dans les rues de Nara, contre toute vraisemblance. Misako peut ainsi perdre de vue Nakamori le malvoyant avant de réapparaître plus tard face à lui, au détour d’une séquence. C’est que le souci de Naomi Kawase n’est pas du tout géographique, mais ne concerne que la distance et la proximité des êtres, la possibilité d’un contact face à la perte.
Or, le contact s’opère par la lumière, ou par une dimension sensitive qu’elle recouvre, et cela par-delà la vue ou la possession d’un appareil d’enregistrement quelconque, la lumière concernant aussi bien la parole ou le toucher que la vue. Misako a beau voir, il s’agit pour elle de trouver les bons mots pour décrire les images des films, mais aussi de fermer les yeux pour partager le monde de l’aveugle. Nakamori a beau devenir aveugle, il s’agit pour lui de comprendre que la perte de la vue n’implique par l’abandon de la lumière et la disparition du monde. Et le contact peut ainsi aussi bien avoir lieu quand l’audio-descriptrice et l’aveugle se touchent. Comme Sentaro et Tokue dans Les délices de Tokyo, Misako et Nakamori sont deux personnages qui, à partir d’un manque respectif, se soutiennent l’un l’autre, leur rencontre n’étant que le moyen par lequel le récit met en scène l’accession au monde à travers une expérience lumineuse. D’où le geste final de Kawase, qui au lieu de s’appesantir sur le destin du couple, nous montre les visages de spectateurs de cinéma anonymes, voyants ou aveugles, spectateur-auditeurs ou audio-spectateurs.
Peut-être peut-on regretter que la cinéaste ne soit pas allée plus loin dans cette direction en ouvrant notamment son récit à davantage de voix. Reste que Vers la lumière rend visible les contours d’un questionnement, et que l’on ne saurait uniquement le juger sur son intrigue sentimentale : l’une des qualités du cinéma de Kawase tient au fait que le scénario n’est pour elle que la base à partir de laquelle déployer une sensibilité. Or, la sensibilité de Naomi Kawase est capable de la porter au-delà du cliché, si bien que ce qui semblerait ailleurs la reprise paresseuse et esthétisante de procédés rebattus prend chez elle l’allure d’une expression sincère : c’est le privilège de ceux qui s’étonnent comme au premier jour de la présence du monde.
Lors de la présentation du film à Cannes, l’acteur Tatsuya Fuji évoquait la force singulière de la réalisatrice, qui serait selon lui capable de trouver l’accord de la nature et du tournage, de faire par exemple apparaître la lumière de la lune. Le temps, quand j’ai marché Vers la lumière, était particulièrement détestable : un vent insidieux, une pluie froide et cinglante. Cependant, une fois ressorti de la salle, le souffle s’était muée en brise, et la pluie passée ne subsistait qu’en flaques. Pure coïncidence, ou effet Kawase ? La météo, parfois, est la meilleure critique de cinéma.
Scénario : Naomi Kawase / Image : Arata Dodo / Montage : Tina Baz / Musique : Ibrahim Maalouf
Durée : 1h41
Sortie le 10 janvier 2017
Images : Vers la lumière, 2017 / Trace, 2012