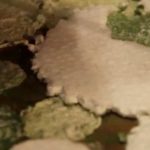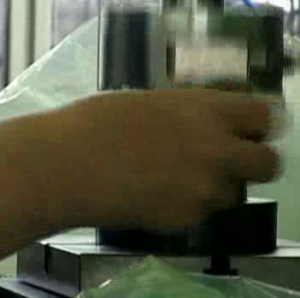Sfumato, Christophe Bisson
Ceux qui s’approchent, ce qui s’accroche
“ Veille à ce que tes ombres et lumières se fondent sans traits ni lignes, comme une fumée. ” Ainsi Léonard, dans son Traité sur la peinture, achevait-il de définir la technique qui donne son titre au nouveau long-métrage de Christophe Bisson, le sfumato. Placés en exergue, ces quelques mots, aussi frappants qu’un aphorisme de Bresson, semblent valoir comme maxime pour le cinéaste. Sans cesse relancée, sa recherche viserait à créer une zone où se trouble la limite, où s’abolit la certitude de l’un et de l’autre. Un flou, par exemple, qui serait non un défaut temporaire, une offense faite au visible, mais le lieu d’un contact. La caméra de Bisson a toujours eu la légèreté du pollen, la douceur de la caresse, l’impudeur du nourrisson. Dans Sfumato, elle nous place d’emblée dans la plus grande proximité avec ce qu’elle filme. Elle se niche dans le cou, se frotte contre les joues, se perd dans le fouillis des cheveux et des poils. Peau contre peau, elle fait corps sans incorporer. C’est qu’elle peut également dériver, flotter sur le courant invisible qui lie l’homme aux objets, au lieu, à la chair du monde. Aussi faut-il parler de la caméra de Bisson comme d’une force autonome, d’un flux. Si le plan porte parfois la marque d’une volonté, celle-ci finit toujours par retrouver son envers, emportée au fil d’une autre logique – celle du vent, de la pluie, de la lumière, de la sensation. La vue ne s’offre trop souvent que par un point ; Bisson lui accorde de s’échapper à travers champ.
Deux écueils au moins guettent qui veut filmer un artiste au travail : l’imitation, et l’effacement. Dans un cas comme dans l’autre, il y a négation davantage que rencontre. Bisson cherche une voie différente. Avec l’artiste-plasticien Bernard Legay, il s’agit de passer alliance : entre deux corps, deux présences, deux pratiques. De mêler son souffle à celui de l’autre, au moment d’affronter le flanc escarpé d’une montagne ; de s’enfoncer là où le cinéma devient peinture, et ailleurs encore : là où la peinture se fait chair et voix. Bisson fait sortir l’œuvre de Legay d’elle-même. Le rectangle de la toile se disperse pour se recomposer ailleurs – dans le plan fixe, par exemple, d’une piscine abandonnée où le vert mousseux le dispute au bleu. Le geste est encore affirmé, appuyé – l’image séduit, assurément. Ce n’est plus le cas lorsque, laissant entendre pour la première fois les mots du peintre, le cinéaste filme la vitre de l’auto qui les transporte. Le spectateur, si bien habitué à ne voir de la parole que le visage, pourra croire à un caprice. C’est tout le contraire. Car qu’est-ce que cette vitre, sinon une toile que Legay ne compose pas avec les mains, mais avec la voix ? Il fallait cela, la buée, la mousse qui gagne le caoutchouc, les gouttes étalées par le vent, les palpitations lointaines du vert et du blanc, pour que le peintre apparaisse, entre les mots, dans la matière vibrante du monde. Qu’est-ce que cette vitre, sinon le lieu d’un autoportrait peint à travers l’écoute de l’autre ?
Si le monde dans Sfumato semble si prompt à se faire art, c’est aussi que tout est pour Legay un matériau potentiel. Dans une usine abandonnée, il gratte la peinture écaillée d’un wagonnet. Il la répandra ensuite sur la toile en une averse scintillante. Du polystyrène fondu lui fournira une épaisse mélasse brune. Etalée au doigt, elle forme une couche compacte, creusée de sillons : une terre et une peau, une peau faite de terre et d’excréments. Il faut « retrouver des formes dans la matière », dit Legay. Et peut-être avant tout, retrouver la matière dans la matière ; retrouver de quoi peindre, de quoi sculpter dans ce qui est délaissé et qui pourtant s’accroche. Cette œuvre a la beauté des ruines, car elle cherche en elles non l’éclat final de ce qui disparaît, mais la lueur de ce qui persiste en se métamorphosant. « Après le désenchantement, on regarde les lichens », murmure encore Legay. Et puisque tout a la dignité ou l’indignité suffisante pour entrer dans l’atelier, l’atelier même, sis dans un sous-sol à peine troué de lumière, pourra échapper à l’enfermement qui guette en se délocalisant – dans une clairière, pourquoi pas. Les herbes, donnant au support un relief imprévisible, s’allient aux gestes du peintre. Là encore, les frontières s’estompent. Legay marche sur la toile, s’y enfonce sans ménagement ; il arpente la couleur comme il arpente la terre de Normandie.
Sfumato renverse peu à peu les rapports usuels entre la toile, le corps et le paysage. Une perception nouvelle s’ouvre. C’est là sans doute ce que le peintre apporte au cinéaste, ce que la main de Legay fait découvrir à l’œil de Bisson. Dans Liquidation (2013) ou Sarah (K.) (2014), ce dernier filmait déjà en très gros plan le cheminement d’un crayon sur le papier. A chaque fois, il s’agissait de re-tracer – Arnaud Geminder surlignant sur des reproductions de toiles de maître les contours des figures, jusqu’à les enterrer sous l’encre ; Philippe Boutibonnes parcourant de l’index les dessins, hantés par la Shoah, de Sarah Kofman. Un abîme s’ouvrait, dans ce face-à-face impossible avec ce qui de l’autre nous regardait dans l’image. Ni le noir de l’encre, ni le blanc de la lumière sur lesquels les films s’achevaient ne pouvaient offrir d’issue. Ecorché, Legay est cependant parvenu à s’inventer de nouvelles peaux. Il lui aura fallu pour cela se situer au niveau des tressaillements microscopiques qui agitent la matière, la transforment et la renouvellent. C’est ce que filme Bisson : non une œuvre exécutée selon un dessein préalable, mais une mise au travail des éléments. D’où cet échange constant entre la toile et le monde. En frôlant du doigt un mur recouvert de mousses vert pistache, saumon, noir, ou brillantes comme la nacre, Legay semble parcourir une de ses toiles. Lorsqu’arrivé en Sicile, il grimpe au sommet d’une montagne constellée de plaques de neige, son corps semble devenu le pinceau qui déposait tout à l’heure des gouttes d’acide sur des ronds de polystyrène. Peinture et nature se rencontrent alors par les moyens du cinéma, non sous les termes de l’imitation, mais du devenir. Bisson aura réussi à dépeindre la peinture – la perdant comme objet, il la retrouve comme processus.