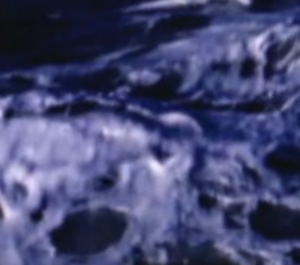Entrevues de Belfort, 2020 (1/3)
Compétition internationale - long métrages
Malou Six,
Elie Rafauste,
Rosalie Tenaillon,
Eve Le Fessant Coussonneau,
Fanny Villaudiere,
le 2 juin 2021
L’édition 2020 du Festival Entrevues de Belfort qui s’est tenue en ligne nous a permis de voir six des dix longs métrages en compétition. Pour la rétrospective Podalydès, totalement annulée, nous avons suivi le guide du programme, et tenté d’en restituer le sel. Quant à l’ensemble du programme Net Found Footage, disponible sur Tënk, a été soumis à la vision curieuse des jeunes chercheurs en études cinématographiques de l’ENS de Lyon (Master Pensées du cinéma) à l’affût des lieux où se repense le medium. Entre kaléidoscope, arc en ciel et drapeau des fiertés, notre compte-rendu a pris les couleurs d’un horizon qui nous manquait tant, et que ces films « d’avant » nous restituaient : des embrassades, des descentes de rivières, des traversées sombres aussi de frontières qui refluent plutôt qu’elles accueillent. Au risque des injustices et des partialités. Manière pour nous de porter les couleurs de ce festival qui, vaille que vaille, s’est tenu.
Elise Domenach
***
Eyimofe / This Is My Desire, Arie Esiri & Chuko Esiri, France, 2020, 116mn.
Gestes de réparation
Espagne, Italie : deux destinations, deux trajectoires. C’est ainsi que se construit Eyimofe, premier long métrage des frères nigérians Arie et Chuko Esiri. Structuré en deux parties, le film conte d’abord l’histoire de Mofe, un mécanicien qui désire partir en Espagne et dont le projet est subitement suspendu par la mort de membres de sa famille. Endeuillé et rattrapé par les galères administratives, Mofe peine à obtenir un visa. Quand, à la fin du film, on le retrouvedans une petite échoppe de réparation d’objets électroniques fraîchement acquise, la perspective d’un départ paraît bien lointaine. La seconde ligne du scénario s’attarde sur les déboires de Rosa et de sa petite sœur enceinte, Grace. Elles souhaitent rejoindre l’Italie, mais les papiers coûtent chers et demandent beaucoup de sacrifices. A l’instar du personnage principal du Mandat (Ousmane Sembène, 1968), Mofe, Grace et Rosa s’engluent petit à petit dans leur quête.
Eyimofe diffère de la plupart des films européens prenant aussi pour sujet les migrations contemporaines, du cinéma de Pedro Costa à celui de Sylvain George, de Bijan Anquetil, d’Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz, ou encore de Jérémy Gravayat. Cette production à tendance documentaire montre surtout les conditions de vie des « migrants » une fois arrivés en Europe (camps ou centres de rétention, violences policières et étatiques, précarité économique…). Les frères Esiri déplacent ce regard en situant leur fiction de l’autre côté de la Méditerranée, comme l’a fait Mati Diop dans Atlantique (2019). La migration, qui se conjugue au présent ou au passé dans la plupart des films susmentionnés, reste ici pure potentialité. Manière pour les réalisateurs de rappeler que le tragique n’est pas l’apanage des histoires de celles et ceux qui ont risqué leur vie pour rejoindre un « pays d’accueil ». Il réside également dans l’impossibilité d’effectuer ce parcours, dans l’échec du départ, les désirs frustrés et les espoirs taris.
Eyimofe donne ainsi moins à voir le point d’aboutissement d’un parcours migratoire que ses multiples pierres d’achoppement. Cette phase infructueuse de préparatifs lie les personnages des deux récits. Mofe, Grace et Rosa se croisent une première fois à l’hôpital : Mofe est venu demander les corps de sa sœur et de ses neveux, tandis que Grace et Rosa se rendent à un suivi gynécologique. Si le contraste entre la mort et la vie paraît flagrant à l’écrit, la rencontre des personnages à l’écran est si brève, la caméra y insiste si peu, que la séquence échappe à cette lourdeur de sens. La seconde rencontre est beaucoup plus nette : Grace se rend au stand de réparation de Mofe, censé remettre en état leur frigo, et s’assoit face à lui. Ces moments de coprésence, et un personnage-liaison (Mr. Vincent, qui connait à la fois Mofe et les deux sœurs, à qui il loue des appartements) permettent de situer les deux histoires dans un même espace-temps. Leur autonomie paraît alors moindre qu’elle n’en avait l’air, et le film invite à rester attentifs aux détails qui tissent les récits entre eux et dessinent les contours d’un destin commun.
La possibilité d’une reconstruction pourrait se loger dans les liens interpersonnels. Survivent aux obstacles l’amour que Rosa porte à sa petite sœur et le rapport filial qui semble naître entre Mofe et son apprenti Wisdom. Lorsqu’il se blesse à la main, une marque rappelle celle que Mofe a au même endroit. Wisdom apparaît alors comme un “Mofe Jr”, restant à ses côtés jusqu’à l’épilogue. L’issue d’Eyimofe n’est peut-être pas si terne : de ce film, tendre et pudique, on retient la finesse de ces subtiles échos, rencontres furtives, et filiations accidentelles. En ouvrant leur film sur l’image d’une multitude de boîtes reliées par des câbles électriques entremêlés, Arie et Chuko Esiri annonçaient la couleur : toutes ces vies se nouent, au moins par le sort qu’elles partagent, jusqu’à, peut-être, se rafistoler mutuellement, à l’image du travail de réparation qu’effectue Mofe sur de vieux objets abîmés.
Malou Six
***
The Last Hillbilly, Thomas Jenkoe et Diane Sara Bouzgarrou, France / Qatar, 2020, 1h20.
Perchés sur les collines
Réunis autour d’un brasier, une poignée d’enfants écoutent avec attention un homme, Brian Ritchie, leur donner une leçon d’histoire. D’un ton grave, un peu grandiloquent, il raconte une déchéance accélérée : « On a eu les mines de charbon pendant environ cent ans. Ça a vraiment tout changé. En trois générations, on est passé de montagnards à gueules noires, puis à un tas de hillbillies ignorants et au chômage ». Installé avec sa famille dans les collines de l’Est, le long du contrefort des Appalaches, Brian prétend être le dernier hillbilly, c’est-à-dire un habitant de la région tel que le surnomment les autres citoyens américains – un « type des collines », un plouc, un pauvre gaillard sans éducation, vivant à l’écart de la société moderne.
Cette figure ne nous est pas étrangère. Héros pathétiques (Les Raisins de la colère) ou sous-hommes cruels et dépravés (Délivrance) parsèment la littérature et le cinéma américain. Comme pour tout stéréotype, la réalité et l’imaginaire s’enchevêtrent et aboutissent à une image décontextualisée, souvent grotesque et sourde aux évolutions historiques. Ces simplifications s’ajoutent à notre méconnaissance de l’Amérique « blanche et rurale », pourtant replacée sur le devant de la scène politique par l’élection de Donald Trump en 2016. Comment démêler par le documentaire ce tissu de représentations préconçues ?
Grâce à la relation de confiance établie avec Brian au fil de quatre années de tournage, les deux cinéastes ont partagé son quotidien. Ils ont pu s’intégrer à ce territoire sauvage où les familles s’organisent en clans et tiennent plus que tout à leur autonomie, malgré des conditions de vie misérables. Le quotidien des Ritchie n’occupe pourtant pas le centre du film, qui cherche constamment à transcender l’ordinaire pour atteindre une vérité plus profonde. Dès le prologue, la voix rocailleuse et monocorde de Brian mentionne les massacres d’Amérindiens par les premiers colons de la région. À l’écran, quelques plans filmés au téléphone suffisent à installer un climat mortifère : impuissant, un cerf agonise dans le lit d’une rivière. Plus tard, un cadavre de veau sera repêché dans un étang : éclats d’une violence sourde, enracinée dans la terre sombre et humide. On découvre peu à peu Brian et les siens. La caméra l’accompagne dans les travaux de la ferme ou la rénovation de la maison de son frère, sans que la chronique familiale ne prenne véritablement une consistance, tant le montage s’avère elliptique et les repères chronologiques fuyants. L’intérêt est ailleurs : les cinéastes privilégient l’évocation, pour révéler la malédiction qui pèse sur ce lieu et ses habitants.
Oui, confie Brian au coin du feu, le visage à demi mangé par l’obscurité, les hillbillies sont bel et bien « ignorants, pauvres, violents, racistes, consanguins » et « responsables de l’élection de Trump, en tout cas selon les infos ». Ironie de la part de cet homme lucide et amer, poète à ses heures perdues. En apparence, Brian reprend à son compte toutes les insultes, toutes les étiquettes, tous les qualificatifs. Il laisse parler les autres et propose, dans le même temps, une identité incarnée, façonnée par les lieux et l’histoire. Un hillbilly, ce peut être aussi cet homme perché sur les collines, hurlant à la mort pour appeler les coyotes. Le récit parvient à désamorcer toute considération sociologique et politique au profit d’une exploration subjective, bercée des doutes et des contradictions d’un seul être.
Brian est associé à la démarche créative des cinéastes qui, très tôt, lui ont confié un enregistreur pour s’exprimer librement, en marge du tournage. De nombreux plans se colorent de pensées métaphoriques, de souvenirs personnels qui recoupent rarement ce que montrent les images. Dans le dernier tiers, néanmoins, cette voix s’amenuise pour laisser une plus grande place aux enfants de la famille Ritchie, qui déambulent parmi la grange familiale, les collines et les clairières sauvages. Baignés dans une lumière chaude qui contraste avec la photographie crépusculaire des premières séquences, ils disent s’ennuyer à mourir. En les regardant flâner en pleine nature, on se dit que, dans leur cas, l’oisiveté est peut-être synonyme d’une liberté rare, encore préservée de l’influence du monde extérieur.
Elie Raufaste
***
La Lévitation de la Princesse Karnak, A. Genoudet, France, 2020, 1h24.
« La magie, c’est l’ivresse sans alcool »
Une fête de fiançailles dans un café parisien. À la lueur des bougies, un homme fait des tours de magie, le couple s’aime et on boit du vin. Mais tout bascule en une disparition, soudaine et irréelle : celle du magicien à la fin de la fête. En un battement de paupière, l’insouciance se perd. Quelques mois plus tard, la fiancée de Camille a disparu elle aussi, et il faut quitter Paris pour échapper à la catastrophe. Une catastrophe jamais nommée. Deux amis, Camille et Paul, traversent la France pour se réfugier dans un village perdu en Italie où vit le frère de Paul. La Lévitation de la Princesse Karnak, qui tire son nom du célèbre tour de magie, se fait alors l’histoire d’un exil, d’une errance pour se retrouver.
Le voyage est pris dans une tension entre légèreté et joie, angoisse et absence. Camille et Paul partagent des moments doux, de vie et de rires autour d’un tour de cartes, de retrouvailles avec un vieil ami, ou dans la rencontre avec un inconnu. Mais la nostalgie d’une vie bouleversée et d’un amour perdu transparaît dans ces moments mêmes. La femme aimée se transforme en un souvenir évanescent, un regard, une main, baignés d’une lumière douce. Le film ne laisse jamais oublier cette sensation de perte. Au pied d’un arbre, protégés du soleil, les deux amis discutent avec un homme plus âgé qui leur raconte la mort de son amant et de deux aviateurs, dont l’appareil s’est écrasé dans la région. La douceur du moment, du soleil et de la nature contraste avec l’agonie des pilotes et la perte d’un amour. Le cadre est idyllique mais la disparition ressurgit, ou comme dirait Verlaine: « Le ciel était trop bleu, trop tendre, La mer trop verte et l’air trop doux » (« Spleen »). Malgré tout, la pudeur est de mise, le pathos ou la sensiblerie évités. Camille et Paul reprennent toujours leur route, souvent en silence, et jamais à la hâte. L’exil devient une opportunité : celle de trouver un autre rythme de vie, plus lent, qui suit les saisons ou le soleil, le voyage physique étant aussi intérieur. La voix off de Paul vient habiter l’image sans la submerger, dans un juste milieu entre implicite et explicite. Camille fait le deuil de sa relation et s’ouvre progressivement à son ami. Les deux hommes se retrouvent dans un silence chargé de sens. L’arrivée de nuit en Italie signe la fin du voyage.
La magie poursuit les deux protagonistes. Dans la première scène, le magicien éblouit personnages et spectateurs. Ces tours de passe-passe sont évoqués avec humour lors d’un énième repas. Et comment expliquer les disparitions dans l’entourage de Camille et Paul, si ce n’est par l’enchantement ? Après la catastrophe, la seule solution est de croire en la magie, en l’impossible. Le temps s’arrête mais on continue de vivre et de s’adapter dans un entre deux : comme la princesse Karnak, on lévite dans un autre état, hors du temps et du monde. Au fur et à mesure, la disparition ne devient plus synonyme de perte ou de manque mais plutôt d’ouverture sur un ailleurs qu’on ne peut totalement saisir.
Fanny Villaudiere
***
Las mil y una, Clarisa Navas, Clarisa Navas, Argentine, 2020, 120mn.
Les mille et un lieux du désir
Iris sillonne sans relâche les rues de Las mil, balade son ballon de basket entre ses mains de façon aussi frénétique qu’elle balade ses yeux sur les habitants et les recoins du barrio. Elle est notre guide dans l’exploration d’une génération, haletante et maladroite, qu’entreprend Las mil y una, deuxième long-métrage de fiction de la réalisatrice argentine Clarisa Navas. Les jeunes du film vivent dans un quartier populaire argentin, près de Corrientes, au nord du pays. Iris occupe son temps entre le sport et ses deux amis, Dario et Ale ; Renata, entre son travail de danseuse dans un club et sa bande plutôt subversive. Sur le fond initiatique d’une découverte précaire et intense de l’amour et de la sexualité, les deux jeunes femmes se rencontrent, et se lient. Mais si leur histoire est touchante, son traitement a de quoi laisser perplexe. La rencontre avec les personnages est rendue difficile par une présentation maladroite, au milieu de situations intenses. La première soirée d’Iris, Ale et Dario avec une autre bande de jeunes est rapidement introduite, avant qu’un jeu de cache-cache à l’échelle du barrio ne disperse soudainement le groupe, pour filmer leurs ébats avides dans les zones d’ombre des bâtiments en béton. L’aspect cru, dramatique, la violence de certaines situations, comme le viol collectif d’Ale diffusé sur les réseaux sociaux, pris avec distance, voire fatalisme par les personnages, met mal à l’aise. On sort malgré tout de Las mil y una émus, les énergies dispersées, une fois canalisées, pouvant faire sens.
Le film dresse le portrait d’une jeunesse marginale, par sa situation économique et géographique, mais aussi par ses orientations sexuelles et ses identités de genre. Ces deux marginalités se font écho, la ghettoïsation de l’environnement proposant difficilement un terrain propice à ces désirs non-conventionnels. « Las mil viviendas » est le barrio populaire où a grandi Clarisa Navas. L’atmosphère sonore du film, très travaillée, en construit l’univers. Dans un hors-champ perpétuel, on perçoit les engueulades à travers les murs, celles qui se font en pleine rue, les coups de feu, les sirènes de police, la musique des autres, et un chien qui aboie, toujours, au loin. En ressort le portrait documentaire d’un lieu, exploré caméra à l’épaule. Cette manière de filmer évoque les précédentes expériences documentaires de Clarisa Navas, qui a travaillé sur les mini-séries El Jardín de las Delicias (2017) et Mujeres entre fronteras (2017).
De ces lieux vécus, on distingue deux variantes, identifiables par le type d’énergie interpersonnelle qui s’y développe. La rue est le lieu du mouvement frénétique, de la caméra portée et du cadre instable. Les personnages y marchent, souvent filmés de dos, et s’y entrechoquent plus qu’ils ne s’y croisent. Comme horizon, le béton à perte de vue. L’énergie serait alors celle de la ligne tendue, avec de brefs et intenses points d’intersection. C’est dans cet espace, et sur cette modalité que la relation entre Iris et Renata débute. À l’inverse, les lieux intérieurs permettent de construire l’intimité, bien difficile à trouver dans un quartier où tout le monde se connaît, où les sons traversent les murs, et les ragots courent les rues. Iris, Ale, Dario et leur mère s’y réfugient, s’y réconfortent. Les cadres sont plus serrés, la caméra souvent sur pied, fixe. La chambre est pleine de draps qui permettent de s’envelopper, et le surcadrage que construit le lit en hauteur réduit encore davantage l’espace. La cuisine est pleine de couleurs, les garçons peuvent s’y maquiller, et Ale peut y livrer sa vision de l’amour. Pas d’horizon dans des lieux immobiles, mais des tanières et des nids, mus par une énergie circulaire qui se construit au fil des regards, des paroles, des gestes d’attention. Les personnages ne s’entrechoquent plus, mais s’entrelacent.
Navas confiait dans un entretien vouloir faire un film sur les potentialités de dissidence. L’histoire d’Iris et Renata en est une. La relation entre les deux femmes fait jaser le quartier, et sort chacune d’elle de sa zone de confort. Mais symboliquement surtout, elle vient mêler les lieux. La force du désir, la ligne droite, s’introduit dans l’intérieur, par exemple quand elles vont passer une soirée chez la mère de Renata. Mais surtout — plus grand encore est le tour de force — elles déplacent l’affectif circulaire, propre aux lieux intérieurs, dans la rue. Dans les recoins des escaliers, au pied d’un mur, elles cherchent une intimité. Elles auraient atteint un entre-deux parfait sur le toit de l’immeuble, si l’emprise du barrio ne les avait rattrapées. Emprise figurée par unn cadre découpé horizontalement, qui laisse au paysage du quartier, dans la partie supérieure, la dominante sur les deux filles recroquevillées dans la partie inférieure.
Sa maladresse, le film la doit peut-être à une volonté sincère de filmer les émotions d’une jeunesse en pleines découvertes. Représenter l’impatience brutale de ce désir non-conforme à travers des situations inattendues, avec des personnages extravagants qui viennent se frayer fébrilement un chemin dans ce quartier, c’est figurer la force de dissidence dont parle Clarisa Navas.
Eve Le Fessant Coussonneau
***
Traverser, Joël Akafou, Burkina Faso/Belgique/France, 2020, 77 mn
«Là où mon âme aura aisance de vie»
Traverser raconte l’histoire de Touré Inza Junior, jeune homme exilé en situation irrégulière, parti de Côte d’Ivoire pour gagner de l’argent. Cette rencontre inhabituelle offerte par le film justifie l’obtention par Joël Akafou du Grand Prix Janine Bazin de la compétition internationale du Festival de Belfort. « Bourgeois », comme le surnomment ses amis, a parcouru le désert, a été fait prisonnier et esclave en Libye, a traversé à plusieurs reprises la Méditerranée sur des bateaux de fortune avant d’arpenter à pied divers pays européens pour arriver, sans le sou et sans papiers, à Turin, ville italienne où le film débute, après un court passage en Côte d’Ivoire.
Le documentaire s’ouvre sur une promenade familiale vers la tombe du père, située au milieu d’un parc ivoirien verdoyant. Décédé depuis peu, l’homme laisse derrière lui un grand sentiment d’abandon : les larmes coulent, les mains se posent sur la terre rougeâtre, les visages sont déformés par le chagrin. Sur le chemin du retour, la fille aînée marchant près de sa mère veuve lui dit son admiration face à la multitude d’humeurs que la nouvelle cheffe de famille devra gérer. Avant de nous transporter vers l’Europe, Joël Akafou nous montre ainsi ce à quoi le personnage principal du film, Inza Touré Junior, s’arrache. On entre dans une maison ivoirienne des plus modestes, un salon à peine meublé où trône l’aïeule dans son fauteuil roulant, en pleine conversation téléphonique amoureuse avec son époux exilé : « Je jure que parler avec toi me fait du bien » dit la voix à l’autre bout du monde. Les mots échangés par ce couple âgé mettent le spectateur face à l’individualité des sujets filmés et imposent le fil que ne cessera de suivre le film : un refus d’essentialiser, donc de réduire, les personnes migrantes à leur statut de migrant. Le cinéaste le soutient dans son mot de réponse au jury du Festival sur le site d’Entrevues : « Je dis non car je suis comme Bourgeois, un homme qui veut aller là où la nature m’amène, là où mon âme aura aisance de vie. »
Le film propulse ensuite le spectateur à la gare de Turin : le choc de la transition est rude, tant au niveau du son que de l’image, avec un passage de l’intimité des dialogues au brouhaha urbain. À Turin, Joël Akafou – auteur d’un premier volet documentaire sur l’exil, Vivre riche – filme une étape cruciale de la vie de Touré Inza Junior : “Bourgeois” décide de désobéir aux institutions – il fuit le « campo » où il doit normalement rester jusqu’à la régularisation de ses papiers – pour accomplir une dernière traversée, à savoir passer la frontière franco-italienne par les Alpes, en hiver. Le titre du documentaire prend tout son sens : la vie du sujet est réduite à ce verbe d’action – « Traverser » -, entendu à la fois comme un obstacle et un objectif, comme la cause des drames que vit le jeune homme, et le potentiel élément salvateur de toute une famille, comme lui rappelle à plusieurs reprises sa mère.
La mère, et plus généralement les femmes, sont d’ailleurs l’un des enjeux problématiques du film. Inza mange grâce aux femmes, dort sous un toit grâce aux femmes et tient moralement grâce aux femmes. D’Aminata, qui habite à Paris en attendant son amant qu’elle a sortie de prison libyenne à trois reprises, à Michelle, chez qui le jeune homme loge à Turin, en passant par Brigitte, une française fantomatique, l’existence du jeune homme semble tenir grâce à ces figures féminines. Mais les femmes face à “Bourgeois” ne sont jamais pleinement représentées, pleinement autonomisées dans le récit : elles sont constamment trompées par Inza qui vogue de l’une à l’autre afin de trouver une issue à sa situation. Alors que les institutions restent passives quant à la demande de régularisation de “Bourgeois”, celui-ci trouve refuge dans les gestes d’accueil de femmes amoureuses de lui.
Rosalie Tenaillon
***
Victoria, Sofie Benoot, Isabelle Tollenaere, Liesbeth De Ceulaer, Belgique, 2020, 71mn.
« Make my own road, walk my own way »
Un écran en format vertical. Au loin, une guirlande de petites taches lumineuses émerge de la nuit. Sur le sol, éclairé au flash d’un téléphone, un défilé de brindilles s’enroulant sous la force du vent (“tumbleweed”). Dès le premier plan de Victoria, le décor est posé : nous sommes à California City, où habite Lashay T. Warren, le personnage principal du film de Sofie Benoot, Isabelle Tollenaere et Liesbeth De Ceulaer.
À Cal City, il n’y a presque rien. Un plan aérien réalisé numériquement sur Google Maps balaye la ville, et zoome quelquefois sur des noms de rues qui apparaissent ou disparaissent au gré des déplacements. Ce qui nous était donné comme une ville s’apparente plutôt à une immense surface monochrome, un espace dénué d’hommes et d’habitations. Seules de rares maisons avec piscine font exception dans cette géographie désertique. Aucune commune mesure avec la densité de Los Angeles, que Lashay et Jordan survolent ensuite, toujours via Google Maps. Lashay s’est justement terré dans une ville fantomatique pour prendre un nouveau départ, loin de L.A et des événements violents qui y ont eu lieu. Les raisons de son déménagement sont évoquées à quelques reprises mais son histoire demeure lacunaire, tout comme sa mémoire : lui-même dit avoir oublié certains visages. Seul un nom nous parvient, celui de T. Brazey, un ami disparu.
Cal City est prête à accueillir du jeu et de la fiction pour combler cette sensation de vide, revitaliser les êtres et les choses qui s’y trouvent. Tout dans cette ville absurde devient matière à imagination. Une épave trouvée par Lashay et ses collègues est immédiatement transformée en vaisseau spatial, et investie de la figure d’E.T. Des petits trésors comme celui-ci, il y en a un peu partout : des os d’animaux dont on aimerait croire qu’ils sont ceux d’un dinosaure, un vieux pneu que les enfants de Lashay s’amusent à faire dévaler d’une colline, un coquillage émettant le bruit des vagues, un harmonica, une tortue, un serpent, une mygale, ou encore un ballon coincé dans les branches d’un arbre auquel Lashay offre un second vol. Ces micro-trouvailles ponctuent le film et gorgent l’anecdotique d’affects et de récits, tendres et drôles à la fois, pour mieux nous conter cet endroit.
Le rapport que les habitants entretiennent avec Cal City est ainsi fait de désœuvrement et d’ennui mêlés à une curiosité et à un émerveillement renouvelés. Les habitants paraissent constamment disponibles au monde pourtant hostile qui les entoure. Une disponibilité qui autorise Lashay à devenir le deuxième créateur de la ville, en la renommant Victoria. Au début du film, il prononçait des noms de lieux qu’ils ne signifiaient rien pour lui. Le changement qu’il opère lui permet de se réapproprier cet endroit ; gravant ses initiales à la craie sur une grosse pierre.
Victoria dresse le portrait d’un homme qui, bien que généralement insatisfait de la réalité, réussit à la transformer, du moins symboliquement. Après avoir prononcé le nouveau nom de sa ville, Lashay enchaîne : « Everything will be different, but still the same ». Concrètement, rien n’a changé, mais la relation de Lashay à cet endroit, elle, n’est plus la même. In fine, la victoire qu’il décroche, c’est d’avoir tenu son pari de départ : « Make my own road, walk my own way ». Un désir de souveraineté qui se traduit dans l’esthétique même du film, puisque le dispositif de tournage implique régulièrement une délégation de la mise en scène et de la prise de vue. Les images que Lashay filme avec son téléphone ainsi que son récit en voix off l’ancrent dans le processus de création cinématographique et font de lui un co-auteur de Victoria.
Malou Six
Coordonné par Elise Domenach.
Remerciements à Catherine Giraud, Elsa Charbit, Bruno Podalydès, et à l’ENS de Lyon.