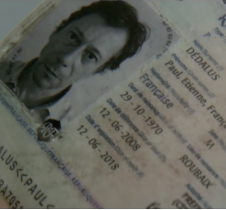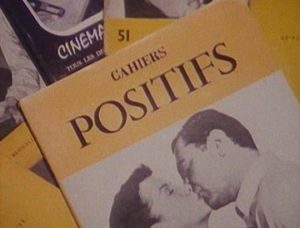Régis Sauder
On s’était dit rendez-vous dans dix ans
En 2009, Régis Sauder suit plusieurs élèves des quartiers nord de Marseille qui s’approprient La Princesse de Clèves. Ce roman leur permet de se raconter, d’évoquer le désir amoureux, un sujet qui n’a pas toujours sa place dans les conversations familiales. Ce texte, dont Nicolas Sarkozy déplorait et moquait la présence au programme du concours d’attaché·e d’administration, s’avère aussi le révélateur des inégalités de l’accès à la culture. La rencontre entre Sauder et les lycéens autour du livre de Madame de Lafayette aboutit à Nous, princesses de Clèves (2011), premier long-métrage du réalisateur. Dix ans et trois films plus tard, le cinéaste retrouve une partie de ces élèves, en majorité des jeunes femmes, devenu·es adultes et leur donne la parole dans En Nous. C’est l’occasion de poursuivre les récits des uns et des autres, et de s’interroger sur l’état d’un pays où les disparités sociales se sont encore creusées. La pandémie, le démantèlement du service public, le poids d’un monde qui continue d’assigner chacun·e à sa place : ces questions viennent lier constamment l’intime et le social dans un récit polyphonique qui a dépassé la salle de classe. Régis Sauder nous parle de ces retrouvailles qui ont fait l’ouverture du festival Cinéma du réel. [11][11] L’entretien a été réalisé lors du festival Cinéma du réel et dans le cadre de l’atelier d’écriture de critique proposé par le Master Pensées du cinéma de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Il sera prochainement complété par la publication d’un compte-rendu du festival.
Débordements : Ça fait quoi de tourner avec les mêmes personnes, dix ans plus tard ?
Régis Sauder : C’est une grosse responsabilité de re-convoquer des gens qu’on a déjà filmés. Le cinéma documentaire, c’est l’art de la rencontre, alors ce n’est pas évident de solliciter les mêmes personnes à nouveau. Ce qui était important pour moi, c’est qu’elles trouvent du sens à ces retrouvailles, de ne pas avoir à réchauffer ce que nous avions partagé, mais au contraire, de le prolonger, de l’amplifier. C’est aussi une grosse responsabilité d’en faire des personnages de cinéma. C’est l’enjeu, qu’elles nous proposent un récit de nous, de notre société et des possibilités d’y trouver sa place. J’ai gardé du travail sur Nous, princesses de Clèves le souvenir d’un plaisir immense, que j’ai toujours cherché à retrouver depuis. C’est une sorte d’étalon, peut-être pas de la réussite du film, mais en tout cas du plaisir que j’ai à le faire. Je dois dire que retrouver tout ce monde, c’était me reconnecter avec cette émotion d’il y a dix ans, qui est une émotion fondatrice pour mon cinéma.
D : Est-ce que l’idée d’éventuelles retrouvailles vous était déjà venue lorsque vous filmiez des lycéens, en imaginant les adultes qu’ils deviendraient ?
R.S. : Non, je n’y ai pas pensé à l’époque, du moins je ne l’ai pas conscientisé. Mais je n’ai jamais perdu le contact, j’ai gardé des liens très forts avec la plupart d’entre eux. C’est notamment le cas avec Laura et Morgane, que j’ai beaucoup accompagnées dans les épreuves qu’elles ont traversées, ou Sarah, dont j’avais des nouvelles régulièrement. Je n’ai pas eu à faire un effort de recherche particulier, ce qui s’explique aussi par la place qu’ont pris les réseaux sociaux dans nos vies. J’ai toujours eu la story de leur life (rires). L’idée de retrouvailles est venue de Morgane : un jour, au téléphone, elle m’a dit qu’elle avait écouté une super émission sur ARTE Radio, dans laquelle une prof à la retraite retrouvait ses élèves en banlieue parisienne, dix ans après. Je l’ai interprété comme un signe, une invitation au retour. En plus, les dix ans qui séparent les deux films ont été cruciaux pour ces jeunes, évidemment, mais pour la société française aussi. On a traversé des choses qui me semblaient importantes, même si toutes les décennies ont leurs marqueurs.
D : D’où cet enchevêtrement très sensible dans le film, entre des récits intimes qui se poursuivent et un portrait du pays aujourd’hui. Quand on accompagne ces anciens lycéens en voiture, la radio aborde l’actualité : les attentats, la crise sanitaire…
R.S. : Cette sorte de profondeur de champ sonore est très importante : c’est le bruit du monde et d’une société qui dysfonctionne. À un moment, sur les images de Morgane qui rentre chez elle, on entend la radio évoquer la crise sanitaire à l’université, la grande précarité qui s’installe. Le film se prépare alors à accueillir les propos de Sarah et d’Aurore sur la faim. Ça ne vient pas de nulle part. Autour de nous, des gens qui peuvent être jeunes, beaux, dont on n’imagine pas la souffrance, ont faim. Ces récits personnels accompagnent vraiment ce moment que notre société traverse, marqué par les désirs des uns et les impossibilités des autres.
D : Dans Nous, princesses de Clèves, on se concentrait sur la question de l’éducation et la difficulté d’accéder à la culture dans les milieux défavorisés. Dans En nous, vous vous emparez d’une myriade d’autres questions, comme la précarité étudiante ou les violences conjugales. Quand vous recueillez ces récits, d’une certaine façon vous êtes en retrait, derrière la caméra, mais en même temps vous les accompagnez, vous filmez des gens avec qui vous êtes très lié : comment arrivez-vous à tenir cette double posture ?
R.S. : Je dirais que je la tiens par un travail sur les conditions d’énonciation de ces paroles, qui ne s’inscrivent jamais par hasard dans le film : elles sont le fruit de la rencontre et de tout une relation d’empathie. J’aime profondément les personnes que vous voyez à l’écran, et elles le savent, donc quand je les filme elles sentent bien ce qui peut se dire. Ensuite, j’applique une sorte d’éthique du récit, qui consiste à la fois à soustraire quand on va trop loin dans l’intime, mais aussi à guider pour que chacun s’empare de ce qu’il a de plus important à dire. Le cinéma documentaire, c’est ménager un cadre où la parole peut intervenir en toute sincérité, et en toute sécurité. C’était déjà vrai dans Nous, princesses de Clèves : quand Albert dit son amour pour ce jeune garçon qui vit à Paris, c’était une chose que je savais mais que je n’attendais pas à recevoir avec ma caméra. À un moment, il a tout simplement senti qu’il fallait le dire, le poser, comme quelque chose d’absolument normal, qui ne faisait pas évènement. De même, dix ans après, quand Virginie parle de son expérience de femme battue, elle a besoin de l’affirmer pour son fils, pour son entourage, elle le fait de façon absolument consciente.
D : On retrouve d’abord des personnages dont la réussite nous réjouit, parce qu’ils ont quitté les quartiers nord, fondé des familles ; et petit à petit, interviennent des récits beaucoup plus sombres, par exemple avec Armelle qui a perdu son frère parce que la police ne l’a pas prise au sérieux quand elle a déclaré sa disparition, ou Aurore qui a été dans le besoin. Comment avez-vous pensé l’architecture du film en ce sens ?
R.S. : C’est l’art du dévoilement. On ne peut pas livrer ces choses plus sombres, plus dures, d’emblée. Le film doit d’abord installer la possibilité de se retrouver, de franchir une distance temporelle et géographique : temporelle puisqu’on se retrouve après dix ans, et géographique puisque ces jeunes adultes vivent désormais aux quatre coins du pays et même au-delà. Ces trajets géographiques recoupent parfois des trajets sociaux, et tout ça met le récit en tension. C’est comme ça que, dans un deuxième temps, on peut accueillir des choses plus souterraines, plus difficiles à dire. Il ne s’agissait pas pour moi de faire la success story de ces élèves. Le récit d’Emmanuelle [NDLR : la femme de Régis Sauder, qui intervient déjà dans les classes du lycée Diderot dans Nous, princesses de Clèves] a aussi un rôle à jouer dans l’architecture du film, elle permet de faire le lien malgré cette distance temporelle et géographique dont je parlais.
D : C’est important, parce que ces personnes que vous filmez ont quitté l’école, mais on sent qu’elles la portent toujours en elles. Il y a par exemple une grande valorisation des enseignants dans le discours d’Abou, quand il explique qu’il a été beaucoup porté par ses profs.
R.S. : Oui, même s’il y a aussi tout une relativisation de ce que peut l’école, notamment dans le discours de Cadiatou. L’école, c’est d’abord l’endroit de la promesse républicaine, pour employer les grands mots. Ce qui m’intéresse, c’est comment elle se transforme, comment elle est assumée par ceux qui y travaillent. On voit bien que le système est défaillant du fait d’une précarisation généralisée du service public, dans la santé comme dans l’éducation. C’est aussi ce que le film raconte, de façon très assumée. En même temps, l’école c’est aussi le lieu de la rencontre, pour les enseignants comme pour les jeunes. Le témoignage d’Emmanuelle, c’est le récit de ceux pour qui cette rencontre a du sens, de ceux qui ont cette mission chevillée au corps, et dont on se souvient plus tard. Elle n’est pas là pour dire à quel point le système éducatif est vertueux, mais au contraire, pour montrer à quel point il est fragile et à quel point cette rencontre est précieuse et nécessaire, à quel point il faut donc ménager ses conditions de possibilité, en particulier dans ces milieux-là.
D : Sur cette question du service public, s’il n’y a pas eu de vocations d’enseignants parmi les différents filmés, on en retrouve en revanche beaucoup dans la santé. Ils disent leur attachement à ces valeurs-là. À cet égard, on sent une transmission qui s’est faite.
R.S. : Oui. Et puis je crois que la transmission se fait aussi avec les enfants, puisque beaucoup des personnages sont devenus parents. Ce choix du service public, qu’incarne notamment Armelle, est un choix très profond. Elle le dit : « C’est en moi, ça correspond à ce que je suis ». C’est ce qu’illustre son parcours, c’est le service public dans ce qu’il a de plus vertueux. Le film essaie de capter cette reconnaissance réciproque.
D : En l’état, le film présente déjà une géographie très éclatée : il y a une unité de lieu dans Nous princesses de Clèves, or là on navigue entre Paris, Marseille, Lyon, la Suisse… Ça n’a pas été trop compliqué à gérer ?
R.S. : Ça l’a été du point de vue de la production. Je voulais un tournage assez resserré, car c’est un film qui est très écrit, avec un découpage assez précis. Mais quand on a commencé à filmer, on a été rattrapé par le deuxième confinement. Il y a cette phrase de Truffaut qui dit que les films sont comme des trains qui avancent dans la nuit. Je ne l’ai jamais aussi bien comprise qu’à ce moment-là : tous les jours, je croyais qu’on allait m’annoncer qu’il fallait s’arrêter. Nous étions confinés à cinq pour tourner sans contaminer les gens qu’on filmait, et éviter de retarder le tournage en tombant malade. En amont, j’avais filmé des moments importants, comme la soutenance de thèse de Laura ou la manifestation pour Adama Traoré. Parfois j’étais convoqué : par exemple quand l’exposition « Le modèle noir de Géricault à Matisse » a lieu au musée d’Orsay, c’est Armelle et Cadiatou qui m’ont proposé de filmer leur sortie.
D : Le film évite ce qui aurait pu être un écueil, la simple galerie de portraits…
R.S. : En effet, il fallait absolument éviter ça, d’où la nécessité d’une dramaturgie qui rende possible les retrouvailles et les paroles des uns et des autres. Le film est traversé par des questions qui tissent un récit de la société dans son entier, de sa fragilité comme de ses espoirs. On touche à des questions qui nous travaillent tous : quand Anaïs s’interroge sur son couple, se demande si on peut être libre et engagé en même temps, elle parle d’elle, mais je pense sans cesse au spectateur qui se pose sans doute la même question. L’essentiel, c’est de découvrir sa propre émotion au contact de l’altérité : le « En nous » ne se réfère pas qu’à eux, il intègre ce spectateur. C’est un enjeu d’écriture, de tournage, mais aussi de montage : il faut réussir à retendre ce lien, et à cet égard mon travail avec Agnès Brücker, avec qui je collabore depuis deux films, est très précieux. C’est une véritable orfèvre du récit.
D : Au sujet du montage, il y a un dialogue constant entre les images actuelles et les scènes de Nous, princesses de Clèves. On a eu l’impression qu’elles étaient parfois plus longues que dans le film. Êtes-vous retourné aux rushs pour nourrir En nous ?
R.S. : Très perspicace ! Oui, on est retourné aux rushs et on a un tout petit peu remonté certaines scènes. On l’a fait pour creuser cette idée de distance temporelle. Ce n’était pas mon intention au départ, mais celle d’Agnès : elle a vu tous les rush d’un film qu’elle n’a même pas monté. D’ailleurs c’était génial de naviguer dans ces archives, ça m’a donné envie de continuer à les explorer.
D : Vous évoquiez plus tôt l’enjeu du « devenir personnage » de celles et ceux que vous filmez. À cet égard, l’ouverture du film est intéressante puisqu’elle est presque hollywoodienne. Les derniers plans sur la grande roue ont également un côté très pop.
R.S. : Oui, pour moi c’est une question d’échelle et c’est très important : par leur récit, leur parcours, ces personnes sont plus grandes que nous, elles sont des personnages de cinéma. Pour le rendre sensible, c’était important de conserver une part de jeu. Or, grâce à cette première expérience sur Nous, princesses de Clèves, on était déjà tous des complices de mise en scène. La scène d’ouverture que tu évoques est très écrite, c’est une fiction, même si elle accueille bien quelque chose du réel. C’est une scène que Cadiatou m’a racontée et qu’on s’est amusés à rejouer : elle va dans un magasin de bijoux, est soupçonnée d’être une voleuse parce qu’elle est noire, et sort avec panache. Cadiatou dégage cette présence de combattante, dans son rythme, dans son allure. J’avais envie de la voir se balader dans son paysage parisien. Pour ce qui est de la grande roue, on l’a aperçue lors du dernier jour de tournage, alors que j’étais malade et que Sarah s’apprêtait à rentrer à Malte. La symbolique nous a frappés : pour moi c’est vraiment l’image de la transmission. La musique joue aussi un rôle central dans le film, parce que c’est leur musique. J’adore cette scène de fête avec Laura et ses amies, quand on entend Jul qui dit : « rien à prouver ». À ce moment-là, Laura ne joue pas la plénitude : elle a trouvé sa place, elle n’a vraiment rien à prouver. De la même manière, j’aime beaucoup cette scène où Armelle et Cadiatou font un karaoké sur du Aya Nakamura. Elles se donnent complètement.
D : C’est une autre force du film, cette complicité non jouée entre Armelle et Cadiatou, Aurore et Sarah. Le film fait aussi le portrait de ces amitiés qui se transforment et évoluent, non plus sur le temps quotidien du lycée mais sur des années et malgré la séparation.
R.S. : Oui, c’était important de ne pas faire que des portraits isolés, mais de montrer aussi des duos. Il y également Laura et Morgane, les jumelles semblables et différentes, sur le plan sentimental comme sur le plan professionnel.
D : Il nous semble qu’en ce moment vous préparez une fiction ?
R.S. : Oui, je suis curieux de voir comment ça va se passer, ce que ça va changer dans ma pratique. C’est surtout le rapport au plateau qui me pose question : pas tellement pour la mise en scène, paradoxalement, puisque je l’emploie déjà beaucoup. C’est plutôt l’idée de hiérarchie, de devoir donner des injonctions à un comédien… La rencontre est très différente à cet endroit. Mais je suis toujours très touché quand, dans le cinéma de fiction, on sent que le plateau a permis cette rencontre, que quelque chose s’est passé, qu’on n’est pas simplement face à un scénario filmé. En cela, le dernier film de Claire Simon, Vous ne désirez que moi, m’a beaucoup touché. C’est une proposition de cinéma très originale, et on sent qu’une forme d’écoute particulière a eu lieu sur le plateau. Le cinéma de Claire Simon m’accompagne beaucoup, comme bien d’autres.
D : Quelles autres filiations sentez-vous dans votre travail ?
R.S. : Il y a Alice Diop, je crois qu’on est travaillé par des choses communes. Nos deux derniers films sont très en lien : il y a par exemple cette importance du RER B dans Nous et du RER A dans J’ai aimé vivre là. Il y aussi l’idée de travailler sur les représentations de territoires marginalisés. Les quartiers nord de Marseille, dans l’imaginaire collectif, c’est d’abord les voitures brûlées et les Kalachs. Je ne dis pas que ça n’existe pas, d’ailleurs cette violence n’est pas évacuée dans mon film : Albert raconte qu’il vit dans une résidence fermée, ce n’est pas pour rien. Mais je pense qu’on peut faire un autre récit de ce territoire, en marge de ces représentations dominantes et très stigmatisantes.
D : Vous envisagez un troisième rendez-vous, dix ans après En nous ?
R.S. : Oui, absolument. J’ai envie de continuer l’aventure. On va forcément se retrouver, même si je ne sais pas encore comment.