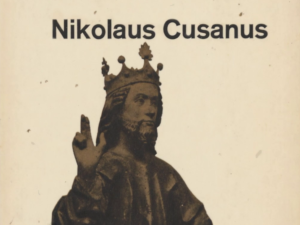Zinemaldia, 2022 (1/2)
États d’âme, états d’art
Pour sa 70ème édition, le festival de San Sebastián nous a réservé bien des surprises. Loin des dates anniversaires, nous avons profité des 70 bougies soufflées par le festival pour découvrir des talents en pleine naissance, afin de prendre la température sur le cinéma de demain.
Fort de sa longévité, San Sebastián reste un festival de premier plan pour la diffusion et la découverte d’un cinéma latino-américain qui impressionne par sa vitalité. Réunissant auteurs confirmés (Patricio Guzmán) et cinéastes émergents, la sélection d’Horizontes Latinos a globalement proposé des œuvres ambitieuses ( La Jauría, Carvão, La Hija de Todas las Rabias ), présentant l’Amérique du Sud comme un continent plein d’espoirs, malgré de grandes fragilités et inégalités entre les différentes structures de production nationales.
Venant de tous horizons nous avons voulu regrouper nos coups de cœur, défendant avant tout les auteurs et les visions nécessaires pour l’avenir du cinéma, sans pour autant taire certaines réticences. Car si l’ensemble du monde du cinéma ne fait que répéter que le septième art est en crise, rappelons que cette crise ne vient certainement pas des cinéastes. Contre vents et marées, ils et elles continuent de surprendre par leurs fulgurances. Charge aux critiques – à défaut de changer le monde, serait-ce celui du cinéma – de faire leur office : parler d’elleux.
La loi du plus fort
Parmi la sélection Horizontes Latinos, la criminalité juvénile et la présence larvée des cartels sont apparus comme des enjeux majeurs pour les sociétés sud-américaines contemporaines. Un Varón de Fabián Hernández s’ouvre sur une séquence dans un foyer de Bogotá, jouant de l’ambiguïté du mockumentaire : des hommes et des femmes interviennent face caméra, parlent de la banalisation de la violence, évoquant la fameuse “loi de la rue” faisant de l’espace public un lieu d’impunité criminelle. La frontière entre documentaire et fiction se résorbe rapidement, concentrant l’intrigue sur le parcours de Carlos, un jeune homme obsédé par les codes virilistes qui déterminent la vie dans son quartier. Toutefois le casting de comédiens non-professionnels choisis dans les rues de Bogotá ne sauve pas un récit qui, loin de déconstruire les stéréotypes accolés à la Colombie, enfonce le clou avec un scénario attendu plaçant crimes et drogues au premier plan. La caméra mobile toujours collée à la nuque du personnage réduit le décor à un flou d’arrière-plan constant : cette esthétique inspirée du jeu vidéo en troisième personne, empêche toute représentation naturaliste de la violence et provoque un étrange sentiment d’artificialité, déréalisant les événements montrés. Le long travelling avant où le protagoniste, pistolet à la main, tente en vain de commettre un meurtre pour se conformer aux critères toxiques et masculins, touche par son honnêteté naïve mais condense cette impression de facticité. Par ailleurs, les difficultés d’entrer en empathie avec Carlos découlent d’une confusion regrettable dans son combat intérieur contre les codes du quartier : le jeune homme rejette-t-il l’extrême violence, ou est-ce une ébauche de coming-out transgenre lorsque s’esquisse un jeu de reflet superposant le visage du héros avec une bouche dessinée au rouge à lèvre ? La fascination de Carlos pour le maquillage et les collants résilles, sa vie sexuelle compliquée et ses efforts constants pour se composer une apparence gangsta – longues séquences chez le coiffeur, devant le miroir de sa chambre ou occupé à essayer diverses tenues – entremêlent maladroitement ces deux sens, diluant irrémédiablement la substance du personnage.
À l’inverse, La Jauría joue l’éternelle rengaine des cartels en la subvertissant à son plus grand avantage, reprenant cette fameuse équation – meurtres, drogues et mineurs – tout en s’émancipant des clichés sur la délinquance. Mis à l’écart dans la jungle, des délinquants mineurs sont envoyés dans un centre de réhabilitation. A l’abri des regards, cette colonie disciplinaire se veut innovante en invitant les jeunes à réfléchir sur leurs actes, en expulsant leurs pulsions destructrices à travers la pratique du yoga et de la méditation. Rapidement, le spectateur est amené à entrer dans un microcosme qui, voulant supprimer la violence, ne parvient qu’à la refouler : si l’espace confiné emprisonne les personnages, ni les sévices physiques ni le travail psychologique ne peuvent mater ce que le dispositif carcéral ne sait traiter que comme une meute de jeunes loups. Les relations entre prisonniers ne sont jamais laissées de côté et prennent toujours en compte la jeunesse des détenus ; même s’ils sont contraints d’être enfermés, la camaraderie prend des allures d’escarmouches fraternelles. Des plans-séquence laissent le temps d’analyser et de vivre les relations inter-détenus, dans leurs mouvements de corps, toujours à la lisière du cadre. Décadrés, leurs conversations baignent dans cette violente fraternité : compétitions à qui est le plus timbré, à qui connaît le mélange de drogue le plus puissant à consommer (coke/weed, exta/weed ou LSD/coke). En regard de cet espace carcéral, la photographie travaille l’espace de la jungle, faisant de son entrelacs végétal un sombre labyrinthe dans lequel les héros s’enfuient, se perdent, et reviennent changés.
Plus que dans la rumeur étourdissante de la ville, la violence s’exprime avec tout son éclat dans un environnement reculé. Ce parti-pris du huis-clos a bien été compris par Carolina Markowicz qui en fait un élément narratif déterminant de son film Carvão. La violence s’introduit de manière bien plus insidieuse dans un quotidien qui semble paisible et sans histoire : héberger secrètement un baron du cartel dans la chambre de son fils pour arrondir les fins de mois, voilà l’étrange marché qu’accepte Irene, mère de famille qui s’efforce de préserver l’équilibre précaire de son foyer. Entre un mari mutique, un enfant insolent et cet invité encombrant, la cohabitation promet d’être difficile : la maison se change rapidement en une redoutable poudrière. Carvão entrelace deux logiques, celle du thriller, et celle de la comédie noire. L’intrigue hybride se resserre autour de ces personnages prisonniers de cette maison miteuse dans laquelle la poussière de la mine s’infiltre. L’équilibre précaire entre gravité et légèreté se maintient miraculeusement, grâce à des situations dont le décalage réinjecte sans cesse de la surprise dans le récit. Par métonymie, la maison dans laquelle cohabitent les personnages représente le pays entier ; l’influence du cartel et de la drogue sont dénoncés avec un humour féroce. On songe à l’entretien entre Irene et la directrice de l’école de son fils, pendant lequel l’institutrice menace d’exclure l’enfant : le gamin de neuf ans a été pris sur le fait alors qu’il tentait de se procurer de la cocaïne. Les secteurs essentiels au bien-être de la population sont rongés par la corruption : l’infirmière d’abord engagée pour accompagner le grand-père dans sa fin de vie est celle qui fait entrer le loup dans la bergerie. Profitant de la pauvreté de la famille, elle les greffe à cette logique de pots-de-vin qui, on le devine, se ramifie à travers le Brésil entier. Carvão est un film cruel, mais il ne prive pas ses personnages d’espoir : le cycle de l’humiliation peut être rompu, et les moutons pourraient bien mettre le loup en pièces. Pari réussi pour un film qui ne tombe ni dans le pathétique ni dans le spectaculaire, et qui montre la violence imposée et subie comme un enjeu politique majeur du Brésil contemporain.
L’orage du désir gronde, libérez la femme
Gangs, stupéfiants et violence juvénile sont aux antipodes du portrait de l’adolescence que propose Carmen Jaquier dans Foudre , qui abandonne cependant la brutalité contemporaine et va folâtrer dans les Alpes suisses à l’aube du XXème siècle aux côtés d’Elizabeth, jeune femme de dix-sept ans qui doit laisser derrière elle le couvent pour retourner auprès de sa famille de paysans montagnards. Les paysages sublimes et bucoliques envahissent l’écran de leur sensualité contagieuse dès l’ouverture. Elizabeth est une jeune fille en fleur dont le désir s’éveille au contact du monde, comme enchantée par la fécondité brûlante de la terre. L’éducation religieuse et austère s’érode rapidement sous le courant irrésistible d’une sexualité neuve, que l’héroïne découvre en lisant le journal intime de sa sœur aînée Innocente. D’abord traitée de traînée par les adolescents mâles qui ne peuvent s’empêcher de graviter autour d’elle, Elizabeth devient la prêtresse d’un nouveau désir amoureux : allongés à ses côtés, têtes docilement posées sur la poitrine de la jeune femme, les garçons agressifs se sont métamorphosés en doux agneaux. On déplore une candeur frôlant la mièvrerie de ces ébats, où les corps filmés en très gros plans sont découpés et fragmentés. En voulant filmer le lien cosmique naissant du rapport sexuel, Foudre pêche par cette excessive soif de transcendance : les personnages se perdent et le contact peine à s’établir, laissant moins transparaître l’amour universel qu’un mysticisme au lyrisme emphatique. Cette déconnexion des corps mine les relations et affaiblit considérablement l’utopie polyamoureuse, célébrant la beauté féminine hiératique autour de laquelle les hommes s’agglutinent. En dehors d’un timide baiser, les garçons ne s’offrent que peu de tendresse, et le désir demeure hétéronormé, loin de l’orgie pansexuelle promise. Mais le scandale éclate dans le village, et c’est bien évidemment Elizabeth qui devra payer, subissant tentatives d’exorcisme et mise au ban dans le chalet familial devenu cellule. Le désir féminin est du côté de la rébellion absolue et irrépressible, malgré l’étau qui tente de le museler. Les voies de l’émancipation sont innombrables, carnet griffonné que le feu n’a pas brûlé ou brassées d’orties frottées à même la peau.
L’ancrage du récit dans un cadre historique passé permet à Foudre de mobiliser légendes locales et rites folkloriques. Dans une séquence de danse nocturne autour d’un grand brasier, jeunes garçons et jeunes filles se tournent autour, se frôlent et se provoquent dans un ballet hypnotique. Les masques dont sont couverts les visages des adolescents donnent un aspect monstrueux et bestial au désir, à la manière de jeunes faunes dont le jeu peut tourner à la violence en un éclair. La Piel Pulpo choisit un tout autre régime narratif, construit sur la dichotomie entre un espace insulaire hors du temps et une grande ville moderne. Entre ciel et mer, la jeune Iris grandit avec sa famille sur une île isolée. L’intimité partagée avec son frère jumeau et sa sœur constitue le pilier de ce foyer régi par une mère célibataire. Le quotidien est d’une quiétude apaisée, au contact de la faune océanique. Mais l’équilibre fragile vole en éclat le jour où la curiosité d’Iris la pousse à s’aventurer loin de ces rivages hors du temps, vers la ville et la civilisation moderne. Cette fugue hors du cocon familial constitue un point de bascule qui pose le récit comme une énième variation autour du mythe du sauvage, à la suite de Robinson Crusoé et autres Vendredi. Toutefois au-delà de cette opposition un peu élimée du sauvage et du civilisé, le récit se concentre sur la métamorphose progressive d’Iris : les derniers feux de l’enfance s’éteignent, et l’adolescente accède à une sensibilité nouvelle. Le parallèle avec la découverte du mode de vie libéral et consumériste n’est malheureusement pas exempt d’une certaine lourdeur. Maquillée et habillée de légers vêtements affriolants, Iris teste son pouvoir de séduction en se déhanchant sur les basses saturées d’une boîte de nuit. Le sexe partagé avec un inconnu rencontré dans la pénombre moite de la discothèque est dépourvu de complicité, et c’est avec une froideur stupéfaite que l’homme reçoit, incrédule, les chatouilles de la jeune femme. Aucun jeu dans ce rapport charnel, et Iris s’en retourne sur son île avec le goût amer de ce contact insensible.
En accordant le primat à la sensation, La Piel pulpo fait l’étonnant récit d’un autre rapport au monde, remettant en question les normes humaines au regard d’un devenir-animal des personnages. Le désir sexuel est présent dès le début du récit, comme un besoin naturel qui s’assouvit avec une simplicité désarmante. On songe à cette saisissante scène de masturbation collective où les trois membres de la fratrie se caressent individuellement, mais dans la même pièce. Il y a une certaine fraîcheur à la découverte progressive du quotidien de cette famille, échappant à nos schèmes ordinaires. Par ailleurs les deux jumeaux, bien qu’en pleine adolescence et de sexes différents, dorment encore enlacés comme des chiots. Aucun caractère malsain ou incestueux ne souille ces interactions, au contraire le spectacle de cette intimité expérimentée en dehors des cadres socialement construits invite le spectateur à se questionner sur l’expression de ses propres affects. Le corps est bel et bien au cœur du film : la parole se fait rare, non essentielle à la communication. Lors de nombreuses scènes de jeu, les adolescents miment des animaux, grognant à quatre pattes. Seul le contact physique et la tactilité sont nécessaires pour souder le lien du sang. Ainsi, si La Piel Pulpo évoque la transformation du désir à l’âge de l’adolescence – thématique travaillée à d’innombrables reprises –, la singularité de son approche produit une déconstruction poétique de l’érotisme, de la pudeur et de la sexualité juvénile.
La naissance et l’affirmation du désir occupent des places centrales dans les films de la sélection qui ont été nombreux à se construire autour de personnages féminins, d’âges et de milieux très divers. Si la pieuse Elizabeth et la sauvage Iris sont des figures d’émancipation qui parviennent à vivre leur sensualité, d’autres héroïnes n’ont pas cette chance. Quittons le conte pastoral et l’utopie rustique : avec On either side of the pond , le réalisateur Parth Saurabh propose le récit d’une quête impossible de liberté pour une jeune femme de l’Inde actuelle.
La pluie tombe doucement, le sol est boueux. Derrière les murs sombres d’un hôtel délabré, vit un couple. Sans argent et coupée de sa famille, Priyanka lutte contre la misère et s’efforce de pousser son compagnon, Sumit, à retrouver du travail. Mais Sumit est aussi insouciant que paresseux, et l’urgence de la situation ne semble pas suffisante pour entamer son oisiveté. Des longs plans fixes s’articulant comme une suite de tableaux, permettent une forte immersion dans le rythme contemplatif du récit : les détails de l’environnement, urbains ou domestiques sont offerts à l’observation. Si la photographie est soignée, elle ne cède pas à un esthétisme aseptisé et conformiste. Le ciel est chargé de nuages sombres et houleux qui défilent inlassablement ; les bâtiments en ruine ont la beauté mélancolique de la déréliction ; le sol rendu boueux par la pluie reflète cette atmosphère opaque et maussade baignant les lieux.
La condition féminine constitue l’enjeu central du film. Si Priyanka cherche à s’émanciper, elle se heurte à des limites infranchissables. Sa fuite avec Sumit, dont elle était tombée amoureuse, est un acte de rébellion contre le mariage arrangé, une tentative d’affranchissement de son existence en rupture avec sa famille. Priyanka représente une minorité de femmes qui luttent et s’efforcent de se défaire de ces phénomènes d’oppression – son entrevue avec une amie qui a accepté le mariage arrangé livre un bref aperçu. Mais la situation de Priyanka ne fait qu’empirer : sa proposition de travailler à la place de son mari est balayée par celui-ci, son devoir étant de s’occuper d’un espace domestique triste et vétuste. Le point d’acmé est atteint quand, poussée à bout, elle tente de quitter Sumit, prête à retourner dans le réseau familial d’oppressions pour fuir le quotidien misérable aux côtés de son époux. Malgré toutes ses tentatives, Priyanka reste à la merci des hommes dans ce système tentaculaire dont elle ne peut s’échapper.
On either side of the pond raconte la lutte de deux mondes en opposition, sans jamais montrer explicitement ces affrontements. Les difficultés de la vie quotidienne viennent subtilement esquisser une réalité ultracontemporaine, bien loin de l’atemporalité de La Piel Pulpo ou du charme désuet de Foudre : les conséquences de l’épidémie du covid sur l’économie du pays pèsent largement sur les personnages face à l’urgence de devoir retrouver un emploi dans un monde en crise, avec de nouvelles contraintes sanitaires. Le port du masque n’est pas dissimulé, et pallie cette amnésie volontaire produite par l’absence de ce nouvel accessoire du quotidien au cinéma.
On either side of the pond se construit d’un bout à l’autre sur cette logique ambiguë qui éclaire le dénouement : la fin ouverte montre simultanément la liberté de Priyanka, poussée jusque dans ses retranchements face aux chaînes qu’elle ne saura rompre. Ce constat pessimiste d’une émancipation impossible n’est toutefois jamais montré de manière univoque, laissant planer des ombres sur ce qu’il adviendra des personnages. Les actions des protagonistes reflètent la grisaille du paysage : sombres, voilés, dans une suspension brumeuse et énigmatique de leur devenir. Des fulgurances traversent le récit et portent l’espoir d’une libération, portée par la rage de l’héroïne. Totalement ivre, Priyanka se moque de son époux et le frappe à plusieurs reprises, sans que ce dernier ne sache réagir face à l’assurance de sa compagne. Tyrannique, inquiétant, ce nouveau visage de Priyanka montre que le désir bridé et la liberté refusée s’accumulent à l’horizon comme des nuages orageux. L’orage est prêt à éclater, prenons garde à la foudre.
Amnésies post-modernes
Reconfiguration des attentes, morcellement des intrigues, la vie est longue pour les tentations postmodernes du cinéma et leur cortège de fausses subversions des structures narratives, de doutes constants (venant à nous demander de quoi l’on doutait en premier lieu) et de mépris par principe du sentiment ; au risque de tomber dans leur propre pastiche. Nagisa, première tentative de long pour Takeshi Kogahara, s’efforce au récit morcelé. Un accident de voiture, une femme qui hante un tunnel, sur une toile de fond de secrets de famille motivant les deux autres éléments, voici les pièces du puzzle offertes à la compréhension. Avec des séquences réfutant toujours ce qui est avancé, le trouble est à son plus haut point. Dans une atmosphère aux néons sanguins, la composition des couleurs agit comme un jeu synesthésique, où l’image, plutôt que vectrice d’un élément narratif concrètement intelligible, agit plutôt par sensations. Cette aventure sensorielle semble nous inviter sur la voie d’une confuse méditation : ne virant jamais totalement dans l’expérimental mais cherchant toujours à déployer un récit qui ne refuse pas complètement l’intrigue, le film stagne à la confluence entre le récit et l’expérience.
Roleless, semble alors le pendant des morcellements de la mémoire. Dès ses premières secondes, vous pensiez voir un film de samouraï ? Raté. Nous sommes sur son tournage. “Samouraï 1 en place, Samouraï 2 en attente, Samouraï 3 à toi” indiquent les gestes rapides et silencieux d’une opératrice aux figurants. Ainsi s’ouvre Roleless . En guise de prière d’insérer, la première image est déconcertante à juste titre : un motif régulier et monochrome brouille notre perception. Vagues immobiles sur mer de plomb, drapé d’ardoise, taffetas en fer, autant d’images traversent l’esprit. Le film s’amuse à brouiller les repères des spectateurs, tout en laissant traîner des indices. A peine le plan chassé, la réponse est trouvée : une toiture aux tuiles de zinc.
Le film co-réalisé entre Masahiko Sato, Yutaro Seki et Kentaro Hirase met au premier plan un métier de l’ombre. Responsable d’une ligne de téléphérique, Miyamatsu est figurant à ses heures perdues. Heureusement loin de l’idée de making of du « moment de gloire » d’une poignée de figurants, c’est bien un travail qui nous est montré, avec des tâches à exécuter, si ce n’est celle de se faire exécuter. Le personnage s’attache à suivre les indications qu’on lui donne, dans un quotidien réglé et calibré où chaque action est déterminée en amont. Pénétrer dans l’arrière-plan s’avère troublant pour le spectateur, constamment secoué par de multiples revirements.
D’un geste fin, le trio de réalisateurs s’emploie à nous faire systématiquement douter des images présentées. Exécutant remarquablement leur geste (rappelant celui d’Edward Yang, dans un de ses premiers longs-métrages The Terrorizers), impossible de croire ce que l’on voit. Un soupçon pèse sur l’image et hante le spectateur jusqu’à le troubler à chaque seconde. En effet, l’identification d’un tournage dans le film se fait uniquement grâce aux techniciens et personnels qui travaillent sur le plateau. Aucun rail de travelling, aucune caméra n’est visible, rendant la porosité avec le réel encore plus grande. Tout repose sur le rôle de chacun, surtout pour les techniciens essentiels mais d’ordinaire “roleless”.
Nagisa et Roleless ont en commun de vouloir nous pousser dans les affres de la mémoire. Chacun à leur manière les récits se diffractent, mais le dernier conserve une structure retrouvant petit à petit la mémoire, où les pièces du puzzle nous sont données en même temps que le personnage principal. Nagisa essaye de faire planer cette perte de souvenirs dans une amnésie généralisée contaminant tous les plans, sans aucun rail auquel s’accrocher. Si la tentative est intéressante, les bouts du miroir sont tellement déplacés et brisés qu’il est absolument impossible d’y reconstituer un canevas général.
Plutôt que le mièvre doute postmoderne de Nagisa , Roleless préfère une représentation systématique de l’oubli. Nous regardons un miroir prismatique où les rayons de mémoire diffractée font de l’oubli une position confortable. Roleless devient alors une leçon sur l’oubli et la liberté. Suite à de multiples rebondissements et leurres, croire qu’effacer le passé rend libre, est l’énième leurre du film. Or le film se conclut avec une dernière séquence aussi jubilatoire que glaçante. Avec un terrible retournement de situation, les cigarettes Hope (nom d’une ironie savoureusement grinçante) permettent à Miyamatsu de retrouver la mémoire, mais c’est là un nouvel effet indésirable du tabac. Jamais la madeleine de Proust n’aura été aussi amère.
Lâchez les chevaux !
Après avoir primé Jean-Gabriel Périot, Damien Manivel, et cette année Hlynur Pálmason avec Godland , la sélection Zabaltegi-Tabakalera reste fidèle à son identité éclectique et à son goût pour le cinéma expanded comme pour l’expérimental. En mettant sur un pied d’égalité courts, longs et installations vidéo, c’est sans doute la sélection la plus surprenante du festival, où la déception s’est faite rare.
Aux partis-pris forts et assumés, il y a tout d’abord le séisme Ann Oren (voir l’entretien que nous lui avons consacré). Annoncé depuis Locarno, son premier long-métrage Piaffe défie toutes les attentes. Occupant un rôle que le cinéma a tendance à reléguer en fin de générique, Piaffe donne une prime importance au son et au métier de bruiteur. L’ajout singulier d’une queue en crins sur le corps d’une bruiteuse suffit à nous entraîner dans la cavalcade sonore de ce cheval imaginaire. Venue des arts visuels et continuant les expérimentations entamées dans son court-métrage Passages, Oren invoque à nouveau le thème du double avec des personnages toujours pris dans des relations d’attraction et de répulsion. Avec un extrême soin plastique, Piaffe reconsidère tous nos mouvements et nos façons de percevoir le monde. Déclinant le motif du piaffere – pas de dressage voulant l’excitation constante du cheval tout en l’empêchant d’avancer – le film se propose comme bestiaire de nos piaffe quotidiens.
Passerelle vers le court, présenté conjointement avec Piaffe le court-métrage de Peter Strickland résonne comme une parenthèse onirique, explorant lui aussi les possibilités plastiques de l’image. Si Oren propose des décors en décalage avec leur temps, à la fois ancrés dans la contemporanéité, Strickland continue toujours dans sa recherche formaliste du décor “carton-pâte” développée à fond dans Blank Narcissus (Passion of the Swamp) . Un vieux réalisateur de films pornos retrouve une cassette dans ses archives personnelles et commente en off les images de ce film supposément tourné des dizaines d’années auparavant. Présenté comme une œuvre de porno gay se passant sous le manteau et fait avec peu de moyens, l’argument est simple : un aventurier se fait charmer par l’esprit de la forêt avec qui il se met à avoir des relations charnelles.
Le commentaire, fait par une voix tremblante par l’âge, le manque de vitalité et un humour plein d’ironie, développant tout le ressort comique de la situation. Du comique naissent des moments remplis d’une poétique réfléchissant sur le désir. Le réalisateur a perdu toute trace de son acteur, amant d’alors. Du pastiche pornographique, il ne reste qu’une lente nostalgie qui trempe dans le kitch gluant de ces images nostalgiques. L’épreuve de l’âge se ressent dans les réactions érotiques du réalisateur, dans lesquelles, même si son nom comme son visage nous sont inconnus, sa voix marquée par le temps décrit un désir charnel toujours puissant, aussi vif qu’alors, mais indéniablement contrarié par l’affaiblissement physique du corps.
Extrêmement vraisemblable malgré son artificialité affirmée, ce mockumentaire replonge dans le cinéma underground des années 1970. Ces films ne passant que dans des circuits pirates, faits pour être vus que par certains, justifient ce décor tout droit sorti d’un trip sous LSD fait de récup’, où les pénis ne devaient être vraisemblables pour éviter toute forme de censure et de poursuites judiciaires. Avec des images supposément tournées en 1972, Strickland reconstitue un monde fait de bric et de broc, aux fantaisies les plus délirantes les unes que les autres, illustrant une époque pleine d’insouciance avant l’épidémie de SIDA. Le salut ne peut venir que d’une malencontreuse cassette retrouvée au fond d’une boîte. Une lettre d’amour à toutes ces cassettes jamais retrouvées, mais toujours aimées.
Politique de l’ennui
Toutefois tirer sur sa bride pour ralentir la cadence s’avère parfois d’autant plus audacieux. Ainsi, le deuxième long d’Anders Emblem, A Human Position séduit par ses pauses et ces instants de quiétude.
Nous sommes emportés dans le rythme routinier d’un couple bien installé dans une ville reculée de Norvège. L’une est journaliste et enquête sur la politique migratoire norvégienne, l’autre poursuit une passion pour les chaises. À elles deux, leurs quêtes rendent compte de cette ambiance désabusée dans les pays dits riches, dans ce pays élu à répétition comme “meilleure démocratie du monde”, où de vraies luttes sociales et des motifs de lutte sont sous-jacents. Pour contrer l’effet “complainte des privilégiés”, Anders Emblem déplace avec intelligence la question et développe son film autour de la nécessité de continuer à lutter pour préserver droits et avancées sociales, jamais totalement acquises, surtout quand elles ne sont pas défendues. Ainsi, par sa position de retrait qu’exige sa profession, la journaliste analyse les mécanismes et les luttes d’un pays apparaissant comme parfait, mais chasse ses migrants, limite son immigration par des leviers parfois teintés de corruption. Lentement, mais sûrement, la pensée a le temps de se poser et nous voyons une enquête en temps réelle se dérouler, avec les hésitations, les doutes, les liens et la compréhension nécessaires pour traiter un sujet de fond.
Dans un festival où bien des films excellent à nous aveugler par l’absence de profondeur de champ, avec des caméras portées vides de sens, l’image ici, n’y rechigne pas. Dans des images comparables à des clichés faits à la chambre photographique, chaque plan fixe contribue à une atmosphère de méditation. Si richement composés, les plans de A Human Position foisonnent de détails. Fixes et longs, ils évitent toute forme de didactisme. Dans un plan fascinant, la caméra se trouve à l’intersection entre deux rues parallèles, l’une montante, l’autre descendante. La perception brouillée par ces rapports spatiaux, croit à un split-screen alors qu’il n’y a bien qu’une image. Dans notre regard porté sur l’œuvre, nous sommes constamment renvoyés à notre position d’humains, toujours partiale, parfois contradictoire. Emblem nous offre le temps d’observer chaque détail, surtout ceux qui nous échappent.
Ainsi, A Human Position ne cherche jamais à imposer un seul point de vue. Avec justesse, les moments sont toujours aigres-doux, on ne sait jamais si on s’ennuie ou si on s’y plaît. L’ennui routinier rassure, mais d’un autre côté nous ne sommes jamais certains du bonheur de ce couple, sans pour autant être assurés de leur malheur. Si toutes deux finissent par trouver l’objet de leur quête, de la parution de son article à la une du journal, à la trouvaille d’un modèle de chaise extrêmement rare, elles n’en sont pas pour autant satisfaites. Il y aura d’autres scandales, d’autres modèles rares de chaises. Non, le bonheur se trouve dans le plaisir à s’ennuyer.