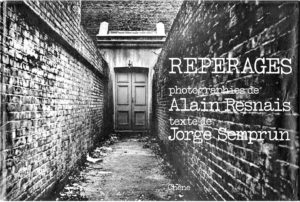Showing Up, Kelly Reichardt
Les Bouches de la Terre
Pierre Jendrysiak : Kelly Reichardt a-t-elle réalisé autre chose que des thrillers ? C’est le genre auquel appartient objectivement Night Moves, ou la seconde partie de First Cow ; La Dernière Piste est un film hybride, entre film « d’auteur », western et thriller ; et ses autres films, de l’animosité grandissante entre les deux amis de Old Joy au récit de survie de Wendy et Lucy, créent aussi ce « frisson » d’inquiétude qui donne son nom au genre. En prenant ses films comme des thrillers (tantôt champêtres, tantôt politiques, tantôt « westerns »…), on comprend que Reichardt ne saurait être seulement décrite (et donc réduite) comme une cinéaste « contemplative » : la durée des plans, la somptuosité de la photographie, l’humilité générale sont moins les éléments d’un cinéma apaisé et coquet que des composantes nécessaires à la création d’une tension presque existentielle – et politique. Showing Up poursuit ce geste, et le pousse peut-être encore plus loin. Lizzie y partage sa vie entre un travail alimentaire dans les services administratifs d’une école d’art et son travail de sculptrice (le film suit les quelques jours qui précèdent le vernissage d’une exposition de ses œuvres dans une petite galerie locale), et au fur et à mesure que les jours passent, des petites crispations, des dangers, des sources d’inquiétude apparaissent dans sa vie : sa chaudière qui met du temps à être réparée, les sculptures qui n’avancent pas comme elles devraient, son frère paranoïaque (Sean), et, au centre de l’intrigue, ce pigeon attaqué par son chat, dont Lizzie est obligée de prendre soin quand son amie-voisine-proprio Joe le retrouve blessé…
Lucie Garçon : Lizzie est d’ailleurs tendue dès le début du film, presque inquiétante, même, dans sa manière (spectrale) de se tenir au seuil de chez Joe, pour lui expliquer qu’il faut bien qu’elle puisse prendre une douche. À mesure que le film avance on se dit qu’elle a beaucoup de raisons de perdre son sang-froid. Joe qui donc, a l’ascendant économique, est également artiste, et sensiblement plus productive qu’elle. Pour lui payer son loyer, Lizzie travaille dans les bureaux de son ancienne école d’art et sa supérieure, qui n’est autre que sa mère, se montre pour le moins dédaigneuse. Sans parler du père qui se laisse envahir par un couple de pique-assiette… Avec l’irruption du frère fêlé, on atteint le sommet, je crois, dans la référence au thriller : il creuse dans son jardin, à la manière des figures paranoïaques ou oppressées qui peuplent ce genre (comme le père de famille de Take Shelter par exemple). Avec tous ces « éléments perturbateurs », le doucet suspense lié à l’échéance du vernissage prend un tour psychosocial assez sérieux.
P. J. : Et en même temps, le frisson est comme un parfum dans l’air, un sous-entendu qui grandit scène après scène – et rien de plus, puisqu’on esquive subtilement le moment normalement inévitable où cette tension devrait aboutir à un climax, une explosion (par exemple celle, littérale, qui se produit au milieu de Night Moves). Cette explosion n’arrive jamais, ou elle reste toujours étouffée, comme lorsque Lizzie laisse finalement un message sur le répondeur de Joe : elle est certes en colère (elle répète plusieurs fois le mot « fucking »), mais reste égale à elle-même et à l’interprétation presque monocorde et très subtile qu’en donne Michelle Williams, fermée, tout en retenue (elle dit par exemple, presque dans un soupir, « It’s such a total drag ! », expression qui semble bien en dessous de la situation). La douceur de ce film, comme de tous les films de Reichardt d’ailleurs, n’a rien de mielleux, d’apaisé : c’est toujours une colère contenue.
L. G. : Ce que je trouve intéressant c’est la place qu’occupe l’œuvre de Lizzie dans ce film (qui donc, ne devient pas un thriller), sachant qu’avec cette affaire d’expo, cette œuvre se présente quand-même comme son leitmotiv. On pourrait voir Showing Up comme un film sur le rapport entre l’art et le reste de la vie des artistes. Le problème c’est bien, pour Lizzie, de trouver le temps, l’espace et la disponibilité pour sculpter, de protéger son activité artistique des aléas de sa vie quotidienne. Son chat qui a faim, puis ce pigeon, et son sentiment de culpabilité, sont envahissants… Malgré tout, compte tenu de tout le contexte socio-affectif assez borderline qu’on a évoqué, ce qui frappe c’est l’autonomie de son œuvre, finalement. Celle-ci se fait. L’une de ses sculptures est légèrement brûlée (peut-être à cause de Joe…), mais ce n’est pas en raison d’un accès d’humeur de Lizzie.
Que dit-elle, cette œuvre, de la vie de Lizzie d’ailleurs ? On sait simplement que l’une d’entre elles représente Joe. On a tout loisir de penser que le médium (l’argile) que Lizzie privilégie, lui vient de son père céramiste, que les « poses » sont inspirée des silhouettes qu’elle observe de loin, pendant sa pause du midi ou sur son temps libre… mais le film n’est pas démonstratif du tout sur ce que ces sculptures doivent à son quotidien ou à son histoire personnelle. Aucune scène ne fait de l’acte créatif, dans ce qu’il pourrait contenir de rage ou d’emportement, un spectacle. Rien n’oblige à penser que Lizzie convertit ses contrariétés en énergie artistique, ou qu’elle compense un sentiment de frustration en sculptant. Sur ce point Showing Up m’a évoqué le Van Gogh de Maurice Pialat où l’humeur agitée du peintre, associée, dans l’imaginaire contemporain, à son génie pictural, se voit réduit à quelques grommellements hors-champ, de rares coups de pinceau un peu plus brusques que d’autres. Comme Pialat, Reichardt a préféré mettre l’accent sur la vie sociale, autour de l’artiste, plutôt que sur son bouillonnement intérieur. Pourtant les sculptures de Lizzie, dans leur grande modestie (elles sont de petite taille, figuratives, le matériau n’a rien d’innovant…) ont une présence remarquable à l’écran. Il faut dire que Lizzie leur parle. Elle s’excuse auprès d’elles, lorsqu’elle les modifie. Si la sculptrice a tout de même un petit « grain », en voici l’expression… délicate, très légère.
J’aime beaucoup la scène que tu évoques, où Lizzie passe une série de coups de fils pour apostropher ses proches. Devant elle se dresse cette jolie sculpture d’argile légèrement brûlée. Sur le plan dramaturgique, c’est la « crise » : Lizzie, qui est particulièrement minutieuse, est face au choix d’inclure ou d’exclure cette pièce dans son exposition. Sur la bande parlée, il est question — si je me souviens bien — de sa chaudière, du pigeon, de son frère… et de fil en aiguille, d’un certain désordre ambiant, d’une absence de considération pour son projet artistique mais jamais de cette sculpture brûlée. Celle-ci n’en est que plus visible. D’ailleurs Kelly Reichardt lui consacre un contre-champ qui, comme d’autres dans le film, lui insuffle quelque chose comme de la vie… ou du moins, comme un regard, une certaine autonomie. Cette séquence est un point culminant du film, le moment où se manifeste le plus ce parallélisme strict entre le l’art et la vie, qui fait, je trouve l’originalité de ce film sur l’art. Le rapport entre les gestes et les choix artistiques de Lizzie, et les autres faits de l’intrigue de Showing Up, est absolument indéfini. Sa sculpture et le reste de sa vie pourraient n’être que synchrones, coïncidents.
P. J. : Il est certain que le film sort assez élégamment de tous les clichés sur la relation entre « la vie et l’art », en faisant de Lizzie une artiste modeste qui sculpte (et dessine, puisque le générique de début montre de belles esquisses préparatoires) dans son « temps libre ». Il y a moins des « affres de la création » (qui se fait de manière méthodique, organisée, comme tout dans la vie de Lizzie) que des affres de la vie quotidienne, et les deux cohabitant avec peine, se nourrissant moins l’un l’autre qu’ils n’entrent en opposition : Lizzie prend un jour de congé pour préparer l’exposition, et finit par passer l’après-midi chez une vétérinaire pour s’occuper du fameux pigeon blessé. C’est peut-être le fait de montrer concrètement ce qui entoure la création qui permet de prendre « au sérieux » les œuvres de Lizzie, et qui permet au champ-contrechamp que tu décris de ne pas rendre ces œuvres ridicules ou superflues, mais au contraire indépendantes – puissantes même. Un des grands enjeux des films (de fiction) sur l’art est de donner aux œuvres une existence autonome, de faire croire que ce sont des vraies œuvres d’art et pas des simples accessoires de cinéma, ce qui est à mon avis fait brillamment ici. Showing Up devait d’ailleurs initialement être un film biographique sur l’artiste canadienne Emily Carr, projet abandonné lorsque Reichardt s’est retrouvée confrontée à la renommée, à l’aura de cette artiste, pourtant méconnue ; il fallait que ce soit une artiste anonyme, sujet qui sied bien à la subtilité fermée de ses films (même si la rencontre avec une artiste en résidence et une galeriste new yorkaise, lors du vernissage final, laisse imaginer une évolution dans sa vie artistique – mais ça, ce serait pour un autre film…).
Cette subtilité avec laquelle la réalisatrice filme (et monte, puisqu’elle est la monteuse de presque tous ses films, y compris celui-ci) cette coexistence de la vie artistique et de la vie quotidienne s’explique peut-être par le fait qu’il s’agit, aussi, d’un subtil autoportrait : Reichardt elle-même a enseigné à l’Université de New York puis au Bard College, et a parfois expliqué que c’est cette carrière universitaire qui, en lui offrant un salaire stable, lui permettait de faire ses films en toute indépendance. Plus concrètement, le film se nourrit de plusieurs détails de sa vie : le quartier où vit Lizzie est un quartier d’artistes qu’elle connaît bien, et les œuvres sont celles de la sculptrice Cynthia Lahti, qu’elle connaît personnellement. Peut-être est-ce, après le déménagement dans le Montana dans Certain Women (elle a tourné la plupart de ses film dans l’Oregon) et le récit historique et très masculin de First Cow (parfois même décrit comme un film queer), une manière de revenir « à la maison », de faire le point en revenant à des choses plus fondamentales pour elle, y compris sa propre manière d’être artiste.
Je repense à ce très beau personnage dont tu parles, Sean, le frère de Lizzie. Lui aussi est confronté à ce rapport compliqué entre la vie et l’art : quand Lizzie lui rend sa seconde visite, un beau plan le montre de dos, se tenant debout dans un des trous qu’il a creusé, en train d’attaquer frontalement la terre à coups de pelle. Il explique alors que creuser ces trous, c’est « faire œuvre », il explique même qu’il cherche à faire parler « les bouches de la terre ». C’est donc, chez lui aussi, une volonté artistique qui se manifeste, différente parce qu’elle ne s’intègre pas dans le même quotidien, le même rapport au monde : Sean vit isolé, on comprend que sa famille lui rend rarement visite, qu’il n’a pas vraiment d’amis, qu’il ne travaille pas, etc. Peut-être que pour Kelly Reichardt, la création n’est pas un luxe ou un « supplément », mais une part de la vie qui se manifeste d’une manière ou d’une autre chez tous les êtres humains (presque tous les personnages du film sont artistes), et dont l’expression est moins déterminée par une inspiration venue d’ailleurs que par les conditions matérielles dans lesquelles nous vivons – comme l’écrivait bien Florent le Demazel à propos de First Cow, si les pionniers risquaient leur vie en volant le précieux lait qui leur permettait de préparer de délicieux beignets, ce n’était pas seulement pour s’enrichir, mais pour démocratiser les raffinements de la cuisine que le propriétaire de la vache gardait pour lui. C’est peut-être là que se loge la part politique de Showing Up : considérer que la création dite « artistique » n’est pas une excentricité, mais une nécessité.
L. G. : D’ailleurs j’y pense : ce projet de « faire parler les bouches de la terre » est un peu décalé, par rapport au tableau clinique dans lequel le film aurait pu enfermer ce personnage du frère (il aurait pu poursuivre un objectif plus typiquement paranoïaque, comme lever le voile sur un crime imaginaire ou autre…) ; en revanche il amène la thématique des profondeurs, l’idée d’une énergie enfouie, primordiale… liée, à l’entendre, au fait de « faire œuvre ». Faire parler les bouches de la terre c’est, en somme, faire advenir du sens à partir d’une matière informe : ce pourrait être une définition de l’art, aussi fondamentale qu’archaïque, que Sean, ici, caricature.
De nombreuses images de Showing Up sont aussi consacrées aux ouvrages des étudiants de cette école d’art que Kelly Reichardt a fait revivre pour le tournage. Elles permettent de découvrir toute une variété d’expérimentations, de gestes, de médiums, de préoccupations artistiques (des problèmes de fermeture éclair, par exemple…) : tout le fourmillement feutré de cette institution artistique. Ces images sont irréductibles à des plans de transition, mais elles ne servent pas vraiment le drame principal non plus : Lizzie et ses proches communiquent assez peu avec ces étudiants. Elles restent donc parallèles – au sens où on le dit d’un montage entre des éléments qui ne sont pas destinés à se rencontrer dans un film. Ce qu’elles disent, en somme, c’est que parallèlement au drame, de l’art se fabrique. Ça sculpte, ça branche, ça projette, ça peint, ça installe, ça tricote et (tant que les conditions matérielles le permettent) ça n’arrête pas. C’est bien plus qu’un décor, cette école, c’est un agencement collectif qui fait presque personnage : comme une sorte d’hydre artistique souterraine, sous-jacente au scénario.
P. J. : Quand je décrivais cet impératif, dans les films sur l’art, de « faire croire » à la réalité des œuvres filmées, je pensais bien entendu à La Belle Noiseuse, un film qui compte beaucoup pour moi et qui, comme le Van Gogh de Pialat (les deux films sont d’ailleurs sortis à quelques semaines d’écart), a poussé la mise en scène de la peinture au cinéma à un niveau inégalé. Or dans La Belle Noiseuse, la question d’une définition ou d’une origine de l’art, enfouie, « archaïque » comme tu dis, est posée caricaturalement, jusqu’au ridicule (il y a une scène où Emmanuelle Béart est prise d’un fou rire à l’écoute des délires de Michel Piccoli-Frenhofer…), et dans des termes qui rappellent ces « bouches de la terre », puisqu’il est question de « maëlstorm », du « grand tohu-bohu des origines »… Et à la fin du film de Rivette, au moment où la création est supposée atteindre le sublime (dans un tableau génialement laissé hors-champ), les personnages ne parlent plus, c’est le corps seul qui parle pour eux. Showing Up, plus bref et plus terre à terre, part de ce constat : c’est justement, chose rare et précieuse dans laquelle Reichardt excelle, un film très silencieux, où cette voix de la matière, si elle parle, le fait silencieusement – l’essentiel, sur l’art comme sur la vie, est exprimé par des regards et des gestes.
Tous ces étudiants que l’on voit affairés, d’ailleurs, ne disent rien, ou parlent des aspects les plus triviaux de leur création (un scratch au lieu d’une fermeture éclair, en effet). Il faut aussi dire que le film donne la part belle à des pratiques, disons, anti-académiques, notamment les arts textiles, jusqu’au générique de fin qui défile sur cette étudiante que Lizzie observait avec attention plus tôt, et qui fait du macramé – on peut aussi penser à la curieuse transmission entre Lizzie et son père, puisqu’il était artisan, alors que la pratique de sa fille est plus « exclusivement » artistique (et – je me répète car je crois que c’est un détail important – non-professionnelle). C’est aussi le signe de l’humilité de Kelly Reichardt : s’interroger sur l’art comme pratique essentielle en partant non pas des beaux-arts, de la grande peinture et des questions générales, mais de l’artisanat et du travail concret des matières.
L. G. : Pour en venir, à propos, aux techniques mises en œuvres par Lizzie (et Joe) : ce que tu m’apprends – à savoir que Kelly Reichardt avais d’abord songé à réaliser le biopic de la peintre Emily Carr – me frappe. Showing up raconte finalement les péripéties d’artistes fictives, mais la réalité de l’art est resté une préoccupation centrale puisque Kelly Reichardt a mis en scène les œuvres d’artistes réelles : les céramiques de Cyntia Lahti dont tu parlais, ainsi que les grandes structures tissées de Michelle Segre. L’authenticité de ces œuvres, dans ce film où les artistes sont, pour leur part, imaginaires et interprétées par des comédiennes, leur confère une certaine souveraineté vis-à-vis de la fiction. En quelque sorte, les œuvres d’art jouent leur propre rôle, dans Showing Up. Celui-ci s’inscrit dans la continuité de deux courts-métrages documentaires, à quelque égard préparatoires, que Kelly Reichardt a réalisés pour répondre à l’appel du centre Pompidou, « Où en êtes-vous ? ». Le premier était consacré au travail de Michelle Segre. Le second, en revanche, à celui de la céramiste Jessica Jackson Hutchins. Toute une myriade de choses pourrait expliquer que ce soit celle de Cynthia Lahti qui ait été choisie pour figurer dans Showing Up ; quoi qu’il en soit, il s’agit également de céramique, c’est-à-dire de terre cuite. Et ce matériau ancestral qu’est la terre cuite avoisine, dans ce film, une autre technique artisanale à peine plus récente (à travers les travaux de Michelle Segre) : le travail du fil, le tissage. Les œuvres de Lizzie et Joe sont donc contemporaines, mais il ne s’agit pas de « nouvelles technologies ». Elle se réclament de médiums millénaires, parmi les plus anciens à être considérés par l’histoire de l’art. Et subrepticement, Showing Up insiste sur celui qu’a choisi Lizzie, l’argile, par l’entremise des membres de sa famille : son père potier, et son frère qui donc, veut « faire parler les bouches de la terre ».
Sur ce : il est difficile de résister à l’envie de surinterpréter un peu. Dans un livre intitulé La potière jalouse (1985), l’anthropologue Claude Lévi-Strauss étudie les fables amérindiennes relatives l’origine de l’argile à poterie : il y est question d’une jalousie entre le soleil et la lune qui étaient alors des hommes, et d’une femme qui se change en oiseau (en l’occurrence, ce n’est pas un pigeon mais un engoulevent). D’après Lévi-Strauss, ces mythes font échos à ceux qui racontent l’origine du tissage, toujours sur le continent américain, et qui font intervenir un autre animal : une demoiselle paresseux – dont il est dit que « nulle femme ne pouvait se comparer à elle comme tisseuse de hamacs, de musette et de ceinture ». Le matériel, les accessoires et les animaux que le film fait intervenir, peut évoquer l’univers de ces mythes (bien que de façon très décousue…). Quant à la jalousie, la rivalité que Lizzie et/ou Jo pourraient éprouver l’une envers l’autre : si elle est une composante typique du genre que auquel le film se dérobe (le thriller), ainsi laissée pour compte par le drame elle peut aussi participer de cet appareil mythologique. En « retraversant » l’Amérique, le cinéma Kelly Reichardt aurait-il rencontré ces nouveaux mythes fondateurs : ceux de l’artisanat (ou de l’art, mais qu’importe) ? En tout cas, cette présence subreptice des mythes amérindiens n’étonnerait guère, finalement, de la part de cette cinéaste qui a réservé des rôles aussi singuliers que cruciaux aux Indiens dans ses fictions (le guide de La Dernière Piste).
Scénario : Jonathan Raymond et Kelly Reichardt / Image : Christopher Blauvelt / Montage : Kelly Reichardt / Musique : Ethan Rose.
Durée : 108 min.
Sortie française : 3 mai 2023.