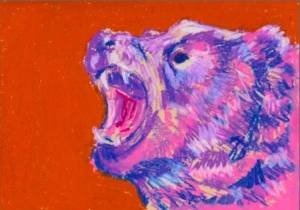L’enfance en ligne de fuite
À propos de Déménagement de Shinji Sōmai

De Zero de conduite (Jean Vigo, 1933) à Linda veut du poulet (Chiara Malta, Sébastien Laudenbach, 2023) en passant par Bonjour (Yasujirō Ozu, 1959) et Les 400 coups (François Truffaut 1959), le cinéma a souvent représenté l’enfance dans son potentiel contestataire en montrant la propension des jeunes personnages à faire vaciller le cadre lorsqu’ils s’opposent à une forme d’autorité, qu’elle soit parentale ou scolaire. Renko, l’héroïne de Déménagement (Shinji Sōmai, 1993 [11][11] Présenté au Festival de Cannes en 1993 dans la section « Un certain regard » le film était jusque-là resté inédit en France comme la plupart des films de Sōmai à l’exception de deux retrospectives au Festival des 3 Continents et à la Cinémathèque française en 2012-2013. Il est sorti le 25 octobre 2023 dans une belle copie restaurée grâce au travail remarquable du distributeur Survivance.) s’inscrit dans la lignée de ces figures indisciplinées : le récit s’articule autour de sa lutte contre le divorce de ses parents dans les jours et les semaines qui suivent le départ du foyer de Ken’ichi, le père.
Dès la scène d’ouverture, le film révèle le dysfonctionnement de la cellule familiale : une table verte triangulaire appuie sa division en trois pôles tandis qu’un long plan laisse affleurer un sentiment de gêne chez les deux parents. Ren, positionnée au centre, essaye de préserver « l’esprit de la famille » quand les adultes peinent à s’adresser un regard. Bien que le film nous fasse d’emblée comprendre le caractère irrémédiable de la séparation, il n’en est pas moins porté par l’élan du personnage principal pour lutter contre cet état de fait. La mise en scène ne cesse en effet d’opposer le corps fougueux de l’enfant à la rigidité du cadre. Ainsi, si la composition des plans, tout en surcadrages, place Ren à distance d’un monde qu’elle peine à appréhender, celle-ci est sans arrêt remise en question chaque fois que la petite fille effectue un geste spontané – la caméra de Sōmai venant capter comme à son habitude une énergie corporelle débordante. Il me semble alors que la beauté du film se trouve dans cette façon de filmer l’enfance comme un mouvement constamment relancé qui ne craint pas l’épuisement.
La jeunesse apparaît donc ici avant toute chose comme une manière d’être au monde. En cela, il suffit d’observer Renko en train de jouer avec son père pour comprendre le lien particulier qui les unit. Ken’ichi, dans ses gestes et l’attention qu’il porte à sa fille, garde quelque chose d’enfantin. Préoccupée par la gestion du foyer à laquelle l’astreint son rôle de mère, Nazuna entretient une relation plus distante avec l’enfant, à tel point que ses efforts pour s’en rapprocher paraissent maladroits. Nous apprenons à cet égard que la répartition des tâches dans le couple était loin d’être équitable, laissant penser que la part de maturité nécessaire à la vie d’adulte éloigne irrémédiablement de l’état d’enfance. Si le film dit bien la nécessité du passage d’un âge à l’autre, il porte un regard un peu triste sur ces personnages qui ont laissé derrière elleux leurs jeunes années insouciantes pour mener une vie responsable.

La première rupture de Ren avec son père a lieu au moment où, postée au loin, l’appelant depuis une cabine téléphonique, elle l’aperçoit derrière une vitre en train de feindre d’être en réunion pour éluder ses questions, comme un adulte parmi tant d’autres. Le « monde des grandes personnes » a tout l’air d’un milieu rigide fait de règles et de contraintes, en atteste l’importance des mots et des injonctions écrites adressées aux corps enfantins : le maître d’école qui s’appuie sur le tableau pour « tenir sa classe » comme la mère fait réciter à Ren les nouvelles règles du foyer inscrites sur une grande feuille blanche. Cela nous laisse penser que pour intégrer la société, représentée ici principalement par l’institution scolaire, les enfants doivent apprendre à canaliser leur énergie et à l’utiliser à bon escient, c’est-à-dire pour faire ce que l’on attend d’eux : Tomoko Tabata (Renko), dont le jeu est d’une justesse remarquable, effectue les tâches ménagères avec le même dévouement que lorsqu’elle joue ou court dans la rue. En guise d’épilogue, la toute fin du film montre le personnage principal pris dans son devenir : à la fuite en avant s’est substituée la marche déterminée, tandis que dans un même plan séquence, Ren troque ses habits de « petite fille » pour un uniforme d’écolière, signe d’une place trouvée au sein du monde social.
Il serait toutefois fort dommage de réduire Déménagement à un récit rectiligne d’apprentissage tant le film joue par ailleurs avec le temps filmique, en enfermant son personnage dans une boucle temporelle ou en ménageant des moments de suspension narratifs. Nous avons vu plus haut à quel point le film s’accordait au point de vue de Renko, y compris dans son déni du divorce (il faut voir comment elle réagit quand une camarade dont les parents sont également séparés lui annonce la douloureuse vérité) si bien que le récit en vient à bégayer, à tourner en rond, en répétant sans arrêt les mêmes types de scènes – les repas où les adultes peinent à se parler, les moments où Renko court sans destination précise – sans répondre aux attentes du personnage principal. Cette structure circulaire est néanmoins trouée à certains moments par d’énigmatiques plans de transition représentant des éléments naturels (ciel bleu strié par un avion, forêt, nuage) dont la tranquillité désamorce l’intensité dramatique et ouvre le film vers un ailleurs.
Ces images détachées de la narration anticipent la fin du film où Renko quitte le cadre de l’intrigue familiale et part sur les rives du Lac Biwa quand a lieu une impressionnante fête traditionnelle. Devant ses yeux vont se dérouler des allumages de feux rituels, feux d’artifice et autres processions nocturnes, jusqu’à ce qu’elle se replie dans une forêt déserte. La petite fille qui n’a cessé de courir tout au long du film montre pour la première fois des signes de fatigue. Mais cet épuisement semble paradoxalement la rendre plus disponible à ce qui l’entoure, comme si, échappée du drame familial, elle parvenait à trouver un lien sensible avec le monde. Débarrassé de toute contrainte narrative, Sōmai filme Renko dans un espace qui apparaît comme hors du temps et où l’action se suspend : pendant une vingtaine de minutes, le personnage ne fait « que » marcher, s’agripper aux arbres, s’asseoir en épousant la forme des rochers et hurler joyeusement en s’adressant à la lune – tel un animal – jusqu’au moment où elle s’endort sur la plage.
Si Renko peut à ce moment précis s’endormir à même le sol, c’est que cette forêt à la lisière du conte se présente à elle comme le refuge attendu. Le film a souvent montré son besoin de se réfugier, et ce dès l’introduction où après un repas familial à l’ambiance glaciale, la petite fille se retire dans sa chambre en espérant des jours meilleurs. Plus tard, alors qu’elle a pour projet de se barricader dans la chambre de Ken’ichi, une nouvelle dispute familiale éclate, plus virulente qu’à l’accoutumée, conduisant Renko à s’enfermer longuement dans la salle de bain. L’irruption spontanée de la main de Nezuna dans le cadre, brisant la vitre pour déloger sa fille fait figure de symptôme ; elle est la manifestation brutale d’une violence jusque-là contenue qui justifie a posteriori la nécessité pour l’enfant de se protéger d’un monde potentiellement hostile. Toutefois, tout comme la fuite, la propension du personnage à se réfugier peut conduire au déni de l’environnement extérieur. C’est pourquoi il faut voir la forêt comme un refuge à ciel ouvert, soit un endroit qui, parce qu’il est à l’écart des rumeurs de la vie sociale, permet à Renko d’embrasser le monde dans une dimension primitive. Le lien quasi magique que le personnage noue à cet espace intemporel lui permet ainsi de se retrouver elle-même en appréhendant son expérience à distance : sur les rives du lac, dans une vision proche du rêve, Ren, telle une grande sœur, étreint la petite fille qu’elle était et laisse derrière elle les souvenirs de sa vie familiale passée.
Grandir c’est, en quelque sorte, trouver un lieu à soi, définir son propre espace détaché du cordon familial. Il s’agit non pas de rejeter le monde en se repliant sur soi-même, mais de trouver la bonne distance pour appréhender le réel et les autres. Après la scène d’adieu décrite au-dessus, Nazuna refait son apparition à l’occasion d’une image bouleversante qui la voit arriver dans la profondeur de champ alors que Renko s’occupe d’un feu de plage au premier plan. Il est frappant de voir le personnage renouer avec sa mère au sein même du cadre quand le film marquait jusque-là sa brutale séparation du monde des adultes par un jeu de surcadrages. On aurait aimé que le film s’arrête ici, avec cette image d’une complicité retrouvée par les gestes, le regard et l’attitude, plutôt qu’avec le retour en classe annonciateur d’une vie réglée. Loin du débordement généralisé de la fin de Zéro de conduite ou même de la course libératrice des 400 coups, les aspirations libertaires des enfants indociles se trouvent contraintes par le programme du récit initiatique dont l’horizon est généralement l’insertion au sein de la société, aussi synonyme de « retour dans le rang » et de ré-union familiale [22][22] Par exemple, si Linda veut du poulet nous offre des scènes de révoltes enfantines des plus enthousiasmantes, le tout est encadré par un récit de deuil initiatique quelque peu conventionnel : en acceptant la mort de son père à la fin du film, Linda se réconcilie avec sa mère et la famille voit son unité retrouvée.. Si Déménagement est rattrapé in fine par ces impératifs scénaristiques plus convenus, le film a par ailleurs esquissé une autre voie d’apprentissage qui passe par l’expérience sensible du monde – nous retiendrons les images de cette petite fille qui s’élance dans la ville, joue, regarde ce qui l’entoure, s’appréhende elle-même, tout en liberté.