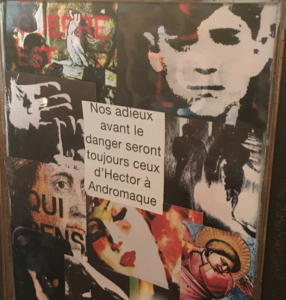Cartes pour collapsonautes
Sur l'exposition "Le monde selon l'IA" (Jeu de Paume, 2025)

Déjouant peut-être certaines attentes, l’exposition parisienne « Le monde selon l’IA » présentée à la Galerie nationale du Jeu de Paume jusqu’en septembre 2025, ne cherche pas à introduire le public à un art qui serait surtout né de l’esprit des ordinateurs, des robots et des automates et qui, en tant que tel, s’attacherait à exploiter ou à faire connaître les dernières avancées des technologies numériques dans le domaine de l’intelligence artificielle. Sous l’égide du théoricien du cinéma et des media Antonio Somaini en collaboration avec l’historienne de l’art Ada Ackerman, le professeur de littérature Alexandre Gefen et la conservatrice Pia Viewing, l’exposition a plutôt cherché à dresser un inventaire exemplaire des gestes artistiques qui, actuellement – surtout depuis les années 2010 –, explorent la logique et les effets de l’IA analytique et générative, que ce soit au niveau social, économique, politique ou même écologique.
Si cette exposition ne vise rien de moins que de situer un monde de plus en plus marqué par la vision et l’écriture artificielles, une série considérable d’œuvres montrées ici témoigne de l’ambition de rendre justice aux conditions et prémisses socio-économiques et culturelles complexes dans lesquelles s’inscrivent la reconnaissance automatique (apprentissage automatique ou machine learning) et le traitement de textes et d’images assisté par des réseaux neuronaux artificiels (apprentissage profond ou deep learning). Le vrai sujet de l’exposition est désigné par le sous-titre du catalogue, à savoir l’ « exploration » des espaces dits « latents ».
Somaini est en effet l’auteur, ces dernières années, d’articles conséquents sur l’espace latent de l’IA générative de type « text-to-text », « text-to-image » et « image-to-text » (comme ChatGPT, Midjournéy, Stable Diffusion, Runway ou Sora)[11][11] Voir notamment Antonio Somaini, « Une théorie des espaces latents », dans Ada Ackerman, Alexandre Gefen, Antonio Somaini et Pia Viewing (dir.), Le monde selon l’IA. Explorer l’espace latent, catalogue d’exposition (fr./angl.), Paris, Galerie Nationale du Jeu de Paume/JBE Books, 2025, p. 21-51.. La modélisation mathématique de ces espaces à l’aide d’ensembles de données complexes perpétue des schémas de perception hégémoniques dont les conséquences sont considérables dans le domaine de la culture visuelle, en particulier de la photographie et du cinéma. Leur structure façonne de nouvelles façons de voir, dont la généalogie est toutefois difficilement accessible. Les questions qui en découlent déterminent le parcours de l’exposition : quelles formes de vie sont activées ou désactivées par les médias assistés par l’IA ? Quelles émotions y sont répertoriées ? Dans quelles traditions culturelles s’inscrivent les « nouveaux » médias assistés par l’IA ? Comment ces espaces abstraits et invisibles de représentation et de transformation sont-ils alimentés et qui les contrôle ?
Spéléologies
Une série d’œuvres tente d’explorer comment la relation entre le visible et le dicible est redéfinie sur le plan technologique et comment, dans des espaces vectoriels dont le codage n’est en aucun cas neutre, se forme la relation entre la reconnaissance et la méconnaissance, entre la saisie, le traitement et le classement. Que signifient aujourd’hui la description et la classification des images, et comment la méthode traditionnelle de l’ekphrasis évolue-t-elle sous l’influence des interventions informatiques ? Face aux processus de transformation fondamentaux au sein des espaces latents, certains artistes parlent de « méta-archives », quand d’autres voient dans la transcription d’images traditionnelles un projet tourné vers l’avenir ou poursuivent des perspectives spéculatives de l’IA, dont le potentiel contrefactuel ne va pas seulement dans le sens de la falsification. De nouvelles approches de morphogenèses de toutes sortes peuvent s’ouvrir, permettant de créer des œuvres perdues, voire jamais créées. Dans quelle mesure l’IA suggère-t-elle de passer de la prétention à la vérité au mode du possible, comme le propose récemment Alexander Kluge dans son livre Konjunktiv der Bilder (2024) ? Dans le catalogue, Somaini présente l’abstraction, la complexité et l’opacité des espaces latents comme un défi central pour l’art contemporain.
Au gré des cinquante œuvres, principalement axées sur les processus, présentées dans cette exposition particulièrement instructive, on pourrait décrire la recherche artistique sur l’IA comme de la spéléologie, dans laquelle on avance à tâtons dans un champ généré par des algorithmes, parfois sur des chemins erronés ou dans des impasses, toujours à la recherche de nouvelles voies et de découvertes inattendues. Au vu de ces questions, il n’est guère surprenant que l’œuvre de Harun Farocki revête une importance paradigmatique, car elle peut être considérée dans son ensemble comme une contribution à une archéologie du présent, axée sur le changement fondamental et le remplacement du travail manuel et visuel par des machines.
Le motif de la technique du tissage, qui traverse l’ensemble de l’œuvre du cinéaste et artiste berlinois, illustre bien ce propos. Dans le contexte de l’histoire sociale des tisserands de soie français et de l’invention de la carte perforée par Joseph Marie Jacquard, ce motif s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’exposition, qui se consacre au sein de quelques « capsules temporelles », conçues à la manière d’un cabinet de curiosités, aux éléments culturels et techniques qui ont précédé l’intelligence artificielle, comme le métier Jacquard. Pour « Le monde selon l’IA », c’est finalement le cycle d’installations le plus connu de Farocki, Eye/Machine 1-3 (2000-2003), qui a été sélectionné, sans doute parce qu’il part d’images dites « opérationnelles » qui symbolisent l’automatisation et la militarisation de la surveillance. Si le cycle d’installations de Farocki présente une sorte d’inventaire des procédés de traitement d’images par des machines, il aborde notamment le changement de paradigme marqué par le passage des systèmes de simulation et de navigation optiques aux systèmes post-optiques, contrôlés par des algorithmes. Eye/Machine 1-3 permet également d’établir un lien avec les conceptions panoptiques du cinéma, rassemblées dans la « capsule temporelle » dédiée à Farocki et consacrée au thème de la vision artificielle, qui va de la caméra de Dziga Vertov au livre marquant de Paul Virilio sur les machines de vision – Guerre et cinéma (1991).

Ce choix a manifestement été fait en tenant compte d’autres œuvres qui occupent ici une place importante dans le dialogue avec Farocki. Trevor Paglen est représenté par plusieurs travaux qui mettent l’accent sur les implications biopolitiques des procédés algorithmiques de reconnaissance faciale ou qui expérimentent de manière critique les réseaux neuronaux. Hito Steyerl présente Mechanical Kurds (2025), un nouveau film-installation convaincant y compris sur le plan formel, traitant des conditions de travail non réglementées auxquelles sont soumis les « travailleurs du clic » – souvent des réfugiés – dans les pays à bas salaires. L’œuvre de Steyerl est suivie dans le parcours de l’exposition par l’installation multimédia d’un collectif d’artistes basé à Rotterdam, qui mène des recherches à la croisée de l’architecture, du design et de la culture numérique, intitulée Meta Office: Behind the Screens of Amazon Mechanical Turks (2021-2025).
Les membres du Meta Office visualisent ici une enquête approfondie sur les conditions de travail liées à la plateforme de crowdsourcing Mechanical Turk d’Amazon. Les conditions disparates, les salaires précaires et la situation décentralisée des travailleurs à la tâche sont représentés statistiquement et affichés sur des tableaux numériques, où une inégalité fluctuante – similaire aux cours de la Bourse – devient visible dans son changement constant et intangible. Lorsque Steyerl communique par Internet avec des microtravailleurs qui passent, dans un pays lointain, leurs journées à coder de grandes quantités de données au service de procédés de reconnaissance d’images artificielles, elle insiste sur leur anonymat en distanciant la scène de diverses manières. C’est précisément parce que ce travail n’apparaît pas dans le quotidien de l’utilisateur final de l’IA qu’il s’agit ici de le mettre en lumière à plusieurs niveaux. L’artiste confronte un monde artificiel en constante évolution, dont l’apparence est extrêmement réaliste, à des enregistrements documentaires d’un quotidien de travail consistant à identifier des objets à la chaîne ou à les marquer à l’intérieur d’un rectangle coloré.
Des vols fantomatiques de drones au-dessus et à travers un camp de conteneurs kurde et de brèves prises de vue des conditions de vie exiguës donnent lieu à une série de compositions picturales de plus en plus étranges. Celles-ci font apparaître des classifications conceptuelles et des structures rectangulaires comme si elles faisaient partie du décor. Puis, à nouveau, des danseurs de rue agiles et de petits véhicules colorés clignotants se dérobent de manière inquiétante. Les marques géométriques laissées par les travailleurs à la tâche, reprises en sculptures dans la salle d’exposition sous la forme d’échafaudages métalliques, acquièrent ainsi un statut ambivalent. Peut-être, selon la thèse implicite du film, dans lequel Steyerl aborde une fois de plus la situation géopolitique et sociale des Kurdes, les lumpenprolétaires du technoféodalisme mondial s’entraînent-ils au service de leur propre ennemi. L’allusion du titre du film à la plateforme Amazon et à son recrutement massif de « Mechanical Turcs » fait référence à une histoire de la cour autrichienne du 18ème siècle dans laquelle un automate jouant aux échecs cachait en réalité à l’intérieur un être humain.
Dans Mechanical Kurds, la visite d’un marché se déroule d’abord dans un décor asiatique, puis dans les Alpes suisses et enfin à Berlin. L’image, artificiellement composée, semble provenir d’un répertoire de jeux sérieux puisant dans l’histoire de la photographie. Le travail cinématographique de Steyerl est donc animé non seulement par une impulsion de critique sociale, mais aussi par l’ambition de révéler sa propre genèse artificielle et de la relier à d’autres éléments médiatiques. Elle s’inscrit ainsi formellement dans la lignée des premiers films dont les vues mobiles étaient marquées par des voyages fantomatiques à travers des paysages spectaculaires et des villes notables, appelés « Phantom Rides ». Si, selon Tom Gunning, ce cinéma des attractions était autrefois perçu comme l’incarnation d’une énergie invisible dévorant l’espace, on parle aujourd’hui d’un « cinéma des extractions » comme le propose Brian Jacobson dans un livre récent.
Le lien entre Hollywood et l’histoire de l’industrie pétrolière et métallurgique américaine a jusqu’alors été trop peu mis en lumière. Il importe de rappeler également que les frères Lumière ont tiré leur principale source de revenus non pas du cinématographe, mais de la fabrication de supports photochimiques. Les questions matérialistes relatives aux contextes socio-économiques et écologiques de la production s’inscrivent de plus en plus dans le champ d’intérêt de la recherche artistique sur l’intelligence artificielle. Compte tenu de la forte consommation d’eau, d’énergie et de matières premières, l’IA soulève des questions matérielles relatives aux contextes socio-économiques et écologiques de la production. Outre des sculptures réalisées à partir de déchets informatiques coulés dans de la lave artificielle (Julian Charrière), la première section de l’exposition présente ainsi des peintures utilisant des cristaux de minéraux tels que le cobalt, le fer et le nickel (Agnieszka Kurant). Les cyanotypes de Clemens von Wedemeyer, issus du cycle Social Geometry (2024), représentent de manière métaphorique la complexité des réseaux neuronaux et établissent, sur le plan esthétique, un lien anachronique avec la culture numérique, renforcé formellement par la reproduction des cartes à bâtons utilisées par les marins micronésiens.

Dans la salle suivante sont accrochées deux fresques géantes imprimées sur papier qui illustrent de manière paradigmatique l’imagination critique de la recherche-création non seulement sur la question de la formation des systèmes d’intelligence artificielle, mais aussi sur la structure des rapports de force mondiaux qui les intègrent. Ces œuvres sont le fruit du travail de la sociologue de renom Kate Crawford, qui a déjà défini la méthode cartographique dans son étude critique Contre-atlas de l’intelligence artificielle (2022), et qui a trouvé un partenaire productif en la personne de l’artiste médiatique et activiste Vladan Joler. Dans leur œuvre déjà maintes fois primée Calculating Empires: A Genealogy of Power and Technology, 1500-2025 (2023), les chercheurs-créateurs ne proposent ni une histoire traditionnelle de la technologie au sens d’un enchaînement linéaire d’objets techniques, ni une archéologie des médias principalement axée sur les « grands » inventeurs, telle que Friedrich Kittler l’a conçue pour les mondes numériques prenant pour modèle Alan Turing, mais plutôt une cartographie mettant en relation les domaines de connaissance de manière diachronique et synchronique, au sein d’une généalogie du pouvoir et de la technologie.
Dans leur œuvre précédente, Anatomy of an AI System (2018), ils s’appuient sur l’étude de cas de l’appareil « Echo » d’Amazon et de son assistant virtuel « Alexa » pour décomposer spatialement les relations de pouvoir complexes de l’intelligence artificielle (IA) et les présenter comme une forme d’organisation globale du travail et de la vie, mais aussi en termes d’empreinte écologique considérable. Dans Calculating Empires, en revanche, les auteurs esquissent une gigantesque carte temporelle qui débute à la Renaissance et qui traite d’une compréhension généalogique des technologies dont la forme d’organisation est déterminée par le pouvoir. En se détournant résolument d’une compréhension de l’IA centrée sur le présent, Crawford et Joller proposent ainsi un diagramme extensible inspiré par Foucault, sur lequel apparaissent les champs de force politiques et économiques du savoir qui rendent quelque chose visible sans nécessairement se mettre eux-mêmes en lumière. Cette carte ne se limite pas à ses infrastructures et ressources matérielles, algorithmiques et économiques, mais souligne également, dans un cadre plus large, l’explosion des coûts écologiques qui y est associée, ainsi que la militarisation, la surveillance et la privatisation croissantes de l’espace public par les nouveaux empires technologiques.
Spéculations
L’intelligence artificielle ne représente pas les mondes ni ne les documente ; elle les crée par d’autres moyens que la photographie, le cinéma ou la littérature, en se fondant sur des probabilités et non sur des réalités. Les artistes-chercheurs de cette exposition ont donc pour objectif de montrer le changement radical dans la manière dont les images numériques sont aujourd’hui produites, diffusées et regardées. On passe ainsi de la visualisation analytique de l’espace latent et de son histoire (dans le domaine des classifications physionomiques, par exemple) à des projets d’intelligence artificielle générative qui procèdent de manière contrefactuelle, complètent des artefacts archéologiques ou développent des spéculations sur le passé ou encore sur l’invisible. C’est particulièrement évident dans les impressions 3D d’Egor Kraft, présentées dans le cadre d’une série sur des archives spéculatives. Cependant, la recherche artistique se concentre également sur les angles morts, en particulier ceux des systèmes d’IA générative. Julien Prévieux, par exemple, part d’un projet récursif d’inspiration situationniste sur les dysfonctionnements et les lacunes de l’IA générative (Poem Poem Poem Poem, 2024-2025).
L’artiste et critique Érik Bullot s’inspire des avant-gardes du cinéma et de la littérature pour intituler une série d’impressions numériques Cinéma vivant (2024), en référence aux idées utopiques du poète symboliste Saint-Pol Roux qui imaginait un film se déroulant dans un futur antérieur. Les instructions textuelles correspondantes (appelées « prompts ») ont été complétées par des informations issues des domaines de la technique (par exemple, des indications précises sur le choix de l’objectif), de l’histoire culturelle (par exemple, en ce qui concerne les images issues de la parapsychologie) et de la littérature. Bullot s’est ici inspiré de traditions expérimentales telles que l’Oulipo. Pour les images fixes générées par l’IA, l’artiste a utilisé l’application web Lexica, comme pour son court métrage Le Rêve d’Abel Gance (2024), qui procède de manière similaire : à l’aide d’images et de sons générés par l’IA, celui-ci présente un univers qui tente de se rapprocher de l’idée d’une « maison de cristal » imaginée par le poète et cinéaste d’avant-garde. Dans la reconstitution virtuelle de Bullot, un laboratoire scientifique, un studio de cinéma et des réseaux neuronaux se côtoient. Il s’agit d’ouvrir une période de possibilités que l’on pourrait qualifier, avec Reinhart Koselleck, de « l’avenir du passé », en référence à l’histoire dans laquelle les utopies de l’époque se voient offrir un nouvel horizon.
On sait aujourd’hui qu’il existe une version intensifiée du grand ciné-roman La Roue (1923), à la manière du cinéma pur, qui a malheureusement été perdue. Cependant, la rêverie de Bullot sur l’intelligence artificielle ne porte pas tant sur la reconstruction d’un tel projet que sur la tentative de donner vie à un projet fragmentaire qui n’a jamais été filmé. Avec cette spéculation complexe, le cinéaste s’inscrit lui-même dans l’histoire des avant-gardes littéraires et cinématographiques dont il relie de manière inattendue les chemins sinueux. Sur le plan formel, son film, monté à partir d’images fixes en noir et blanc, de voix générées par intelligence artificielle et de musique, rappelle La Jetée (1963), le film de science-fiction de Chris Marker. Les configurations visuelles créées à partir d’instructions textuelles pourraient, dans l’esprit de l’interprétation freudienne des rêves, être qualifiées de « formations mixtes » issues des traces semi-compréhensibles de notre passé visuel. Selon la généalogie de Kate Crawford, le « continent obscur » de l’IA se trouverait alors dans la boîte noire de l’espace latent, qui ne doit pas seulement être comprise comme une métaphore, mais qui, d’un point de vue matériel, fait également partie de l’histoire du radar et de ses ancêtres[22][22] Voir Kate Crawford, « Cartographies critiques de l’IA », Entretien avec Antonio Somaini, dans Ada Ackerman, Alexandre Gefen, Antonio Somaini et Pia Viewing (dir.), Le monde selon l’IA, op. cit., p. 64-73..
Ce que Joanna Zylinska appelle dans son article du catalogue« l’animisme de l’ombre » de l’IA ne se présente pas seulement comme l’héritage culturel et imaginaire du cinéma, au sens d’une « momie du changement » (André Bazin) ou d’une « machine intelligente » (Jean Epstein) [33][33] Joana Zylinska, « De l’animisme de l’ombre dans l’intelligence artificielle », dans Ada Ackerman, Alexandre Gefen, Antonio Somaini et Pia Viewing (dir.), Le monde selon l’IA, op. cit., p. 194-206.. Si l’image cinématographique en mouvement a toujours été marquée par la discontinuité et l’impureté, l’exposition montre la diversité des formes que peuvent prendre les résultats « injustifiés » de l’IA, souvent décrits par le terme « hallucination ». Une section est consacrée aux écarts visuels ou textuels, aux déformations, aux défauts ou aux vides qui apparaissent dans l’espace latent de l’IA, en raison de connexions entre des points de données fondées sur des probabilités mathématiques. La visualisation de ces calculs, autrement invisibles, produit une « danse fluide de pixels », pour reprendre les mots de Zylinska. La vidéo Behold These Glorious Times! (2017) de Trevor Paglen vise par exemple à représenter ces processus au sein de la boîte noire algorithmique ; mais sa mosaïque scintillante ne cherche en aucun cas à créer les effets immersifs qui sont aujourd’hui présentés à un large public dans des lieux spécialement dédiés à cet effet, en dehors de l’espace artistique, dans le cadre d’une esthétique de l’IA spectaculaire et souvent kitsch.
À y regarder de plus près, la vidéo de l’artiste présente d’innombrables images enregistrées dans une immense base de données pour la reconnaissance de visages, de gestes ou d’objets, puis traitées pour former des groupes d’images. Elle permet de visualiser les effets des processus de codage qui déterminent la façon dont les machines « voient ». À l’instar de son installation interactive Faces of ImageNet (2022), Paglen s’attache sans cesse à représenter les implications politiques et épistémologiques de l’intelligence artificielle, allant jusqu’à expérimenter les GANs (Generative Adversarial Networks), qui lui permettent de créer des hallucinations sous forme de figurations floues et indéterminées dans des espaces latents. D’autres artistes, comme Nouf Aljowaysir, mettent en évidence la situation coloniale des clusters d’images en générant, à partir d’un traitement approprié de photographies orientalistes, des vides figuratifs qui apparaissent de manière frappante dans une installation artistique et pédagogique de grande envergure (Salaf, 2021-2025). Julien Prévieux, quant à lui, cherche à représenter les visages hypothétiques (appelés « Eigenfaces ») d’anonymes « célèbres », tels qu’ils sont utilisés dans le processus d’entraînement du GAN pour la reconnaissance faciale automatique (Les Inconnus connus inconnus, 2018).
La vidéo à double piste Better Mont Blanc (2024) de Jacques Perconte, qui expérimente des techniques d’upscaling fondées sur l’intelligence artificielle à partir de procédés de compression numérique, est une forme poétique d’« animisme de l’ombre ». Dans les vues régénérées du plus majestueux massif montagneux d’Europe, des formations de pixels remplacent soudainement les endroits où l’on croyait auparavant apercevoir des alpinistes. Léos Carax et Jean-Luc Godard ont également fait appel à l’inventivité numérique de Perconte dont les images ont été utilisées dans leurs films.

Déséspérances
La deuxième partie de l’exposition est dominée par l’installation monumentale de Grégory Chatonsky, La Quatrième Mémoire (2025), qui comprend des objets tridimensionnels, des pierres et des robots, ainsi qu’un film généré artificiellement, expérimentant des modèles d’intelligence artificielle et des langages de programmation tels que Stable Diffusion, AnimDiff, Llama et Python. Grâce à sa projection infinie d’images fondée sur des modèles génératifs, Chatonsky suggère la détermination de notre présent à la lisière du temps historique, à l’extrémité de l’entropocène (Bernard Stiegler), qui succède à l’anthropocène, dans une époque entièrement extériorisée par des objets techniques. En dialogue avec la théorie des media et la philosophie des techniques, l’artiste représente ici l’idée du dédoublement du monde à travers une application d’intelligence artificielle qu’il a développée, permettant de créer en continu de nouveaux mondes dans lesquels apparaissent des variations infinies de ses propres portraits. Il présente ce film post-cinématographique, qui est censé lui survivre, comme une nouvelle technique culturelle qui cherche à interrompre une époque tout en en créant une époque, à travers une réponse programmatique.
Avec cette installation apocalyptique, Chatonsky semble vouloir représenter une sorte de méta-mémoire. Dans un article cosigné avec Antonio Somaini, l’artiste évoque les efforts actuels des législateurs européens concernant les données initialement stockées (textes, images) et leur traitement potentiel[44][44] Grégory Chatonsky et Antonio Somaini, « Sortir du paradigme de la copie », AOC, n°1, 2025, p. 106-113.. Cependant, le potentiel de l’IA à produire quelque chose de nouveau, d’inhabituel, voire d’unique, n’est pas abordé. Selon l’argument avancé, les images générées par l’IA ne sont pas de simples copies, montages ou collages à partir de matériel préalablement introduit, mais résultent de connexions entre des espaces vectoriels multidimensionnels. Leur complexité est comparable à celle des systèmes de théorie des jeux et ne peut donc pas être évaluée selon les critères de la logique du réalisme représentatif. C’est la raison pour laquelle Chatonsky, suivant en cela Stiegler, propose d’étudier la détermination de l’être humain à travers ses techniques mnémotechniques. Alors que Stiegler englobe de manière critique le complexe indissociable de matière et d’information à l’ère informatique sous le terme de « rétention tertiaire », Chatonsky vise frontalement, dans AOC, l’espace invisible et abstrait de la représentation des données avec sa proposition d’une « quatrième rétention », sorte de « mémoire de mémoire ». Il écrit : « Cette récursivité est celle d’une mémoire qui pourrait avoir lieu sans nous, sans témoin, après que nous avons disparu jusqu’au dernier. » L’idée est qu’il s’agit aujourd’hui, d’un point de vue artistique, d’explorer cet espace latent de manière expérimentale et non instrumentale, comme le font la plupart des internautes.
Ce que Chatonsky n’aborde pas ici, c’est une fonction de l’IA que Stiegler, dans Prendre soin. De la jeunesse et des générations (2008), face à l’imbrication des économies mondiales, appelle le « pouvoir psychique du marché », et dont le philosophe diagnostique, entre autres, la perturbation tendancielle de l’attention des consommateurs. Dans le manifeste sur la quatrième mémoire, rédigé par Chatonsky pour la revue Multitudes en collaboration avec Yves Citton, une autre fonction de l’art confronté aux défis de l’IA est toutefois esquissée. Sa mission ne consisterait pas tant à critiquer ce qui est faux qu’à utiliser les deep fakes générés par l’IA pour créer de nouveaux terrains politiques de lutte. Il s’agirait précisément, comme le soulignent les deux auteurs, de « […] fabriquer des objets contrefactuels qui fassent voir, entendre, penser avec la force du réalisme de quels contre-mondes nos sociétés sont porteuses [55][55] Grégory Chatonsky et Yves Citton, « La quatrième mémoire », Multitudes, n°96, automne 2024, p. 189-195. ». Cela implique au minimum de contredire les attentes futures (ou la protention, pour reprendre les termes de Stiegler et de Husserl) de l’ordre néolibéral existant, notamment en ce qui concerne la commercialisation de la mémoire.
Les recherches de l’artiste parisienne Gwenola Wagon sont consacrées, de manière complémentaire, à cette économie de l’attention. Dans son film Chroniques du soleil noir (2023), elle part d’un scénario post-catastrophique rappelant Chris Marker, dans lequel les survivants se sont retirés sous terre pour se protéger d’un soleil brûlant. Quelques enfants et des photographies rappellent une époque révolue où l’on pouvait encore s’exposer directement à l’étoile céleste. Outre une série d’éclipses solaires, d’innombrables images d’incendies de toutes sortes générées par l’IA apparaissent aujourd’hui sur les réseaux sociaux et sur Internet. Si cela met en évidence l’anamnèse d’une obsession bien réelle que l’on pourrait qualifier de pictomanie catastrophique, cette fable, écrite en collaboration avec Pierre Cassou-Noguès, se concentre sur le plaisir spécifique de la dépense d’énergie inhérente à l’utilisation de l’IA, dont le revers inconscient et la base matérielle sont un extractivisme gigantesque. Cherchant à qualifier cette autre scène, dans les années 1970, Jean-François Lyotard avait ainsi attribué au film expérimental, avec le concept d’acinéma, la forme d’un art brut artisanal dans lequel le simulacre, en tant que question esthétique, ne cherche plus à produire un signe par son lien direct avec l’affect, mais sert en quelque sorte directement la pyrotechnie d’un monde en ruine. Vu sous cet angle, le cinéma conserverait aujourd’hui encore sa fonction de medium phare. La recherche artistique et ses multiples formes auraient pour tâche de répondre aux questions posées plus haut sur l’intelligence artificielle, peut-être de manière paradoxale : dans l’un de ses manifestes imaginatifs, Yves Citton postule également la double réévaluation des traditions de pensée du progrès et du déclin, qu’il a intitulée « progressisme collapsonaute[66][66] Yves Citton, « Collapsologie. Tomber vers le haut », Le Nouveau Magazine Littéraire, n°29, mai 2020, p. 26-28. ». Cette notion vise à susciter une nouvelle attention envers tout ce qui rend la vie digne d’être vécue.