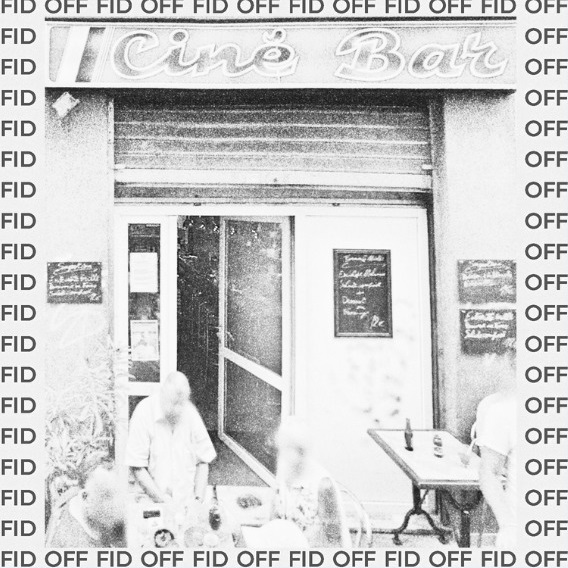FIDMarseille, 2025 (3/3)
Dans les marges. Films d’ateliers dans le IN, expérimentations dans le OFF
Cette année au FID se sont invités, ou plutôt ont été programmés, plusieurs films que leurs conditions de production confinent généralement aux marges des festivals de cinéma, ceux qu’on appelle films « d’ateliers », « d’intervention sociale », ou parfois films « collectifs » (comme si les autres ne l’étaient pas aussi), « co-créés », « participatifs », « de création partagée ». J’ai proposé dans une thèse en cinéma l’expression de « partage de la mise en scène » pour penser cette circulation de la création documentaire, en particulier via la caméra, entre cinéastes et personnages.
Faut-il s’accorder sur les termes, pour savoir de quoi l’on parle, ou bien leur multiplicité et le flou artistique (et auctorial) qui les entoure nous permettent-il au contraire de mieux penser leur diversité, leur complexité ? Quoi qu’il en soit, j’ai repéré au sein de la programmation au moins trois films correspondant à ce procédé de fabrication, que l’on pourrait définir comme une invitation, par un·e cinéaste ou un groupe de professionnel·les, artistes ou pédagogues, faite à des personnes que l’on considère à tort ou à raison comme « éloignées de la culture » (en tout cas, a priori, la culture légitime, donc celle des festivals de cinéma), à réaliser ensemble un film.
Cela peut signifier l’écrire et le penser ensemble, faire circuler les moyens techniques comme la caméra et la prise de son, inviter les participant·es au montage. Ces manières de faire peuvent parfaitement être intégrées dans la réalisation de n’importe quel film, en particulier documentaire, dont les initiateur·ices cherchent à construire les conditions d’une aventure collective dans laquelle les sujets puissent prendre activement part à leur propre représentation. Le film d’atelier se distinguerait par son cadre de production, ce qui implique de prendre en compte son économie : plutôt que porté par une société de production qui va chercher des financements (publics ou privés) pour le film, ces films reposent la plupart du temps sur une structure associative, et/ou sur un financement dédié au temps passé par les artistes ou professionnel·les avec le « public » (les personnes invitées à prendre part au projet), dans un objectif de transmission, d’éducation populaire, d’action culturelle.
Ce mode de production implique à mon avis au moins trois choses qui définissent et distinguent ces films : d’abord, que le tournage se fait en général dans un temps resserré et prédéterminé ; ensuite, que c’est l’expérience vécue par les personnes qui fait l’objet du financement et qui est censée être primordiale, rendant par-là même le résultat secondaire ; ensuite, que la co-construction bouleverse le statut d’auteur·ice des professionnel·les étant à l’initiative de ces projets. Ces trois éléments rendent exceptionnelle la programmation de ces films en festivals de cinéma, d’abord parce que sans être adossés à une société de production et sans avoir suivi un certain parcours de validation au sein de l’industrie et ses institutions, leur découvrabilité s’en trouve restreinte, ensuite parce que leurs qualités esthétiques pourront être jugées trop faibles (à moins que la valeur accordée au film ne repose justement sur l’effet d’authenticité produit par son esthétique « amateur », en particulier lorsqu’il s’agit de ce que je nomme un point de vue endogène, c’est-à-dire des images documentaires filmées « de l’intérieur ») ; et enfin parce que les festivals participent à l’émergence et la consécration d’auteur·ices qui doivent pouvoir être identifiés nommément et artistiquement à travers des films qui traduisent leur « point de vue » singulier. Caroline Zéau pointe cette tension entre « film fini » et « processus » et montre qu’au cœur de cette tension, on trouve la notion d’auteur comme outil de reconnaissance, enjeu symbolique, juridique et financier, et clé d’une carrière de cinéaste – du moins dans le cinéma défendu par le FID Marseille.
Faut-il favoriser le film fini – et sa capacité à convaincre le grand public et les instances concernées ? Ou plutôt favoriser le processus de fabrication du film comme révélateur pour les acteurs sociaux eux-mêmes ?[11][11] Caroline Zéau « La contribution de l’amateur dans le cinéma documentaire : autour de l’idée de participation » in Valérie Vignaux et Benoît Turquety, L’amateur en cinéma, un autre paradigme : histoire, esthétique, marges et institutions, Paris, Éditions du Seuil, 1999, p. 233.
Mais sans doute faut-il être philosophe ou chercheur, et n’être pas vraiment cinéaste, pour renoncer aussi vite à une reconnaissance – celle de l’auteur de cinéma – acquise de haute lutte et sans cesse contestée quand il s’agit du documentaire. Car outre les considérations esthétiques, c’est toute la structuration – professionnelle, institutionnelle, juridique – d’un secteur qui repose sur celle-ci. Et parce que ce secteur, partout où il existe, est précaire, le danger est grand de renoncer au statut d’auteur qui en constitue le socle[22][22] Caroline Zéau, Le cinéma direct, un art de la mise en scène, Lausanne, L’Âge d’Homme, 2020 , p. 105..

Bonne journée est un film de 53 minutes signé Pauline Bastard, lauréat du Grand Prix de la Compétition Française. Lorsqu’un spectateur lui demande si la réalisation du film, qu’elle présente comme collective, devrait impliquer une signature collective, la réalisatrice répond que finalement, un film est toujours collectif. À ce spectateur qui insiste en citant une personne qui affirmait lors d’une table ronde à Grenoble que même dans le cadre d’un tel film, l’auteur se distingue par la responsabilité, la réalisatrice répond qu’elle n’est pas vraiment d’accord. Sa réponse se précise lorsqu’elle explique ne pas être dans une « économie de droit d’auteur », compte tenu des conditions de production de son film, et sous-entendu, de l’argent qu’elle a pu toucher grâce à lui en tant qu’autrice. Bonne journée est le fruit d’une résidence artistique de plusieurs années dans un Emmaüs de Grenoble, auprès des travailleur·euses qu’on appelle les compagnon·nes.
Ce travail a donné un premier film en 2022, qui n’était pas exactement pensé comme un film d’atelier ou un film collectif : après sa première projection, la réalisatrice raconte avoir compris que les participant·es s’étaient vraiment emparé·es de sa proposition et considéraient ce film comme le leur, alors qu’elle croyait « les embêter avec son trépied ». Forte de cette expérience, elle propose de continuer le travail, ce qui donnera Bonne journée. Dans ce film quasi-muet, on voit d’abord les travailleur·euses au travail, et on ne voit pas la réalisatrice, qui est derrière la caméra. Jusqu’ici, un dispositif documentaire classique où chacun·e est à sa place de filmante et de filmé·es. Puis, lors d’une opération de tri, quelqu’un trouve un appareil photo doté d’un flash. Les compagnon·nes se mettent alors à se prendre en photo les un·es les autres, en utilisant des vêtements collectés, en prenant la pose devant ou sur les meubles qu’iels vendent. Iels créent un petit studio avec un fond orange pour prendre en photo et filmer un à un tous les objets collectés. Ces photos seront ensuite imprimées sur du papier glacé et exposées dans la boutique, comme l’air de rien, dans les cadres vendus, ou sous forme d’une sorte de magazine que vendeur·euses comme client·es peuvent consulter tout en testant l’assise d’un canapé. Les vidéos des objets manipulés devant le fond orange seront diffusées dans les téléviseurs.
Ainsi, peu à peu, compagnon·nes comme client·es sont invité·es à poser un autre regard sur ces personnes et ces choses, grâce à cette forme de mise en valeur que ces mises en images permettent. Ces personnes, travailleur·euses précaires, souvent racisé·es, dont le labeur peu valorisé socialement est censé garantir leur « réinsertion », et ces choses, rebuts de peu de valeur à qui Emmaüs tente de donner une seconde vie à bas prix, sont ainsi par cette double caméra ennoblies et sublimées. Les photos des personnes et des choses reprennent avec malice une esthétique publicitaire renforcée par ce papier brillant qui évoque les magazines de mode ou de déco. Le film travaille ainsi à bas bruit – c’est-à-dire dans le silence et la discrétion – les notions de représentation et d’autoreprésentation, en articulant lentement et délicatement une chorégraphie des regards qui invite aussi le nôtre. L’ « atelier », c’est donc à la fois le film filmé par Pauline Bastard, les séances photos et l’exposition in situ qui suit. Si le silence est propice à l’observation et promet une expérience de cinéma singulière, on peut peut-être néanmoins regretter de n’avoir jamais accès à la parole, et donc à la pensée des participant·es, ce qui aurait peut-être déployé autrement leur agentivité.

Notre père, signé par Joris Lachaise, est un film de 49 minutes programmé dans la section « Autres joyaux », sorte de section parallèle non compétitive. L’association Lieux fictifs, qui a produit le film, a une très longue expérience de films d’ateliers réalisés avec des détenus de la prison marseillaise des Baumettes. Fondée en 1994 par Caroline Caccavale et José Césarini, elle a depuis 2020 ouvert le Studio Image et Mouvement, un lieu permanent dédié à la création associé à la Structure d’Accompagnement à la Sortie de la prison. Cette « boîte noire » est le décor de Notre père, tourné en trois semaines. Lors de sa projection, le programmateur précise que c’est la première fois que le FID sélectionne l’un de ces films, car cette fois-ci la qualité artistique aurait été au rendez-vous. Le cinéaste aurait-il trouvé le bon équilibre entre « processus » et « film fini » pour franchir les mailles de l’exigeante sélection ? Cela tient-il à l’aspect « léché » des images, qu’il a conçues lui-même ?
Trois régimes d’images cohabitent, définis par le décor et la couleur. Au premier niveau, la fiction co-écrite par les détenus participants (castés parmi les volontaires par la cofondatrice de l’association) : un repas de famille dans lequel le patriarche annonce à ses fils sa décision concernant la succession de l’entreprise familiale. Ces images-là sont en couleur. Tout ce qui relève du métafilmique (les temps d’écriture ou entre les prises) est en noir et blanc pour signaler clairement le passage à un régime documentaire. Enfin, le film est ponctué d’entretiens avec les détenus-acteurs, qui évoquent leur expérience du film qu’ils ont écrit et partagent leurs réflexions sur les thématiques qu’il charrie : la paternité, la filiation, les masculinités. Ces plans-là ne sont pas tournés dans le décor du dîner, les détenus témoignent face caméra, assis dans un confortable fauteuil de cuir, un micro rétro placé devant eux.
Lors de la projection, les trois protagonistes présents – dont certains découvraient le film pour la première fois – racontent leur fierté. L’un d’eux admet n’avoir pas bien compris ce que le cinéaste cherchait, ou pourquoi il avait filmé certains plans, avant d’avoir vu le résultat. Ce qui est partagé et co-construit, semble-t-il, c’est surtout le scénario, le niveau 1 des trois régimes d’images. Le reste est pris en charge par le cinéaste seul. Ce dernier explique qu’il est arrivé avec la proposition suivante, formulée aux détenus : réaliser un film de procès. Ces derniers ont refusé, cette idée ne leur permettant pas « l’évasion » (sic) qu’ils cherchaient en participant à ce projet. Au fil des discussions, est survenue l’idée du procès d’un père, en famille, la dimension judiciaire étant évacuée.
Cette anecdote dit bien l’ambiguïté et la richesse de ces films : pour accueillir la co-construction, mettre en partage la création, les cinéastes doivent savoir abandonner leurs intentions, et c’est pourtant souvent de celles-ci que peuvent émerger les idées collectives. Le film mêle ainsi le désir de fiction, d’écriture et de jeu des détenus, et deux niveaux documentaires, peut-être surtout impulsés par le cinéaste : sur l’expérience de l’atelier, et sur le rapport de ces hommes aux thématiques précitées. À la différence de Nos défaites de Jean-Gabriel Périot (2019), qui fonctionnait aussi sur une partition jeu/entretiens, les protagonistes de Notre père ne sont pas mis en difficulté dans leurs prises de parole, on sent que le dispositif laisse celle-ci se déployer, leur permet de soigner leurs mots et leurs pensées, sans craindre de donner de mauvaises réponses.
Où sont nos feux d’artifice ? est un autre film produit par l’une des structures de création cinématographique populaire les plus importantes de Marseille, le Polygone Étoilé, créé en 2001 après la création de l’association Film Flamme, productrice et signataire du film, en 1996. Le court-métrage de 20 minutes, également programmé hors compétition, a été tourné le 14 juillet 2024 dans le quartier de la Joliette par des jeunes, à qui « Matti et Nicola », dont les noms de famille ne sont pas précisés, ont prêté une caméra. Au générique, des dizaines de prénoms sans noms, et un film sans auteur·ice. Ici, la caméra circule, et sert à présenter les copains par leur blaze, à les filmer posés au kebab du coin, et enfin à enregistrer les tirs de mortiers et autres pétards qui constituent la contribution des garçons et jeunes hommes du quartier aux festivités de la fête nationale. À la fin du film, une projection collective des images au Polygone devient le théâtre d’une fête improvisée, au son du morceau de Leto « Sale histoire ». Le cinéma, comme trouple caméra-écran-projecteur, se fait outil de la fête, catalyseur d’énergie, témoin – au sens aussi de passeur – d’amitié, instrument d’une revendication à la fois joyeuse et rageuse, et envers du couple spectacularisation-misérabilisme qui préside souvent aux représentations des quartiers populaires et de leurs jeunes habitants.


J’aimerais également citer un autre film collectif, bien qu’il ne réponde pas exactement à la définition du film d’atelier que je tentais ci-dessus. À Gaza est signé dans le catalogue du festival par Catherine Libert bien que la réalisatrice-monteuse refuse de parler de « son » film et insiste sur sa dimension collective et militante. Ce film d’1h40 est composé de plans filmés par des journalistes et des citoyen·nes gazaouies pendant la première année du génocide entamé par l’armée israélienne en réponse aux attaques du Hamas le 7 octobre 2023. Comme le précise Catherine Libert, ce qui permet de dater les images et nous les rend déjà lointaines est la présence d’hôpitaux et de routes empruntées par des ambulances. Il est évidemment impensable de rester insensible devant un tel film, devant ces images produites par des personnes qui documentent de l’intérieur le génocide subi par leur peuple.
Comme le rappelle la réalisatrice dans une voix-off, de telles images nous parviennent en masse à travers les réseaux sociaux et malgré elles, la perpétration des massacres avec la complicité de nos gouvernements ne fait qu’accroître notre sentiment d’impuissance. Si elle décide de contacter ces gazaouies pour leur proposer ce projet de film, c’est parce qu’elle a une forme de foi dans le cinéma. Dans sa capacité à faire trace, à faire archive, à donner du temps et de l’espace à ce qui ailleurs est balayé dans un scroll, dans sa capacité à faire voir et à alerter, avec l’espoir, peut-être, de contribuer à faire en sorte que cela cesse.
Côté palestinien, les protagonistes-filmeureuses ne s’expriment pas sur ce qu’iels projettent dans ce projet, on ne peut qu’imaginer que pour elleux, tous les moyens sont bons pour être vus et donner à voir ce qu’iels voient, ce qu’iels vivent. Il aurait toutefois pu être intéressant de laisser dans le film une place à leur réflexivité sur la question, et peut-être faire quelque-chose de la distinction entre les journalistes et les autres : ont-iels un rapport différent à l’image, à l’information ? Le cinéma n’a-t-il que faire d’un savoir journalistique, celui qui contextualise, date, analyse, recoupe ? Dans un contexte où, comme le rappelle Siham Assbague, les médias « occidentaux » ne reconnaissent pas la légitimité des journalistes palestinien·nes, des éditorialistes ou essayistes allant jusqu’à affirmer qu’il n’ « existe pas de journaliste palestinien[33][33] « Encore une fois : il n’y a pas de journaliste palestinien. Vous collez un concept occidental sur une entité qui n’existe pas. », tweet de Géraldine Woessner, rédactrice en chef au Point, publié sur la plateforme X le 30 mai 2024. / « Il n’y a AUCUN journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d’otages avec une carte de presse. », tweet de Raphaël Enthoven publié sur X le 15 août 2025. », et où les journalistes gazaouies sont ciblé·es et attaqué·es par Israël, en témoigne le meurtre de 5 journalistes d’Al Jazeera quelques heures avant que je n’écrive ces lignes, un documentaire d’initiative française peut-il se permettre de ne pas considérer des journalistes autrement que comme des preneur·euses d’images doté·es d’un gilet pare-balles ? N’aurait-il pas pu ou dû s’appuyer sur ce savoir-faire pour documenter avec précision la chronologie du génocide, ses logiques, ainsi que la structuration et les systèmes de cette guerre coloniale ? L’espace-temps du cinéma ne permet-il pas, justement, autre chose que le constat déprimant des pertes et des deuils ? Enfin, puisque le film, à travers la voix-off de la réalisatrice, propose d’interroger la circulation des images en temps de génocide, n’aurait-il pas pu mobiliser des moyens cinématographiques pour penser cette circulation ?
Des films collectifs, d’ateliers, co-construits avec leurs sujets, parfois filmés par des non-professionnel·les, se sont faits une place dans la programmation du FID, qui cherche à concilier deux exigences, l’une esthétique, l’autre politique. Je serais curieuse de savoir quels sont les critères, conscients ou inconscients, mobilisés par leurs programmateur·ices pour décider ceux qui, parmi ce type de films, auront droit à leurs toiles. Il faut rappeler que les processus de sélection sont drastiques, et qu’envoyer son film au FID a un coût élevé : 45€ pour un long-métrage. Cette année, 76 films ont été choisis, pour environ 3 000 reçus. Cela fait beaucoup de refoulés, de déçu·es, et de films invisibles.
Pour répondre à cette frustration, de jeunes cinéastes ont lancé cette année le FID OFF, un clin d’œil au festival d’Avignon, qui aujourd’hui est aussi connu pour son OFF que pour son IN. Grâce à un appel lancé sur Instagram, iels ont proposé à des cinéastes non-programmé·es au FID d’envoyer leurs courts-métrages. Les projections se sont faites dans l’arrière-salle du café bien-nommé Cinébar – qui n’avait pourtant jamais accueilli aucune projection, d’après ce que j’ai compris – grâce à un système de non-sélection, c’est-à-dire de tri par tirage au sort. 111 films ont été reçus, beaucoup trop pour être tous montrés, ce qui a condamné les programmateur·ices à cette forme de non-programmation à la fois arbitraire et démocratique. Les séances, devant un public plutôt très réduit, étaient à l’image de l’économie des films convoqués : débrouillardes et foutraques. D’étranges rituels étaient censés se substituer aux rituels sérieux que l’on connaît bien (annonce en grande pompe des sélections, conférences de presse, présentations des cinéastes, Q&A et autres remises de prix). Après une demi-heure d’installation chaotique, les présentateurices annoncent que le film choisi – au hasard, donc – sera dévoilé à travers l’impression d’un photogramme (le tout filmé au portable et projeté en direct. Pourquoi ? Aucune idée) : lae cinéaste reconnaissant son œuvre, étant forcément dans la salle puisque telle était la condition, est invité·e à se saisir de son photogramme imprimé et d’un couteau pour « couper son plan » avant la projection.
Quittant la salle après seulement un court-métrage pour rejoindre vite une séance du IN, je me demandais ce que je pensais, au fond, de ce FID OFF. Je crois que l’initiative est à défendre et à soutenir. Le territoire de l’autoproduction est immense et il existe tant de films qui méritent d’être vus. Peut-être que les organisateurices gagneraient à prendre un tout petit peu plus au sérieux leur idée, en faisant commencer les séances à l’heure par exemple, et peut-être, en faisant de ce FID OFF un espace de réflexion sur la programmation du IN et ce qu’elle dit ou ne dit pas du OFF, c’est-à-dire de tout ce qui n’est pas retenu, et de manière générale, sur la notion de programmation et ses pratiques ? À suivre lors des prochaines éditions, je l’espère.