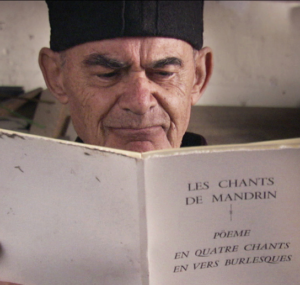On Falling, Laura Carreira
Hors-sujet

Dans la cadence impersonnelle des bips du scanner, des pas répétitifs, de la quête mécanique de l’objet et du souffle ajusté, la vie s’efface, se réduit à l’étroitesse des allées. Aurora (Joana Santos), immigrée portugaise, est assignée à remplir des chariots dans une chaîne de commandes en ligne. Si l’on pense naturellement à Amazon, l’identité visuelle des lieux – cupcakes bleu et jaune – évoque davantage IKEA, avec sa culture d’entreprise tout aussi rigide et uniformisée, où chacun devient « collaborateur ». Plus que le lieu, c’est le regard qui compte : la caméra épouse la restriction de cet espace, en partage la fatigue, l’usure, le temps. L’austérité méthodique – plans longs et souvent sans aucun contrechamp, neutralité chromatique, rareté de la musique – transforme chaque plan en mesure de l’érosion progressive de la subjectivité, une ascèse formelle qui refuse un temps l’ornement et la dramatisation.
Là où la mise en scène impose déjà cette impression d’étouffement, l’aliénation que Karl Marx décrivait comme la séparation de l’ouvrier et du produit de son travail prend ici une forme extrême. Aurora ne fabrique ni objet ni mémoire mais elle déplace un flux abstrait de marchandises et d’affects. Son travail ne lui offre aucun repère, aucune appropriation du geste : l’aliénation touche non seulement le produit mais l’acte même de travailler. Le geste répété perd toute portée, et tout ce que l’on voit de sa vie subjective se réduit au strict nécessaire pour « renouveler sa force de travail » – sommeil, alimentation, un minimum de sociabilité humaine. Le capitalisme ne lui laisse rien de plus, aucun superflu, aucun « plus » : c’est l’orthodoxie de l’exploitation : chercher à réduire au maximum le renouvellement de la force de travail rend l’exploitation sans limite. Le sens s’efface, et c’est l’existence elle-même qui se dilue.
Aurora se voit ainsi privée d’horizon narratif : aucune trame de vie ne se dessine, elle n’évoque jamais son passé au Portugal. Elle est enfermée dans la catégorie du travail pur, sans accès à l’œuvre durable ni à l’action qui révèle une identité. Sa subjectivité se réduit au maintien en vie et à la répétition. Ce glissement de la répétition gestuelle à l’absence d’une histoire de soi éclaire la radicalité de l’aliénation. Le dispositif de travail engendre un isolement qui déborde l’entrepôt, affectant ses interactions sociales : timidité, retenue, addiction au téléphone, incapacité à prendre la parole. Son supérieur la contrôle, l’évalue, la récompense – elle fait partie des meilleures employées de la semaine et reçoit une barre de chocolat, petite douceur dérisoire qui souligne le paradoxe de cette organisation : obéir, produire, et être reconnue dans un système qui ne laisse aucun espace à l’initiative ou à la singularité. Aurora est à la fois félicitée et subordonnée, tenue dans une tension entre performance et effacement. Cela se remarque lorsqu’elle est invitée par son colocataire polonais à dîner avec lui et ses amis – un fragment de récit possible : elle hésite longuement avant de dire oui, suspendue entre le désir et l’empêchement du lien. Même en club, elle regarde son téléphone et parle de la météo, avant de danser sans donner l’impression de s’amuser.
Cette dépendance au téléphone devient, à mi-film et à la suite de cette soirée, le pivot d’une série de micro-crises qui condensent sa vulnérabilité quotidienne : dans un geste maladroit, Aurora le fait tomber et l’écran se brise. Le téléphone portable se transforme en urgence : elle doit le faire réparer dès le lendemain, en payant un tarif plus élevé. Pour cela, elle puise dans ses économies, sacrifiant une partie de son budget pour la facture d’électricité. Le concret de la panne survient alors qu’elle est sous la douche, révélant brutalement sa fragilité et son isolement : elle choisit de ne pas répondre à ses colocataires qui la cherchent dans l’appartement.
Là où la trilogie Jeunesse de Wang Bing rend sensibles les dynamiques collectives et les solidarités, On Falling choisit une expérience intérieure : une immersion sensorielle dans la dépossession du corps et de la subjectivité, une perception intime et immédiate de l’aliénation. Le choix de mettre en scène une immigrée féminine n’est pas anodin. Il ne s’agit pas seulement de situer Aurora dans une fragilité individuelle, mais de suggérer comment les conditions sociales et économiques s’articulent avec genre et migration dans l’exploitation contemporaine. Montrer une femme immigrée dans un entrepôt britannique (ce n’est sûrement pas un hasard si le récit se déroule en Angleterre, milieu privilégié par Marx dans ses analyses) cumule en creux plusieurs vulnérabilités : emploi précaire, isolement social, normes de contrôle rigides. Mais le film ne les illustre pas directement : la seule difficulté concrète mise en scène est celle de poser une journée de repos. Aurora s’y prend trop tard dans le système en ligne, et doit finalement mentir en prétextant une maladie le matin même. Sa subjectivité se trouve ainsi circonscrite non par de grands conflits spectaculaires, mais par ces micro-régulations administratives qui réduisent sa liberté à presque rien. La vulnérabilité d’Aurora apparaît alors moins comme un état abstrait que comme une dépossession quotidienne, silencieuse, de son droit à décider de ses gestes et de ses jours.
Le film ne cherche jamais à restituer les dynamiques collectives, les solidarités ou les stratégies de résistance. Il choisit au contraire de maintenir le personnage dans son isolement, et de réduire l’expérience sociale globale à une série de micro-instants. Ces éclats acquièrent une force singulière : ils révèlent l’aliénation non pas dans sa totalité structurelle, mais dans ses manifestations les plus sensibles et intimes. Même le petit acte de rébellion, lorsqu’un collègue substitue un objet par un godemichet – geste qu’Aurora reproduira ensuite, avec un autre objet – reste ponctuel, mais sa brièveté souligne précisément la difficulté d’inscrire une résistance durable dans cette chaîne logistique.
Cette mécanique se heurte à de rares instants d’humanité, immédiatement étouffés. Les échanges entre collègues se réduisent à des gestes pratiques ou à des conversations superficielles : les téléphones, les séries à regarder, la répétition de ce que l’autre a déjà vu. Tout semble rejoué à l’identique, jour après jour, comme si aucun nouvel objet d’écoute ou d’attention ne pouvait émerger. Cette monotonie du discours devient une forme d’asphyxie collective. Le montage lui-même prolonge cet étouffement : elliptique, resserré, il coupe avant que la parole ne prenne corps, empêchant toute continuité relationnelle. Dans la cantine, Aurora croise le regard d’un collègue anonyme. Rien ne semble se jouer là, sinon la banalité d’un échange ordinaire : deux corps assis presque face à face, quelques mots échangés sur la vie après le travail. « Je fais la lessive », dit le collègue, avec ce ton faussement léger qui dissimule mal une sincérité brute, comme si l’aveu du quotidien était la seule parole encore possible. Cette phrase, d’ailleurs répétée à la fin, témoigne de l’emprise du capitalisme : aucun loisir véritable, encore du travail après le travail, et le temps hors de l’entrepôt entièrement dévolu au renouvellement de la force de travail. Rien ne signale l’importance du moment, et pourtant, quelque chose d’indéfinissable circule – un épuisement, une fraternité muette. Quelques scènes plus tard, on apprend que ce même collègue s’est suicidé.
La violence réside dans l’impossibilité de nouer un lien, dans l’effacement des existences au sein d’un flux qui n’admet ni hasard ni fragilité, et dont le temps hors de l’entrepôt ne sert qu’à anticiper le retour à la chaîne. Les signes de détresse se confondent avec la simple routine. En contrepoint, le colocataire polonais offre plusieurs moments de chaleur et d’ouverture : il invite Aurora à sortir, à voir du monde, à faire la fête. Ces instants fragiles rappellent que la vie peut surgir dans les interstices du dispositif, mais ne suffisent jamais à rompre la mécanique impersonnelle. Dans un magasin de maquillage et de parfums, Aurora s’attarde devant les produits. Une vendeuse lui propose du fard à paupières ; sur son poignet, des cicatrices témoignent d’une tentative de suicide passée. Cette scène juxtapose fragilité et intimité, montrant que l’identité persiste même dans un monde dominé par la logique du flux. Après l’entretien d’embauche, Aurora, évanouie dans un parc, est approchée par un gardien qui prend soin d’elle, mais appelle sa femme pour prévenir de son retard. Ces gestes simples introduisent la possibilité de la vie et du soin au milieu de la répétition et de l’aliénation.
La scène de l’entretien d’embauche condense cette dépossession dans sa forme la plus crue. Lorsque la recruteuse lui demande ce qu’elle aime faire, Aurora éclate en sanglots, prétexte ses règles, puis s’invente des vacances aux Bahamas. Cette improvisation fragile a quelque chose d’absurde, au sens camusien : le monde exige une réponse pleine de sens alors même qu’il en est vidé. Aurora doit inventer une identité fictive pour donner le change, comme si la subjectivité n’était plus qu’un masque provisoire exigé par la machine sociale. Le titre, On Falling, condense alors toute l’expérience : moins une chute brutale qu’une gravité continue. Tomber, c’est glisser hors de soi, se laisser absorber par la logique du flux. Le film ne propose ni échappée durable – la récréation finale ne tiendra que le temps d’une panne –, ni rédemption. Sa force tient à ce qu’il impose au corps et à l’esprit l’expérience de continuer à exister dans un monde où l’identité se dissout – et où la seule ressource devient de s’inventer, face à l’injonction sociale de « dire qui l’on est », une vie imaginaire.

Scénario : Laura Carreira / Image : Karl Kürten / Montage : Helle le Fevre
Durée : 1h44.
Sortie française le 29 octobre 2025.