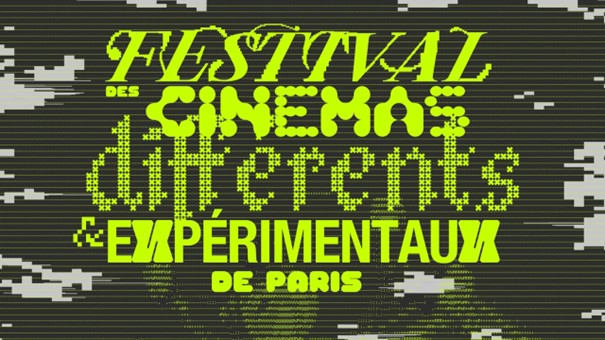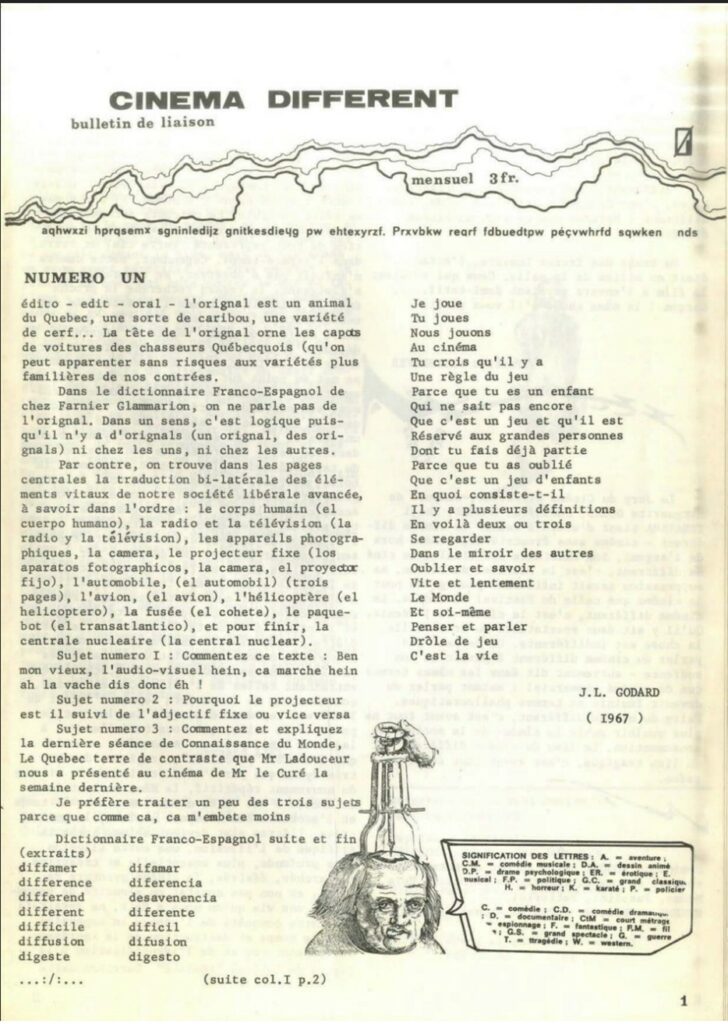La marge au centre
Entretien avec Charlie Hewison et Pétronille Malet à propos de la 27ème édition du FCDEP
Le Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris (FCDEP) du Collectif Jeune Cinéma (CJC) entre cette année au club des 27. À défaut d’envisager sa propre mort, cette édition montre qu’au gré des années on peut encore et toujours se réinventer. Encore une fois, mettre à mal les images, chercher à atteindre l’au-delà du médium pour mieux se poser la question de ses puissances, mais aussi de ses limites, tout cela sous l’égide du thème « technocritique : des cinémas luddites ».
Comme lors des éditions précédentes, le festival se compose en plusieurs volets : la Compétition, pour présenter 45 films venus de 22 pays. Les Focus, cinq projections organisées par cinq programmateur.ices différent.es dans cinq espaces alternatifs à Paris et en banlieue parisienne, le DOC!, le Shakirail, Cyberrance, Mains d’œuvres et l’AERI. Ces séances proposent toutes un sujet en lien avec le thème du festival (brainrot, transhumanisme, féminisme anti-industriel, surveillance de masse et hacktivisme).
La sélection jeunes cinéastes quant à elle propose des films de réalisateur.ices allant de 0 à 17,9 ans. Dans la foulée, la séance jeunes publics se veut être une introduction au cinéma expérimental dédiée aux enfants. Enfin, nouveauté de cette année, la soirée Off propose une exploration plus dynamique des échanges entre programmateur.ices, artistes et public. À noter que chaque projection démarre par un vidéo tract du collectif Video Tract for Palestine.
Cette édition annonce dès son titre une filiation claire avec le mouvement révolutionnaire des ouvriers saboteurs anglais « luddites » du XIXème siècle et, une continuation du travail des fondateurs avant-gardistes du collectif. Dans le catalogue accompagnant le festival, le festival se propose d’explorer le concept de société conviviale d’Ivan Ilitch – c’est-à-dire vouloir refonder la communauté politique en sabotant les institutions antérieures, « soit en déréglant la machine-cinéma, soit en la réinvestissant autrement ». Promesse ambitieuse dans un contexte festivalier dont le qualificatif expérimental peut parfois décourager, perçu comme vieillissant et fermé, aux antipodes de l’horizon convivial annoncé.
Après le renouvellement de l’équipe de programmation lors de l’édition 2024, Débordements s’entretient avec Charlie Hewison, directeur artistique et programmateur, et Pétronille Malet, coordinatrice et responsable de la programmation jeune public
Débordements : Comment expliquez-vous aujourd’hui le choix de scinder cinéma différent et expérimentaux dans le nom du festival ?
Pétronille Malet : D’abord, pour ouvrir encore un peu au-delà de ce que l’on peut spontanément qualifier de cinéma expérimental. Le terme « différent » était là dès le départ pour montrer qu’il ne s’agit pas simplement de la catégorie « expérimental » et que nous nous ouvrons à des formes très variées. Que ce soit de la pellicule, de la 3D, de l’animation, du found footage, de l’IA et tant d’autres.
Charlie Hewison : Jusqu’en 2010, le festival se nommait « festival des cinémas différents ». Mais il s’agissait déjà de ne pas être dans une tradition seulement affiliée au cinéma expérimental, de ne pas être contraint par les formes canoniques de l’avant-garde. Si ce cinéma peut comprendre tout et n’importe quoi, il y avait l’idée au moment de la création du festival que les films différents peuvent, par exemple, aussi être narratif avec toutefois un apport qui les inscrivent dans les marges. On peut penser au terme de cinéma pirate par exemple. Avoir ces deux termes, ça nous permet d’avoir quelque chose de joyeusement foutraque qui n’est pas purement formaliste ou structuraliste. Le Collectif Jeune Cinéma (coopérative en charge du festival) lui-même a été historiquement très proche de mouvements de cinémas expérimentaux différents comme l’école du corps dans les années 1980-1990 où des cinéastes rejetaient parfois le terme d’expérimental. Il y a donc une volonté de s’ouvrir à différentes formes.
D. : Cet objectif rappelle celui de ce qu’on a nommé l’expanded cinema, avec en plus le choix de faire que cette extension dépasse la forme filmique pour se retrouver jusque dans les lieux de projections. Chaque séance du FOCUS est hébergée par des lieux alternatifs, souvent des squats d’artistes autogérés. La question de la marginalité est omniprésente dans ce festival mais est, cette fois-ci, redoublée par le choix du thème : « technocritique : des cinémas luddites ». Cela confère à ces espaces de projection une notion en plus de sabotage des multiplexes.
P. M. : Le festival s’est toujours déroulé dans des lieux marginaux mais là on a davantage poussé en proposant que tous les FOCUS se passent ailleurs qu’au cinéma le Grand Action. Des lieux autogérés, plus festifs, qui reflètent un peu plus l’ADN du festival.
C.H. : Il y a cette idée d’être dans des lieux différents qui ne sont pas que des cinémas. Historiquement, le cinéma expérimental était dans ces lieux-là plus que dans les circuits commerciaux. Pour reprendre l’idée d’expanded cinema, il s’agit d’exploser la structure même de ce qu’est une séance de cinéma classique. On peut beaucoup plus se le permettre dans des lieux comme le DOC ! ou le Shakirail. On propose aussi des performances cinématographiques.
D. : Des films en marges, dans des espaces en marges avec des performances en marges pour aller à la marge du cadre. Comment, quand on se veut en dehors de toute institution et institutionnalisation, fait-on pour transmettre ces images à un jeune public ?
P.M. : Il y a un effort qui est fait pour attirer les jeunes public dans la programmation autant que dans la communication. Cette année encore le public était majoritairement jeune. Il y a dans certains cercles du cinéma expérimental un côté vieillissant, ce qui rassure quand l’on voit la fréquentation des séances que l’on propose. Pour les très jeunes publics, on a eu une séance avec des tout petits. Bien sûr on adapte la séance à la sensibilité d’enfants de 6, 7, 8 ans. On propose d’ailleurs des séances comme celle-ci toute l’année.
Ce volet s’accompagne de celui des jeunes cinéastes avec un appel à projet destiné aux moins de 18 ans. On constate que les jeunes font du cinéma expérimental quoiqu’il arrive puisque dès qu’ils prennent une caméra ils n’ont pas encore les codes des formes classiques. Récemment, nous avons suivi le travail d’Eric Semashkin qui faisait déjà partie de la sélection jeune cinéaste et qui a, par la suite, accédé à la sélection de la compétition.
D. : Il est en effet rare de voir des volets jeunes dans le monde du cinéma expérimental. Tu parlais de public vieillissant et je m’interroge sur ce paradoxe entre la niche que représente la forme expérimentale et l’exercice de sa diffusion. Cinquante ans après, vous perpétuez l’esprit en dehors des lignes qu’avait revendiquées le cinéaste Patrice Kirchhofer dès la première page du premier numéro de la revue du CJC, « Cinéma différent ». Introduction dans laquelle il affichait un poème de Godard qui s’attaquait à ceux qui n’interagissent plus avec le cinéma comme le feraient des enfants.
P.M. : C’est amusant parce qu’il est arrivé à Charlie pendant les interventions d’écorcher luddite pour dire ludique et c’est un lapsus qui en revient à ce qu’est l’expérimental. Faire avec pas grand-chose. Il y a plus de liberté et de jeux que dans des formes trop produites, moins spontanées.
C.H. : C’est vrai. C’est sans doute le fait de tout art qui existe depuis longtemps. Je donne cours sur le cinéma expérimental depuis maintenant dix ans et chaque année je me retrouve face à des étudiants qui arrivent avec des aprioris sur ce qu’est l’expérimental. Assez rapidement ils réalisent que « expérimental » ça ne veut tout et rien dire. Il y a certes des formes très travaillées, compliquées qui demandent beaucoup de références mais il y a aussi des formes libérées de toute contraintes narratives, historiques ou institutionnelles.
Je pense que, s’il y a un regain d’intérêt pour l’expérimental, c’est que l’on se rend compte, comme disait Pétronille, que c’est une forme que n’importe qui peut faire, sans équipe, sans budget. Hier on a vu Film de feu de Jacques Sorrentini dont le dispositif technique repose simplement sur une pellicule exposée au feu. De travailler avec les mains si c’est de la pellicule, des logiciels si c’est du numérique, produire des formes qui peuvent aussi être montrées sur grand écran, c’est ludique mais aussi déjà luddite d’une certaine manière.
D. : Le regain d’intérêt pour ce qu’il se passe en marge passerait donc en partie par une réappropriation de la technique ?
P.M. : Oui, en tout cas c’est l’idée que n’importe qui peut le faire, notamment parce que l’aspect technique des films est devenu très accessible.
[À ce moment de l’entretien, Pétronille Malet a dû partir pour présenter la séance qui s’apprêtait à débuter]
D. : On en vient donc au concept de convivialité d’Ivan Ilitch, cité dans votre texte du catalogue qui accompagne le festival. Vous y mentionnez aussi Stiegler dont on peut citer le concept de circuit de transindividuation qui, je pense, va de pair avec celui d’Ilitch, et évoque l’idée de se réapproprier la technique dans un but émancipateur. Comment avez-vous conçu la programmation des différentes séances du festival, et notamment de la soirée off, pour répondre à cette exigence politique ?
C.H. : C’est une proposition de Frédéric Tachou, membre historique du CJC. La proposition part du principe d’une soirée qui n’est pas une sélection, qui vise à proposer un espace de discussion entre les cinéastes et les publics, un espace déhiérarchisé. On essaie d’ouvrir des espaces de discussions partout mais la forme même d’une projection impose souvent un face-à-face entre les artistes et les spectateurs là où la soirée off cherchait à défaire cela.
Ce à quoi la soirée off s’essaye, c’est de saboter même le principe de sélection qui est un sujet compliqué lorsque l’on parle d’expérimental et qui a été une question historique des coopératives du milieu. Comment adopter une posture critique sur le principe de sélection (nous avions 1700 films parmi lesquels choisir cette année). Est-ce que sélectionner ce n’est pas déjà imposer un point de vue à des films qui cherchent à briser les préconceptions ? C’est une proposition intéressante au sein du festival, au regard du thème technocritique. Peut-être déclinerons-nous les moyens de questionner cela.
D. : Saboter le cinéma autant que les cinémas, donc.
C.H : Que ce soit en lisant les éditos, en venant voir les films ou en discutant, on réalise que la question technocritique c’est avant tout la question de comment les technologies nous façonnent. Je pense que tout le monde s’est posé cette question à des échelles différentes et des endroits différents. C’est aussi une question qui a traversé le cinéma expérimental dès le départ : que peut-on faire pour dévier cette technologie qu’est le cinéma ? La question résonne encore beaucoup aujourd’hui.
D. : Et ces questions ne présentent-elles pas un paradoxe entre la portée universelle que suppose le concept de société conviviale d’Ilitch et la niche que constitue le cinéma expérimental ? Comment surmonter les enjeux de la transmission d’une telle culture ?
C.H. : Je pense que ce sera toujours le paradoxe du cinéma expérimental. C’est un débat qui a eu lieu dès les débuts du XXème siècle avec des questions comme « Qu’est-ce qu’une forme politique ? », « Qu’est-ce qu’une forme radicale ? », ou sous la forme : est-ce plus intéressant de compromettre une forme radicale pour la transmettre au plus grand nombre, parce qu’à partir de cette diffusion plus large on va pouvoir faire passer des idées, des formes ou des volontés révolutionnaires petit à petit, ou est-ce qu’au contraire, on reste dans la radicalité avec les lieux marginaux que l’on peut s’accaparer en espérant que ça touche un public que l’on espère de plus en plus grand ?
Le choix de diffuser les soirées focus dans des espaces alternatifs, c’est aussi chercher à toucher différents publics. Il y a aussi un gros travail sur la communication mais la volonté de rendre cela accessible ne doit pas compromettre ce que l’on cherche à réaliser. Nous ne cherchons pas à adoucir ce que les films peuvent proposer de radicalités formelles ou politiques. C’est ce que je dis dans mon article dans le catalogue en faisant référence à Dominique Noguez. Dans Éloge du cinéma expérimental, il dit que le cinéma expérimental aurait toujours voulu être partout et s’est fait reléguer dans des espaces marginaux parce que la société n’est pas prête pour cela. Je suis d’accord d’une certaine manière, on aimerait voir les formes les plus radicales sur grand écran mais il faut aussi garder à l’esprit que le cinéma expérimental recherche ces lieux autres et ne veut pas se compromettre avec l’industrie. On prend donc acte de ce choix et à partir de ces endroits on grignote. Ce cinéma a toujours été méprisé, mis de côté par le cinéma industriel mais, en même temps, ce que l’on y recherche, cette exploration des limites, finissent souvent par se retrouver dans l’art et essai puis dans le grand public.
Le terme avant-garde n’est pas anodin. Tout cet écosystème a du sens. L’enjeu n’est pas de conforter un public déjà acquis en rejetant les autres, mais de provoquer la curiosité et d’offrir des cadres pour comprendre ces œuvres, on veut les rendre les plus accessibles possibles et c’est pourquoi je pense que l’idée d’Ilitch est parlante et productive. L’idée de départ est de ne pas se compromettre vis-à-vis de la société industrielle et pour cela il faut construire ce qu’il appelle des outils conviviaux. De nouvelles manières de faire qui seront plus accueillantes que celle de l’industrie. On ne va jamais montrer un film à UGC, mais on ne veut pas le faire et ce n’est pas plus mal.