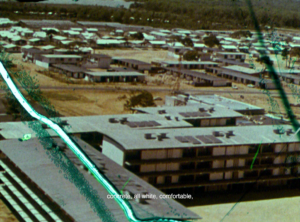L’Inconnu de la Grande Arche, Stéphane Demoustier
Le rebelle au cube

Après l’incandescent, et bien vite volatilisé – tant il était flamboyant –, Megalopolis (Francis Ford Coppola, 2024) et le pachydermique The Brutalist (Brady Corbet, 2025), L’Inconnu de la Grande Arche est en un peu moins d’un an le troisième film à se saisir du thème de l’architecture. Sans doute dans l’air du temps, le film de Stéphane Demoustier, adapté du roman La Grande Arche de Laurence Cossé (2016) est des trois celui qui s’inscrit le plus dans l’héritage du Rebelle de King Vidor (1949), où Gary Cooper incarnait un architecte (inspiré de Frank Lloyd Wright) disposé à tous les sacrifices mais aussi à tous les coups d’éclats pour ne pas compromettre sa vision moderniste dans une époque prêchant pourtant le néo-classicisme.
Comme ses prédécesseurs, il met en regard le cinéaste et l’architecte, tous deux porteurs d’un projet visionnaire mais voué à l’échec, ou en tout cas à la tiédeur, soit par sa démesure, soit par la médiocrité du monde qui l’entoure. Mais c’est avec un film qui se tient comme en retrait par rapport à son sujet grandiose, que Stéphane Demoustier parvient à en décliner une version d’une grande justesse : celle qui parvient à éviter d’une même esquive à la fois démesure et médiocrité. À travers une mise en scène mesurée et discrète, le réalisateur signe son film le plus fort (et qui commencera sans doute à l’affirmer comme un auteur) après les plus ou moins remarqués Terre Battue (2014), La Fille au bracelet (2018) et le récompensé Borgo (2023, César de la meilleure actrice pour Hafsia Herzi), tout en revenant à un domaine qui lui est familier, puisque son apprentissage de cinéaste s’est fait, au milieu des années 2000, par la réalisation de plusieurs films d’architecture pour le Pavillon de l’Arsenal et la Cité de l’architecture.
Nous sommes en 1983. Le danois von Spreckelsen (Claes Bang), architecte visionnaire mais inconnu, est désigné par Mitterrand (Michel Fau) en personne pour réaliser le projet de l’Arche de la Défense. Il a devancé 242 autres propositions à l’aide de son gigantesque « Cube », forme quasi-abstraite et percée d’est en ouest, qui s’inscrit parfaitement dans l’axe Louvre-Arc de Triomphe. Propulsé ainsi à la tête d’un chantier à 1,3 milliards de francs, Spreckelsen n’a pourtant construit que sa maison et quatre églises – et tout cela au Danemark. Lui que l’on découvre au début du film en train de pêcher nu sur un rivage danois, se retrouve dans les bureaux des hautes tours de la Défense ou encore à l’Elysée, à devoir marchander avec une ribambelle de technocrates, promoteurs et architectes spécialisés dans les grands chantiers. Alors qu’il se considère comme un artiste à part entière, il se voit rapidement contraint de collaborer avec Paul Andreu (Swann Arlaud), l’architecte du terminal circulaire de Roissy 1, rompu aux négociations en haut lieu et, surtout, aux concessions à répétition. Dans un rapport de force déjà mal engagé avec la réalité et ses représentants (les pouvoirs publics), Spreckelsen verra son idéalisme définitivement enterré par les élections de 1987 perdues par Mitterrand et la période de la cohabitation avec la droite, qui lui imposera compromis et coupes budgétaires.
L’Inconnu de la Grande Arche, dont le format carré veut embrasser la vision cubique de Spreckelsen, prend fait et cause pour son architecte danois. Claes Bang, géant rigide, rejoue l’obstination et la droiture toute érectile du Gary Cooper de King Vidor, et Stéphane Demoustier l’accompagne dans sa lutte en lui faisant constamment dominer le cadre au détriment des autres personnages : ceux-ci, non seulement plus petits, sont à la lutte pour se faire une place dans le plan, tout entier gagné à un Spreckelsen dont il épouse systématiquement les mouvements.
Dès la première scène du film, où Mitterrand dévoile le nom du vainqueur de l’appel à projets devant un parterre de collaborateurs et de journalistes interloqués. Offrant d’abord le centre du cadre à Mitterrand, entouré de sa cour tel un « roi Soleil » au moment où il ouvre l’enveloppe, Demoustier finit par reléguer le président aux marges de l’écran pour faire défiler les visages étonnés de l’assistance. Le simple nom de Spreckelsen dispute le centre du plan à son monarque présumé, et il faudra rapidement quitter le salon de l’Elysée pour découvrir l’architecte dans son plus simple appareil, occupé à pêcher le hareng à l’aide de petits appâts… cubiques. Plus tard, celui-ci ira jusqu’à faire plier (littéralement) un Mitterrand devant mettre un genou à terre afin de se mettre au niveau de la maquette du Cube et observer de ses propres yeux la perspective que cela donnerait depuis les Tuileries. Et Demoustier de cadrer Mitterrand à travers le Cube de son avatar-architecte, dernier moment de petit triomphe avant l’inexorable chute.
Spreckelsen parvient ainsi à s’approprier le cadre au détriment de ses interlocuteurs et serait toujours victorieux, si Demoustier ne choisissait pas de le confronter à la monumentalité des bâtiments eux-mêmes. Quatre moments, en plan large, laissent particulièrement voir l’architecte entièrement dominé, voire écrasé, par son sujet. Spreckelsen est en effet confronté à une monumentalité dont le cadre épouse les proportions, réduisant ainsi celles de l’architecte à la presque-miniature. Au pied des carrières de Carrare, de l’Arche en construction, du palais de l’Elysée qui lui ferme ses portes et enfin de l’Arche achevée et dénaturée par les compromis, Spreckelsen éprouve la disproportion séparant son corps (pourtant grand) des monuments colossaux. Le même marbre dans lequel Michel-Ange a taillé sa Pietà finira par écraser l’architecte, tant il symbolise l’idéal de l’artiste renaissant, dont le Danois ne peut se défaire. La façade de l’Elysée et la masse de la grande Arche opprimeront enfin Spreckelsen sous les revirements de la politique et les vicissitudes des grands projets. À cet égard, le recours aux effets spéciaux pour restituer plusieurs décors d’époque (dont, notamment, le chantier de la Grande Arche) à partir d’archives photographiques déploie l’effet d’écrasement sur le plan historique, comme si Demoustier donnait à voir des personnages projetés malgré leurs efforts dans une histoire figée et comme jouée d’avance.

L’une des singularités de la version de Stéphane Demoustier, réside peut-être dans son traitement des rapports de l’architecte et du président. Mitterrand, en effet, ne représente pas l’inertie des pouvoirs publics et la matrice de toutes les entraves possibles (ce que Demoustier confie à un Xavier Dolan en technocrate fidèle mais facétieux), mais précisément ce qui les court-circuite. Car Mitterrand, lui, est plutôt du côté d’une incarnation monarchique du pouvoir qui, pouvant se permettre d’enjamber toutes les institutions démocratiques, entretient une relation privilégiée avec l’artiste, dont il semble apprécier la personne et comprendre les principes. Demoustier replace justement Mitterrand dans le contexte des grands chantiers architecturaux de son septennat – dont les plus connus, comme la BNF ou la Pyramide du Louvre, sont, comme l’Arche de la Défense, avant tout des figures géométriques – et en fait un président qui rêve de laisser une empreinte pharaonique sur sa capitale. C’est d’ailleurs lui qui, le premier, loue la capacité de l’Arche de la Défense à s’intégrer parfaitement dans « l’axe royal » Louvre-Arc de Triomphe. Et ce n’est pas non plus un hasard si, avant de l’observer sur la maquette que lui propose l’architecte, Mitterrand emmène celui-ci au beau milieu de la circulation bruyante des Champs Elysées. Parce que le président veut voir par lui-même les reflets du marbre de la future Arche apparaître sous les voûtes de l’Arc de Triomphe, un coup de jumelle fera alors apparaître le marbre sous forme d’une gigantesque dalle élevée dans les airs afin de simuler le futur toit du bâtiment.
De même, le président et l’architecte semblent partager tout au long du film un goût prononcé pour le marbre de Carrare, matière noble par excellence, que Spreckelsen soumet à l’appréciation d’un Mitterrand dont il réveille ainsi un semblant de droit de divin. Mais si un président de la Ve République a bien le pouvoir de faire passer un tel projet de la vision à l’incarnation, il sera lui-même rattrapé par la défaite aux législatives de mars 1986. Le roi-Mitterrand est donc un protecteur imparfait (et finalement affaibli) pour l’artiste Spreckelsen, qui sera abandonné à lui-même lorsque, au moment de la cohabitation, il s’agira de négocier avec les commissions de la droite. Et les deux figures anachroniques du président-roi et de l’architecte-artiste se rejoindront dans leur désillusion de tard-venus, réveillés en sursaut dans ces années 1980 déclinantes.
De toute évidence, Spreckelsen restera, comme le titre du film l’indique, un architecte inconnu. Et quand bien-même la mise en scène prend fait et cause pour le très vidorien Spreckelsen, c’est paradoxalement dans la figure d’Andreu, architecte pragmatique, que Demoustier – à cet égard, non-vidorien – trouve son véritable avatar, loin de l’intransigeance et de la mégalomanie tourmentées de son personnage principal, qui finira par reconnaître – lors de sa dernière entrevue avec Mitterrand – qu’« il y avait trop de Cube dans [sa] vie » . L’Inconnu de la Grande Arche est ainsi un film qui cherche à penser de concert le rôle du cinéaste et celui de l’architecte : construire, ce serait peut-être moins remplir un espace, que chercher à laisser sa juste place au vide, véritable matière première de ce Cube ouvert de part en part.

Scénario : Stéphane Demoustier, d'après le roman La Grande Arche de Laurence Cossé / Image : David Chambille / Montage : Damien Maestraggi / Musique : Olivier Marguerit
Durée : 1h46.
Sortie française le 5 novembre 2025.