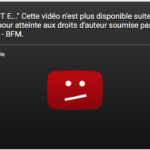Autour des Nuits Debout #3
L'écran des affrontements
Un vieux slogan qui n’a rien perdu de sa saveur, « L’Etat nous pisse dessus, les médias disent qu’il pleut. », demande de nos jours à être complété : l’Etat nous gaze, les médias disent qu’on pète. Deux imperturbables litanies inondent les chaînes et les journaux chaque jour de manifestation : « mobilisation en baisse » (cas exemplaire de wishful writing) et « des heurts en marge des défilés ». Inutile d’épiloguer sur la fonction de ces refrains mensongers : décrédibiliser, terroriser, masquer surtout, puisque la fascination craintive pour la violence, savamment entretenue par une presse servile, détourne le regard de ce qui, littéralement, se manifeste – un peuple las d’être gouverné, et désireux de rappeler ce que signifie « démocratie ». On peut détailler par contre les scénarios de la division déployés de part et d’autre.
Les débordements dont se repaissent les médias mettent en scène une figure mythique, le « casseur ». Golem d’images, il est, pour ce discours, la part obscure de la colère, le mauvais démon des manifestations, et surtout l’alibi d’une violence d’Etat dont la légitimité tend à se réduire comme peau de chagrin. Le « casseur » serait le cancer des luttes, la dérive d’un courroux préféré atavique, et il est triste de voir combien ce lexique infâme a été tant et si bien répandu qu’on le retrouve dans la bouche de certains manifestants, adoptant sans trop s’en rendre compte le scénario que l’ennemi voudrait imposer. Ceux qui ont pris part au cortège du 1er Mai à Paris ont pourtant pu contempler un tout autre spectacle. Une police qui osait bafouer cette cérémonie ancestrale de la gauche en nassant les manifestants et en les gazant à tout va, sans sommation et sans autre raison qu’un désir de mater la plèbe. Une police qui provoquait et, affirment certains, cassait, elle pour de bon, afin que les médias puissent jouir de ce spectacle dont ils raffolent. Mais aussi, en face, des milliers de manifestants qui, encerclés, criaient en chœur « Nous sommes tous des casseurs ! », pour rappeler que la seule division qui vaille oppose une police abusive à des cortèges solidaires. Et une fois à Nation, lorsque quelques centaines de jeunes bien équipés s’apprêtaient à rendre les coups indûment reçus, nombreux étaient ceux qui les acclamaient, parce que dans leurs cailloux se cristallisaient la fureur de chacun.
Le soir, une BFM définitivement lobotomisée accueillait Louis Aliot en lui demandant de commenter quelques images de combats. Avec sa carrure d’armoire à glace, il pouvait rassurer les chaumières : si le FN passe, finie l’insolence de la tourbe ; le Parti des Patriotes est celui du Phallus, de la trique de la matraque, celui qui virilisera enfin une République décidément trop douce envers ses enfants. Les autres médias, quand ils n’optaient pas pour une démission par le silence, serinaient prudemment l’antienne des affrontements. À part dans de rares journaux indépendants, rien ne fut dit de ces comportements policiers qui ont largement dépassé le stade de l’abus pour accéder à celui de l’iniquité – qu’on pense au matraquage et gazage de ceux qui filment les exactions. Pourtant, depuis quelques jours, certaines langues médiatiques se délient, des textes timides paraissent dans les pages les plus autorisées. Le 1er mai, point d’orgue de la répression, sera peut-être un point de bascule.
Il est temps en tout cas de dessiner la généalogie de cette guerre iconographique. D’analyser comment se construit l’image d’un mouvement, entre les vignettes officielles et les vidéos-preuves, vidéos-scandales et vidéos-fiertés, les photos-choc, photos-symboles et photos détournées. Pour comprendre aussi comment, et à quels risques, le spectacle de cette contestation contre « la loi travail et son monde » s’est tant concentré sur les confrontations.
Premières manifestations. Premières photos dans les médias. Des jeunes et des moins jeunes brandissent pancartes aux slogans inventifs, poétiques ou ironiques. Quelques cagoules, capuches, keffiehs, vite maîtrisés en « marge des cortège ». Sur la toile circulent quelques vidéos, un peu floues, qui dénoncent un rapport de force inégal : les maîtrisés en question sont peu nombreux, peu protégés. Dans un cas comme dans l’autre, ils sont figurés comme des marginaux, distincts du reste des manifestants, en infériorité numérique et symbolique. Nous sommes dans une première phase, une première catégorie d’images : les affrontements sont des débordements paradoxalement ritualisés. C’est la routine de fin de manif. Elle est donc traitée par les médias de manière routinière, on pourrait presque recycler des photos d’il y a plusieurs années.
C’est à côté de cette routine de la manifestation que se sont dessinées des alternatives créant de nouvelles images. Des corps statiques, réunis en demi-cercles, agitant les mains d’une drôle de façon : nouvelle figure de la foule, pacifiste, « naïve » pour certains, platement « citoyenne » pour d’autres, différente surtout. Ces images en ont dérangé plus d’un, parce qu’elles déplaçaient trop la routine. La foule, dans sa grouillante incommensurabilité, ne pouvait être contenue dans les portraits que Le Monde ou Libé tentent de faire des Nuit Deboutistes. Un mot d’ordre : pas de représentation, et ce dans les deux sens du terme. Ce mouvement immobile (mais dynamique), à force d’occuper les places, bousculait les rôles. Et en lui émergeaient des chaînes non canalisées, d’un périscope polyvalent (et parfois ambivalent) aux vidéos proliférant partout sur la toile, jusqu’à la Télé Debout. Malaise dans les médias. Une parole plurielle et dispersée, aussi, rentre mal dans ses formats.
Le pouvoir, de son côté, faisait d’un bâton deux coups. Celui sur la tête, déjà, pour châtier l’insoumission. Celui sur les yeux, ensuite, pour rabattre ce qui apparaissait – un Non tout neuf – sur une scène trop connue. Quand surgissent ces clones anonymes, bottés et casqués, chacun s’en retourne à sa place. Le rapport de force est à nouveau emblématisé, visualisé, simplifié. Mutique, vide d’affects, le CRS ou le gendarme mobile ne vaut que par la fonction qu’il symbolise, la face cachée du droit. Le problème, c’est qu’il nous oblige à n’exister ensemble que par rapport à lui : le Nous se solidifie de s’opposer à un Eux bien identifiable. Certes, le policier a ses avantages : on peut en détourner l’image, la remonter, la ridiculiser pour en pointer l’absurdité ; ainsi de ce coup de pied devenu un mème, qui décontextualise le geste et le fige. Cette statufication fonctionne à plein lorsque lui répond une figure de l’innocence, comme cette inoffensive soupe jetée au caniveau. Même système depuis des lustres, depuis le landau dégringolant les marches d’Odessa filmé par Eisenstein en 1925 jusqu’à cette fleur tendue aux fusils captée par Marc Riboud en 1967. Le rapport de force est unilatéral : la violence ne peut pas être du côté de la soupe. Mauvaise com pour la Police chaque fois qu’une de ces figures surprotégées et surarmées apparaît face à quelque bras nu, chevelure libérée ou vêtement déchiré.
Le « casseur », c’est connu, permet justement de replacer les bottés-casqués du côté de la violence légitime. Souvent vêtu de noir, de plus en plus équipé, le visage dissimulé, il est lui aussi une métonymie pratique ; transformé en ennemi commun, il autorise les médias à créer face à lui un Nous absurde, l’entité contre-nature « police + manifestants pacifiques ». De là que les médias, lors de la troisième phase iconographique de cette lutte, se sont échinés à les débusquer aux abords des Nuits debout. Seulement voilà : il est dans l’essence figurative de cette figure de se situer « à la marge ». Le hic, c’est que les cortèges prennent de plus en plus l’allure d’armée de « casseurs ». Il faut dire que, après s’être fait gazer les semaines passées, de nombreux manifestants ont opté pour la panoplie écharpe-devant-le-nez-et-lunettes-de-ski, histoire de pleurer un peu moins. En résulte ce que les médias sont prompts à faire passer pour une militarisation des manifestants, qui justifie en retour la surprésence de CRS désormais habilités à ne plus lésiner sur les grenades en tout genre, pour protéger on ne sait plus trop qui, à part eux-mêmes (mais dans ce cas, que font-ils ici ?). Tout bénef pour l’Etat. Pour les médias aussi, qui y trouvent leur ration de spectaculaire.
Des manifestations ne sont presque plus montrées, aujourd’hui, que les images des affrontements opposant deux rangées d’anonymes dont les journalistes continuent de faire croire qu’ils se battent à armes égales. L’esthétique, ici, importe. La scénographie de ces combats vise avant tout à un isolement figuratif qui scinde les « casseurs » de ceux qui les entourent. Les fumées de lacrymogènes opacifient les images, invisibilisent les corps. Elles convoquent le répertoire visuel de la guerre, tous les clichés de la menace. Quand il s’agit de vidéos, les sons retentissants des tirs et des pétards dissimulent la clameur, les chants et les slogans. La plupart des images ne montrent que quelques individus. Problème d’échelle : quiconque tenterait un plan large ou une vue aérienne changerait tout le discours sur lesdits « casseurs ». On verrait aussitôt qu’il ne s’agit pas d’une bande d’excités à la marge, mais qu’ils font partie des manifestants, qui souvent leur en savent gré – après tout, ils repoussent une police qui ne se gêne plus pour bloquer les cortèges quand bon lui semble. Réduire l’échelle des plans permet d’occulter cette solidarité qui s’accroît de manif en manif. Car le « débordement » n’a plus rien d’un rite complémentaire au défilé ; il est de plus en plus, à mesure que la colère s’accentue, la manifestation elle-même.
Nous en sommes à la quatrième phase de la bataille visuelle. La normalisation des conflits, leur généralisation, a radicalisé les deux bords. Les médias réactivent, sans toujours s’en rendre compte, toute la tradition iconographique et discursive qui depuis près de deux siècles a servi à disqualifier les mouvements sociaux au titre de leur irrationalité, ou de leur supposée propension au crime. Le « casseur » contemporain est l’héritier du sans-culotte, de l’apache, du blouson noir et du loubard, tous décrits depuis des lustres comme illettrés, alcooliques et anarchistes. Peu de temps avant, les grévistes d’Air France, de Continental ou de Goodyear étaient passés par le même filtre figuratif. Criminaliser les mouvements sociaux a toujours demandé une opération de partage divisant l’intelligence : à la police la rationalité, aux manifestants l’ignorance avinée, la fureur propre aux abrutis. Les discours d’un Valls ou d’un Finkielkraut ne font que répéter, l’élégance et la subtilité en moins, les descriptions que Taine avait donné des émeutes révolutionnaires dans Les Origines de la France contemporaine (pour résumer : l’émeute, c’est la canaille au pouvoir, le monde renversé, la déraison à son comble), ou les réflexions bien situées du salonnard Gustave Le Bon, dont La Psychologie des foules fait passer tout mouvement de masse pour une assemblée microbienne hystérique. Il y aurait une violence réfléchie et une autre démentielle. On se souviendra aussi du mot de Serge Daney : le cinéma est à la télévision ce que le latin est au français ; le cadre mental influant sur le cadrage des opérateurs de BFM et consorts, ce sont les films, américains au premier chef, qui depuis l’époque du muet dépeignent tout soulèvement comme pagaille sanguinaire : Orphans of the Storm de Griffth et Madame du Barry de Lubitsch dès l’origine, jusqu’aux récents Marie-Antoinette de Sofia Coppola et, pire, The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, qui transforme les militants d’Occupy Wall Street en une bande de truands et de terroristes. Le « casseur » est une fiction figurative dont l’origine n’est autre que la crainte viscérale des élites face à la démocratie, qui pour elles a tout d’un débordement fondamental.
Reste à voir quelles images alternatives on y oppose. Taranis News en est un bon exemple, notamment pour ce qui touche aux limites de ces vidéos. Celles-ci, bien souvent, se complaisent dans la construction jouissive d’une scénographie du combat : montages alternés de mains se saisissant de projectiles de fortune et de bras gantés brandissant les grenades destinées à disperser la foule, silhouettes de dos se ruant sur le camp adverse, fumées de diverses origines (voitures brûlées pour les uns, gaz légaux pour les autres), le tout agrémenté d’une musique visant tantôt à la célébration (Emportée par la foule, d’Edith Piaf, dans le clip intitulé Riot), tantôt à la stimulation (un rock gras, tonitruant, viriliste). La pulsion scopique suscitée fonctionne supposément comme un exutoire, et tend à réduire les actes filmés à cette fonction : un défouloir d’énergie, un exorcisme. Ceci contribue malheureusement à aplanir, voire à effacer leur dimension politique, et à abonder dans le même sens que les discours dominants auxquels ces vidéos dissidentes sont censées s’opposer : il ne s’agirait plus de résister à une force oppressive légale mais illégitime, mais simplement d’exprimer un amour de la confrontation physique et de l’adrénaline. D’autres vidéos penchent plus vers la victimisation, offrant à l’indignation publique le spectacle d’une jeunesse martyrisée. On en reste malgré tout rivé à ces affrontements dont l’ultime fonction est d’enfumer, plus que les yeux, les esprits, qui dès lors ne voient pas plus loin que la matraque.
Il est devenu courant de comparer les CRS à des schtroumpfs. Mais ces images ne répondent pas à ce problème crucial : où est le Grand Schtroumpf ? Pas derrière les cordons, en tout cas. Plutôt chez Gargamel (aka le Capital), à profiter du répit que lui offrent les charges de ses sbires mal coiffés pour préparer en cachette d’autres potions assassines. C’est parce que la police a une place si spéciale dans l’ordre étatique – elle n’est pas la représentante de la loi, mais de l’ordre, et fait presque mine d’institution séparée – que ses agissements laissent presque indemne la figure du souverain : honnie en soi, elle couvre le Grand Schtroumpf. À bien des égards, nous sommes tombés dans le piège politico-médiatique. Le terrain sur lequel nous contre-attaquons a été balisé par d’autres, et notre stratégie n’est que de riposte, et pas assez d’invention.
En quoi, finalement, pourrait consister un véritable débordement ? Est-il vraiment dans les affrontements avec la police, si leurs représentations finissent par être si codifiées, reproductibles à l’identique ? L’ordre contesté trouve son intérêt dans cette fixation, qui camoufle une violence moins visible, aux images moins virales. Pour insoumettre, il faudrait peut-être aussi, en plus, déplacer. Une vidéo récemment publiée par la chaîne youtube « Les yeux de Marianne » trace une de ces autres voies possibles. Le montage, malin, évite à la fois l’écueil de la pétrification de la figure du CRS et de la proportionnalisation du rapport de force, tout en laissant la revendication politique au premier plan. On part d’un combat simple et précis, présenté d’emblée comme légitime, et de surcroît légal : installer la sono et le matériel logistique place de la République pour l’assemblée générale de la Nuit debout, autorisée par la préfecture mais rendue impossible par un barrage de CRS. La preuve de cette bonne foi est donnée par la lecture du texte authentifiant cette autorisation. Partant, il s’agit de s’organiser pour faire valoir ce que de droit. Un plan assez long montre une femme montée sur un muret, s’adressant à une assemblée, pour recueillir les différentes propositions de réactions à ce blocage. Pendant quelques minutes, les corps s’organisent et finalement convergent : un cortège de piétons accompagne le camion jusqu’au barrage de CRS. De là commence « l’affrontement », il n’est pas né de nulle part, il n’est pas « gratuit ». Les CRS arrêtent le camion, des voix s’élèvent, le ton monte, un chœur se crée, contractant en quelques mots l’enjeu du conflit, calé sur un rythme connu, ritualisé : « Libérez la sono ! Li-bé-rez, la so-no », crie ainsi une voix inassignable, horizontale, anti-représentative. A cette opposition purement vocale et musicale, une réponse sourde. En un plan large et fixe, l’on voit plusieurs CRS gazer à bout de bras des manifestants qui lèvent les mains en l’air et tentent d’avancer. La caméra se rapproche et l’on capte les regards de certains agents, qui ont l’air décontenancés. Tout à coup, ils semblent libérés de cet anonymat que leur assigne leur armure. Les individualiser, c’est déjà renverser le rapport de force. Le montage accuse une courte ellipse pour amplifier la gradation de la violence : soudain, un manifestant se retrouve plaqué contre un capot et menotté. Le dialogue est rompu. Des scènes de confusion, au milieu des fumées, les corps se déplacent de quelques centimètres, les CRS essaient de s’organiser mais semblent dépassés par la propre absurdité de leur présence. Autre ellipse, des femmes sont à terre, les yeux rougis par les gaz. Il n’y a pas d’« affrontement » physique, pas de heurts, simplement une violence légale dont l’illégitimité est rendue manifeste par l’ellipse elle-même. Les visages découverts permettent de déconstruire les figures casquées. Les deux camps finissent dé-momifiés, et les rôles dévient accidentellement au point que clignote un instant la possibilité d’un échange – et c’est là le plus grand péril pour le partage des places.
La vidéo, surtout, se concentre moins sur le rapport de force que sur l’intelligence collective émanant spontanément d’un groupe cherchant à éviter le choc. Les plans suivants insistent sur les bâches et les caisses qui se promènent de mains en mains, sur la constitution d’un corps collectif. L’inventivité de cette scène de confrontation est aussi de montrer comment échapper au conflit auquel l’ordre entend nous forcer. La confrontation n’est pas le cœur de l’image, plutôt ce qu’elle s’acharne à éviter. Moyen de s’échapper d’une certaine prison esthétique, en couplant aux nécessaires contre-images de conflits d’autres déclinaisons de ce combat, qui est autant affrontement contre le pouvoir qu’écart par rapport à lui. Reste à trouver des formes modelées sur ce pas de côté.