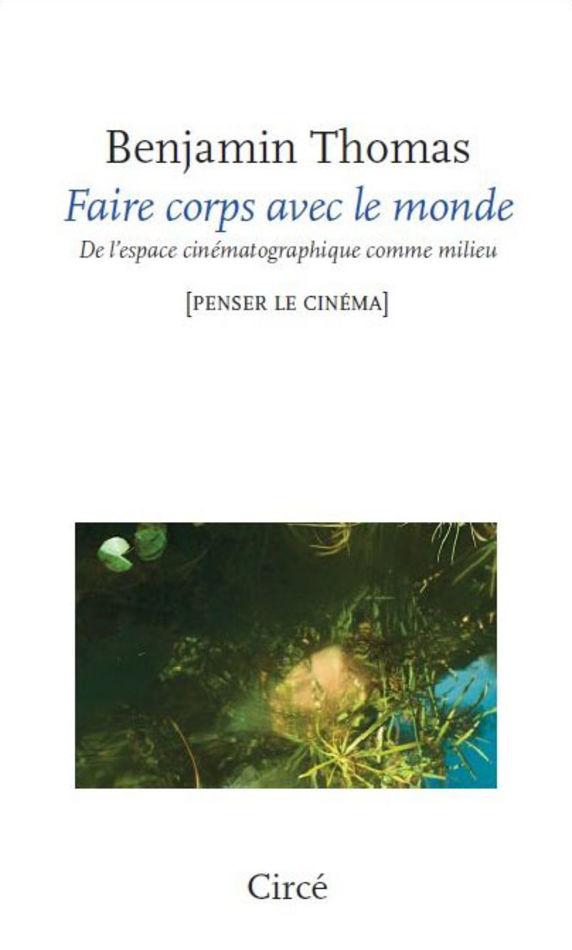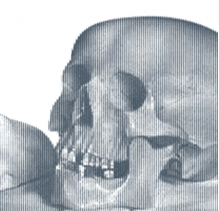Benjamin Thomas
Dans le milieu des images : en cinéma, et au-delà ?
Prolongeant un travail sur les formes sensibles de l’être-au-monde que le cinéma façonne selon ses moyens de figuration spécifiques, aussi bien dans ce qu’il donne à percevoir sur l’écran qu’au travers de ce qu’il requiert du spectateur, Benjamin Thomas propose, dans Faire corps avec le monde. De l’espace cinématographique comme milieu (Belval, Circé, « Penser le cinéma », 2019), une prise de position théorique à la fois marquée et toute en nuances. Relativisant le regard consistant à réduire le traitement cinématographique de l’espace à la mise en scène d’un décor qui serait le lieu d’accueil (et éventuellement le reflet) de la personnalité ou des états d’âme des personnages, il élabore une approche « mésographique », inspirée, notamment, des réflexions du géographe Augustin Berque. Nourri de nombreuses lectures philosophiques, et se montrant très attentif aux formes filmiques concrètes, le livre de Benjamin Thomas apparaît non tant comme une remise en question d’une certaine conception traditionnelle de l’espace au cinéma que comme une mise en perspective salutaire, qui dévoile une inclination jusqu’alors méconnue du 7e Art et enrichit notre regard de spectateur en étoffant la palette de ses possibles. Compte tenu de l’importance et de la portée potentielle des enjeux théoriques que soulève ce travail, au-delà même du domaine cinématographique à propos duquel il a été élaboré, il nous a paru opportun, en tant que chercheur issu d’un autre champ (les études littéraires), de permettre à son auteur de prolonger et d’approfondir certaines de ses réflexions.
Débordements: Dans Faire corps avec le monde, toute ta démarche semble sous-tendue par le souhait de faire droit à ce que tu désignes comme « les puissances mésographiques du cinéma » (p. 84). Cette idée de « puissance » me semble informer en sous-main l’ensemble du livre, sans que tu ne l’abordes véritablement de front. Pourrais-tu expliciter le recours à cette notion ? En quoi te paraît-elle nécessaire ? De quel(s) type(s) de puissance parles-tu et quelle place lui confères-tu dans le développement de ta réflexion ?
Benjamin Thomas: Cela relève pour moi d’un présupposé disciplinaire, qui dépasse largement le cadre de mon livre (sans revenir sur l’expression « puissances cinématographiques », je m’en explique d’une certaine manière en revenant dès l’entame de l’essai sur l’importance de l’analyse filmique et sur le sens à donner à l’esthétique).
Des puissances cinématographiques, l’on pourrait dire en effet qu’elles sont l’objet de réflexion premier de tout chercheur en études cinématographiques. Les films sont des actualisations spécifiques d’infinies virtualités (combinatoires) offertes par tout un appareil (le cinéma : la caméra, l’image en mouvement, le cadre, le montage, la possibilité du son, du silence, etc.). Appareil, donc, au sens que Jean-Louis Déotte donnerait à ce mot : « l’appareil, c’est ce qui prépare le phénomène à apparaître pour “nous”[11][11] Jean-Louis Déotte, L’Epoque des appareils, Paris, Lignes, 2004, p. 102. ». Le cinéma ne se contente pas d’enregistrer : l’appareil cinématographique propose d’éprouver des durées, des rythmes, des états de corps, des effets de matières, des appréhensions de l’espace, des temporalités, des affects qui dénotent et détonent par rapport à l’expérience que l’on fait du monde en dehors de cet appareil[22][22] Ibid.. En somme, il contient de nombreuses virtualités que le chercheur en études cinématographiques se donne pour tâche de recueillir et de penser. Pourquoi ? Parce que ces formes et procédés en puissance, lorsqu’ils s’actualisent dans un film dévoilent de nouveaux champs du cinéma, ce qui est déjà important en soi. Mais ce n’est pas tout ; ces formes et procédés constituent l’économie sémantique particulière de l’image en mouvement : ses modalités d’exprimer et d’affecter. Depuis les années 1970, au moins, en philosophie (Jean-François Lyotard, plus tard Gilles Deleuze, dans son travail sur Bacon) et en histoire de l’art (Hubert Damisch, Louis Marin), on a compris l’importance déterminante du geste qui consistait à reconnaître à l’image une densité expressive propre, qui se déploie sur le plan figuratif, mais est prise en charge aussi par la perceptibilité même de la matière, des textures – et, pour le cinéma –, des durées, des mouvements dont procèdent les figures. Bien au-delà de ses capacités mimétiques, il s’agit de voir que le visible structuré par l’image n’est que la pointe émergée d’une densité sensible dans l’épaisseur de laquelle s’expriment d’autres choses que ce qu’elle montre : des affects, des sensations, des idées, qui peuvent y coexister, y compris quand la raison discursive les jugerait contradictoires. C’est ce régime de l’image que l’on appelle figural, à la suite des travaux de Lyotard, qui ont connu reprises et prolongements jusque dans le champ du cinéma (Thierry Kuntzel, Christian Metz, Nicole Brenez, Jacques Aumont, Philippe Dubois, Luc Vancheri, …).
Autrement dit, dans « puissances cinématographiques », il faut aussi entendre ces « forces actives » que sont les figures et opérations de figuration non langagières déployées par un film : actives parce qu’elles consignent de la pensée, des affects, des sensations – comme une allitération en « s » dans un vers de Racine, si l’on veut –, toutes choses qui ne sont pas arbitrairement projetées sur elles par un spectateur particulier, mais qu’elles auront suscitées parce qu’elles les consignent et peuvent les réactiver. Au passage, analyser ces puissances, c’est donc – très souvent – faire le deuil de l’univocité, mais pas pour autant épouser le règne du chaos : si ce qu’exprime telle puissance cinématographique actualisée dans tel film à tel moment – un mouvement de caméra, un jeu avec la texture de l’image – peut maintenir une certaine polysémie, elle ne le fait pas moins dans une économie figurale dont se soutient le film, et au regard de laquelle cette polysémie, cette densité expressive même, est cohérente. En d’autres termes, ce travail est sérieux ; ce n’est pas la libération, face aux formes, de la seule sensibilité subjective d’un spectateur. C’est une esthétique au sens fort, et en deux sens complémentaires : la conviction que les puissances cinématographiques participent d’une connaissance sensible (c’est ainsi, pour rappel, qu’Alexander Baumgarten, « père » de l’esthétique au sens moderne [xviiie siècle] la définissait ; c’est en ces termes que Jean Epstein, avant même d’être cinéaste, la défendra de nouveau en 1921 [La Lyrosophie]) ; et c’est aussi l’esthétique au sens que donnait Marie-Claire Ropars à ce mot : l’analyse de la « construction du regard et de l’écoute [33][33] Marie-Claire Ropars-Wuillemier, Ecrire l’espace, Saint-Denis, PUV, 2002. » par l’œuvre (soit les conditions de cette connaissance sensible ménagées par l’œuvre elle-même). En bref, ce n’est de la surinterprétation que pour les gens qui, pour le dire avec Damisch, feignent « de ne retenir des images que l’information qu’elles véhiculent[44][44] Hubert Damisch, Théorie du nuage. Pour une histoire de la peinture, Paris, Seuil, 1972, p. 42. ».
Or donc, parmi cette infinité de puissances cinématographiques, celles qui ont retenu mon attention, auxquelles mon essai tente de faire place, ce sont des puissances que je me suis résolu à nommer « mésographiques » (« dessinant » des « milieux »). Elles consistent donc à actualiser dans l’image des milieux, c’est-à-dire des configurations sensibles dans lesquelles les corps et les lieux figurés interagissent activement, se qualifient réciproquement. Je prendrais simplement l’exemple mentionné en quatrième de couverture du livre, tiré de Vincent n’a pas d’écailles (2014), de Thomas Salvador. Dans ce film, quand le corps de Vincent, doté de pouvoirs singuliers, entre dans l’eau, ses mouvements prennent des qualités aqueuses : fluidité, impétuosité, jaillissement… Le corps du protagoniste flue à des vitesses inconcevables. Et si ce corps apparaît si singulièrement aquatique, c’est parce qu’il s’associe aisément à des mouvements d’eau. Mais, on le sait, l’eau pourrait être tout autre : lourdeur, stagnation, imprégnation… Or donc, si à l’image s’actualise sa fluence, c’est grâce à ce que nous avons vu du corps et de ce qu’il fait d’elle. Ce serait un tout autre milieu, si j’avais vu Vincent peiner à s’avancer dans l’eau, y être alourdi et entravé… Et, bien sûr, le cadrage, les durées de plan, les mouvements de caméra ont travaillé à consigner autant qu’à susciter cette définition réciproque d’une spatialité et d’une corporéité. Voici donc les puissances auxquelles s’attèle ce livre : comment elles s’actualisent, ce qu’elles peuvent exprimer.
D.: Dans une discrète note du début de ton livre, qui me semble être une résultante des fondements phénoménologiques de ton approche, tu affirmes que « la question d’espace qui va nous occuper ici est loin d’être d’abord celle d’une construction culturelle de l’espace » (p. 22, note 20, c’est toi qui soulignes). Dans la mesure où cette remarque me paraît toucher au cœur de ton approche, pourrais-tu préciser la manière dont tu envisages ce qui échapperait à (ou précéderait) une telle « construction culturelle de l’espace » (cette fois, c’est moi…), ainsi que le rapport entre ce donné pré-culturel et un espace, disons, « culturalisé » ? Un espace dans lequel évoluent des humains, un « milieu » pour reprendre la terminologie d’Augustin Berque, n’est-il pas toujours d’emblée culturel ?
B.T. : Pour commencer, insistons sur le fait que la notion de « milieu » permet de distinguer radicalement la qualité de présence de l’espace figuré qui m’intéresse des notions de « décor », de « lieu de l’action » (qui n’accueillent les personnages que très passivement) ou encore de « paysage » (qui, en toute rigueur, est une construction visuelle dont l’enjeu est de faire de la présence du lieu le motif principal de la composition, ce qui, pour advenir pleinement au cinéma, réclame entre autres choses une disparition ou une neutralisation des corps et de leurs mouvements). Mais « milieu » permet aussi d’éviter le recours au seul terme d’« espace », très polysémique, surtout et y compris dans le champ des études cinématographiques. Ainsi, l’espace devient-il ici la matière première du « milieu ». Cette notion a fait l’objet d’un travail de redéfinition ces dernières décennies – notamment chez Augustin Berque[55][55] Augustin Berque, La Mésologie. Pourquoi et pour quoi faire ?, Nanterre, Presses Universitaires Paris Ouest, 2014. –, qui la rend tout à fait opérante pour ce qui nous occupe ici, fût-ce en assumant de la déplacer dans ce périmètre singulier qu’est l’analyse du sensible structuré par les films. Un milieu existe donc dès lors qu’un corps, selon ses possibilités propres, fait être et apparaître un lieu par interaction avec les ressources de ce lieu (éléments topographiques, qualités physiques, possibilités de déplacement, etc.). Ce qui implique, dans le même temps, qu’une corporéité prenne forme à partir de ce qu’un lieu offre à un corps. Le géographe et philosophe Augustin Berque en donne une définition simple, réfutant ce que l’usage le plus courant du mot retient d’une force environnante aux sujets qui les déterminerait de manière unilatérale : « Le milieu suppose le sujet, qui suppose le milieu. Il y a entre les deux termes non point l’altérité radicale que le dualisme postule abstraitement entre le subjectif et l’objectif, mais une élaboration concrète et réciproque […]. Ni le sujet, ni le milieu n’existent en soi : le sujet suppose le milieu pour devenir sujet, le milieu suppose le sujet pour devenir milieu. [66][66] Augustin Berque, « Mésologie. De milieu en art », Mésologiques [en ligne], publié le 25 juin 2014.
La pensée du milieu de Berque – ce qu’il nomme mésologie – se conçoit comme une sortie du paradigme dualiste, mais, loin d’envisager un abandon des catégories d’objet et de sujet, elle veut les ressaisir à l’aune d’un tiers qu’en a exclu le dualisme, et qui est le tissu vif de leurs relations. Dès lors, il s’agit de continuer de penser « à la fois l’objet et le sujet » mais en ce qu’ils sont « trajectivement unis dans le milieu[77][77] Augustin Berque, Poétique de la Terre. Histoire naturelle et histoire humaine, essai de mésologie, Paris, Belin, 2010, p. 200. ». Le trajectif, la trajection, désignent ainsi chez Berque ce qui se joue sans cesse entre le subjectif et l’objectif, et par quoi se tisse donc le milieu : « Les choses du milieu ne sont pas des objets substantiels, subsistant dans leur en-soi ; elles sont toujours en train de se faire dans leur interaction avec le sujet. Réciproquement, le sujet aussi est toujours en train de se faire dans son interaction avec les choses[88][88] Ibid., p. 179.. » Or, ce sujet, chez Berque, peut être « individuel […] ou collectif[99][99] Ibid., p. 205. C’est Berque qui souligne. ». En effet, en géographe, il déploie volontiers sa réflexion à l’échelle macroscopique. Ainsi, « la trajection est une saisie globale de la Terre ou de la nature par les sens, par l’action, par la pensée et par le langage[1010][1010] Augustin Berque, « Mésologie. De milieu en art », art. cit. », et la mésologie s’intéresse dès lors à des constructions collectives, historiques, sociales, culturelles complexes. De même, dans la lignée de Jakob von Uexküll[1111][1111] Voir Jakob von Uexküll, Milieu animal et milieu humain (1933), Paris, Payot & Rivages, 2010., qui est une de ses inspirations, toute forme du vivant – humaine ou non – peut être pensée comme sujet se constituant par interaction avec un milieu. Cependant, au soubassement de la pensée de Berque, il y a aussi une influence phénoménologique maintes fois revendiquée (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, ou encore Tetsurô Watsuji, dont il est le traducteur). Or, en revenant à la phénoménologie après la mésologie, et notamment à Maurice Merleau-Ponty (ou Henri Maldiney), vers qui je suis allé plus volontiers, l’on y revient avec une attention renouvelée aux occurrences du terme « milieu ». Dès lors, celles-ci nous ramènent au niveau inframince et impalpable de l’expérience intime. Ainsi, le sujet, écrit Maurice Merleau-Ponty, « est une puissance qui co-naît à un certain milieu d’existence ou se synchronise avec lui[1212][1212] Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 2005, p. 256. Je souligne. ».
Et c’est d’abord à cette échelle-ci que joue selon moi la notion de milieu en cinéma : au plus près du sensible, au plus près de ce qui advient quand un corps naît avec un milieu (et inversement), et que l’on assiste à autre chose qu’au passage d’un personnage devant un décor. Un milieu, non plus sur le plan sociologique, culturel, géographique, mais sur le plan esthétique – et donc figuratif/figural –, c’est ce qui advient au cinéma à chaque fois que ses moyens de figuration sont mobilisés pour faire exister des états de corps et des états d’espace s’entre-définissant (c’est donc moins de milieux au cinéma qu’il s’agit ici que de milieux en cinéma). Cela étant dit, la mise en question du dualisme dont ce simple geste procède est culturelle, bien évidemment. Et, puisque je disais tout à l’heure que les puissances cinématographiques n’expriment pas qu’elles-mêmes, mais sont transitives, il est évident que ces puissances libèrent des densités expressives dont la charge peut être éthique, politique, culturelle (en ce qu’elle interroge, interpelle, les configurations que s’est données une culture, ou un état entériné de la culture). Les configurations mésographiques du film jouant très souvent à l’échelle d’un corps, de quelques corps pris dans un moment[1313][1313] « Moment : […] Espace de temps précis, situé dans une durée et généralement considéré par rapport à ce qui le caractérise » (Trésor de la langue française)., il est moins évident d’en voir cette portée-là tout de suite. Mais elle me semble présente au fil des analyses, et la conclusion de l’ouvrage s’emploie à l’aviver.
D. : En plus de travaux examinant la culture dans une perspective globale (de Certeau), voire holistique (Berque), ton livre s’appuie sur un nombre considérable de lectures issues de la philosophie (Merleau-Ponty), ou de pensées de l’esthétique issues du domaine de la philosophie (Bachelard) ou y puisant une part notable des fondements de leurs travaux (Maldiney). Cela me semble conférer à ton travail une assise très générale quant à ce qui touche aux rapports du corps et de l’espace. Or, pour ce qui te concerne, tu étudies des représentations, cinématographiques. Première question découlant de ce constat : comment opères-tu le passage d’une perspective disons philosophique, qui touche à la réalité du monde et du rapport que nous entretenons avec lui, à une approche consistant en l’analyse d’œuvres esthétiques, qui figurent ces rapports entre corps et espaces ? En d’autres termes, qu’est-ce qui change, entre l’expérience sensible d’un milieu et la figuration de l’expérience d’un milieu ?
B.T. : On ne peut déplacer ce que Jacques Aumont appelle à juste titre des « leviers théoriques » d’un champ à un autre sans les altérer un peu, ou sans redéfinir leur périmètre. Leur rencontre avec un autre objet les fait opérer différemment, sans qu’ils en perdent leur identité de concept, ce en quoi ils ont une valeur heuristique.
Mais pour te répondre concrètement quant à ce qui change radicalement ici entre la réalité et le filmique : d’abord, je l’ai dit, les capacités mésographiques du cinéma agissent toujours au plus près du sensible, et non pas d’emblée à des échelles macroscopiques, socio-historiques, parce que le film, le plan de cinéma me met d’abord en contact avec des corps à hauteur d’humain, et au plus près des lieux ; ensuite, les formes et les procédés cinématographiques inventent et consignent ce qui normalement est intangible, invisible, insensible pour l’observateur extérieur, lorsqu’il voit un autre humain « faire corps avec un lieu ». C’est aussi « simple » que cela. On pourrait prendre l’exemple, dans L’humanité (1999) de Bruno Dumont, d’une scène dans laquelle Pharaon De Winter, sur son vélo, se lance dans l’ascension du modeste mont des Cats. On pourrait même prendre un seul des plans de cette séquence. Le plan en question se compose en tension : Pharaon de dos, pédale dans la montée ; la caméra le suit à un rythme tel que la silhouette du cycliste occupe constamment le même point au centre du cadre ; le cadre est donc mouvant, il suscite une impression de mouvement car le lieu semble se mouvoir lui-même, ses aspects se modifient à l’écran ; mais, en même temps, et au contraire, le plan suscite aussi une impression de stase dès lors que l’on s’avise que la mobilité du cadre a pour effet d’annuler le mouvement du corps, qui pourtant se déplace bel et bien. Le milieu se tisse d’effort, je le devinerais sans doute si, hors d’une salle de cinéma et posté au bord de la route, je voyais passer ce cycliste. Mais là, face à un plan de cinéma, qu’est-ce que c’est que ce milieu : c’est un lieu qui bouge et un corps qui semble ne pas pouvoir bouger avec lui. Et, on le voit bien, il ne s’agit pas tant d’un duel que d’une interaction : le mouvement du cycliste ne pourrait être qualifié comme on vient de le faire si le mouvement (cinématographique) du lieu n’était pas tel qu’il est, et inversement…
D. : Tu situes les séquences d’ordre mésographique des films que tu analyses dans une sorte de soustraction au régime du narratif. À propos de ce passage de L’humanité de Bruno Dumont, tu écris par exemple : « Il n’est même pas besoin de situer davantage la séquence au regard de l’histoire du film, tant ses enjeux ne semblent absolument pas narratifs » (p. 97). Bien sûr, à la faveur des nombreuses analyses de films que tu élabores, tu nuances cette perspective par la suite, en indiquant par exemple que de tels plans ou séquences « ne se rapportent que difficilement à des enjeux narratifs marqués » ou encore en parlant d’« absence de charge narrative évidente » (p. 110). Il n’en demeure pas moins que ce retrait par rapport à l’ordre de l’intrigue et de la narration constitue un levier déterminant des mésographies cinématographiques que tu mets en évidence. Estimes-tu qu’il existe des marqueurs particuliers de cette soustraction ou de cette neutralisation, qui indiquent que, dès lors qu’il y va des « puissances mésographiques » du cinéma, l’on entrerait, pour un temps du film au moins, dans un régime distinct ? Quels seraient-ils ?
B.T.: Pour être tout à fait clair, cette absence patente de charge narrative, dans les premières séquences auxquelles je reviens, est moins un trait définitoire du mésographique qu’une « station » qui, sur le plan heuristique, me semblait importante. Autrement dit, les puissances mésographiques ayant été a priori peu perçues, il fallait d’abord se concentrer sur des objets qui les feraient saillir en ne mobilisant qu’elles. Mais c’était surtout important pour commencer d’entrevoir qu’elles forment en fait une constellation esthétique à l’échelle du cinéma, qu’elles travaillent vraiment ce médium au fil de son histoire, dans des films d’époques et de provenances très différentes, qu’elles y sont disponibles depuis toujours. D’où, pour commencer, l’analyse de cette séquence de Pharaon De Winter à vélo, dans L’humanité, ou le segment chorégraphique « Come Out » d’Anne-Teresa De Keersmaeker, non pas « capté » par Thierry De Mey, mais véritablement mis en scène, hors les planches, par lui (Fase, 2002). Ici, donc, on entre dans un régime particulier de l’image, où c’est véritablement la co-affection des corps et des lieux qui jouent, et c’est parce que rien d’autre ne mobilise les sens dans ces séquences que cet enjeu atteint cette intensité de présence. Quand, pour prendre l’exemple de Dumont, pendant de longues minutes et près d’une dizaine de plans, ce qui se passe, c’est qu’un corps peine et s’obstine à gravir à vélo une montée raide, il est clair que le narratif s’est raréfié ; mais de plus, comme j’essaie de le montrer, ce qui se modèle dans le sensible des images, c’est donc un milieu. Est-ce un régime d’image distinct de tout autre ? Non, je ne le crois pas, car j’achève – si tant est qu’une analyse puisse être achevée – ces études en soulignant systématiquement que ces moments, tout mésographiques qu’ils puissent être, prennent toujours davantage en charge : l’intensité de ce moment d’entrelacement du corps de Pharaon et du mont flamand, dès lors qu’on le réinscrit dans l’économie du film, dit quelque chose de la manière d’être au monde du personnage, mais aussi de son inclination à s’oublier pour toucher, accueillir l’altérité, qu’elle s’incarne dans la matière du monde ou dans le corps d’un autre être humain. De même, la corporéité des danseuses, dans « Come Out », qui dansent rivées à leur tabouret, dans des uniformes ternes, dans un quelconque immeuble froid de verre et de béton (en fait le siège social de Coca-Cola à Anderlecht, mais on n’a même pas besoin de le savoir pour que la séquence « fonctionne »), en synchronisant puis désynchronisant leurs mouvements, dans des cadres mouvants qui accusent leur immobilité ou les circonscrivent, sur une composition de Steve Reich qui disloque une voix humaine jusqu’à la faire ressembler à un bruit de machine, tout cela ne participe pas seulement à faire accéder au sensible un milieu dont je viens d’esquisser les qualités ; ce milieu prend en charge, figuralement, une critique des entraves du corps et de l’automatisation de l’humain qui s’instituent dans de tels lieux.
D.: Estimes-tu qu’il existe une différence entre des séquences « purement » mésographiques et celles qui pourraient être réinscrites dans la trame narrative du film ? Cet aspect me paraît soulever la question du point de vue. Quel serait en effet l’opérateur d’une telle réinscription ? Le film lui-même ? Le spectateur ou le critique dans le regard qu’il pose sur le film ? Selon quelles modalités s’opèrerait cette réinscription ?
B.T. : Non, in fine, je ne vois pas de différence fondamentale entre les séquences mésographiques, qu’elles évacuent ou non le narratif. Ce qui m’intéresse, c’est qu’elles mobilisent ces puissances-là. Pour le dire autrement, ces séquences, ces plans sont tous éminemment singuliers, mais ils ont tous en commun de mettre en œuvre cet entrelacement constitutif de corporéité et de spatialité qu’est un milieu en cinéma.
En ce qui concerne la réinscription de ces séquences mésographiques dans la trame narrative du film – et je dirais même dans son économie sémantique –, si c’est le spectateur ou le critique qui en est l’opérateur, c’est parce que le film l’y invite et l’y autorise. Cela tient à ce que je notais dans ma première réponse, et que l’on pourrait dire en paraphrasant Umberto Eco : les limites de l’interprétation, c’est l’œuvre elle-même qui les fixe. Il s’agit de prendre au sérieux l’idée de pertinence (comme y engage J. Aumont dans À quoi pensent les films ?). Déjà, ce que je mets au jour du travail du film est-il bien attesté dans l’image ? Si je fais bien mon travail, on peut ne pas être d’accord avec ce que je dis d’un travelling, mais pas que ce travelling n’existe pas. Ensuite et surtout, le film est un cadre spatio-temporel dont on peut éprouver la totalité et la finitude, c’est-à-dire qu’il est par la force des choses l’espace-temps commun des événements narratifs, dramatiques, phénoménologiques mais aussi plastiques qu’il accueille, quand bien même ils n’y existent pas comme strictement simultanés. Dès lors, on ne peut ignorer qu’agit là un principe de cohésion qui a décrété nécessaire la co-présence de ces événements, qui s’affectent mutuellement. C’est « comme » le cadre d’un tableau : pourquoi ce ciel occupe-t-il les quatre cinquièmes du cadre, pourquoi les nuages nombreux et massifs interpellent-ils l’œil à ce point, pourquoi n’y a-t-il là qu’un homme réduit à une minuscule silhouette (ce pourrait être un Ruisdael) ? Je ne le sais pas, ou pas tout de suite, mais je vois bien que leur présence, leur relation les uns aux autres, leur relation au cadre, font que ces événements trament un certain aspect du sensible, prennent en charge certains affects possibles, et que c’est à partir de là qu’éventuellement ils feront sens. C’est en vertu de telles relations, et en actualisant celles des directions de sens qu’elles contiennent et autorisent et qui lui semblent pertinentes, qu’un analyste interprétera un film (et qu’il pourra donc tisser un lien entre un séquence mésographique a-narrative et d’autres plus chargées narrativement). Un autre analyste actualisera d’autres de ces directions de sens en puissance. Si tel est le cas, les deux auront « raison ».
D.: Le mésologique, au cinéma, n’en passe-t-il que par des apparitions ponctuelles, exclusivement ? Un film entièrement ou purement mésologique te paraît-il envisageable ? À quelles conditions ? Serait-il nécessairement dépourvu de toute narration ? Se situerait-on alors du côté d’un cinéma que l’on pourrait qualifier de « poétique » ?
B.T.: Alors, attention, je ne parle pas de mésologie ou de mésologique au cinéma, mais bien de mésographique. C’est important car le seul néologisme que je m’autorise – « mésographique », donc – veut désigner une capacité des puissances cinématographiques à faire accéder au sensible des milieux, dans les images filmiques. Je voulais marquer par là que je prétendais seulement (me) donner de quoi désigner et penser ces puissances-ci précisément, mais non en faire le fondement d’une nouvelle esthétique générale du cinéma, qui risquerait de tomber, selon moi, dans une recherche systématique du mésographique absolument partout. La question du milieu en cinéma, de toute évidence, m’est chère, car elle me semble augmenter la connaissance des formes filmiques, mais elle ne recouvrira jamais toutes les questions théoriques que me pose le cinéma. En ce moment, par exemple, je travaille plus spécifiquement sur la question du paysage cinématographique, auquel je consacrais quelques pages dans l’essai qui nous occupe ici, pour l’écarter du périmètre du mésographique. Mais je l’en écarte par souci de clarté, pas parce qu’il s’agirait pour moi, en soi, d’un problème esthétique négligeable. Cependant, si l’on veut donner tous les égards au mésographique, on se souciera de marquer qu’il n’y a pas paysage quand il y a milieu. Et pourtant, encore une fois, la question de savoir « quand il y a paysage » au cinéma, et pourquoi, me semble cruciale au point que je m’y consacre désormais.
Dès lors, en effet, je pense que, dans certains films, les puissances mésographiques ne seront pas actualisées. Dans d’autres, un plan, une séquence, parce qu’il y aura une nécessité à le faire, actualiseront ces puissances. Et puis certains films, en effet, pourront être entièrement mésographiques. Il me semble que c’est le cas, par exemple d’Under the Skin (2014, Jonathan Glazer) auquel je consacre plusieurs pages : non seulement le narratif et le mésographique travaillent de concert dans ce film, mais de surcroît, il ne raconte que cela : une velléité de faire milieu.
D. : Dans ton livre, tu accordes une place cruciale au personnage. Cet aspect découle du point de vue mésologique que tu adoptes et qui se concentre sur l’interaction réciproque de personnages avec l’espace. Mais les personnages sont envisagés, en première instance du moins, essentiellement comme corps, comme présences corporelles, ainsi que le laisse entendre le titre de ton livre. Tout se passe à cet égard comme si tu souhaitais faire percevoir une autre facette du personnage et de son rapport à l’espace, et montrer que l’appréhension de cette relation ne se réduit pas, ou pas toujours, à une psychologie. En contrepoint de certaines lectures disons « psychologisantes », tu plaides pour « un plus grand égard ou […] une qualité d’attention différente au lieu » (p. 173). À cet égard, tu notes que les motivations du personnage à se comporter de telle ou telle façon demeurent parfois, et au moins temporairement, impénétrables. Dans cette optique, tu écris ainsi, reprenant une formule de Merleau-Ponty, qu’« un sujet est aussi une “mélodie cinétique”. Ainsi un corps peut-il se donner comme sujet au cinéma, quand bien même ses mouvements resteraient obscurs ou injustifiés, ou peut-être : avec plus d’intensité lorsque ses mouvements sont obscurs ou injustifiés… » – au passage, pourquoi « avec plus d’intensité » ? encore la question de la puissance ? Pourrais-tu préciser comment tu articules, d’un point de vue théorique approche mésographique et approche psychologique des personnages ? Y aurait-il une forme de hiérarchie entre les deux ou s’agit-il plutôt, et peut-être plus simplement, de regards portés sur des aspects distincts d’une même figure, le personnage ? Jusqu’à quel point ces perspectives sont-elles combinables ? À cet égard, tu sembles supposer que ces deux volets œuvrent parfois (souvent ?) conjointement. Ainsi écris-tu que, « parfois […], dans certains films, lorsque les “états d’âme” ou les affects plus lisibles des personnages s’expriment, ce peut être par tout un travail mésographique comparable à celui que l’on a vu à l’œuvre dans des scènes qui ne laissaient que peu de place à quelque aspect de l’intériorité du personnage » (p. 173).
B.T. : Dès lors que l’on accepte que, dans les moments mésographiques d’un film, le corps qui apparaît à l’écran y est moins présent en tant que personnage (y compris avec sa psychologie) que comme une corporéité en train de se définir à partir d’une spatialité (et inversement), alors c’est une autre facette de la figure humaine que l’on éprouve. Et dans de tels moments, il peut arriver que le film se contente de faire exister un corps, des comportements, parfois inintelligibles. Or je crois en effet que lorsque la présence d’un corps est à ce point soulignée, mais que les signes d’une intentionnalité siégeant dans ce corps sont à la fois perceptibles et indéchiffrables, ce qui demeure, insistant, c’est qu’il y a là de l’intentionnalité, et donc qu’il y a là un sujet. C’est une autre modalité d’accès au visible du sujet filmique. Si l’on veut emprunter cette distinction à Berque, notamment, l’enjeu ici serait la subjectité (le fait d’être sujet) plutôt qu’un accès aux spécificités d’une subjectivité (par exemple, une tique, pour Uexküll est un sujet, sa subjectité ne fait pas de doute selon lui, puisqu’elle interprète son environnement et agit en conséquence ; on ne sait pourtant rien de la subjectivité de cet insecte…). Dans la ligne de ce que je disais tout à l’heure sur la possibilité pour un film de jouer de moments mésographiques et d’autres qui ne le sont pas du tout, la perceptibilité d’un personnage peut se feuilleter de ces différentes facettes, qui ne sont pas incompatibles. Il sera alors ce qu’il dit, les réactions et les gestes clairement motivés qu’il produit, mais aussi cette manière qui lui est propre de faire corps avec le monde, en d’autres moments. Pharaon De Winter, c’est un être qui dit son indignation, qui pleure, mais c’est aussi ce corps qui se résume un moment à l’effort par où il trouve un point de contact avec le lieu singulier qu’est un certain mont des Flandres. Et tout cela compose le sujet filmique qu’est Pharaon. Mais il peut y avoir aussi une imbrication plus ferme des aspects psychologiques, ou du for intérieur d’un personnage et du mésographique. L’un des films emblématiques d’une telle intrication est selon moi Take Shelter (2011, Jeff Nichols) que j’analyse dans le livre selon cet axe. Pour le rappeler d’un mot, le personnage principal du film est saisi de visions et cauchemars qu’il pense prémonitoires, annonciateurs d’une catastrophe climatique. On le prend pour fou, il s’y résigne, jusqu’à ce que la fin oblige à une réévaluation totale du film : il avait en fait vu (et senti) juste… Le film de Nichols pose en fait que la vie intérieure de son personnage (ses visions) est indissociable de sa corporéité (elle a des effets physiques : douleurs « rêvées » mais éprouvées, saignements, etc.), et que c’est donc bien une expérience du sentir, puisque, littéralement, le protagoniste du film vibre « corps et âme » à l’unisson de ce qui arrive au monde, comme certains animaux – qu’après tout nous sommes – dont on dit qu’ils sentent arriver la catastrophe.
D.: Les analyses de films que tu proposes dans ton livre portent, presque exclusivement, sur des œuvres de fiction. S’agit-il d’un parti pris ? Penses-tu que des documentaires seraient en mesure de développer des plans ou séquences mésographiques ? De la même manière que des œuvres de fiction ? Qu’est-ce que le caractère non fictif d’un documentaire pourrait induire au sein d’une composition d’ordre mésographique ?
B.T.: Je dirais que c’est un parti pris impensé… Un parti pris qui procède d’un réflexe… Comme le disait Christian Metz, quand l’on dit que l’on va « voir un film », il est tellement évident, car ancré culturellement dans les usages (et donc dans les formes dominantes) que l’on va voir un film narratif de fiction, qu’on ne le précise même pas. Eh bien je dois avouer que c’est en effet de films narratifs de fiction que se composent mes corpus de travail, quelles que soient mes recherches, à de très rares exceptions près. Ceci dit, je ne pense absolument pas que les puissances mésographiques du cinéma connaissent ces frontières. Il est des documentaires qui travaillent avec ces puissances-là. Songeons par exemple à Jaime (1974) d’Antonio Reis ou plus près de nous à certains des documentaires de Ben Rivers.
D. : Compte tenu du caractère d’interaction réciproque entre les êtres vivants et leur milieu de la conception mésographique, dans quelle mesure peut-on ou doit-on en tenir compte dans l’expérience du spectateur (et dans celle du critique) qui éprouve l’objet filmique ? On sent bien dans ta manière d’écrire et de décrire ta démarche, et quoique ce soit de façon somme toute assez discrète, que se joue une implication résolue et explicite de l’auteur, Benjamin Thomas. Les premières lignes de ton livre me semblent en témoigner exemplairement, comme si tu souhaitais noter cette prise en considération de la logique mésographique dans le rapport que tu entretiens avec les films que tu décris, et plus généralement avec la problématique qui est au cœur de ton livre, jusque dans la façon dont tu l’appréhendes. Je cite l’incipit : « Ce livre est l’histoire d’une rencontre avec l’une des puissances de figuration du cinéma. […] Une question, ça surgit, mais ça s’accueille aussi. La forme d’une rencontre avec une question tient au “lieu” d’où la voit venir à lui celui qui voudra répondre à sa sollicitation » (p. 9). Au-delà de ta manière de « répondre » à cette « sollicitation », c’est-à-dire par l’écriture de ce livre, penses-tu que l’expérience filmique est comparable à l’expérience d’un « milieu » ?
B.T. : La question touche à plusieurs aspects importants.
Tout d’abord, oui, j’assume – aucune gloire là-dedans, c’est un principe méthodologique essentiel, tout simplement – que toute proposition théorique, en esthétique (comme en tout autre domaine, en fait), procède de la rencontre d’une subjectivité avec une œuvre, ou avec un problème figuratif ou figural, etc. Cependant, eu égard à ce que je rappelais dès le début de notre entretien, ce point de départ n’ouvre pas la voie à une forme d’impressionnisme, de délire surinterprétatif, de lecture affective ou que sais-je encore. Non sans mauvaise foi, on réduit encore parfois l’esthétique à cela. Si l’on est un peu sérieux, au contraire, on sait qu’outre la compréhension rationnelle du monde, nous le connaissons aussi sensiblement ; de même si l’on n’ignore pas les évidences, on sait que toute œuvre configure le regard et l’écoute d’une certaine manière, qu’elle vise et autorise certains points de vue et certains affects, sans garantie aucune qu’ils seront actualisés par tous les spectateurs. Si je devais le dire avec un lexique emprunté à la mésologie, je dirais que les attaques envers l’esthétique – que tu ne formules pas, mais c’est l’occasion de les évoquer – me semblent souvent procéder d’un dualisme grossier, qui pense que le sujet traite d’objets situés face à lui, réduits à des caractéristiques « objectivement » mesurables, et que tout contact trop proche (ou trop sensible) avec l’objet condamne au subjectif, mettant en danger cette belle division garante de l’objectivité. Pour la mésologie, si le milieu advient au niveau du corps individuel – ce que j’en ai gardé et qu’elle partage donc avec la phénoménologie –, tout ne se joue pas uniquement là : nous endossons tous aussi, collectivement, ce que Berque appelle des « corps médiaux », c’est-à-dire des corporéités collectives, partagées. Le fait même que des gens comme Alain Corbin ou Georges Vigarello puissent faire des histoires de la sensibilité atteste de l’existence de tels corps médiaux, même si on les nomme autrement. Or donc, faire de l’esthétique des formes filmiques, loin de donner à lire à des lecteurs les aventures de sa petite sensibilité idiosyncrasique, c’est s’adresser à ce corps médial, à une sensibilité partagée. C’est ainsi que l’esthétique augmente bien évidemment les connaissances sensibles des œuvres, et du monde dont elles procèdent. Alors, mon travail, dans ce livre ou en général, se fait dans un tel cadre, mais il n’en fait pas son sujet. Ou plutôt, c’est son sujet en creux puisque tout travail traite toujours à la fois de ce dont il traite et des méthodes qu’il mobilise ; ici, ce positionnement épistémologique soutient chaque analyse, et il est parfois explicité, en effet, mais de manière liminaire, et bien moins frontalement que je viens de le faire. Autrement dit, pour répondre tout à fait à l’une des questions que comporte ta longue question : oui, on pourrait pertinemment penser en termes mésologiques le travail du chercheur en esthétique des formes filmiques ; mais ce n’est pas la tâche que je me donne dans le livre.
Dans le même ordre d’idée, je précisais tout à l’heure ne pas vouloir aller jusqu’à user du terme de mésologie (du cinéma) pour désigner ce que je fais. Il y a une raison plus fondamentale qui s’ajoute à celle que je donnais, et qui répond à un autre point que tu soulèves ici : je crois que s’engager dans une mésologie du cinéma au sens strict serait une toute autre affaire que celle qui m’occupe. Pour le dire vite, cela impliquerait d’étudier, non plus le geste du chercheur, mais le cinéma en ce que lui-même, comme dispositif – ou plutôt comme appareil – est l’une des modalités parmi bien d’autres dont se sont dotés les sujets humains – donc les spectateurs – pour faire milieu. On quitterait vite l’esthétique des formes filmiques pour une théorie médiale du cinéma. Cela reviendrait à faire pour le cinéma ce que Berque a fait pour les langues (notamment japonaise et française) dans Poétique de la Terre. D’une certaine manière, puisque je l’ai cité, et même s’il est un peu artificiel de l’amener sur ce terrain, ce que fait Déotte dans son étude du cinéma comme appareil n’est pas éloigné d’un tel projet (et Raymond Bellour n’en est pas loin non plus, dans Le Corps du cinéma, lorsqu’il pense la rencontre du corps du spectateur et du « corps du film »).
Or, ce qui m’intéresse dans le livre, ce à quoi je me suis véritablement cantonné, ce sont les corps singuliers figurés dans l’image et les milieux tissés par l’image. Il est un théoricien du cinéma, notre contemporain, pour les travaux duquel j’ai la plus grande admiration, et qui place sa réflexion, pour sa part, à l’endroit que tu évoques. Il n’a pas besoin du vocabulaire de la mésologie pour cela, « simplement » de celui de la phénoménologie (mais aussi de la géopoétique) : il s’agit pour lui de penser le cinéma comme nous permettant d’éprouver, dans et avec nos corps de spectateurs, des images-espaces, qui sont loin de n’être que des restitutions de nos expériences spatiales vécues par ailleurs, mais augmentent pour nous le territoire du sensible. Ce chercheur c’est Antoine Gaudin, dont je parle dans le livre (voir son Espace cinématographique, 2015, Armand Colin). Nos cadres de pensée se recoupent, se rejoignent partiellement. Mais la différence est donc qu’Antoine Gaudin place le curseur sur la relation du corps spectatoriel aux images-espaces des films, tandis que, pour ma part, je ne m’intéresse qu’à la relation des corps figurés à l’espace figuré. J’ajoute que, si mon travail est possible, c’est parce qu’Antoine a raison (il met au jour la dynamique même, pour le cinéma, du corps médial dont je parlais) ; c’est parce que l’on éprouve les films, et qu’on les éprouve dans la mesure où les formes et les opérations filmiques travaillent à modeler cet « éprouvable ». Cependant, quand je fais place explicitement au spectateur dans mon étude, c’est seulement à un périmètre restreint de cet éprouvable que je m’attache : je prends en considération le spectateur tel qu’il est ciblé par certains procédés synesthésiques activés par le film, ne visant qu’à lui faire partager des affects qui sont d’abord ceux du personnage. Autrement dit, m’intéressent alors les effets des opérations filmiques, dont il est présupposé que le spectateur les actualisera, et qui participeraient alors pleinement à qualifier le milieu que le film s’emploie à faire accéder au sensible. Pour prendre un exemple précis : le long travelling arrière qui s’éloigne des danseuses assises de « Come Out » ne m’intéresse pas en ce qu’il me dévoile l’étendue incroyable du couloir (ce qu’il fait aussi), il m’intéresse en ce qu’il laisse sur place les danseuses.
D.: Tiens, tant que j’y suis, sans doute la question la plus anecdotique de cet entretien, mais je crois que les anecdotes ont, parfois, un certain potentiel de révélation : as-tu envoyé ton livre à Augustin Berque ? Si oui, quelle a été sa réaction ?
B.T.: Non. En revanche, j’évoquais déjà, mais vraiment très synthétiquement, ces questions de milieux en cinéma dans L’Attrait du vent (Yellow Now, 2016) et un collègue, qui connaît Berque, lui avait fait lire ce passage du livre. Berque lui avait dit, je crois, que les artistes, en effet, étaient plus sensibles à ces questions, ou en tout cas depuis plus longtemps que les intellectuels.
Il serait trop long de développer cela ici, et c’est un prolongement de ce travail qui commence seulement à m’occuper, mais je pense que la relation non duelle au monde, dont procède le mésologique, a longtemps été, de fait, un refoulé de la modernité. Toutefois, loin de ne constituer qu’une critique à l’endroit de cette modernité, elle lui préexistait, elle a continué à exister en son sein (dans la phénoménologie, par exemple), et je crois surtout, pour aller en effet dans le sens de Berque, que cette relation s’est « dite » dans les images de notre culture depuis toujours, depuis longtemps en tout cas ; ce que permettrait de penser l’iconologie warburguienne. Ainsi, le mésographique qui opère dans le cinéma serait pensable également dans une telle généalogie iconologique. Mais c’est un chantier dont j’entrevois à peine la vertigineuse étendue… Par ailleurs, pour finir sur Berque, il lui arrive aussi d’écrire sur les arts plastiques, je crois.
D.: Pour conclure sur une perspective plus large, je me demandais dans quelle mesure tu penses que les lectures générales qui informent ton travail relatif au cinéma seraient en mesure de pouvoir être mobilisées pour d’autres formes d’art ? Tu écris par exemple qu’« étudier l’espace ouvert par un plan cinématographique et les corps qui en participent, c’est précisément étudier les formes d’un imaginaire – mais d’un imaginaire concret, consigné en affects et percepts par des formes et des mouvements. Cette étude se déploie à partir du postulat […] d’une indissociabilité du corps et de l’espace. Mais elle s’attache à l’entr’appartenance de corps et de lieux figurés, et à ce que cette entr’appartenance doit à des opérations figurantes » (p. 198). Mais d’autres arts que le cinéma sont des arts de la figuration… En d’autres termes, penses-tu que la notion de « milieu » serait en mesure d’apporter une éclairage, analogue à celui qu’elle produit pour le cinéma au sujet d’œuvres issues de la peinture, de la photographie, de la littérature, par exemple, mais aussi des œuvres sonores, notamment celles issues du domaine du field recording, ou encore, pourquoi pas, de la musique ? Il me semble au demeurant que tu effleures ponctuellement la question, en particulier s’agissant de la danse, dans ton commentaire de Fase, de Thierry De Mey (2002), qui correspond à une « version » cinématographique d’une chorégraphie d’Anne-Teresa De Keersmaeker. À ton sens, quelle pourrait être à cet égard la spécificité de l’image et du domaine visuel ? Penses-tu par ailleurs que les arts de l’enregistrement analogique (photographie et cinéma, par exemple, mais aussi le son) présentent quelque chose de particulier à cet égard ? S’agissant de la photographie, je songe à une remarque, formulée par Clément Chéroux à l’occasion d’un entretien avec Jean-Luc Moulène. Elle me paraît indiquer ce que l’on pourrait qualifier de nature mésographique de l’acte photographique : « Beaucoup d’historiens de l’art n’ont toujours pas compris que dans le domaine de la photographie le réel fait jeu égal avec l’auteur. Autrement dit : ce qui est devant l’objectif a une responsabilité partagée dans l’acte de création avec celui qui se trouve derrière l’objectif[1414][1414] Clément Chéroux, « Jean-Luc Moulène. Photographier pour savoir à quoi ça ressemble », dans La Voix du voir. Les grands entretiens de la Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris, Éditions Xavier Barral & Fondation Henri Cartier-Bresson, 2019, pp. 149-150. ». Penses-tu que ce paramètre confère un statut particulier à la figuration des milieux en photographie et au cinéma ?
B.T.: La question que soulève Chéroux n’est pas de celles que pose le livre, mais elle est passionnante. À partir du moment où l’on appréhende l’acte de prise de vue sous un angle mésologique, alors oui : filmer, photographier, c’est une manière de répondre aux propositions du réel, d’en faire quelque chose, et l’opérateur comme ce qu’il cadre ont une part active dans l’affaire. Et c’est en effet propre à ces médiums, dont la « matière première » est en composée des aspects du monde, des plus concrets aux plus évanescents. Bruno Dumont pourrait être un exemple éloquent, pour le cinéma, de ce que dit Chéroux : il soigne ses compositions, il contraint volontiers le corps de l’acteur à se soumettre au cadre, mais il met aussi un point d’honneur à accueillir les accidents et les résistances du réel.
Pour répondre à l’autre partie de ta question, je crois en effet que les autres arts peuvent eux aussi « dessiner » des milieux. Et j’évoque même des œuvres picturales dans le livre, qui me semblent tout à fait mettre en jeu des puissances mésographiques à leur manière propre. Que l’on pense à Turner, ou à ce que Deleuze écrit sur Bacon et que – de manière moins incongrue qu’il n’y paraît, j’espère – je mets en relation avec une combinaison de motifs qui me semble importante chez Ozu. La danse, bien évidemment, comme le montrait avec brio la théoricienne Laurence Louppe, a cette capacité de susciter des affects d’espace par un simple geste (une manière de déplier le bras avec lenteur et « difficulté » peut donner le sentiment d’un corps qui évolue dans un espace visqueux, par exemple). Mais je suis à peu près sûr que l’on pourrait trouver des exemples d’un travail mésographique littéraire. Marguerite Yourcenar, quand elle s’attache à dire, en passant, dans Archives du Nord, que nous (je m’y inclus, étant né de ces plaines, fût-ce dans leur partie romane), Flamands, avons des monts que partout ailleurs on appellerait collines. C’est plus qu’une boutade : ça dit une vérité mésologique ; le géomètre appellerait le mont des Cats une colline, nous l’appelons mont parce que la vérité, c’est que nous avons la plaine dans les jambes, et que lorsque nous gravissons l’un de nos monts, c’est bien en un mont qu’il s’offre à nous. Il y aurait toutefois, à n’en pas douter, des œuvres qui travailleraient moins « anecdotiquement » que dans cet exemple, dans la texture même du texte, à activer des puissances mésographiques où joueraient de concert le style et le récit.
Images : Fase (Thierry De Mey, 2002) / Vincent n'a pas d'écailles (Thomas Salvador, 2014) / L'humanité (Bruno Dumont, 1999) / Under the Skin (Jonathan Glazer, 2014) / Take Shelter (Jeff Nichols, 2011).