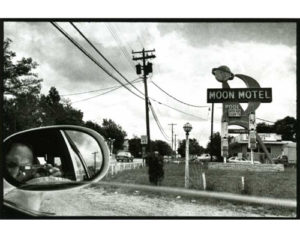Devant la douleur des autres, Susan Sontag
Pour un usage "dissensuel" des images.
Avec ce court essai rédigé dans l’Amérique post-11 septembre, Susan Sontag tente de dresser un bilan synthétique, tantôt historique, tantôt théorique, des emplois de la photographie devant les souffrances de la misère et de la guerre. Découpé en une dizaine de chapitres, le livre questionne l’impact de la photographie sur notre perception des évènements historiques et contemporains, et sur le pouvoir des images à informer, indigner ou révolter le spectateur, voire à le pousser à l’action.
Si la posture de l’auteur peut paraître parfois prévisible, l’ouvrage a le grand mérite de revenir sur un certain nombre de problématiques inhérentes au medium et à ses différents aspects, tout en interrogeant l’évolution de la sensibilité collective face aux visions d’horreurs du 20ème siècle. Comment la photographie a-t-elle modifié la perception des évènements dramatiques au fil de son histoire ? Peut-elle provoquer le rejet total et sans concession de la guerre et de sa violence ? Ou du moins permettrait-elle de mieux comprendre les causes et les conséquences des crimes et conflits passés ?
Conserver la trace, construire le souvenir.
Quiconque a lu Barthes (dont le nom n’apparait étrangement pas ici) sait que la photographie a partie liée avec le passé : « ça-a-été » dit-elle. Ce que donne à voir la photographie est un instant du passé, qui a existé et n’est plus. D’où cette relation forte qu’elle entretient avec la mort : la photo permet d’abord de conserver la trace des disparus, et plus tard, de saisir la mort dans son immédiateté (voir ci-dessus la photographie de Robert Capa, Mort d’un soldat républicain, 1936).
Pourtant, convergence des intérêts étatiques (cherchant à redorer le blason de la guerre de Crimée, alors très impopulaire) et d’un temps de pose encore long, les premières photographies de guerre (au milieu du 19ème siècle) ne pouvaient garder trace des combats qu’une fois la bataille achevée et le terrain « nettoyé » de ses victimes. « La guerre – ses mouvements, son désordre, son drame – reste inaccessible à l’appareil » (p58). Roger Fenton, le photographe envoyé sur place par le gouvernement britannique, se concentre donc surtout sur des tableaux de vie militaire, où les soldats – des officiers – posent pour l’appareil.
Au milieu de cette commande, peignant la guerre comme « une excursion à laquelle seul participerait un groupe d’hommes très dignes », trois vues de paysages que la mort, bien qu’absente, a traversés, et sur lesquels plane encore son ombre. Seules traces de la guerre dans l’image, les boulets de canon dans le fossé et sur la route.[11][11] On retrouve dans cette photographie, hantée par une violence qui n’y figure pas, commémorant la mort par le vide qu’elle a laissé, un principe qui sera au centre de l’une des plus grandes œuvres cinématographiques du 20ème siècle : Shoah (1985) de Claude Lanzmann. Là encore, il s’agit de faire sentir un drame – peut-être le plus grand que l’humanité ait connu – inaccessible aux regards de l’homme et de l’appareil (pour des raisons éminemment différentes : évènements appartenant à l’histoire et non plus actualités, impossibilité de reconstitution/représentation). Outre le pouvoir de conserver les vestiges du passé, l’image photographique possède également un grand pouvoir de suggérer, à condition de présenter des traces, des indices suffisamment évocateurs pour lancer l’imagination du spectateur (boulets, ruines, etc.). A condition également que celui-ci dispose du savoir nécessaire à leur interprétation (dans Shoah, la parole des témoins joue parfois le double rôle de trace et de guide pour l’imagination). Quelques années plus tard, lors de la Guerre de Sécession, les cadavres remplaceront les boulets de canon [22][22] Sontag cite les photos du studio de Matthew Brady lors des batailles d’Antietam, 1862, et Gettysburg, 1863..
Figure 1 : Roger Fenton, The Valley of the Shadow of Death, 1855
Avec l’amélioration des techniques et la naissance du photojournalisme, la guerre sera de plus en plus couverte : dans les années 1930, la guerre d’Espagne est le premier conflit armé véritablement suivi par les photographes, dont bien sûr Robert Capa. Si son cliché d’un milicien abattu (1936) est devenu si célèbre, c’est qu’il conjugue l’immédiateté de la mort et l’authenticité de la prise sur le vif, dérobant à son sujet son tout dernier instant. Une telle image symbolise parfaitement ce qu’un spectateur de photographie d’actualité attend : un instant saisi au vol, témoignant d’une situation sensationnelle à laquelle le photoreporter vigilant a assisté, « espion dans la maison de l’amour et de la mort » (p63). De là, une certaine déception quand on apprend que le vol n’est qu’apparent et que la situation représentée a été commanditée (Sontag prend pour exemple le fameux « Baiser de l’Hôtel de ville » de Doisneau). Cette recherche du spontané conduirait la photographie à être le seul art majeur où le professionnel ne l’emporte pas définitivement sur l’amateur, tant la part de chance ou de hasard est importante. Le frustre, l’imparfait peuvent avoir une valeur plus grande aux yeux du lecteur qu’un cadre et une lumière soignés[33][33] Ajoutons que la vidéo accentuera ce principe d’égalité entre amateurs et professionnels. Le film de Zapruder sur la mort de Kennedy ou la vidéo du passage à tabac de Rodney King en sont les exemples les plus fameux, mais à l’heure de Youtube, tout fait marquant ou presque trouve son illustration amateur anonyme sur le web, où l’information télévisuelle peut aller puiser si elle n’a pas d’image.. Evidemment, comme le cliché de Doisneau, cette spontanéité peut aussi être le fait d’un gros travail de l’artiste, d’une mise en scène rigoureuse cherchant à donner l’illusion du pris au vol.
Sontag souligne par ailleurs la méfiance du spectateur face à une image ostensiblement trop artistique, car synonyme d’artifice, et donc de perte d’objectivité. C’est oublier un peu vite, continue-t-elle, que la photographie se situe au croisement entre l’enregistrement mécanique (donc objectif) de l’instant et l’orientation humaine de l’appareil, c’est-à-dire le point de vue, nécessairement subjectif, du photographe. L’image photographique n’est jamais immanente, coupe transparente de réel, mais toujours soutenue par le regard d’un homme qui cadre, donc sélectionne, une portion de ce qu’il voit.
A cette dualité ontologique s’ajoute la question cruciale de l’utilisation de l’image. Car évidemment, la photographie ne parle pas seule (elle présente mais n’explique pas). Son message change selon l’usage et le contexte, et les intentions du photographe sont finalement bien peu de choses face aux manipulations (légende, commentaire) de ceux qui viennent après. Sontag rappelle ainsi que l’information est une sempiternelle construction, alliant éventuellement compte-rendu, témoignage, analyse…, à laquelle la photographie, l’image, confère un surplus de réalité. Difficile effectivement pour une actualité, quelle qu’elle soit, d’exister dans l’esprit du spectateur si une photo ne vient pas illustrer le compte-rendu du journaliste. Cette fonction illustrative correspond à l’usage basique de l’image dans le dispositif médiatique.
De même, l’Histoire se construit et se concrétise dans l’imaginaire collectif grâce à des images, au point que chaque évènement historique appelle ses images types, ses symboles. Et peu importe que l’attribution de ces images soient erronées ou qu’elles aient été mises en scène, elles n’en constituent pas moins un stock d’images mentales. La révolution soviétique, les camps de concentration ou la guerre du Vietnam appellent successivement leurs illustrations types : on peut aussi bien penser aux marches d’Odessa revues par Eisenstein, à l’ouverture des Camps (qui valent le plus souvent pour les Camps eux-mêmes, dont il n’existerait « que » quelques centaines de clichés), ou à cette fillette fuyant son village bombardé au napalm.
La photo de Fenton déjà citée est elle-même le fait d’une mise en scène : les boulets ont été soigneusement éparpillés pour créer un effet de désordre dans l’image, pour « faire plus vrai ». Dès les prémices de la photographie de guerre, la question de la mise en scène est donc déjà soulevée. Ainsi, si l’appareil photo est à cette époque envisagé comme « l’œil de l’Histoire » (formule que l’on prête à Brady), Sontag note qu’à ce devoir d’enregistrement correspond immédiatement un désir de mise en scène, signe que depuis l’invention du médium, « photographier, c’est composer (ou poser quand il s’agit de sujets vivants) » (p61). Les photographes comprennent l’importance de cette technique nouvelle pour conserver la trace des évènements importants, mais ne résistent pas à la tentation d’organiser la réalité qu’ils enregistrent. Et la mémoire s’appuie sur ces compositions pour se représenter l’évènement.
Paradoxalement, le surplus de réalité que porte l’image serait donc aussi une perte, car on aurait tendance à ne plus se souvenir que des images, dont beaucoup ne sont finalement que des mises en scène, des reconstitutions. C’est un constat similaire que suggérait Chris Marker dans Sans soleil. Se demandant comment se souviennent ceux qui ne photographient pas, ceux qui ne filment pas, il concluait que filmeurs et photographes ne gardent en mémoire que leurs images : « elles se sont substituées maintenant à ma mémoire, elles sont ma mémoire »[44][44] Commentaire du film Sans Soleil , Chris Marker, 1982.
On ne se souvient pas de l’évènement lui-même, mais de sa représentation. De là l’importance des pratiques artistiques et culturelles : se souvenir d’un fait historique impose perpétuellement de créer un nouveau rapport au passé et à ses images, afin de retisser du lien entre les nouvelles générations et l’histoire. Primo Levi déplorait qu’à chaque génération les massacres nazis semblaient de plus en plus lointains, de plus en plus abstraits. Proposer de nouvelles images, ou d’autres façons d’appréhender les images existantes, est une solution à cette perte intrinsèque, afin de reformuler, de repenser notre compréhension de l’Histoire.
Enfin, si l’Histoire et l’information sont des constructions, se pose la question de leur orientation, de leur partialité. Sontag pointe le fait troublant que s’il existe un mémorial de l’Holocauste à Washington, le gouvernement américain n’a toujours pas jugé bon d’ouvrir un musée retraçant intégralement l’histoire de l’esclavage. Manière pour l’auteur de rappeler que même si l’on se souvient souvent mieux de son histoire locale, celle-ci reste soumise à un consensus veillant à ne pas déranger l’ordre social dominant. De même qu’il est plus facile de montrer les cadavres du camp adverse que ses propres pertes, il est souvent plus aisé de commémorer les crimes commis au loin que de rendre hommage aux descendants de ses propres victimes.
Dans Sans Soleil encore, Marker rejetait l’idée qu’il y ait une mémoire collective, mais bien plutôt « mille mémoires d’homme ». Sontag ajoute pour sa part que ces mille mémoires sont néanmoins façonnées par une « instruction collective ». C’est cette écriture officielle qui fait de l’image un outil politique dont on se sert pour construire un passé tel qu’on veut le retenir, le réviser, le revoir.
Montrer les victimes, toucher le spectateur.
Un aspect historique intéressant soulevé par l’auteur est le changement dans la perception spectatorielle (occidentale du moins) que l’avènement de la photographie a induit au cours de ces deux derniers siècles, face à la guerre et ses horreurs. Une diagonale forte est ainsi ouverte par Sontag entre le peintre et le photographe. A partir de Goya et Les désastres de la guerre (1810-1820), une série de plus de quatre-vingt eaux-fortes décrivant les crimes de l’armée napoléonienne en 1808, « un nouveau modèle de sensibilité à la douleur fait son entrée dans l’art » (p53). La guerre y est représentée « sans l’ornement du spectaculaire », et l’accumulation de scènes atroces provoque un effet dévastateur. Le but est de choquer le spectateur, de mettre à mal sa sensibilité, d’où le choix de saynètes ponctuelles et non de grandes fresques, des à-côtés des combats et non des batailles elles-mêmes. A travers ce qu’on peut appeler des « temps faibles » (en opposition aux moments-clefs du conflit que l’Histoire retiendra), Goya représente une violence qui paraît d’autant plus illégitime, et donc plus à-même de persuader le spectateur de l’injustice de cette guerre.
Figure 2 – Francesco Goya, Les Désastres de la Guerre, « Pourquoi ? », 1810-1820
Alors que pour Goya, et même au siècle suivant, pour Virginia Woolf, dont un article (Trois Guinées, 1938) ouvre l’essai, les images de guerre sont encore un savoir clandestin (mais néanmoins accessible), il n’est personne aujourd’hui qui n’ait été confronté à ces visions d’horreur. Celles-ci nous abreuvent littéralement au quotidien. Vient donc la question de la sensibilité du spectateur, face aux images atroces, dans les médias contemporains. Ce flot d’images nuit-il à notre sensibilité, s’habitue-t-on à elles ? Ou est-ce plutôt, comme le pense Sontag, l’impuissance du spectateur face à ce qu’il voit qui émousse sa sensibilité ? Et surtout, grande question qui court dans tout l’ouvrage, un brin naïve sans doute : pourrait-on imaginer une photo qui nous choque, nous émeuve et nous dégoûte pour de bon de la guerre et de ses horreurs, au point de les bannir à jamais de notre futur ?
La théoricienne rappelle ici plusieurs points importants à propos de notre perception de la douleur des autres par le filtre de l’information. D’abord, toutes les guerres, tous les conflits ne sont pas égaux en soi : le plus souvent, leur écho doit être international pour que l’information vaille la peine d’être construite et largement diffusée. Peu importe que le conflit soit meurtrier et que des photographies le prouvent, les images seules ne suffisent pas : l’information n’aura de place dans les médias que si le conflit dépasse les belligérants eux-mêmes et cristallise des tensions plus vastes, et qu’une certaine proximité existe de ce fait entre les victimes et les regardants. Finalement, un tel filtre médiatique pousse les appareils et caméras à ne se tourner que vers les conflits mettant en jeu ce « surplus de signification ».
Par ailleurs, le fonctionnement télévisuel exige, pour mentionner quotidiennement un conflit, qu’il y ait sans cesse « du nouveau », afin que l’attention du spectateur soit stimulé en continu, sous peine de le voir changer de chaîne. Les images illustrant ce conflit doivent provoquer du choc, tout en étant immédiatement lisibles, car le modèle informatif télévisuel fonctionne dans une perpétuelle urgence : « l’image-choc et l’image-cliché sont les deux aspects de la même présence » (p31), de la même surexposition à l’image. Et si les images télévisuelles émoussent le sentiment, c’est moins par la redondance des mêmes horreurs que par la lassitude intrinsèque qu’instaure le média, lassitude liée au fait que l’information télévisuelle n’a pas le temps d’installer « l’intensité de conscience » nécessaire à la prise en compte de la souffrance de l’Autre.
Toutefois, ajoutons que si le choc est indispensable à l’audimat, il a aussi ses limites, déterminées par un consensus auquel les médias sont soumis (dicté par les annonceurs publicitaires et les instances gouvernantes), consensus qui tient en quelques règles élémentaires. La première concerne l’exhibition des victimes. Exemple canonique repris par Sontag : l’abstraction des morts du World Trade Center, réduits à des virgules lointaines se jetant du haut des tours, tranche radicalement avec les cadavres afghans puis irakiens. Autre détail : on cache généralement le visage des morts de son propre camp, dignité que l’on refuse à l’ennemi. Enfin, le vocabulaire de la guerre fait de l’armée américaine une armée intouchable, dont les victimes sont le fait « d’embuscades » ou « d’attentats » : l’ennemi est un sauvage qui ne respecte pas le code de la guerre. Et décrit comme tel, il devient difficile de comprendre ses motivations, le pourquoi de son intransigeance.
Combien de temps ce choc peut-il fonctionner ? Et quelle peut être son utilité ? Selon la théoricienne, il est des choses auxquelles on ne s’habitue pas : des toiles, des films, des pièces de théâtre qui font pleurer à chaque vision. Le récit serait selon elle garant d’un « pathos qui ne s’use pas », plus efficace que l’image car s’étalant dans la durée. De la même manière (mais sans cependant se restreindre au récit), Marie-José Mondzain souligne que le propre des chefs-d’œuvre artistiques est de ne pas s’épuiser en une seule vision, en une seule écoute, en une seule lecture [55][55] Marie-José Mondzain, L’image peut-elle tuer ?, 2002, Bayard, 2010, p51 : « Cet ensemble disparate d’objets [les chefs-d’œuvre] a en commun de faire l’offre d’une liberté, la donation d’un sens qui n’est jamais assigné, jamais le même, toujours fragile. Il y a donc des objets qui résistent à l’érosion nécrosante des appropriations idolâtres. Ces productions font d’autant plus autorité que rien ne les épuise, comme si elles échappaient pour toujours à toute assignation du sens. Elles opèrent comme une incarnation d’une liberté incertaine et sans fin. ». A condition, du moins, de savoir initier le regard du public. Est-ce là le caractère de l’œuvre d’art seule ? Pas forcément. Concernant la photographie, la question est épineuse, puisque le médium produit des documents autant qu’il crée des œuvres (double statut découlant directement de la superposition du regard de l’homme et de l’appareil, énoncée plus haut). Les photos d’agence, tout spécialement, se situent sur la frontière, en rapportant un évènement tout en l’esthétisant.
Devant une exposition de photographies sensées choquer le public, Roland Barthes remarquait que la plupart des œuvres manquaient leur but, pour la simple raison que le choc était trop visible, et l’intention de l’auteur trop évidente. A contrario, les photographies d’agence, par leur volonté peut-être plus journalistique que sensationnelle, parvenaient à rendre compte de l’évènement et de son drame. Car, et par là Barthes rejoint Sontag, « il ne suffit pas de signifier l’horrible pour que nous l’éprouvions. »[66][66] Roland Barthes, Mythologies, « Photos-chocs », 1957, Points Essais, 1970, p105. Les photos qui parviennent à signifier l’horreur sont celles qui optent pour le temps faible : des photos dépouillées du choc primaire, direct, de « l’ornement du spectaculaire » (Barthes parle du numen de la photo, qui correspondrait à l’instant prégnant d’une peinture : Napoléon sabre au clair sur son cheval cambré, dans une pose aussi glorifiante qu’impossible). Défaite de ce numen, les photos poussent le regardant à une « interrogation violente » afin de déchiffrer dans le calme de la représentation la violence qui couve, en une opération de pensée proche de ce que Brecht a défini comme une « catharsis critique » : que ce choc avorté impulse une prise de conscience nécessaire à une réflexion sur ce que je vois, à un jugement.
Nous aurions alors tort d’attendre d’une photo d’actualité qu’elle nous émeuve, car il ne suffit pas seulement d’être ému pour être poussé à (ré)agir. S’il est d’ailleurs une émotion que Susan Sontag bat en brèche dans ces pages, c’est la compassion. Quoi de plus normal en effet que de compatir face à la souffrance d’autrui ? Le problème c’est que ce réflexe compassionnel tend parfois à innocenter le spectateur, à lui faire perdre de vue sa part de responsabilité potentielle dans les crimes qu’il regarde. La compassion se suffirait alors à elle-même : puisque je pleure le sort des victimes, je ne saurai en être jugé responsable. Or précise l’auteur, désapprouver la violence est une chose différente que de s’en indigner et la rejeter complètement.
Une telle émotion, nuisant à la réflexion, masquerait donc les causes et conséquences des crimes commis, et notamment ses implications politiques, ce qui induirait une passivité chez le spectateur. L’accumulation d’images-choc risque d’ancrer un état du monde comme une fatalité dans l’imaginaire collectif : la famine en Afrique peut paraître inévitable, tant les images qui nous parviennent de ce continent ne sont que des images de mort. Cette mort est toujours choquante, mais elle parait banale à cet endroit de la planète : ces photos signifient l’horreur sans nous la faire éprouver, pour reprendre Barthes. Le spectateur compatit, mais ne s’indigne plus.
Si ces remarques valent pour les images médiatiques, on peut supposer que les pratiques muséales, n’étant pas soumises aux mêmes impératifs d’une temporalité quotidienne, à cette urgence caractéristique, sauraient remédier à ce travers de l’émotion facile. Revenons sur deux manifestations photographiques analysées par Sontag, l’une exposant des archives (des photographies de lynchages dans les Etats-Unis du début du 20ème siècle), l’autre des clichés d’immigrants de tous horizons par l’artiste Sebastião Salgado, soit les deux aspects (documents et œuvres) propres au médium.
Les photographies (dont certaines ont été éditées en leur temps en cartes postales !) de mises à mort d’Afro-américains de l’exposition Without Sanctuary n’apprennent que peu de choses sur les faits qu’elles documentent. Elles portent simplement témoignage des actes qu’un peuple de « barbares » a pu perpétrer, aveuglé par une lecture raciste du monde. Ce racisme est aujourd’hui condamné par une majorité d’Euro-américains, majorité qui se sent en devoir de contempler ces crimes de race commis il y a un siècle. Le devoir de mémoire impose ici un « devoir de regard », une obligation de regarder en face la barbarie de ses aïeux. Mais, poursuit Sontag, ces Afro-américains assassinés sont tout aussi innocents que les victimes de Dresde ou de Hiroshima, des Philippines ou du Vietnam. Un musée des guerres américaines ne serait-il pas nécessaire, afin de rappeler les victimes civiles d’une puissance de feu lointaine et sans concurrence, et de prévenir les prochaines. D’où cette question : « qui croyons-nous être en droit de blâmer ? […] Quelles atrocités d’un passé irréparable nous sentons-nous tenus d’aller revoir ? » (p101)
Là encore, l’usage de l’image est affaire de choix, de ce que l’on accepte de retenir de l’histoire. Il est sûrement plus facile d’inviter à contempler une horreur révolue (puisque les crimes raciaux, s’ils existent encore, sont théoriquement punis par la loi), que de questionner la politique militaire américaine à l’étranger. Les musées, en tant qu’institutions étatiques, obéissent souvent au même consensus que la presse et l’histoire officielle.
L’exposition Migrations : Humanity in Transition affiche quant à elle des photographies admirablement composées de migrants aux quatre coins du monde. Le principal problème que pose cette série n’est pas tant lié à la beauté de ces clichés, qu’on a pu juger déplacée, qu’au regroupement indéfini de ces souffrances. Des réfugiés, voyageurs, immigrés de toutes sortes s’y côtoient pêle-mêle, sans souci de précision ni d’identification, sans que le visiteur ne sache quoi que ce soit de leur parcours : les légendes se bornent à ne mentionner que le lieu et l’année de la prise, sans jamais nommer les sujets, ni préciser les circonstances de ces déplacements de population. Cette souffrance glisse alors vers l’abstraction, au point que le public ne peut à aucun moment imaginer une action possible pour infléchir cette détresse.
Commentant une exposition d’Edward Steichen de 1955, The Family of Man, à laquelle Sontag fait elle aussi allusion, Roland Barthes remarquait déjà comment cette tendance à l’universalisme pouvait être manipulatrice. La foule des anonymes souffrant tous de la même manière efface à bon compte les causes, précises et concrètes, de cette somme de souffrances individuelles. « Ce mythe de la condition humaine repose sur une très vieille mystification, qui consiste à placer la Nature au fond de l’Histoire. […] L’humanisme progressiste, au contraire, doit toujours penser à inverser les termes de cette très vieille imposture, à décaper sans cesse la nature, ses « lois » et ses « limites », pour y découvrir l’Histoire et poser enfin la Nature comme elle-même historique. »[77][77] Roland Barthes, Mythologies, op. cit., « La Grande famille des hommes », pp174-5. Naissance, mort, travail, et donc migration, sont des données humaines qui perdurent certes depuis des siècles, mais qui pour être comprises doivent être « historifiées » (Barthes), sous peine de trouver leur justification dans un lyrisme sans nuance, une prétendue sagesse qui masque ce qu’il convient de nommer avec Barthes un immobilisme injuste.
Ainsi, la récrimination esthétique que certaines critiques ont adressée de prime abord à ces portraits d’individus ou de groupes n’est que secondaire. Sur ce point, il est primordial de rappeler comment Jacques Rancière a montré que l’esthétisation de la misère pouvait être un geste politique, à condition que l’artiste ne cherche pas à gommer la singularité de son sujet. A la série de photographies décriées par Sontag pourrait s’opposer la trilogie réalisée par Pedro Costa sur le quartier lisboète de Fontainhas. Plutôt que d’extraire ces habitants de leur quartier, de les sortir de leur existence, le cinéaste a pris soin de les suivre dans leur quotidien, et de mettre en avant la richesse sensible de cette vie, afin de la faire partager au spectateur. « Faire du beau avec du pauvre » devient un acte politique car le film montre que le marginal cherche lui-même à embellir son existence, et que cette beauté peut aussi être appréciée par le spectateur. Pas de rapprochement indu entre les hommes : l’habitant de Fontainhas reste à Lisbonne, et le spectateur n’ira sans doute jamais lui rendre visite. Cependant, un comportement similaire, une contemplation partagée les ont rapprochés[88][88] Sur ce point, voir Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, 2008, et Les écarts du cinéma, 2011, La Fabrique..
Figure 3 – Pedro Costa, En avant jeunesse, 2008
Contre un universalisme bon teint, sur le mode « tous différents mais tous pareils », il s’agit au contraire de souligner les différences propres à chacun, tout en rendant sensibles les richesses de leur existence. Plutôt que de faire une belle photo avec des toxicomanes portugais, montrer comment eux-mêmes s’évertuent à créer de la beauté dans la misère de leur quotidien ; plutôt que de montrer les corps de victimes du génocide rwandais, redonner le nom à une rescapée, et faire exister son récit (Alfredo Jaar, The Eyes of Gutete Emerita, 1996[99][99] L’installation ne donne accès à l’image (les yeux du témoin-rescapé Gutete Emerita) qu’une fois lu le récit de son évasion. « Ces boîtes fermées mais couvertes de mots donnent un nom et une histoire personnelle à ceux et celles dont le massacre a été toléré non par excès ou manque d’images, mais parce qu’il concernait des êtres sans nom, sans histoire individuelle. » Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, op. cit., p106.). Contre l’image-cliché, le déplacement des attentes du spectateur ; contre l’image atroce vue et revue, le récit individuel d’un sujet. Rancière montre comment ces pratiques artistiques, en faisant bouger les frontières de la représentation, pourraient nous permettre de mieux comprendre l’Autre, ce qu’il vit et ce qui nous en rapproche, en lui attribuant des façons d’être que nous ne soupçonnions pas et qui sont pourtant siennes. L’esthétisation n’est donc pas incompatible avec la représentation de la misère, mais peut-être une garante de la compréhension du sujet.
C’est par cette compréhension que le spectateur peut, même de façon parfois minime, avoir envie d’agir sur ce qu’il voit (ou du moins réclamer de ses dirigeants qu’ils interviennent d’une façon ou d’une autre, comme le suggère Sontag). Car le problème principal n’est peut-être pas finalement d’être ému ou choqué par la douleur des autres, mais aussi de comprendre que l’Autre n’est pas seulement quelqu’un que l’on regarde (la philosophe compare l’exotisme des photographies de morts étrangers aux zoos humains des empires coloniaux, p81), mais quelqu’un qui vit et qui, par conséquent, ressent et nous voit aussi.
Un auteur devant la douleur des autres : l’exemple de Raymond Depardon.
Revenons à Goya. Sontag pointe une différence marquante entre le peintre et le photographe : Goya assortit chacune de ses gravures d’une courte légende, précisant souvent qu’il a vu les scènes qu’il représente. Le photographe quant à lui est considéré comme ontologiquement présent : il a dû assister à la scène pour l’immortaliser, la légende n’a aucun besoin de le préciser. Au « J’ai vu cela » de Goya répond donc le « ça-a-été » de la photographie, signe d’une différence de nature entre les représentations. La série de l’artiste espagnol se veut une synthèse qui évoque : « des choses de cet ordre se sont produites ». Au contraire, on attend de la photographie qu’elle témoigne avec exactitude : elle ne doit pas évoquer mais montrer, elle prouve autant qu’elle représente. On prend la photo « au pied de la lettre ». Certes. Mais cette lettre justement, c’est la légende qui l’impose à l’image, puisque « toutes les photographies attendent d’être justifiées ou falsifiées par leur légende » (p18) : c’est le texte qui clôt définitivement le sens de l’image.
Ce rapport de pouvoir entre les mots et l’image, rapport d’usage dans la grande majorité des photos de presse, un photographe s’est ingénié à le mettre à bas. Dès la fin des années 70, Raymond Depardon s’est insurgé contre le despotisme de la légende sur la photographie. Avec un petit livre à valeur de manifeste, Notes (Editions Arfuyen, 1979), il pose les premières pierres d’un rapport nouveau entre le texte et l’image. Carnet de voyage de Beyrouth à l’Afghanistan, chaque cliché de Notes est accompagnée d’une pensée personnelle et biographique, généralement assez courte, révélant l’état d’esprit de l’auteur au moment de la prise de vue, le parcours qui l’a amené à la situation représentée, ou encore la suite, l’avenir des évènements dont la photo ne donne à voir qu’un instant.
Cette sorte de montage que Depardon met au point avec Notes deviendra la forme de prédilection pour l’exposition de son travail photographique. Ce choix s’est imposé au photographe (terme d’autant plus ambivalent chez Depardon, passé du journalisme à l’art, non sans rendre poreuse la frontière entre ces deux domaines) en réponse aux méthodes du reportage et de l’édition, contre lesquelles il se montrait de plus en plus critique. Photos non créditées, légendes falsifiant les faits représentés… l’absence d’auteur permet aux magazines de faire dire ce qu’ils veulent aux images. Et ce qu’ils veulent justement, c’est ce qu’ils supposent que chaque spectateur attend : des illustrations stéréotypées des conflits. La boucle est bouclée : de même que chaque conflit passé s’illustre par des images-clichés, les drames actuels, pour être appréhendés au plus vite, appellent des images immédiatement reconnaissables par le spectateur. Pour le cas de Beyrouth dans les 70’s, des voitures criblées de balles, des façades éventrées, des phalangistes armés, etc.
La mise en avant de la subjectivité du photographe devient pour Depardon un rempart contre cette illustration consensuelle. Une distance paradoxale s’instaure. Paradoxale car c’est en se rapprochant de l’auteur, en partageant ses doutes sur son métier ou ses pensées intimes, que le lecteur s’éloigne peu à peu du visible pour appréhender ce que l’image ne montre pas. Alain Bergala a proposé la belle expression « d’absence du photographe » pour décrire ce moment où Depardon, prenant la photo, se laisse aller à penser à autre chose, est ailleurs, absent de la scène et absent à lui-même : « impossible de devenir le reporter de sa propre vie sans s’en absenter […], sans cesser, ne serait-ce qu’un bref instant, de la vivre pour la regarder passer. »[1010][1010] Alain Bergala, Les absences du photographe, 1981, Cahiers du Cinéma, p119. En s’absentant de la scène, le photographe pose une distance entre lui et l’action, comme une rampe imaginaire. Très concrètement, cette distance s’exprime spatialement par un espace de cinq à dix mètres entre le photographe et son sujet : c’est sa distance, son « inclination personnelle », dit-il en se référant à Eisenstein.
De plus, en faisant partager « son ailleurs » à son lecteur, l’artiste « ne triche pas ». Ce refus de la tricherie est un souci récurrent dans l’œuvre et les commentaires de l’auteur : « tricher » c’est pour lui faire comme si la photographie n’était pas le fait d’un auteur ; c’est du même coup faire semblant de donner à voir la scène dans son entièreté, alors qu’il sait bien que toute photo est toujours partielle, donc partiale. On saisit d’autant mieux la nécessité de la subjectivité de la parole accolée aux images.
Pour décrire cette pratique originale, Depardon s’appuie sur un article de Barthes, «Rhétorique de l’image», où le critique détermine deux fonctions du texte par rapport à l’image : l’ancrage et le relais. Dans le cas du premier, « le texte est vraiment le droit de regard du créateur (et donc de la société) sur l’image : l’ancrage est un contrôle, il détient une responsabilité, face à la puissance projective des figures, sur l’usage du message ; par rapport à la liberté des signifiés de l’image, le texte a une valeur répressive. »[1111][1111] Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », Communications, N°4, 1964, pp44-5. C’est le cas de la légende classique déjà évoquée. Dans l’autre fonction, le texte « relais », le texte suit sa propre voie, parallèle à l’image. Barthes note encore que dans les cas d’ancrage, l’information est « paresseuse », tandis qu’elle serait plus « coûteuse » dans les cas de relais : d’autant plus coûteuse en temps qu’elle se veut moins paresseuse en pensée.
Effectivement, ce relais confère à l’image une dimension nouvelle, la creuse en quelque sorte d’une histoire, propose un récit dont l’image serait moins l’illustration qu’un résultat à un moment donné. Le récit est, comme le rappelle Sontag, synonyme de durée. C’est sans doute pour cela que Barthes pense surtout au cinéma ou à la BD quand il décrit cette fonction du texte : une voix-off qui décrit l’état d’esprit d’un personnage sans se référer directement à l’image.
Creuser l’image, l’installer dans une durée, se garder de lui imposer un sens unique. Non asservie par le texte, mais au contraire « déployée » par lui, la photographie résiste à l’urgence, à la reconnaissance immédiate. Sontag déplorait l’édification de la guerre comme spectacle, devant lequel le spectateur ne pouvait être qu’impuissant et passif. Il est clair que le travail de Depardon n’incitera pas le lecteur à se révolter directement contre ce qu’il voit, mais il se peut bien en revanche que sa passivité soit d’un autre ordre. En appelant le lecteur à regarder au-delà du visible, le « commentaire » pare la photographie d’une certaine « pensivité » (selon le mot de Jacques Rancière, emprunté à Barthes) : l’image empêche la compréhension immédiate et invite à la contemplation, en elle « quelque chose résiste à la pensée, à la pensée de celui qui la produit et de celui qui cherche à l’identifier. »[1212][1212] Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, « L’image pensive », op. cit., p139. Cette difficulté d’identification est concomitante de « l’absence » du photographe, qui sort de la scène pour mieux y assister, pour mieux la faire partager.
Les photographies de Depardon ne sont pas « choquantes ». Elles n’assaillent pas la sensibilité du spectateur. Très peu d’images de combats, plutôt des temps faibles, mais d’un autre ordre que ceux de Goya : non plus des souffrances collatérales, mais des moments de vie quotidienne (un mariage à Beyrouth, des jeunes soldats qui paradent, les paysans chiliens après le coup d’état de Pinochet, etc.). Cette vie quotidienne qui continue malgré la douleur environnante, c’est cela qui intéresse Depardon. Il est rare que la douleur apparaisse ouvertement dans ses images. Elle est pourtant partout présente. C’est donc le texte qui va relayer cette information du dehors, filtrée par la sensibilité de l’homme d’image. Aux absences du photographe correspond un manque perpétuel, une inévitable absence dans l’image. Ses photographies ne se cantonnent pas au présent, à « l’ici et maintenant » : elles tentent de rendre compte d’un certain état du monde, et le texte les gonfle en quelque sorte d’un contexte, à la fois subjectif et extérieur.
« La douleur c’est le cadre, la lumière c’est le bonheur. » C’est par cette phrase que Depardon terminait un très bel épisode de la série Contacts (1990). A la douleur des autres s’ajoute la douleur du photographe qui se sent impuissant, forcé qu’il est de faire des choix, afin de saisir du mieux qu’il peut la scène à laquelle il assiste. Redoublée par le texte subjectif, la douleur de l’Autre n’est plus un spectacle abstrait et impersonnel, mais une situation d’autant plus réelle qu’elle a été « partagée » (toute proportion gardée bien entendu) par ce témoin privilégié. Elle acquiert de cette manière « l’intensité de conscience » nécessaire pour être éprouvée. Car Depardon sait que la souffrance n’est que rarement quelque chose qui se voit, et malgré tous ses efforts, le photographe ne pourra jamais que la rendre à demi. D’où son humilité, cet aveu d’impuissance et d’échec (devant un enterrement photographié à Beyrouth – deux clichés publiés dans Notes, il avoue avoir raté la photo : « je n’ai pas pu »). Cette douleur du cadreur rend justice à une souffrance qui échappe à l’objectif de l’appareil. Elle ouvre à l’invisible dans l’image, l’inscrit dans un parcours, dans une totalité qui la dépasse. L’émotion qui s’en dégage n’est plus la compassion rapide pour un sujet en détresse, mais oblige le lecteur à imaginer au-delà de ce qu’il voit, de sorte que puisse naitre peut-être une réflexion critique.
Conclusion : Des images pour mettre fin à la guerre ?
Au terme de son essai, Susan Sontag conclut que « la photographie n’est pas censée remédier à notre ignorance quant à l’histoire et aux causes de la souffrance qu’elle choisit de cadrer. Ces images ne peuvent guère faire plus que nous inviter à prêter attention, à réfléchir, à apprendre, à examiner les rationalisations par lesquelles les pouvoirs établis justifient la souffrance massive » (p25). Un appel à l’examen, une invitation à la vigilance et à l’imagination, telle serait finalement la fonction de la photographie. Les images seules n’empêcheront jamais l’homme de faire la guerre. En revanche elles peuvent être un support à partir duquel critiquer les rapports de pouvoir et en imaginer de nouveaux.
Selon Jacques Rancière, une grande erreur de l’art politique aura été de penser pouvoir mobiliser, faire agir le spectateur. C’est aussi à cette question que l’essai de Sontag apporte une réponse déceptive : quelle image pour mobiliser contre la guerre ? Aucune évidemment. C’est que pour le philosophe français, il est simpliste d’opposer activité et passivité chez le spectateur. « Les pratiques de l’art ne sont pas des instruments qui fournissent des formes de conscience ou des énergies mobilisatrices au profit d’une politique qui leur serait extérieure. Mais elles ne sortent pas non plus d’elles-mêmes pour devenir des formes d’action politique collective. Elles contribuent à dessiner un paysage nouveau du visible, du dicible et du faisable. Elles forgent contre le consensus d’autres formes de « sens commun », d’un sens commun plus polémique. »[1313][1313] Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, « Les paradoxes de l’art politique », op. cit., p84. Il ne s’agit pas de pousser le spectateur à l’action, mais de lui permettre de penser autrement le monde qui est le sien et qu’il partage avec d’autres.
Parmi ces « formes dissensuelles », comme les nomme Rancière, ouvrant de nouveaux découpages du monde commun, d’autres partages du sensible, les films de Costa ou le jeu de montage entre texte et image chez Depardon construisent une autre condition de spectateur face aux souffrances du monde. Sontag termine quant à elle sur un montage photographique de Jeff Wall, Dead troops talk (1992), illustrant tout à fait le fossé infranchissable entre victimes et spectateurs, entre morts et vivants : ces soldats morts discutent paisiblement entre eux, sans faire attention aux visiteurs, pour la bonne et simple raison qu’ils n’ont rien à nous dire, à nous qui sommes incapables de les entendre.
Figure 4 – Jeff Wall, Dead Troops Talk, 1992
« Qu’aurait-il à nous dire ? « Nous » – ce « nous » qui englobe quiconque n’a jamais vécu une telle expérience – ne comprenons pas. Nous ne saisissons pas la chose. Nous ne pouvons pas nous représenter ce que c’était. Nous ne pouvons imaginer à quel point la guerre peut être horrible – ni à quel point elle peut devenir normale. Nous ne pouvons ni comprendre, ni imaginer » (p133). C’est ce qu’éprouve avec raison tout rescapé, tout témoin des combats (souvenons-nous de la souffrance de Depardon). Mais – et c’était tout le sens du grand livre de Georges Didi-Huberman, Images malgré tout (Minuit, 2002) – c’est bien parce que nous ne pouvons pas nous représenter de telles atrocités que nous avons besoin d’images pour nous aider à le faire malgré tout.
De même que les morts de Wall n’ont rien à nous dire, n’attendons pas des images qu’elles fassent tout le travail de la parole et du souvenir, qu’elles soient à elles seules véhicule de savoir historique. Mais leur incomplétude fondamentale ne doit pas pour autant nous faire oublier leur force évocatrice, et le rôle qui peut être le leur dans la compréhension des injustices du monde. « Voilà ce que l’homme peut faire à l’homme, dit l’image. N’oubliez pas. » C’est peut-être le rôle de celui qui vient après, historien, philosophe ou artiste, de situer, remonter, reconstruire cette souffrance afin de nous la rendre accessible, que la part de réalité que les images portent indubitablement puisse être un peu plus imaginable. Et le monde ne comporte que trop d’injustices ayant besoin d’être revues, à défaut d’être réparées. En attendant ce travail second, comme le suggère Sontag, la meilleure façon de rester vigilants est peut-être de « laisser les images atroces nous hanter ».
Publié aux Etats-Unis en 2002.
Traduit en français par Fabienne Durand-Bogaert et publié par Christian Bourgois, en 2003.