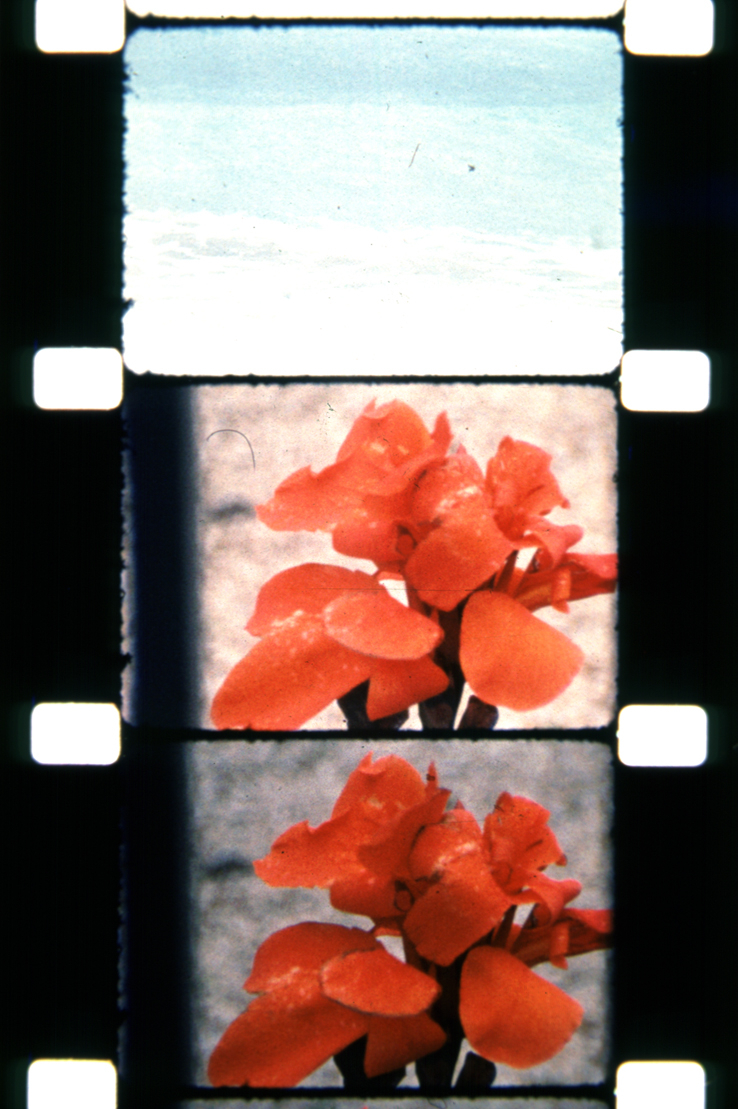Le cinéma autre #4
Jonas Mekas, un art de vivre
Avant de réinvestir, depuis le territoire du cinéma, le paradigme d’un « autre de l’art », il parait utile de se pencher sur la définition de l’art brut, manifestation saillante de cet « autre ». Parler « des » définitions serait plus juste, le singulier se perdant vite dans un effet de flou, dans de multiples ramifications : art brut, art naïf, art hors les normes, art moderne rustique, art obscur, art populaire, primitif, surréalisme, art schizophrène, art spirite, chamanisme, création franche, neuve invention, primitivisme, singuliers de l’art[11] [11] Respectivement : Expression qualifiant la collection de Lausanne / Regroupement d’œuvres d’artistes autodidactes prolongeant une tradition populaire, artisanale, folklorique et issue d’une “ingénuité de l’âme, idéaliste et poétique, soucieuse de retourner la virginale fraicheur des aurores premières, la pureté originelle du monde, le mystère permanent de la vie dévoilé telle une révélation mystico-apparitive” (Robert Thilmany, Critériologie de l’art naïf, 1984) / Terme de Dubuffet choisi par les collectionneurs Alain et Caroline Bourbonnais datant de 1972. Dubuffet avait également proposé : art spontané, invention spontanée, production extra-culturelle, invention hors les murs / Expression du peintre Gaston Chaissac pour définir son univers et son mode d’expression qu’il compare à un dialecte, au patois même, tout sauf quelque chose d’épuré et de correct / Terme proposé par le peintre René Auberjonois en 1945 à Dubuffet pour exprimer la nature de ce qui s’appelle désormais art brut / Notion apparue en Europe au 18ème pour définir les productions artisanales et artistiques souvent anonymes des populations modestes (rurales ou urbaines) à vocation utilitaire, religieuse ou décorative / Les arts primitifs : expression pour définir des œuvres non-occidentales qui ont été estimées plus authentiques par les romantiques. Art nègre disait Picasso. Arts primordiaux disait André Malraux. Arts premiers ont nuancé certains intellectuels face à l’aspect péjoratif du terme primitif / Mouvement initié par André Breton à partir de 1922 : explorer l’inconscient humain, rêves, transe, expression automatique / Art réalisé par des personnes souffrant de maladies mentales proches de la psychose telle qu’elle a été définie en 1911 par le docteur Bleuler. Il existe plusieurs types de schizophrénie dont la paranoïde qui est dominée par les délires / Le mot spiritisme provient d’une expression anglaise désignant la réception de messages de l’au-delà. Parallèlement à la popularité des médiums et des théories sur le spiritisme, des pratiques comme le psychosisme émergent (capter les bons esprits pour transmettre leurs forces et guérir les maux) / Religion d’Asie centrale et septentrionale dont on retrouve des aspects en Amérique latine, fondée sur les relations avec les esprits surnaturels. Le dessin y joue un rôle privilégié. L’animisme, comme le vaudou, qui en découle, s’apparentent au chamanisme / Expression choisie par le musée de Bègles en 1989 pour définir les œuvres spontanées, signées d’artistes autodidactes / Terme de Jean Dubuffet de 1982 pour qualifier ses œuvres de la collection annexe /Mouvement artistique du début du 19ème (prolongement de la tendance orientaliste des peintres romantiques), chez Gauguin essentiellement qui s’inspire de formes issues de cultures non occidentales (Afrique, îles du Pacifique) ou populaires (enseignes, imagerie). Influence sur Picasso et Matisse / Expression de Michel Ragon et Alain Bourbonnais pour qualifier les œuvres de l’exposition de 1978 au musée d’art moderne de la ville de Paris. , etc… Devant une telle pluralité, riche de tensions et de recouvrements, il semble que l’art brut doive être considéré dans une tendance à l’élargissement du champ de la création, et pensé comme un pôle d’aspects.
Mais, puisque des repères sont nécessaires, on pourrait d’abord qualifier l’art brut de la manière suivante, avec Jean Dubuffet qui en est le fondateur : “Nous entendons par [Art Brut] des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique, dans lesquels donc le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, ait peu ou pas de part, de sorte que leurs auteurs y tirent tout (sujets, choix des matériaux mis en œuvre, moyens de transposition, rythmes, façons d’écritures, etc.) de leur propre fond et non pas des poncifs de l’art classique ou de l’art à la mode. Nous y assistons à l’opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions. De l’art donc où se manifeste la seule fonction de l’invention, et non celles, constantes dans l’art culturel, du caméléon et du singe“[22] [22] Jean Dubuffet, L’art brut préféré aux arts culturels, Paris, Galerie René Drouin, 1949. ,[33] [33] Jean Dubuffet, Notice sur la Compagnie de l’art brut, 1963 : “Des productions de toute espèce – dessins, peinture, broderie, figures modelées ou sculptées, etc. – présentant un caractère spontané et fortement inventif, aussi peu que possible débitrices de l’art coutumier ou des poncifs culturels, et ayant pour auteurs des personnes obscures, étrangères aux milieux artistiques professionnels” , [44] [44] Jean Dubuffet, Cahiers de l’Art Brut n°1, 1964 : “Œuvres ayant pour auteurs des personnes étrangères aux milieux intellectuels, le plus souvent indemnes de toute éducation artistique et chez qui l’invention s’exerce, de ce fait, sans qu’aucune incidence en vienne altérer la spontanéité” .
Ainsi, l’art brut émergerait d’individus dont la création s’affranchit – involontairement – de l’art officiel. L’opération de Dubuffet s’avère paradoxale, puisqu’il s’agit tout à la fois de s’opposer à un art culturel et de lutter pour la reconnaissance de certaines pratiques comme art ; le produit de cette opération sera donc un élargissement de notre définition de ce que peut être une œuvre d’art. Il faut noter par ailleurs une certaine porosité quant à la dimension culturelle : Dubuffet était lui-même « cultivé », et des références à la mythologie, au cinéma, au théâtre ou encore à des cultures non-occidentales, sont visibles dans certaines oeuvres, comme celles d’Aloïse Corbaz. Enfin, il est évident qu’avoir une culture artistique n’empêche pas de travailler contre des normes. Pour apparaître d’emblée trop exclusifs, certains critères sont en fait portés à l’assouplissement. Certains observateurs ont d’ailleurs pu souligner que les œuvres considérées comme « brutes » ne rentrent pas toujours dans les critères canoniques établis par Dubuffet, qui a, de son côté, également exprimé l’idée que l’Art Brut était avant tout à envisager comme un pôle, c’est-à-dire un point magnétique exerçant des forces dans un champ sans frontière :
« Il sera bon de regarder l’Art Brut plutôt comme un pôle, comme un vent qui souffle plus ou moins fort et qui n’est le plus souvent pas seul à souffler. C’est très difficile de marcher à contre-courant sans dévier parfois quelque peu. »[55] [55] « L’art brut », exposition à la galerie des Mages, Vence, août-septembre 1959. Ajoutons à notre citation ce passage où Dubuffet répond à Gombrowicz, pour qui l’idée d’une création a-culturelle relève du mensonge : « Il y a tous les degrés, tous degrés, veux-je dire, de profondeur, tous niveaux, dans le culturel. Je sais bien que les esprits les plus libérés et inventifs, les accents les plus personnels, les plus sauvages spontanéités, ne peuvent prétendre à ne rien devoir à la culture. Mais il y a question de plus ou de moins ; il y a question du niveau de cette culture auquel l’emprunt est fait, celui du vieux bois dur ou de l’aubier. Je veux pour finir marquer mon étonnement de vous voir mettre en cause la seule peinture. Tout ce que vous dîtes d’elle s’applique aussi bien à l’écrire, et d’ailleurs à toute forme d’expression qui soit. Bien sûr que tout repose sur un langage conventionnel (« la rose »), qui en fait le jalonnement, qui en situe l’espace. Mais pensez bien à mon aubier. Plus ou moins conventionnel ; conventionnel à des niveaux différents. Gardons-nous d’effacer les distinctions entre ce qui procède plus du conventionnel et ce qui en procède moins. D’un conventionnel qui sera suivant le cas plus ou moins de la chair tendre ou bien du vieil os. De chair immédiatement, passivement, empruntée, ou bien de sécrétion personnelle à partir du vieil os », dans Jean Dubuffet, Witold Gombrowicz, Correspondance, Paris, Gallimard, 1995, p 45-46.
Par conséquent, le fait qu’une œuvre ou qu’un artiste présente certains traits apparemment contraires à une définition «pure » de l’art brut n’est pas un obstacle absolu à tout rapprochement. Notre thèse n’est pas ici de considérer les films de Mekas comme des “films bruts” qui seraient au domaine du cinéma ce que l’art brut serait au domaine de l’art en général, mais bien de penser sa conception du cinéma et ses films au regard de la conception de l’art brut héritée de Dubuffet, dans une forme d’analogie.
Parler de « cinéma brut » pose nécessairement des questions. Pour y répondre, deux pistes se présentent. Une piste générale (et en fait excessive), d’abord, qui a trait à la technique et au matériau : le cinéma induirait d’emblée une déprise de l’artiste vis-à-vis de son œuvre, en l’obligeant à passer par un instrument, la caméra, qui enregistre mécaniquement le réel. Cela a d’ailleurs constitué l’une des raisons pour lesquelles la valeur artistique du cinéma a été au départ problématique : l’idée d’une image obtenue par un processus mécanique ou automatique s’opposait à une conception de l’œuvre comme résultat du travail d’une subjectivité, d’une sensibilité ou d’une vision particulière d’un artiste sur un matériau. Le cinéma, à la suite de la photographie, introduisait apparemment la reproduction du réel là où se trouvaient jusqu’alors des traductions ou des transformations du réel, des créations artificielles.
Dans sa Théorie du film, Siegfried Kracauer, se posant cette question du rapport du cinéma à l’art, en arrive à la conclusion que si le cinéma est un art, c’est « un art pas comme les autres » ou « un art à part », car « le cinéma comme la photographie est le seul art qui montre son matériau à l’état brut. L’art tel qu’il se manifeste dans les films cinématographiques renvoie à l’aptitude qu’ont leurs créateurs de déchiffrer le livre de la Nature ». Le cinéaste doit donc travailler avec la nature, c’est-à-dire la réalité matérielle qui s’offre à lui à travers la caméra. Comme il le dit ailleurs : « le réalisateur le plus créatif sera toujours plus dépendant de la nature à l’état brut que le peintre ou le poète »[66] [66] Siegfried Kracauer, Théorie du film, Paris, Flammarion, 2010, « avant-propos », p. 15-16, « La question de l’art », p. 78-79, « un art à part », p. 423-427. Notons, p. 425, l’idée de Kracauer selon laquelle l’art classique s’avère au cinéma « réactionnaire ». Cela suggère que les discussions sur l’art recouvrent un enjeu plus largement politique. .
Kracauer cite en passant l’écrivain et journaliste Michel Dard, qui relevait que nous sommes au cinéma « frères des plantes vénéneuses, des cailloux… ». Si le cinéma montre donc un matériau à l’état brut, ce matériau peut aussi être sans noblesse. Le cinématographe, qui se déploie dans les sites touristiques du monde entier, et auprès des « grands de ce monde », va aussi donner visibilité aux masses, et aux objets de la vie quotidienne. On peut ainsi concevoir le cinéma, avec Jean-Louis Leutrat, comme « art du ruisseau »[77] [77] Jean-Louis Leutrat, Un autre visible. Le fantastique du cinéma, De l’incidence éditeur, 2009, p. 45, p. 100. , ou bien parler avec Rancière du lien du cinéma à l’ « âge esthétique » des arts[88] [88] Comme l’a proposé Suzanne Liandrat-Guigues dans son texte, qui fait également partie de cet ensemble autour du « cinéma autre », « La marche, un autre mouvement du cinéma ». . Dans sa réflexion, Kracauer dresse une liste de ce qu’il nomme les « affinités » du cinéma, à savoir les motifs qui y sont particulièrement prégnants : le non-artificieux, l’indéterminé, l’illimité, le flux de la vie, et le fortuit[99] [99] Siegfried Kracauer, « Affinités intrinsèques », op. cit., p. 108-127. . Le fortuit, le hasard, le non-intentionnel, sont évidents des termes importants dans la définition de l’art brut.
Mais le rapprochement entre art brut et cinéma en général, sur la base de la technique, peut paraître excessif. Ainsi Noël Burch, dans Praxis du cinéma, tout en notant que le hasard est « chez lui » au cinéma, ou encore que « le matériau du cinéma est toujours plus ou moins réfractaire », laisse entendre que la plupart des cinéastes ont mené une lutte contre ce hasard en délaissant par exemple les tournages en extérieur pour les tournages en studios[1010] [1010] Noël Burch, « Fonctions de l’aléa », Praxis du cinéma, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », p. 153-176. .
Proposer un rapprochement entre cinéma et art brut sur la base d’éléments comme l’utilisation d’un matériau brut, la disparition d’une hiérarchie et le hasard, signifie recourir à une définition tronquée du cinéma ou entrer dans des considérations sur sa spécificité en concevant comme le fait Kracauer un cinéma par nature réaliste (ce qui se fait plus difficilement si l’on ne prend pas comme point de départ le cinéma à la fois en prise de vue réelle et sur support argentique – le cinéma d’animation ou l’image numérique déplacent en effet les problèmes).
Si la technique et le matériau sont des éléments importants et peuvent constituer une base, ils ne sauraient être suffisants pour rendre le rapprochement convaincant. Il faut donc abandonner la piste générale, pour emprunter celle des usages de la technique : tout comme il y a des manières de faire de l’art qui peuvent, réunissant un certain nombre de critères, s’apparenter à de l’art brut, il y a des manières de faire du cinéma qui peuvent être rapprochées plus que d’autres de ce type d’art. C’est cette piste de l’usage que nous allons suivre en étudiant la pratique singulière de Jonas Mekas.
1) Le journal filmé, le hasard, la spontanéité
Lorsqu’il traite de la place du hasard au cinéma, Burch note qu’il ne s’agit pas d’une règle générale, mais d’une affaire de degrés, d’une question de « plus ou moins ». Ce « plus ou moins » nous semble la seule manière de concevoir un rapprochement fructueux entre le cinéma et de l’art brut. A bien des égards, Mekas se situe du côté du « plus », sur un pôle analogue à celui qu’occupent les artistes bruts. Plusieurs aspects de son travail trouvent en effet un écho dans les pratiques propres à l’art brut, tels que l’usage de matériaux naturels ou de recyclage (dénotant un aspect trivial ou détaché de l’artistique au profit du réel), l’émergence de nouveaux modes de figuration ou d’expression, l’importance de la spontanéité dans la création, cette dernière dénotant parfois un aspect proliférant ou obsessionnel (soulignons la productivité de Mekas dans le 365 Days Project). L’on peut également se demander s’il n’y aurait pas entre l’art brut et le journal filmé, genre dont Mekas est l’un des plus illustres représentant[1111] [1111] Des rapprochements pourraient être effectués avec d’autres œuvres proches du “genre” film-journal utilisé par d’autres cinéastes comme Peter Hutton, Andrew Noren (The adventures of the exquisite corpse), Joseph Morder (qui commence à filmer à l’âge de 18 ans avec une super-8 un journal filmé), Marcel Hanoun, Teo Hernandez, Gérard Courant, Lionel Soukaz, Tonino De Bernardi, Shirôyasu Suzuki, Nobuhiro Kawanaka, Hiroyuki Ôki, Andrew Noren, Howard Guttenplan etc. , une affinité spéciale.
Initialement, les usages liés au genre du journal sont pluriels : on peut parler de journal filmé, de film de famille, de film amateur, etc. Se déplie alors tout un ensemble de pratiques qui déplacent les frontières de l’art vers le “populaire” et rendent la frontière poreuse entre l’art et la vie : raison pour laquelle la problématique de la légitimité artistique se retrouve au sujet du film-journal. La question de la légitimité du journal en général – qu’il soit littéraire, photographique ou cinématographique – n’est d’ailleurs pas nouvelle : elle s’est notamment énoncée dans le champ littéraire, ce dont témoignent le chapitre « Le journal intime et le récit » dans Le livre à venir de Maurice Blanchot, et l’article de Roland Barthes, « Délibération » (Essais critiques IV, Le bruissement de la langue). Colette Hinzelin écrit quant à elle : « le genre du journal, par son refus de travailler de prime abord la représentation, confiné qu’il est à la consignation de l’instant, a longtemps été considéré comme un genre illégitime, un sous-genre, qui ne pouvait pas accéder au statut d’œuvre »[1212] [1212] Colette Hinzelin, « La pratique du journal photographique comme questionnement des codes artistiques », Revue marges 04, La revue du département Arts Plastiques de l’Université Paris 8, octobre 2005, p.47. .
Des multiples points d’accroche entre art brut et journal filmé, nous retiendrons pour notre propos les suivants :
– La déhiérarchisation des matériaux, au sens où l’art nous met à l’épreuve d’une remise en question de la distinction entre le noble et le trivial.
– Le caractère « mineur » du genre du journal, qui a suscité, avant une reconnaissance ultérieure, une sorte de mépris.
– La porosité extrême entre l’art et la vie au sens où, plus qu’une “utilisation du proche” ou qu’un travail sur la vie quotidienne, il s’agit d’une création profondément enracinée dans l’expérience de la vie. L’étymologie du mot “journal” invite de fait à souligner la dimension temporelle dans laquelle s’inscrit un processus d’écriture, lequel devient relatif à chaque jour. Ce que ce mot revêt d’important et de légitime, d'”élargi”, au regard d’œuvres comme Walden de Mekas que nous aurions tort de réduire en leur apposant cette étiquette de « journal », c’est la perspective du présent, de créer avec et au présent. Il y a par ailleurs une grande hybridité dans Walden puisque, outre la référence explicite à Henri David Thoreau, il contient aussi des notes d’un journal écrit.
La question de la légitimité ne porte alors pas uniquement sur le possible du journal en tant qu’œuvre mais aussi sur le possible d’un nouveau cinéma – lequel assumerait et revendiquerait certaines imperfections liées au matériel (la caméra portée à l’épaule créant des saccades, des mouvements improvisés provoquant des variations d’exposition, des imprévus aussi peut-être dans la vitesse d’enregistrement, et de manière générale le grain d’une pellicule 16mm) et requalifierait « les défaillances d’une pratique « amateur » en fonctions expressives »[1313] [1313] Colette Hinzelin, art. cit., p.51. .
La dimension contingente du bricolage, que nous évoquerons ultérieurement à travers la définition qu’en propose Lévi-Strauss, est à penser au regard de la manière dont Mekas filme , c’est-à-dire sans scénario :
“Mais quand on filme, quand on tient des carnets avec la caméra, le principal défi est la manière de réagir avec la caméra sur-le-champ, au moment où cela se passe […] Le défi, maintenant, est de capter cette réalité, ce détail, ce très objectif fragment physique de réalité d’aussi près que possible de la manière dont mon moi le voit »[1414] [1414] Jonas Mekas, « Le Film-Journal », in Jonas Mekas, op.cit., p.49. .
Il y a un rapport d’instantanéité et de contemporanéité entre Mekas et ce qu’il souhaite « capturer » dans la prise de vue, rapport fondamentalement impossible dans l’écriture. Cette instantanéité suppose une part d’aléatoire. Mais bien que rien ne soit prévu et préétabli (par un scénario, un sujet, un lieu de tournage), Mekas n’en choisit pas moins avec beaucoup d’attention ce qu’il désire filmer. Si le hasard joue donc un rôle évident (improvisation face à l’imprévisibilité de la vie lors de l’acte filmique et au montage), cela ne veut pas dire que les choses sont faites par hasard. Le cinéma de Mekas semble en effet jouer le rôle d’un filtre, d’un tamis, d’un crible de la vie. En nous offrant une vie découpée en fragments, le cinéma invente comme une vie en accéléré, et rend sensible le fait que l’importance des moments ne nous est pas forcément donnée lorsque nous les vivons. Comme l’a en outre souligné Colette Hinzelin à propos de Mekas: « le journal est […] envisagé comme une pratique radicale, seule à même, par la simplicité de son dispositif, d’être en prise sur le réel, dans une stratégie de réparation de la perte, voire de survie post-traumatique »[1515] [1515] Ibid., p.50. . Contre la perte, le journal devient alors une manière de créer non plus seulement pour l’art mais pour la vie. Connaître la vie de Jonas Mekas permet alors, dans une certaine mesure, d’éclairer son travail et le lien qui les unit.
2) L’art comme nécessité
Jonas Mekas a vu le jour en 1922 en Lituanie, où il grandit dans un milieu rural. Mais, tout en prenant part aux activités de la ferme et en fréquentant la nature, Jonas se cultive : il devient assez tôt un grand lecteur et commence dans la foulée à écrire de la poésie. Il travaillera pendant la guerre pour un hebdomadaire local, et participera à la publication d’un journal clandestin. C’est cette activité illégale qui, lui faisant courir le risque d’une arrestation, le fera fuir son pays en 1944. S’ensuivent alors des années très difficiles. De 1944 à 1949, Mekas et son frère Adolfas vivent dans divers camps de réfugiés, tout en continuant à lire et écrire (cette période est racontée dans son journal écrit, publié sous le titre Je n’avais nulle part où aller). En 1949, ne pouvant rentrer en Lituanie passée sous contrôle soviétique, il embarque pour New-York et, là-bas, son investissement dans la vie culturelle cinématographique va s’enclencher. Il achète sa première caméra Bolex en 1950, mais fréquente aussi les salles et organise bientôt lui-même des projections de films. En 1954 il fonde la revue Film Culture et devient critique pour The Village Voice. L’importance de Mekas dans le milieu du cinéma « underground » américain va se maintenir à travers les années, il côtoiera grand nombre de figures de l’art d’avant-garde et participera à des projets collectifs visant la promotion et la conservation du cinéma d’avant-garde, comme la Filmmakers’cooperative (1964) ou l’Anthology Film Archives (1970) dont il assurera la direction.
L’œuvre de Mekas s’étend sur plus d’un demi-siècle et est protéiforme ; le tout qu’elle parvient à former se compose de films aux formats divers (d’une durée de plus de quatre heures à des films très courts), passe par un recours à différents supports (l’écrit, la pellicule, la vidéo), et se diffuse dans différents espaces (cinéma, galeries d’art puisqu’il a également fait des expositions et des installations, et, tout récemment, un Burger King à Venise). Le premier point pouvant fonder un rapprochement entre Mekas et l’art brut découle directement de la vie du cinéaste. Nombre d’artistes bruts ont développé une pratique artistique en réponse à un traumatisme, comme une nécessité, une forme de thérapie. Pour Mekas, ce sera l’expérience de la guerre et du déracinement. La crise qu’il traverse alors n’est pas uniquement matérielle, elle est aussi spirituelle.
Dans les pages de son journal écrites pendant et après la guerre, Mekas exprime à plusieurs reprises de la mélancolie, un sentiment dont il n’arrive pas à se dépêtrer malgré divers changements de lieux. Pour résumer, il est possible de caractériser ce sentiment comme un sentiment de distance, ou d’étrangeté. L’exil apparait comme le noyau du mal-être de Mekas. Il éprouve une nostalgie pour la Lituanie, l’impossibilité d’établir de nouvelles racines, mais aussi une incompréhension vis-à-vis du monde dans lequel il évolue, qu’accompagne logiquement une grande solitude (amplifiée par les problèmes de langue que rencontre l’exilé – mais Mekas se sent en fait aussi très différent des membres de la communauté lituanienne qu’il côtoie). Que ses plaintes portent sur la perte d’une terre natale, sur la « civilisation » où règnent la technique et la raison, sur le manque de volonté de ses congénères, il s’agit toujours de l’expression d’une distance :
« Décembre 1951. J’ai essayé. J’ai fait ce que je pouvais pour être simplement comme les autres. Je me suis efforcé d’être terre-à-terre, d’enfoncer mes mains dans le tas de sable sur la 6ème avenue, de fouler de mes pieds nus l’herbe de Central Park. Mais je demeure un étranger ici. Un abîme me sépare de chaque immeuble, de chaque rue, de chaque visage. Alors je replonge dans mon imagination, mes souvenirs, mes rêves. Ou je fais le pitre. Oui, même les sons que j’entends prennent pour moi un sens différent. Ils n’évoquent aucun souvenir. Les camions qui nettoient les rues, ou les voitures. Mouvements, sons de voix, expressions, formes, je les perçois, mais je ne les comprends pas. Ils n’éveillent aucun écho au plus profond des cellules de mon corps, non, aucun. J’arpente cette ville jour et nuit sans vraiment la comprendre. Rien de tout cela n’a de sens. Les choses se passent, et c’est tout. Elles existent, tout simplement, exactement comme moi, mais nous sommes des étrangers. »[1616] [1616] Jonas Mekas, Je n’avais nulle part où aller, Paris, P.O.L., 2004, p. 351.
Pour Mekas, le cinéma sera d’abord une solution au problème de la mémoire et au sentiment de distance. L’habitude qu’il prend de filmer les événements survenant autour de lui a une vertu rassurante pour lui qui a été détaché de son passé. Il s’agit aussi de se constituer une nouvelle mémoire, comme il l’exprime dans le commentaire de Lost Lost Lost (1976): « c’est ma nature maintenant d’enregistrer, d’essayer de conserver tout ce que je traverse, d’en conserver au moins des bribes. J’ai trop perdu ; Alors maintenant j’ai ces bribes de ce que j’ai traversé. »
Il y va donc d’une possible résorption de la distance aux choses, d’une affirmation de sa présence au monde. Mekas a pu parler de la caméra comme un remède à sa timidité : « Ma caméra était un moyen de participer à la vie qui m’entourait (…) Ma Bolex me protégeait et en même temps me permettait de jeter un œil et de me concentrer sur ce qui se passait autour de moi »[1717] [1717] Jérôme Sans, Morgan Boëdec, Léa Gauthier, Entretiens avec Jonas Mekas, Paris, Paris Expérimental, « Les Cahiers de Paris Expérimental », 2006, p. 5. . Ainsi la pratique du cinéma ouvre-t-elle la voie d’un investissement paradoxal dans le monde, à travers une dialectique de la proximité et de la distance qui accompagne toute activité de filmeur et toute image. Dans une chronique écrite pour le Village Voice en 1966 autour du développement des caméras 8mm qui permettent une démocratisation des tournages, Mekas témoigne d’un énorme enthousiasme et émet le souhait qu’arrive un moment où tout puisse être filmé et montré. C’est un souhait qui s’ancre dans une croyance exprimée par cette phrase : « Quelque part, nous avons perdu le contact avec notre propre réalité et l’œil de la caméra nous aidera à reprendre contact avec elle ». Voilà donc ce que peut être la caméra pour Mekas : une manière de se relier aux choses après la perte d’un contact, donc la possibilité d’une mue ou d’un nouveau commencement, comme il l’exprime également dans ce texte[1818] [1818] Jonas Mekas, « A M. Lindsay, maire », Ciné-Journal, Paris, Editions Paris Expérimental, 1992, p. 214. Cette idée que filmer est un moyen de reprendre contact avec la réalité est partagée par bon nombre de réalisateurs de journaux filmés : Perlov, Kawase, Cabrera… .
Enfin, le cinéma semble avoir été pour lui une manière de convertir en affirmation positive, vitaliste, ce qui semblait le miner en 1951, à savoir l’absence de sens de l’existence. Mais le cinéma va peut-être finalement moins résoudre cette absence, que devenir le lieu de sa célébration.
Tels pourraient être les trois éléments autour desquels se crée un lien particulier entre Mekas et le cinéma, une coalescence véritable entre l’homme et son art. On peut d’ailleurs noter que très tôt Mekas est conscient de sa condition et du lien particulier à l’art que cela suppose. Ainsi écrit-il en 1948 (soit avant l’achat de sa première caméra), dans une lettre intégrée à son journal : « Je veux seulement m’étendre sur le dos dans un champ et regarder le ciel entre les brins d’herbe. Et puis…mourir. Ou alors marcher derrière la charrue, pieds nus dans la terre sombre et humide, et puis la nuit…rêver. Vous vivez parce que vous voulez écrire un poème. Nous en écrivons parce que sinon nous ne pourrions pas vivre. Etre ou ne pas être. Ecrire ou ne pas écrire. »[1919] [1919] Jonas Mekas, Je n’avais nulle part où aller, op. cit., p. 156. Nécessité intérieure donc, qui entraîne chez Mekas une indistinction entre l’art et la vie. Celle-ci s’exprimera directement dans Walden, où l’équation « vivre et écrire » posée en 1948 devient « vivre et faire des films de famille (home movies)».
3) Les matériaux bruts
“L’art doit naître du matériau. La spiritualité doit emprunter le langage du matériau“
Jean Dubuffet
« Le matériau doit vous dire ce qu’il faut faire avec lui. Vous pouvez jouer à l’idiot et imposer quelque chose, forcer le matériau pour qu’il donne quelque chose. Ou vous pouvez regarder, regarder jusqu’à voir ce que le matériau veut que vous fassiez avec lui. Regarder et écouter. »
Jonas Mekas, dans entretien pour Débordements
Cette citation de Dubuffet nous invite à revenir sur la définition de “brut” : qui est à l’état de nature, sauvage, à savoir ce qui n’aurait pas été façonné par l’homme, ou qui ne serait pas domestiqué ou formé par la civilisation (ou la société, l’éducation). Les œuvres d’art brut sont faites avec “les moyens du bord”, des bricoles récupérées à droite et à gauche (stylo, couteau volé, chiffon, morceau de papier, emballages, tickets, etc..). Il s’agit d’une pratique de récupération, d’assemblage-collage, de bricolage. En l’occurrence, cela rejoint la définition du bricolage que légitime l’ethnologue et anthropologue Claude Lévi-Strauss dans La Pensée sauvage (1962) lorsqu’il met en avant le fait de travailler avec ce que l’on a à portée de main. Pour lui, la dimension contingente inhérente à cette pratique est constitutive d’une certaine “poésie du bricolage”.
Cette absence de moyens économiques se retrouve chez Jonas Mekas, qui a souvent évoqué le manque de temps, d’argent et de bon matériel pour réaliser ses films, ainsi que sa persévérance à filmer, suivant le principe du faire avec ce que l’on a. Mais il s’agit aussi et surtout de faire avec le réel. Et ainsi donner de l’importance au concret par des films réalisés avec des fragments bruts du réel. Ainsi, dans A letter from Greenpoint (2004), Mekas se filme en train de marcher, de discuter avec ses amis, d’échanger sur la vie. Il témoigne de ce qui est important alors qu’il filme : « Le moment où je choisis de tourner est déterminant. Je suis là, avec ma Bolex, attendant pour m’en saisir que quelque chose d’intense survienne : des réactions dans les voix, dans les visages, des relations, des manifestations d’amitié. Je m’attache à témoigner des moments de joie, de célébration de la vie. […] D’une certaine manière, telle est ma ligne « politique », je ne veux promouvoir que l’amitié, la joie, la nature »[2020] [2020] Jonas Mekas, « Entretien » avec Hopi Lebel, in Jonas Mekas, op.cit., p.71. . Mekas écrit encore : « Tout ce que j’ai appris dans ma vie (et j’ai vu maints films) se ramène à cela : les feuilles tombent tous les automnes. Je serai là avec ma caméra quand elles tomberont »[2121] [2121] Jonas Mekas, Ciné-journal, op.cit., 19 septembre 1963, p.99. . Ses films ne semblent présenter aucune hiérarchie axiologique : inconnus ou amis, arbre ou marche pour la paix en pleine nuit, oiseau ou arrestation de manifestants par la police à Times Square, travaux des rues ou empreintes des pattes de pigeon dans la neige pendant un « rêve de Jean Cocteau », tout cela est à égalité. De même, il remet en question l’opposition entre le trivial (l’ordinaire, le quotidien) et le noble, l’intime et l’universel, le singulier et le commun.
Au regard de toutes les séquences qui relèvent de la vie quotidienne de Mekas, Claudine Eizykman rappelle que dans Walden, « quatre [séquences] ont un double statut : Report from Millbrook, Cassis, Hare Krishna et Notes on the Circus sont des films réalisés en 1966, qui ont été incorporés à Walden »[2222] [2222] Claudine Eizykman, « Mekas Film Mémoire », in Jonas Mekas, op.cit., p.26-27. . On peut donc s’interroger sur le statut de ces films (sont-ils des brouillons, des esquisses, des embryons de films à venir ? ) et sur les raisons de leur présence dans ce qui serait un film-journal. Une réponse s’esquisse dans ce propos : « Je ne suis pas venu à cette forme par calcul mais par désespoir. […] Je veux dire que je n’ai pas disposé de ces longues plages de temps nécessaires à la préparation d’un scénario, puis au tournage, puis au montage, etc.. Je n’ai eu que des bribes de temps qui ne m’ont permis de tourner que des bribes de film. Toute mon œuvre personnelle est devenue comme une série de notes. […] Si je peux filmer une minute, je filme une minute. Si je peux filmer dix secondes, je filme dix secondes. Je prends ce que je peux, désespérément »[2323] [2323] Jonas Mekas, « Le Film-Journal », in Jonas Mekas, op.cit., p.47. .
4) Le rejet des normes, l’inventivité
En libérant le concept de langage cinématographique de ce qu’il peut avoir de problématique, le propos de Jonas Mekas s’avère pertinent, lorsqu’il écrit dans « Le langage du cinéma change » : « Même les fautes, les plans pas au point, les plans tremblés, les travellings incertains, les mouvements hésitants, les morceaux sur- ou sous-exposés font partie du vocabulaire. Les portes du spontané s’ouvrent ; l’air vicié du professionnalisme rassis et respectable s’échappe. Ce que la vieille génération élégante croit important, l’artiste nouveau le trouve sans importance, prétentieux, lassant – et, qui plus est, immorale. Il trouve plus de vie et d’ « importance » à de petits détails insignifiants, secondaires. C’est l’insignifiant, le fugace, le spontané, ce qui passe qui révèle la vie et qui est tout ce qu’il y a d’excitant et de beau ».
Ces propos font pour nous écho aux écrits de Dubuffet, lorsque ce dernier s’attaque, dans L’art brut préféré aux arts culturels, avec autant de virulence et de poésie que Mekas, aux artistes professionnels et aux “intellectuels de carrière”. Mekas interroge ici le fait que les règles et les conventions cinématographiques demandent à être dépassées. Pour ce faire, il revendique un cinéma non-conventionnel, fait d’imperfections volontaires, de vibrations, de flous[2424] [2424] Voir Bidhan Jacobs, « Usages radicaux du flou dans le cinéma et la vidéo », in Nicole Brenez et Bidhan Jacobs (dir.), Le cinéma critique. De l’argentique au numérique, voies et formes de l’objection visuelle, Publications de la Sorbonne, 2010, p.127. , d’aléas, de choses et de moments de la vie quotidienne, et l’idée que « seul le cinéma qui est toujours en éveil, toujours en train de changer »[2525] [2525] Jonas Mekas, Ciné-journal, op.cit., 25 janvier 1962, p.60. est nécessaire – sous-entendant par là que le cinéma doit être à l’image et à l’égal de la vie elle-même.
Il convient tout de même de redire que la revendication d’une esthétique du bricolage, lequel serait fait d’imperfections, n’est pas réductible à une manière d’être contre certaines normes esthétiques. Il s’agit en fait moins de s’opposer à une culture dominante que de s’en détacher afin de trouver un style qui s’accorde avec sa propre manière d’éprouver la vie. Mekas en témoigne ainsi : « Il fallait jeter aux orties les notions académiques de « bonne » exposition, de « bon » mouvement, de « bon » ceci ou « bon » cela. Il fallait que je me lance, que je me fonde avec la réalité que je filmais, que je m’y mette directement »[2626] [2626] Jonas Mekas, « Le Film-Journal », in Jonas Mekas, op.cit., p.49. .
La quête d’un style personnel apparaît alors indissociable d’une manière de vivre. Mekas remet en question le statut de l’artiste, du cinéaste et de l’œuvre. Il est dans une logique “autre” que celle des cinéastes « officiels » travaillant en équipe. Il vit sa vie avec son corps et sa caméra dans son sac. Il ne fait pas des films, mais il filme.
Cette distinction doit être couplée à une autre, entre « création » et « invention ». Mekas, qui a été très attentif au renouvellement des formes, refuse catégoriquement le terme de « création ». « Vous voyez, je ne crois pas à la création. J’ai même toujours insisté pour dire que ce que je fais, je le fais par nécessité. Quand je filme quelque chose je ne le fais pas parce que je veux créer quelque chose. Je le fais parce que je veux capter l’essence de ce qui est devant moi. (…) Tant que la spontanéité est là, je ne suis pas sûr qu’il y ait aucune « création » si ce n’est spontanée ou improvisée…»[2727] [2727] Jérôme Sans, Morgan Boëdec, Léa Gauthier, op. cit., p.18. L’invention qui résulte de la nécessité d’une expression n’a donc rien à voir avec la création, qui elle suppose à la fois une forme de prétention, d’artificialité et une velléité toute consciente et culturelle de distinction qui passe notamment par l’originalité. Le rejet de la création par Mekas est en d’autres termes un rejet de toute pratique inscrite dans la « culture », entendue comme institution normée. La culture de Mekas nourrit son être, mais sans surdéterminer sa pratique. Il n’est pas guidé par une volonté de démarcation vis-à-vis de prédécesseurs. Ou, pour le dire autrement, sa pratique ne vise pas d’abord un positionnement au sein d’un champ culturel mais le partage d’une expérience humaine.
5) Atteindre au fondamentalement humain.
Nous avons déjà évoqué la croyance selon laquelle le cinéma pourrait redonner un contact avec le monde. Il faut préciser que ce contact ne passe pas par une opération de l’entendement, mais plutôt par sa mise en défaut : les images auraient la capacité de toucher le spectateur au plus profond. C’est cela qui va en partie déterminer les choix de « sujets », de filmage et de montage de Mekas. L’association des plans ne produit pas un sens, mais un rythme ; le film ne vise pas à une « compréhension », mais au partage d’une sensibilité. Au terme de la guerre, le cinéaste perçoit et interprète celle-ci comme l’échec de la pensée rationnelle et consciente, des idéologies et des discours. Ainsi qu’il le formule dans Lost Lost Lost, les « grands esprits de la civilisation » sont la cause de son exil. La conception de l’intelligence comme presque exclusivement verbale a amputé l’homme moderne[2828] [2828] Mekas apparait ainsi bien comme le contemporain d’une critique de la rationalité ou du logocentrisme menée dans divers domaines. Derrida et Blanchot sont, en philosophie, des grands noms de ce courant critique. . Ecrit après une conférence sur le bouddhisme à partir des propos entendus, ce passage de son journal exprime clairement sa nouvelle position : « L’occident (…) est trop calqué sur le Denkakt, l’acte de penser, la raison. Il a parlé du Ich, le je, le moi, dont un enfant ne commence à prendre conscience que vers quatre ans – la seconde naissance. Il a également déclaré que les seuls moments où nous ressentons profondément la joie, la tristesse, la beauté, sont ceux où nous n’y pensons pas. La pensée ne peut (rien) éprouver) »[2929] [2929] Jonas Mekas, Je n’avais nulle part où aller, op. cit., p. 143. . Dans leVillage Voice, il opposera encore l’ « intelligence verbale » à la « sensation immédiate », et caractérisera le cinéma comme « art anti-verbal, anti-idées », « arrivé juste à point pour préserver notre sensation irrationnelle, non conceptuelle, immédiate »[3030] [3030] Jonas Mekas, « Sur la sensation immédiate », Ciné-journal, op. cit., p. 84. Voir dans le même esprit « Sur Godard et le rationalisme », p. 100. .
Ici se retrouve le paradoxe voulant que ce soit à une invention moderne, liée à l’émergence de l’industrie et de la technique, que revient la fonction de produire un retour vers quelque chose de fondamental, voire d’archaïque. Le parti-pris de la sensation contre l’intelligence pourrait lui-même passer pour régressif. Néanmoins, si le cinéma a pour rôle de faire advenir une sensibilité immédiate, celle-ci s’intègre totalement dans un mouvement historique qui est celui du XXème siècle et vient l’accomplir. « Dans un film de la fin du XXème siècle (…), nous sommes à l’affût de quelque chose de complètement différent, qui ne peut pas se dire en mots et ne peut être révélé que par certains rythmes lumineux – des intensités ou des événements de lumière -, quelque chose qui se déroule à un niveau mental communiquant directement avec nos ondes psychiques (nos nerfs) »[3131] [3131] « Sur Ernie Gehr et le cinéma “sans intrigue“ », Ibid., p. 282. .
La pensée de Mekas vise plutôt à dépasser les oppositions conventionnelles.L’intelligence devrait comprendre aussi la sensation, et l’art, en procurant une « sensation immédiate », permettre aussi une « connaissance immédiate ». Répondant aux attaques contre l’art underground émergeant qui l’accusent d’être opposé aux valeurs et à la culture, Mekas explique qu’au contraire celui-ci « restaure la culture ». Sa manière d’argumenter consiste à reprendre des oppositions pour en faire des synthèses : ainsi écrit-il que ce nouvel art ne marque pas la victoire de l’imagination sur la raison, mais révèle que l’imagination est aussi raison, que l’expérience est aussi savoir, et qu’il ne s’agit pas de bouleverser la perception mais de l’élargir[3232] [3232] « Sur la continuité culturelle », Ibid., p.353. On peut y lire : « La vieille culture banale persiste à considérer la nouvelle en termes d’oppositions, de négations, alors qu’il s’agit en vérité d’un processus d’approfondissement, d’affinement, d’expansion, d’élargissement, d’addition. » .
Mekas n’est ni le seul ni le premier à exprimer et souhaiter de telles réunions. Jean Epstein conçoit le cinéma comme à la fois le produit d’une époque scientifique où le savoir technique est plus fort que jamais (« le temps du ventilateur »), et comme le moyen de réunir deux connaissances, une connaissance de raison et une connaissance d’amour, qui ont de tous temps été présentes et en lutte à l’intérieur de l’être humain. Epstein introduit ainsi la notion de « lyrosophie », qui traduit l’idée d’une « connaissance par le sentiment ». Le cinéma ouvre une nouvelle voie à la connaissance, esthétique et affective. En posant cela, Epstein semble balayer tout un appareillage scientifique et logique introduisant de la distance ou de l’abstraction dans le rapport des êtres au monde et se basant sur des procédures de vérification et de validation rigoureuses[3333] [3333] Jean Epstein, « La lyrosophie », Ecrits sur le cinéma, I : 1921-1947, Paris, Seghers, 1974, p. 15-23. . Un passage du « Cinéma du Diable » explicite cependant la dialectique paradoxale entre le retour à une donnée primitive de l’humain et une avancée continue dans l’histoire : « Le retour au concret, mais à un second concret, développe et réhabilite un mode de penser très ancien (…). Cet ordre analogique et métaphorique traverse l’ordre plus étroitement rationnel et s’ajoute à lui, mais sans toujours le détruire, comme, sur un échiquier, la marche bondissante et brisée du cavalier traverse le mouvement rectiligne des autres pièces et s’y ajoute pour dessiner les figures d’une stratégie complète »[3434] [3434] Jean Epstein, « Le cinéma du diable », Ibid., p. 408. .
En tant que critique, Mekas s’est toujours montré attentif aux expérimentations, qu’elles portent atteinte à l’image figurative (jeux sur la lumière, travail sur la pellicule) ou modifient le dispositif cinématographique traditionnel (écrans multiples, mélanges d’images et d’actions réelles, lumière, fumées et vapeurs sans écran…). A chaque fois, c’est la possible mutation de la perception chez le spectateur qui l’intéresse. Selon lui, l’exposition répétée à un type de spectacle peut changer l’homme (« les poètes peuvent faire muter les atomes » est sans doute sa formule la plus directe[3535] [3535] Jonas Mekas, « Sur la forme, la structure et la proportion (suite) », Ciné-journal, op. cit., p. 309. ). Tout en accompagnant avec enthousiasme ces recherches artistiques, et en rêvant à travers elles une évolution individuelle, il leur fixe un seul point d’arrivée, un modèle indépassable : l’esprit humain, le cinéma de notre esprit. « Car qu’est-ce qu’en réalité que le cinéma, sinon des images, des rêves et des visions ? Un pas de plus et nous abandonnons les films, nous devenons des films (…) Nous sommes les vrais cinéastes, chacun de nous, traversant l’espace et le temps et la mémoire – c’est le cinéma fondamental, celui de tous, comme il l’a été pendant des milliers et des milliers d’années. Tout cela est réel ! Il n’y a pas de limites aux rêves, fantasmes, désirs, visions de l’homme. Cela n’a rien à voir avec les innovations techniques : cela a à voir avec l’infinitude de l’esprit humain, qu’on ne peut jamais confiner à des écrans, des photogrammes ou des images imposés. Il bondit hors des limites de tout rêve qu’on lui impose et cherche ses propres mystères et ses propres rêves »[3636] [3636] Ibid., p. 141. Epstein qualifie pour sa part, dans « Esprit de cinéma » (Ecrits sur le cinéma II, 1921-1953, Paris, Seghers, 1974, p. 93), le film d’expression artistique la plus semblable au « songe originel », assimilant le film découpé à une « rêverie dirigée ». .
Dans Le cinéma ou l’homme imaginaire, Edgar Morin évoquera pour sa part « ce petit cinéma que nous avons dans la tête ». Construit à la ressemblance de notre « psychisme total », le film associe l’objectif et le subjectif, la raison et l’affect[3737] [3737] Edgar Morin, Le cinéma ou l’Homme imaginaire. Essai d’anthropologie sociologique (1956), « Métamorphose du cinématographe en cinéma », Editions de Minuit, 1977, p. 185-187, p. 207. . Morin pose de son point de vue anthropologique que l’humain est nécessairement un phénomène total au sein duquel la magie, le sentiment et la raison sont fondamentalement liés, contradictoirement unis (leurs dosages et leurs jeux, leurs relations pouvant ensuite varier en chaque individu, selon les cultures et époques). Le cinéma, esprit naissant, total, rapproché de l’esprit humain, est donc conçu comme le lieu d’une réunion. Si le film peut tout à fait s’organiser sur le modèle du langage conceptuel, réduisant ses images à des symboles abstraits véhiculant un discours, Morin met l’accent sur la synthèse qui s’y joue par principe, et sur la proximité entre le cinéma et ce qu’il appelle le langage « archaïque » qui s’exprime par images, métaphores et analogies, et non par concepts définis et figés, et qui est déterminé par des schèmes rythmiques tendant à le rapprocher du chant, de la musique. Musique qui est d’ailleurs donnée chez Morin comme l’élément où peut s’opérer un lien entre cinéma et langage archaïque : « Tout ce qui rend le cinéma plus proche du langage archaïque que du langage ordinaire est dans le fond ce qui rend le langage archaïque plus proche de la musique : rythme, leit-motivs, réitérations. Et de plus : fluidité, intensité, simultanéité »[3838] [3838] Ibid., p. 191. .
L’opposition entre parole et chant apparait dans le journal de Mekas[3939] [3939] Jonas Mekas, Je n’avais nulle part où aller, Op. cit., p. 114 : « Non, je n’ai pas soif de tout connaître. Mais je connais mille chansons que j’ai apprises dans mon village. Leurs paroles et leurs mélodies sont enracinées au plus profond de moi. Professeurs : levez-vous et secouez votre corps. Secouez-le un bon coup. Puis faîtes silence et écoutez. Entendez-vous la moindre chanson remonter de vos entrailles ». et son goût pour le chant s’exprime plus d’une fois dans son cinéma ; son montage fait sans cesse primer le rythme, la création d’intensité, le partage d’une sensibilité subjective, sur la reproduction objective d’une réalité ou sur la transmission d’un sens par l’organisation des plans. La dimension musicale des œuvres de Mekas peut ainsi nous indiquer que, si rien n’est exclu par essence de l’homme ou du cinéma, néanmoins la sensibilité de Mekas le conduit à inventer des structures qui renvoient particulièrement à une logique pré-conceptuelle et qui demandent de fait une appropriation particulière pour le spectateur, confronté à une expérience face à laquelle mobiliser des codes culturels ne peut s’avérer totalement pertinent. Au-delà de tout rapport du cinéma au réel, au hasard, ou au sentiment, c’est un tel usage singulier qui permet de fonder le rapport entre Mekas et art brut.
Conclusion
Dans la « Présentation à l’édition française » de L’art comme expérience de Dewey, Shusterman écrit : « L’art n’est pas à lui-même sa propre fin, ce que nous recherchons en lui, c’est une possibilité de vie meilleure »[4040] [4040] Richard Shusterman, « Présentation à l’édition française », Ibid, p.14. . Cela n’est pas sans écho avec un moment d’A Letter from Greenpoint. Après avoir trinqué « à demain » avec deux amis, Mekas se saisit de sa caméra, posée sur le comptoir du bar, et la tourne vers lui le temps d’adresser, les yeux dans l’objectif, un message. Le passé, dit-il, est sanglant, et il n’y a rien à en apprendre. Ce triste constat posé, il ajoute que cela va changer, que « nous allons le changer », alors que la caméra se tourne à nouveau vers les deux amis, comme s’il y avait déjà là, dans ce présent du geste, dans l’élévation d’une caméra et de verres, un premier changement, ou l’apparition d’une communauté pouvant soutenir une telle croyance en demain. Comme chez Dewey, l’art apparaît comme une possibilité d’enrichir notre expérience et un moyen de nous guider dans notre vie quotidienne. Ces deux possibilités soulignent l’indissociabilité de l’art et de la vie, unis dans une aspiration à un bien-vivre, un être meilleur pour soi et pour autrui.
Stanley Cavell, dans A la recherche du bonheur, envisage le cinéma comme un outil de thérapie par l’expérience : celui-ci rendrait en effet visible toutes ces choses de l’ordre de la fragilité, de l’imperfection, du manque, du besoin, du désir. C’est dans une telle dynamique que Mekas et les artistes d’art brut redéfinissent l’art et ses critères institués. Pour Mekas, « il y a un désir de changer l’homme plus profondément, plus essentiellement (et plus existentiellement) : de changer le cœur de l’homme »[4141] [4141] Jonas Mekas, Ciné-journal, op.cit., 25 juillet 1963, p.92. , qui passe par l’art. Il partage alors, avec les artistes exposés au musée du LAM l’idée qu’il ne s’agit pas nécessairement de “faire de l’Art” avec un grand A, mais qu’il s’agit plutôt de créer et de vivre en créant.
Dans son premier ouvrage sur le cinéma, Cavell prend comme point de départ une réflexion sur Tolstoï et un déplacement de la question posée à l’art : celle-ci n’étant plus « qu’est-ce-que l’art ? » mais « quelle est l’importance de l’art ? »[4242] [4242] Stanley Cavell, La projection du monde, réflexions sur l’ontologie du cinéma, Trad. Christian Fournier, Belin, (première édition anglaise en 1971), 2004, p.27-28. – entendant par là non pas son utilité, mais sa nécessité et sa valeur. Derrière la question cavellienne de « l’importance de l’importance » se trame un fond moral ou éthique, comme l’indiquent significativement les titres de ses ouvrages sur le cinéma : Le cinéma nous rend-il meilleurs ? ou encore A la recherche du bonheur.
Cette question, qu’il pose depuis sa place de spectateur philosophe, pourrait tout aussi bien se poser du point de vue du créateur. L’expérience créatrice – poïétique – nous rend-elle meilleurs ? L’art paraît offrir de nouvelles possibilités pour la vie, non seulement parce qu’il permet de s’épanouir dans la création mais aussi parce qu’il créé et rend perceptible de nouvelles manières de vivre, des manières « autres ». Les expressions “l’autre de l’art”, “le cinéma autre”, pourraient faire écho à Henry Maldiney lorsqu’il écrit: « Notre contact avec l’œuvre est une rencontre. Toute rencontre est rencontre d’un autre, d’une altérité »[4343] [4343] Henry Maldiney, L’art, l’éclair de l’être, Éditions Comp’Act, Collection La Polygraphe, 2002, p.10. . C’est en ce sens que le cinéma de Jonas Mekas nous a permis de repenser avec le cinéma le paradigme d’un “autre de l’art”.