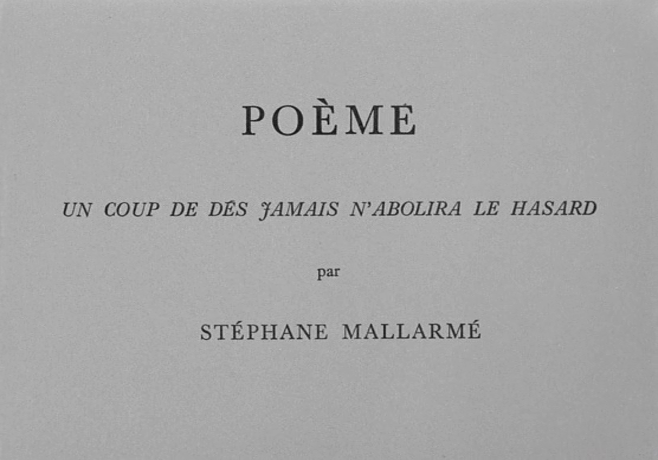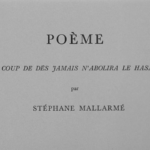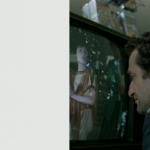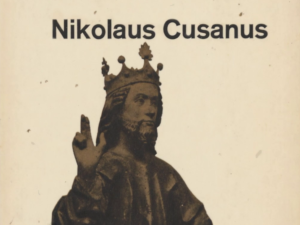Sans regrets
À propos de quelques films de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet
La disparition de Jean-Marie Straub, comme l’ont fait remarquer la plupart des hommages qui lui furent consacré, a eu lieu quelques semaines après celle de Jean-Luc Godard. Une disparition conjointe qui en rappelle d’autres, notamment celle d’Antonioni et de Bergman, tous deux disparus le 30 juillet 2007, et qui emportaient avec eux une certaine idée de la « modernité cinématographique ». Straub et Godard, leurs cadets, en emportent une autre. Deux cinéastes qui étaient factuellement proches, des amis sans doute, des camarades de lutte si on veut, des voisins aussi (factuellement, puisque Straub avait rejoint Godard à Rolle il y a quelques années). Deux cinéastes réunis par Pascal Bonitzer qui avait eu l’intuition géniale, en 1976, de rapprocher leurs initiales, J.-M. S. et J.-L. G, afin d’en faire l’emblème d’un cinéma révolutionnaire (oubliant sans l’oublier, comme on le fait trop souvent, la place centrale de D.H., disparue en 2006). L’un dédiait ses films au second (le dernier film de Straub, le très austère La France contre les robots, est « pour Jean-Luc »), l’autre citait les films du premier avec amusement (les personnages d’Hélas pour moi cherchant le lézard qui passe dans un plan d’Antigone). Les hommages à Straub, cependant, furent moins audibles, plus rares. D’abord parce que Straub n’était pas, comme Godard, une figure incarnant le cinéma tout entier, une figure beaucoup plus célèbre que son œuvre – il n’avait rien d’une célébrité. Son retrait, aussi, était plus franc : ses derniers films, des court-métrages assez peu diffusés, n’avaient pas l’écho des œuvres finales de Godard, projetées au Festival de Cannes, commentées par toute la presse cinéma. C’est aussi que leur rapport à la part la plus chic du cinéma était fondamentalement différent, Godard ayant toujours accepté de s’y confronter en multipliant les apparitions télé, le travail avec les stars de cinéma et les gros chèques, là où l’intransigeance de Straub lui interdisait la plupart de ces compromis (je n’ai jamais compris comment il s’était retrouvé dans l’épisode du Cercle de Minuit , en 1987, où il s’engueulait avec Philippe Quéau). Si sa figure, sa voix et sa manière d’être étaient connues de quelques cercles cinéphiles (comme Godard, il s’était inventé un personnage public où le cigare tenait une place de choix), il ne fut pas un guide, un pape, un Dieu – ou alors, seulement par ses films.
L’œuvre de Straub et Huillet, plus confidentielle que celle de Godard, est paradoxalement mieux comprise. On se trompe moins sur son oeuvre : Straub disait ainsi que ses films laissaient les spectateurs libres, « y compris libres de quitter la salle ». Alors, souvent, les salles étaient vides. On ne peut pas se tromper face à un plan de ces films, ils expriment avec évidence leur refus de tout spectaculaire. Si l’on y est pas sensible, alors on repousse, on déteste, mais toujours on comprend, presque malgré soi. Ce sont des films qui forcent la compréhension – et qui, aussi, forcent le respect.
S’il est difficile d’écrire un hommage à Straub, c’est aussi parce que son œuvre est sans regrets. Straub et Huillet sont peut-être les seuls cinéastes au monde dont on peut dire que l’œuvre (immense, étendue dans le temps et dans l’espace – une quarantaine de titres tournés sur plus de cinquante ans dans plusieurs langues, plusieurs pays) est exempte du moindre compromis, du moindre geste esthétique fait contre leur conscience morale. Alors que l’on considère souvent que le cinéma est un art de l’impureté, où les puissances de l’argent et les petits sentiments personnels font aussi la matière du film, Straub et Huillet ont prouvé qu’il était possible d’œuvrer librement, et avec succès. Dans le film magnifique de Pedro Costa revenant sur le montage de Sicilia!, Où gît votre sourire enfoui ?, on découvre une intransigeance admirable dans le travail de montage, où les cinéastes prouvent par l’exemple qu’un vrai plan de cinéma, où les choses existent « vraiment » (« monumentalement », disent-ils dans un documentaire de Manfred Blank, Wie will ich lustig lachen), ne peut être coupé qu’à un seul endroit – un photogramme de plus ou de moins et la coupe n’est plus la bonne. Et l’on comprend alors qu’il n’y a pas un plan de leurs films, pas un seul, qui n’est pas coupé avec la même précision au vingt-quatrième de seconde, et que cette précision de la coupe est peut-être le socle sur lequel repose leur cinéma. Or on pourrait dire la même chose de la manière de diriger les interprètes des textes mis en scène (dont plusieurs documentaires témoignent aussi), le cadrage (Straub et Huillet avaient une théorie précise concernant la position que doit occuper la caméra dans l’espace), la fabrication de costumes, l’enregistrement sonore… Tous les éléments formels de leur films sont uniques et ne sauraient être différent – leur refus du compromis n’était pas un snobisme ou une austérité janséniste, mais une nécessité politique et esthétique. Ou bien, le seul compromis de leur cinéma, c’est celui que Straub et Huillet ont dû trouver entre eux, sur un détail – mais précisément le détail sur lequel d’autres cinéastes n’auraient tout simplement pas le temps ou les moyens de s’attarder, c’est à dire en fait le plus essentiel ; le geste discret d’un acteur, le bourdonnement d’un insecte. Straub et Huillet ont fait des films selon leur volonté, et c’était une volonté profondément unique (peut-être seulement partagée avec les cinéastes qu’ils ont côtoyé : Pedro Costa, Valérie Massadian, Jean-Charles Fitoussi…).
Capricci ressort en salles, ce mercredi, dix films de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, réalisés entre 1962 et 2003. Cette rétrospective, organisée avant la mort de Straub, est un portrait intéressant de leur filmographie en ce qu’il en épouse la multiplicité : films courts ou longs, en allemand, en italien ou en français (Straub et Huillet se définissaient comme « les seuls cinéastes européens »), basés sur des œuvres musicales, littéraires ou picturales. Mais cette multiplicité est aussi dans les moyens, les dispositifs des films : si leur cinéma part d’une intransigeance formelle bressonnienne (ils font leurs premiers pas dans le cinéma en suggérant à Robert Bresson le sujet de Chronique d’Anna Magdalena Bach) mêlée à l’influence de Brecht, chacun de leurs films rebat les cartes et propose une nouvelle méthode. Ainsi la mise en scène de la musique de Schoenberg, à deux ans d’écart, dans Introduction à la « Musique d’accompagnement pour une scène de film » et Moïse et Aaron, change radicalement d’un film à l’autre ; le premier est une analyse brève et dialectique confrontant texte, musique et image comme des éléments entrant en contradiction, le second une mise en scène frontale et continue d’un opéra enregistré en son direct. C’est que Straub et Huillet, tout en s’attachant à quelques principes reconduits de films en films (le son direct, la théâtralité brechtienne du jeu…), considèrent avant tout la singularité de chaque texte adapté – le terme même « d’adaptation » semble d’ailleurs incommode ou insuffisant à définir l’opération particulière qu’ils appliquent sur chaque texte, qu’ils vont fouiller, analyser, déplier afin d’en tirer un film.
Le texte n’est pas considéré, comme chez Godard ou Duras par exemple, comme un matériau brut que la mise en scène viendrait découvrir ou mettre à l’épreuve, mais est d’abord travaillé comme un matériau déjà transformé, ou, comme on dit de certaines manières premières, « raffinée ». Toute révolution est un coup de dés, basé sur le Coup de dés de Mallarmé mais dont le titre est emprunté à Jules Michelet, attribue par exemple à chacun des neuf « récitants » un type de caractère du texte. Ce faisant, il propose quelque chose qui semble impossible, compte tenu de la complexité typographique du poème : une lecture. Ce film, le plus bref de la rétrospective (une dizaine de minutes), témoigne en effet d’un travail colossal de préparation, de lecture et de découpage : il a fallu découper ce poème, attribuer à chaque type de caractère un récitant correspondant, tirer de ce texte célèbre et si souvent commenté de l’arbitraire afin d’inventer des formes esthétiques qui lui correspondent. Par exemple, les caractères « majuscules » sont lus par des hommes, et les caractères « minuscules » par des femmes – choix étrange, qui pose question, mais qui permet de rendre « audible » la différence entre les caractères autrement que par un excès ou un défaut d’interprétation (cela laisse ainsi aux comédiens la possibilité de parler fort ou bas, lentement ou rapidement). Par des moyens spécifiquement cinématographiques, un découpage et une interprétation extrêmement précises, Straub et Huillet parviennent donc à faire entendre ce poème à peu près impossible à lire à haute voix ; et, ce faisant, ils font ressortir de manière inédite sa sonorité particulière et sa force poétique qui, chez Mallarmé, poète réputé difficile, ne va pas de soi.
Les films adaptent donc moins une œuvre littéraire ou musicale préexistante qu’ils n’en proposent ce qui est déjà une interprétation, un compte-rendu vivant où l’on peut entendre en même temps le texte et ce que Straub et Huillet y ont vu, entendu, compris. Soit à peu près une transcription cinématographique du Verfremdungseffekt de Brecht, qui écrivait dans le Petit organon pour le théâtre que le comédien doit à la fois faire passer le récit (la « fable ») et le contexte politique, social, historique de ce récit. Et si, devant un film de Straub et Huillet, on peine souvent à comprendre l’un et l’autre (d’où, aussi, l’intérêt de revoir leurs films plusieurs fois), c’est sans doute parce que les comédiens, souvent non-professionnels, y sont des palimpsestes humains traversés par leur propre existence, par le texte même, par leur interprétation du texte et par l’interprétation qu’en font les cinéastes ; le cinéma de Straub et Huillet est peut-être simple et austère, il n’en est pas moins saturé.
Saturé, aussi, par le rapport très complexe qu’il entretient avec la réalité qu’ils captent. Les films de Straub et Huillet, faut-il le rappeler, ne fondent des dispositifs fermes et rigides que pour y accueillir avec plus d’intensité des éléments extérieurs – c’est le bruit de la ville qui s’efface peu à peu dans Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer, le mouvement des vagues dans la marche au bord de l’eau dans Amerika – Rapports de classe, les variations de lumière naturelle changeant la perception des tableaux dans Une visite au Louvre – on sait l’importance qu’avait pour eux la phrase de Griffith où il reprochait au cinéma de ne pas assez montrer le vent passant dans les feuilles des arbres. Mais, plus évident encore, c’est l’humour discret de leur cinéma qu’il faudrait souligner, car la tension créé par l’irréalité de l’interprétation des acteurs et la matérialité de leur présence créé un trouble qu’il faut apprendre à prendre avec un certain second degré. Le réalisme des films de Straub et Huillet est aussi, geste brechtien s’il en est, la réalité de leurs tournages – or les récits du tournage de Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer le décrivent par exemple comme un moment d’amusement et de légèreté, et de nombreux documentaires témoignent aussi du climat d’incompréhension amusante et de bonhomie qui régnait sur leurs tournages (il faudrait d’ailleurs s’interroger sur l’image austère et studieuse transmise par Où gît votre sourire enfoui ?, qui est forcément en partie mise en scène – le court-métrage Six bagatelles, basé sur des chutes du documentaire de Pedro Costa, le prouve). Il ne faudrait pas se laisser terrasser par le respect que forcent ces films, et il faut, comme Straub et Huillet eux-mêmes savaient le faire, apprendre à les considérer avec un certain détachement – un détachement qui, cependant, n’est pas une indifférence, bien au contraire. Pour détourner une phrase que Straub aimait citer et qu’il attribuait à Rosa Luxemburg, leurs films ont peut-être autant d’importance que le sort du moindre insecte, c’est à dire autant d’importance que le sort de la révolution.
Ce détachement est aussi ce qui permet de donner un accès privilégié aux œuvres à travers des formes austères et singulières – les films ne sont pas grand-chose de plus que cette lecture, ce texte enfin entendu, et Straub disait lui-même qu’à l’exception de Moïse et Aaron, aucun de leurs films n’avait de « message ». C’est un des paradoxes de l’œuvre de Straub et Huillet, qui ont souvent revendiqué d’être mieux compris par certains publics « populaires » qu’intellectuels. Leurs œuvres ont en effet le mérite de prendre ces textes préexistants, souvent parmi les plus problématiques ou les moins célèbres de leurs auteurs (chez Corneille, ils choisissent la pièce la moins jouée et la moins éditée, Othon ; chez Marguerite Duras, un texte à peine signé, Ah ! Ernesto), et de leur donner l’honneur d’être lu, et brillamment lu. C’est ce que dit, par exemple, le générique de Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer, où on lit que le film est dédié « au très grand nombre de ceux nés dans la langue française, qui n’ont jamais eu le privilège de faire connaissance avec l’œuvre de Corneille. »
Les films font entendre, font comprendre des œuvres – et j’irai jusqu’à dire qu’ils les font aimer. Ce n’est pas qu’ils forceraient quoi que ce soit sur leur public (public laissé, rappelons le, plus libre que jamais), mais qu’ils naissent de l’idée que le texte devrait se suffire à lui-même, et qu’une confrontation authentique à celui-ci, dépoussiéré de tout artifice de mise en scène et de tout effet rhétorique, permettrait de se défaire des malentendus à son sujet. Voilà, en tout cas, la croyance sur laquelle se fonde leur cinéma : que le cinéma garde encore une qualité « populaire », et qu’il peut encore arriver jusqu’à un spectateur ou une spectatrice éloignée de cette grande culture que la bourgeoisie garde pour elle et grâce à laquelle elle se distingue, alors même que la conviction de Straub et Huillet est que cet art devrait être pour toutes et tous (il faut les entendre parler de Bach comme d’un travailleur de l’art, qui œuvrait jour et nuit pour faire entendre son œuvre). Leurs films se fondent sur l’espoir qu’un seul individu, par hasard, aille voir un de leurs films dans un cinéma, et soit soudainement frappé par la beauté de l’œuvre de Corneille, de Bach, ou qu’il puisse découvrir les grands tableaux du Louvre qu’il n’irait pas voir par ailleurs. Croyance naïve, mais qui trouve son sens si cela arrive rien qu’une fois ; et bien sûr, cela, nécessairement, a dû arriver. C’est ce qui donnait à Straub et Huillet l’énergie pour continuer leur travail.
Leurs films sur la musique sont à ce sujet les plus frappants : en donnant avant tout à entendre la musique, et ce dans des films qui n’ont pas d’ambition pédagogique, ils permettent, plus encore qu’au concert ou à l’opéra (événements de distinction sociale par excellence) d’entendre la musique pour ce qu’elle est, détachée de son apparat social embarrassant – tout en donnant à voir un autre apparat social (les costumes d’époque), mais déréalisé, abstractisé (Brecht est toujours là). Comme Glenn Gould estimant que la musique en concert était dépassée et se consacrant uniquement à l’enregistrement avait réussi à faire de ses Variations Goldberg un incroyable succès commercial et de les faire entendre au monde entier, Straub et Huillet parviennent, dans Moïse et Aaron, à faire entendre la beauté immédiate de la musique de Schoenberg, comme si le dispositif si simple et si singulier du film (un tournage en son direct et en extérieur), en sortant la musique du lieu pour lequel elle était écrite, la libérait. J’irai jusqu’à dire que par leur précision et leur intransigeance, Straub et Huillet ont, à chacun de leurs films, donné une forme idéale et indépassable pour l’œuvre qu’ils adaptaient ; je peine à imaginer une meilleure manière de découvrir, dans sa langue d’origine, les premières pages d’Amerika de Kafka, auteur auquel je n’ai jamais prêté beaucoup d’attention mais que, devant Amerika – Rapports de classe, tout à coup, je comprends et j’admire. Et j’irai même jusqu’à dire que, dans notre société capitaliste encroutée et médiocrisée, celle que Straub détestait mais où il parvenait, à force de travail, à distinguer quelques œuvres d’art qui échappaient, ne serait-ce qu’un peu, à son contrôle malfaisant, et à en tirer des films – dans cette société donc, on voit mieux les chefs d’œuvres des grands maîtres en regardant Une visite au Louvre de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet qu’en se rendant dans les couloirs du Palais, où ils sont invisibles.
RÉTROSPECTIVE À TRAVERS LES ARTS
Machorka-Muff (1962, 18′) / Non réconciliés (1965, 52′)
Toute révolution est un coup de dés (1977, 10′) / Chronique d’Anna Magdalena Bach (1967, 93′)
Le Fiancé, la Comédienne et le Maquereau (1968, 23′) / Othon (1969, 88′)
Moïse et Aaron (1974, 105′)
Amerika – Rapports de classe (1984, 130′)
Introduction à la « Musique d’accompagnement pour une scène de film » d’Arnold Schoenberg (1972, 15′) / Une visite au Louvre (2003, 48′)
Sortie en salle à partir du 18 janvier 2023
Illustrations : Jean-Marie Straub dans Où gît votre sourire enfoui ? (Pedro Costa, 2001) / La France contre les robots (Jean-Marie Straub, 2020) / Hélas pour moi (Jean-Luc Godard, 1993) / Amerika – Rapports de classe (Jean-Marie Straub & Danièle Huillet, 1984) / Toute révolution est un coup de dés (Jean-Marie Straub & Danièle Huillet, 1977) / Jean-Claude Biette et Jean-Marie Straub dans Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer (Jean-Marie Straub & Danièle Huillet, 1970) / Une visite au Louvre (Jean-Marie Straub & Danièle Huillet, 2003)