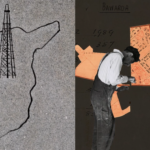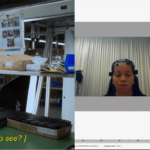Sheffield Documentary Festival 2021
Des yeux sans visage
Dernier rendez-vous cinématographique contraint de se dérouler ailleurs que dans un fauteuil de cinéma ‒ du moins faut-il l’espérer ‒, le festival du documentaire de Sheffield s’est tenu durant les premières semaines du mois de juin. Doté de deux sélections compétitives, britannique et internationale, le Sheff Doc Fest a surtout déployé son envergure grâce aux abondantes sélections parallèles : la plus ouvertement politique Rebellions où figurait en avant-première britannique le film de David Dufresne Un pays qui se tient sage, le terrain d’expérimentation intermédiatique Rhyme and Rythms ou encore la très suggestive et exploratrice Ghosts and Apparitions. Par-là le Sheff Doc Fest signalait une tendance importante des festivals de ces dernières années, et peut-être amenée à perdurer du fait de l’interruption abrupte des projets cinématographiques durant ces derniers mois : qu’en matière de documentaire, la cohabitation du neuf et du moins neuf fait toujours bon ménage.
Décoloniser les esprits
Montré en même temps à Sheffield et à Berlin lors de la seconde partie de la Berlinale 2021, Juste un mouvement de Vincent Meessen s’ouvre sur les lieux de la rétrospective consacrée à Jean-Luc Godard au théâtre des Amandiers à l’automne 2019. Au milieu des télévisions diffusant l’œuvre vidéo du cinéaste et plusieurs de ses interviews, un jeune étudiant noir déambule sur la scène et les coulisses du lieu converti pour l’occasion en espace muséal, à deux pas de ce qui fut l’un des points chauds de la contestation étudiante pré-soixante-huit, l’Université de Nanterre. À côté de figures plus médiatiques, comme Dany le Rouge, d’autres groupes de la gauche maoïste ont plus nettement lié leur combat révolutionnaire à la libération des pays colonisés par l’État français, comme l’Union des Jeunes Communistes marxistes-léninistes où milite l’étudiant en philosophie d’origine sénégalaise Omar Blondin Diop. C’est par l’entremise d’Anne Wiazemsky, qui le présente à Godard en 1967, que celui-ci est intégré au projet de ce qui deviendra La Chinoise[11][11] Le film de Meessen, à côté de d’un autre film du programme Rebellions, The Inheritance d’Ephraim Asili (déjà lauréat du Grand Prix du Cinéma du Réel 2021), signe le retour du film de Godard dans l’imaginaire autonomiste contemporain, et en particulier pour les groupes militants antiracistes et décoloniaux.. Son petit rôle de professeur de philosophie, chargé par Godard d’enseigner en tant qu’homme noir la condition des pays colonisés à la gauche blanche, sert alors de catalyseur à une série de rapprochements virtuoses. Dans un fulgurant remake qui cherche à mettre en rapport la situation de 1967, et sa construction par Godard, avec celle du Sénégal au XXIème siècle, Meessen met en œuvre un montage que n’auraient pas désavoués les « situs » abondamment cités par les protagonistes du film. Il profite en effet du jeu fortuit des relations existant entre le film de Godard, dont la protagoniste devient une allégorie de la gauche maoïste, et l’opération industrialo-culturelle entamée sur le continent africain par la République Populaire de Chine, cherchant – à grands renforts de partenariats universitaires, de centres Confucius et de projets architecturaux – à assurer sa mainmise sur les ressources minières du sol sénégalais.
Le film s’étoile à partir de la figure d’Omar Diop et enquête sur la postérité de sa pensée et de ses combats anti-impérialistes, intimement mêlés à sa vie et aux circonstances encore non résolues de son décès (il disparaît en 1973 alors qu’il projetait l’enlèvement de l’ambassadeur de France au Sénégal pour libérer ses camarades emprisonnés dans les geôles du Président Senghor). Surtout, la mise en avant de ce personnage permet de mettre en lumière la contestation par les groupes de gauche de la politique du poète-normalien Léopold Sédar-Senghor, vu comme un « relai de l’impérialisme français » accueillant avec les honneurs son ancien camarade Georges Pompidou, alors que le discours français de la décolonisation heureuse le décrit encore comme un libérateur du peuple sénégalais. Meessen cherche alors, à la suite de son installation One.Two.Three (2015), de son dernier film Ultramarine (2018) ou de son exposition Blues Klair (2021) à défaire l’eurocentrisme des mouvements contestataires de gauche des années 1960 et 1970. Souvent relayés à la périphérie des mouvements situationnistes ou internationalistes français ou américains, les penseurs et penseuses noires se révèlent en effet centrales dans la construction de la pensée révolutionnaire de la deuxième partie du vingtième siècle. Le film s’achève sur un débat, qui rejoue l’épilogue de La Chinoise à bord d’un train, entre le philosophe Felwine Sarr et le rappeur Foumalade (de son vrai nom Malal Almamy Talla) à propos de la restitution des œuvres africaines : retrouvant le giron sénégalais, celles-ci sont censées garnir les vitrines d’un grand musée offert par l’État chinois. À son interlocuteur inquiet d’une simple reconduction de la dépendance impérialiste, le philosophe commandité par Emmanuel Macron, représentant d’une nouvelle génération, répond par le pragmatisme : le peuple sénégalais peut-il se développer sans la confirmation d’être jamais « entré dans l’Histoire » et au patrimoine artistique de l’humanité ?
D’autres fantômes décoloniaux hantaient le festival de Sheffield dont l’un des programmes, l’excellent Ghosts and Apparitions élaboré par Rabz Lansiquot, s’intéressait particulièrement aux enquêtes spectrales menées sur des territoires marqués par l’impérialisme occidental. C’est le cas de One Image, Two Acts (2020) dans lequel Sanaz Sohrabi prend pour point de départ la tombe d’un exploitant pétrolier inhumé dans l’Illinois aux États-Unis. Sur le marbre de la stèle, une carte stylisée de la Syrie avec, dans l’angle supérieur droit, un unique derrick. À partir de cette étrange inscription, se déploie un film d’archives photographiques mais aussi graphiques, faites de tableaux et de diagrammes représentant la production de British Petroleum dans la région. Utilisés par la cinéaste comme matériaux dans la composition de collages faits de paysages ravagés par l’exploitation pétrolière et de travailleurs autochtones à la tâche, ces schémas remployés rendent manifestes, à travers la formation à l’écran d’une troisième image, les logiques entremêlées de l’extractivisme informationnel (région cartographiée, parcellisée, rentabilisée) et de l’extractivisme colonial du pétrole. The White Death of the Black Wizard (2020) de Rodrigo Ribeiro procède d’un semblable traitement de l’archive photographique : une enquête sur le banzo, maladie proche de la mélancolie diagnostiquée chez les esclaves du Brésil né·e·s en Afrique, racontée par le commentaire subjectif prononcé par le fantôme d’une des victimes de cette affection. Dans le film de Ribeiro, les archives se dévoilent par seuils de visibilité, à l’intérieur de l’image elle-même, tandis que les taches et stries qui affectent les copies filmiques s’immobilisent le temps de révéler les gestes d’un·e esclave au travail. Et dans le dernier plan, le cadre s’élargit progressivement sur des photographies qui ne révèlent leur sujet qu’au rythme de la parole spectrale qui les accompagne. La question du positionnement du cadre et du découpage dans le paysage qu’il s’agit de filmer se pose constamment lorsque l’espace fait l’objet d’une inscription de la colonisation ou de la guerre. Inspiré par La Condition humaine de Magritte (1935), le dispositif du film de Minjung Kim, The Red Filter is Withdrawn (2020) ne cesse de recourir au surcadrage naturel que prodiguent les grottes et les mires des bunkers de l’île coréenne de Jeju pour filmer la mémoire de cet espace traumatisé. Position stratégique de la dictature militaire en mer de Chine, le soulèvement de sa population en 1948 est réprimé au prix de dizaines de milliers de victimes. Au début des années 2000, c’est pour répondre aux exigences de l’impérialisme américain dans la région que la Corée accepte d’y détruire un site coutumier protégé au profit d’une base militaire. Appliquant un refus manifeste de l’observation frontale et scrutatrice, la cinéaste préfère épier le paysage, le dévoiler étape par étape, à travers les hautes herbes ou depuis une iris rocheuse, ne montrant le cimetière aux épitaphes en kanji (et non en hangeul, l’alphabet coréen) qu’à l’occasion de discrets aperçus. L’île est ainsi révélée par touches, dans une errance qui ne différencie pas les traces de l’érosion naturelle des inscriptions du passé violent de cet espace et, ce faisant, formule une proposition éthique : laisser au lieu traumatisé le choix de ses propres cadrages, de ses propres travellings et de ses propres hors-champs.
Out of the corner of my eye
Membre d’une mission d’exploration polonaise en Antarctique, Viera Čákanyová filme le combat que les vents polaires et le froid mènent contre les efforts déployés par les humains pour la terraformation du continent. Dans son journal de bord qui est aussi le journal du tournage de White on White (Compétition internationale) et de son précédent film de fiction réalisé sur les lieux, FREM (2019), la réalisatrice slovaque met en scène une conversation avec un chatbot philosophe supposément évolué (c’est un « réseau de neurones ») : cette rencontre posthumaine initie le thème du film, la prise de conscience que tout est voué à l’épuisement énergétique. L’axiome suggéré par l’intelligence artificielle, qui suit la seconde loi de la thermodynamique, se révèle surtout un emprunt au film de genre, qui borne encore souvent la rencontre avec l’altérité non-humaine à un rappel néo-stoïcien de la vacuité des valeurs humaines. Peu après cette introduction un peu verbeuse, une tempête de neige se veut prétexte à une interruption des communications de la réalisatrice avec le serveur qui abrite l’IA, permettant à la fois de couper court à un dispositif visuel somme toute peu attrayant (la conversation écrite sur l’écran) et de figurer l’isolation de la scientifique. Seule conscience écologique de la mission, la réalisatrice perd peu à peu tout contact avec ses semblables humains, et s’abandonne alors à une méditation poétique sur l’empreinte carbone et la consommation de temps et d’énergie de la base polonaise, dont le caractère scientifique est d’ailleurs dévoyé par l’arrivée progressive de touristes américains menés là par un paquebot de croisière. Une deuxième prothèse technique, un drone, accompagne la dernière partie du film, presque dénuée de figures humaines. Celui-ci permet à la réalisatrice d’explorer les terres gelées par les conditions météorologiques et dévoile, sans trop encore les fausser, les splendeurs du continent. Mais le dispositif, comme le constate bien vite la réalisatrice, possède un effet délétère : celui de décorréler l’image de l’expérience de son tournage, en rompant l’association formée par le duo corps de la filmeuse/caméra. L’outil abandonné, la réalisatrice-actrice se met alors à rêver d’une symbiose avec les éléments, et à préférer l’expérience immédiate d’un bain dans l’eau glacée à la succession des médiations techniques dont elle s’était dotées. En désavouant de la sorte les efforts d’incarnation de ses appareils, et en plantant là le dispositif, la réalisatrice achève le film sur la question qu’elle s’était pourtant fixé pour objectif de déployer, sinon de dépasser : de quelle ressource peuvent se révéler nos instruments techniques pour comprendre un monde non-humain ou post-humain ?
La question du point de vue et des dispositifs de surveillances traversait deux autres films du programme Ghosts and Apparitions : All of Your Stars Are but Dust on My Shoes du Libanais Haig Aivazian (2021) et All Light Everywhere (2021) de l’Étatsunien Théo Anthony. Les deux documentaires sont extrêmement proches par les thèmes qu’ils explorent et par leur usage d’images de remploi. Le premier interroge la politique de la gestion de la lumière et de l’ombre par les pouvoirs à travers l’histoire, depuis l’exploitation de l’huile de baleine au Royaume-Uni jusqu’aux inventions de la smart city pour gérer l’éclairage public et, par là-même, gouverner les nuits de ses habitant·e·s. Entre les images pédagogiques ou publicitaires visant à expliquer le fonctionnement de ces dispositifs et les gravures des premiers lampadaires, ne cessent de reparaître Beyrouth, les manifestations nocturnes de l’année passée et le chant militant qui donne son titre au film. Théo Anthony choisit quant à lui d’entrelacer ses archives et ses expérimentations visuelles (des lâchers de pigeons équipés de GoPros pour reproduire l’invention du proto-drone par le médecin Julius Neubronner de Kronberg ou des expériences d’eye tracking sur vues aériennes) avec l’étonnante visite d’une usine de l’entreprise Axon (nom qui recouvre désormais son ancienne appellation, de plus sinistre mémoire : Taser). Fièrement, le patron guide l’équipe de Théo Anthony dans les bureaux et les ateliers de la compagnie connue pour fournir la police étatsunienne en célèbres shockers à impulsions électriques et en caméras corporelles. L’homme déploie ses éléments de langage avec enthousiasme tandis que la caméra et le montage s’occupent d’en faire un personnage burlesque : alors qu’il s’emploie à faire la démonstration d’une vitre pouvant passer sur commande d’opaque à transparente, le plan le montrant en train d’actionner répétitivement un interrupteur, privé de contre-champ, dure légèrement trop longtemps pour que l’homme ait l’air tout à fait sérieux. Les questions qui lui sont posées, en relation avec les autres types d’images qui composent le film, ne peuvent de même que lui conférer l’air tantôt naïf, tantôt cynique : « I believe camera can change behavior in a very positive manner » s’exclame-t-il avec assurance, sans penser au double sens que porte en lui l’adjectif positif et sans savoir de quel sens le film s’occupe de charger ce mot.
Déesses, sorcières et cheffes d’États
En un sens, le titre du précédent film de Julien Faraut, L’Empire de la perfection (2018), aurait encore pu s’appliquer à son dernier, tant Les Sorcières de l’Orient (2021) – après une première demi-heure en phase totale avec la geste sportive de l’équipe japonaise féminine de volleyball, championne olympique 1964 – tresse un tableau progressivement révélateur des relations entre l’impérialisme militaire japonais et le culte de la performance sportive et de l’autorité culturelle dans laquelle s’est mué le nationalisme post-Hiroshima. Dans ce film déjà présenté à Rotterdam en début d’année, Faraut porte l’interrogation sur une imagerie sportive d’un type nouveau : non plus seulement le ralenti, encore présent pour magnifier certains gestes techniques, ou l’image de synthèse, mesure et modèle de la performance, mais les images animées qui assurent l’héroïsation quasiment immédiate de cette équipe de jeunes femmes, détentrice du record inégalé d’une série de 258 victoires consécutives pendant une décennie. Avec les images du shōjo (manga destiné à un jeune public féminin) Attack No.1 (1968-1971), que Faraut monte avec des rushes des matches des « sorcières », le film montre bien, notamment dans sa troisième partie, l’imbrication d’un tel culte de la perfection avec la nécessité de reconstruction du pays à la suite de sa mise à genoux par l’impérialisme américain. Absent de l’image lors des entretiens réalisés avec les joueuses cinquante ans après leur épopée, le réalisateur ne manque pas de signaler sa présence dans des séquences plus énergiques en se livrant à quelques exercices plastiques (bande musicale synchronisée à des effets de négatif ; rotation de l’image dans le sens des plongeons des joueuses, afin d’en dynamiser l’effort) qui achèvent d’assurer la cohésion des prises de vues réelles avec l’univers plus cartoonesque de l’animé.
D’autres images seront cependant nécessaires pour révéler l’intégralité de cette aventure sportive, dont la signification idéologique s’avère de plus en plus transparente. Pour signifier la discipline militaire maintenue sur le groupe par leur coach, ancien capitaine d’une division japonaise en poste dans les jungles de Birmanie pendant la Seconde Guerre mondiale, Faraut monte à côté de l’animé des images des brimades subies par l’équipe, montrées (mais déjà justifiées) par le court-métrage que Nobuka Shibuya, primé au Festival de Cannes 1964, avait précisément intitulé Le Prix de la victoire. Les images de Shibuya, formellement splendides, dépeignaient déjà l’usine où les futures « sorcières » – des ouvrières triées sur le volet – tissent des mètres de toile dès le petit matin avant de rejoindre le terrain d’entraînement, où elles triment six jours sur sept, et parfois jusqu’à plus de minuit. Le rapport sadique entretenu par le coach avec les jeunes femmes sous sa férule, ne fait pourtant l’objet que d’une seule séquence de l’entretien mené avec les joueuses. Peut-être gêné par la fascination que celles-ci témoignent encore à l’égard de leur entraîneur (figure qu’elles décrivent aussi bien comme un père idéal, un homme à épouser et un « démon » tortionnaire), Faraut semble parfois reculer devant la complexité exigée par le sujet, qui impose d’en critiquer la structure sans avoir l’air d’accuser les victimes-participantes. C’est que le film n’est plus un face à face entre le cinéaste et le joueur prodige d’une aire culturelle dominante, le joueur irascible au comportement facilement critiquable qu’était John McEnroe dans L’Empire de la perfection, mais bien un complexe écheveau mêlant le patriarcat, l’impérialisme et leurs conséquences sur la compétition sportive.
S’il n’est pas aisé de trancher en faveur ou non de la portée féministe de l’épopée des « sorcières » volleyeuses une tendance de la programmation s’emparait plus explicitement de figures de femmes pour tenir un discours antipatriarcal. L’enquête ethno-cinématographique menée par Yudhajit Basu dans Kalsubai (2020) prend pour thème l’épopée de la déesse Kalsu du peuple Mahadeo Koli dont la légende raconte la retraite dans les contreforts de la montagne après avoir refusé de servir les hommes. Cette figure de déesse révoltée se retrouve dans le film de Rokhaya Marieme Balde, À la recherche d’Aline (2020), journal d’une jeune réalisatrice en quête d’une actrice pour incarner Aline Sitoe Diatta, résistante sénégalaise à la colonisation, élevée au rang de divinité locale vénérée aux abords d’un plan d’eau. Dans la performance filmée In Posse (2021), l’artiste Charlotte Jarvis se rêve en démiurge transhumaine, fabricant, avec l’aide d’une biologiste, du sperme à partir de son propre matériel génétique, répandu à l’occasion d’une reconstitution de la cérémonie antique des Thesmophories. L’expérience démiurgique filmée dans Two Minutes to Midnight, celle de la désescalade nucléaire menée dans la salle ovale de Dr. Strangelove, remplace quant à elle les hommes en costume du film de Kubrick par des actrices qui campent les cheffes des États les plus puissants du monde, auprès desquelles se succèdent des expertes scientifiques et diplomatiques pour commenter cette crise des missiles semi-fictive.
Bien plus ordinaire et bien plus touchante, impossible de conclure sans citer la jeune militante écologiste de The Battle of Denham Ford (Bradley & Bradley, 2021, Compétition britannique) qui s’attache dans les hauteurs d’un arbre pour faire obstacle à la construction d’une ligne de train à grande vitesse (HS2, reliant Londres au nord de l’Angleterre). Au cœur de cette micro-lutte écologique dérisoire, comme il en existe tant, elle tient bon, plaisante avec deux policières et défie les forces de l’ordre, encouragée par ses camarades. La jeune militante finit par être délogée. La bataille de Denham Ford s’achève dans la rivière sur un mode burlesque, les policemen, gauches dans leur équipement anti-émeute, chutant dans l’eau, les images numériques en haute définition se mélangeant avec les vidéos diffusées en direct via smartphone et les commentaires caustiques des spectateur·ice·s derrière leur propre écran.