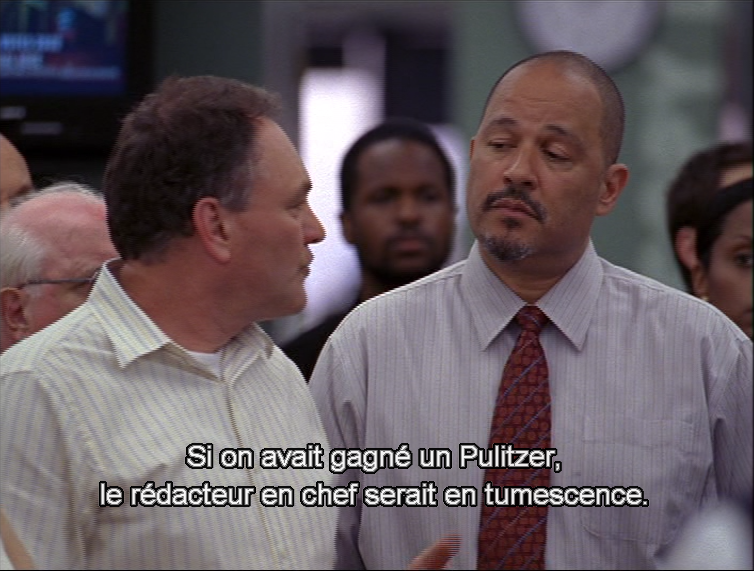The Wire, Linda Williams
Un imaginaire ethnographique : genèse et génie de The Wire
La télévision est chronophage, surtout maintenant que les histoires qu’elle raconte semblent s’éterniser. Du temps, néanmoins, j’en avais durant l’été et l’automne 2007. Un ami m’avait alors fait un cadeau inspiré : les trois premières saisons piratées de The Wire. J’ai tout regardé d’une traite ; puis j’ai dû attendre la saison suivante (la série est passée sur HBO de 2002 à 2008 – de 2007 à 2008 sur la télé de ma chambre). À la fin, j’étais plus qu’une fan : une convertie. Mais je ne savais pas à quoi. Je n’avais jamais rien vu d’aussi absorbant, d’aussi complexe, d’aussi ambitieux et enthousiasmant à la fois, sur un écran. Dans le microcosme d’une ville américaine en déshérence, nous découvrons les vérités enchevêtrées de nombreux dysfonctionnements institutionnels – le commerce endémique de la drogue et l’indissociable échec de la loi et de la police, le déclin des syndicats et celui de la valeur du travail, le cynisme des pouvoirs politiques locaux et la faillite de toute réforme, le saisissant gâchis des écoles, et une presse incapable de voir la vérité nue sous ses yeux[11][11] L’article, “Ethnographic Imaginary: The Genesis and
Genius of The Wire“, est disponible dans sa version originale. Il faisait partie d’un ensemble de textes que Critical Inquiry a consacré à The Wire. Pour une présentation générale du travail de Linda Williams, nous renvoyons à l’entretien qu’elle nous avait accordé (ndt)..
Certains critiques pourraient dire qu’à partir du moment où m’est apparue sans fard la vérité de la culture américaine, peu importe le médium. Regrettant par exemple l’impuissance du roman américain à raconter des histoires qui s’inscrivent dans notre présent néolibéral, Walter Benn Michaels prétend, non sans une certaine connivence avec le créateur de The Wire David Simon, que la série est « jusqu’ici l’une des fictions les plus sérieuses et les plus ambitieuses du XXIe siècle »[22][22] Walter Benn Michaels, « Going Boom : The Economic Collapse Points up How Little Our Literay World Has to Say about Social Inequality », bookforum.com (Feb-Mar, 2009).. Bien qu’elle n’ait jamais été publiée en prose, ce serait, à en croire Simon et Michaels, le grand roman qu’aucun écrivain du XXIe siècle n’a encore écrit[33][33] Simon le qualifie de « roman visuel » et va jusqu’à le comparer à Moby Dick (David SIMON, « Introduction » in Ralph Alvarez et al, The Wire, truth be told, ed Alvarez, New York 2004, p. 25).. Anmol Chaddha et William Julius Wilson la considèrent aussi comme de la littérature, affirmant qu’elle « appartient à une longue série d’œuvres littéraires qui parviennent à saisir la complexité de la vie urbaine en des termes qui font défaut aux sciences sociales »[44][44] Anmol Chaddha et William Julius Wilson, « Way Down in the Hole : Systemic Urban Inequality and The Wire », Critical Inquiry n°38, Automne 2011, p. 166.. Ils mentionnent à titre de modèle Richard Wright, Italo Calvino et Charles Dickens, tandis que Michaels évoque Émile Zola et Theodore Dreiser.
Wilson et Chaddha notent qu’en tant qu’œuvre fictionnelle, The Wire parvient à témoigner de « l’interconnectivité d’un système d’inégalités urbaines d’une manière qui trouve peu d’équivalents dans les travaux académiques ». Les études scientifiques, affirment-ils, « ont tendance à traiter ces problèmes dans une relative étanchéité », alors que la fiction de The Wire « lie habilement ensemble l’éventail des forces qui contribuent à la pauvreté urbaine tout en dénonçant les profondes inégalités qui forment le trait principal de ces modèles sociaux et économiques »[55][55] Ibidem..
Si chacun s’accorde à louer en premier lieu The Wire pour la représentation authentique de l’ordre social et économique permise par son observation réaliste de la vie quotidienne des institutions dépeintes – la police, les syndicats, le trafic de drogue, les autorités locales, l’école, la presse –, alors il n’y a rien de surprenant à ce que le premier adjectif qui vienne à l’esprit pour le qualifier soit « romanesque ». À l’instar de Dickens, Wright, Zola et Dreiser, la série parvient à donner, sur une longue durée, une résonance dramatique à un écheveau de couches sociales interconnectées, à leurs comportements respectifs et à leurs discours. Mais comment s’associent dans cette œuvre cette authenticité et la liberté d’expression artistique auxquelles Chaddha et Wilson font allusion ? Parce que décrire The Wire comme notre plus grand roman ou bien comme la meilleure étude non-académique de sociologie des inégalités ne nous aide pas vraiment à comprendre ce qu’est cet objet en soi. Dans une étude plus conséquente, je mentionne ce que Jeffrey Sconce appelle « les univers narratifs toujours plus complexes » et la façon dont ils sont passés des soaps aux séries policières et aux récits à épisodes en tirant profit de l’abondante ressource de temps à la télévision[66][66] Jeffrey Sconce, « What if ? Charting Television’ New Textual Boundaries », in Lynn Spigel and Jon Olsson (dir.), Television after TV : Essays on a Medium in Transition, N.C. Durham, 2004, p. 95. Voir aussi mon livre à paraître sur The Wire.. Dans ce qui suit, je m’intéresserai seulement au passage du fait journalistique à la fiction télévisée en recherchant les origines créatrices de la série.
L’imaginaire ethnographique : aux origines de The Wire
Simon n’a jamais voulu être autre chose qu’un grand journaliste. Néanmoins, sa conception du journalisme était grandiose, avec l’ambition d’une étude socioculturelle approfondie des existences de ceux dont il racontait les histoires alors qu’il était reporter au Baltimore Sun. Si l’ethnographie peut être définie comme une méthode qui « privilégie l’implication du chercheur dans une étude qualitative au contexte riche et nuancé, et dont l’essence est constituée par la richesse et la diversité des interactions », alors le journalisme de Simon était ethnographique dès l’origine[77][77] Marc Anthony Falzon, « Introduction : Multi sited ethnography : Theory ,Praxis and Locality in contemporary Research », in Multi-sited ethnography : Theory, Praxis, and Locality in contemporary Research, ed. Falzon, Surrey 2009, p. 1..
Simon a signé trois cents articles dans le Baltimore Sun dans la seule année qui a suivi son diplôme à l’Université du Maryland, tous sur les activités de la police. D’abord l’auteur de textes courts, il devait bientôt passer à des formats plus longs, des séries aux multiples intrigues. Son premier récit d’envergure sur Little Melvin Williams, édité en cinq parties en 1987, faisait le portrait d’un ancien baron de la drogue qui tenait le haut du pavé à la fin des années 1980 (Williams a sans nul doute inspiré le personnage d’Avon Barksdale et devait jouer plus tard le diacre dans The Wire)[88][88] Voir Simon, « Easy Money : Anatomy of a Drug Empire », Baltimore Sun, 11 Janvier 1987, PP, 1A, 14A-15A ; 12 Janvier 1987, pp. 1A,6A ; 13 Jan 1987, pp. 1B,2B ; 14 Jan. 1987, pp. 1B, 2B, and 15 Jan. 1987, pp. 1B , 6B.. Cette histoire fut publiée juste après que Simon eut pris un congé pour écrire Homicide: A Year on the Killing Streets, qui lui donna le goût des très longs récits. Le livre s’inspirait d’affaires datant de 1988 et ses 646 pages furent finalement publiées en 1994[99][99] Voir Simon, Homicide : A Year on the Killing Streets, New York, 2009. (Les références aux ouvrages de Simon sont celles de l’édition originale. Une traduction française existe cependant : David Simon (trad. Héloïse Esquié), Baltimore : une année dans les rues meurtrières, Paris, Sonatine, 2012 (ndt).. Simon avait été autorisé à suivre les vies professionnelles et privées des enquêteurs de la criminelle à la condition qu’il ne transmette aucune information à son journal et qu’il ne mentionne aucun nom sans l’accord des personnes concernées[1010][1010] Ibid. p. 624.. Alors âgé de vingt et quelques années, Simon se mêla aux équipes sélectionnées, se soûla avec les enquêteurs dans les bars de la ville, connut les développements et les impasses d’affaires bouleversantes ou ordinaires – la plus frustrante d’entre elles étant celle, jamais résolue, du viol et du meurtre d’une jeune fille.
Après avoir terminé Homicide, fort d’une remarquable connaissance du département de police, Simon écrivit une autre série pour le Baltimore Sun, « Crisis in Blue », un article en quatre volets sur les dysfonctionnements de plus en plus nombreux du département de police de Baltimore. Dans cette série, il révélait qu’un tel échec n’était pas seulement individuel mais institutionnel[1111][1111] Voir Simon, « Crisis in Blue », Baltimore Sun, 6 Février. 1994, pp. A1, A21 ; 7 Feb 1994, p. A1 ; 8 Feb. 1994, p.A1, et 9 Feb . 1994, pp. A1,A12. Dès cette époque, note son premier rédacteur en chef au Baltimore Sun, Simon « avait une approche sociologique de la ville à travers les activités de police et le système judiciaire… Il avait un regard unique sur ces gens que l’on considère habituellement seulement comme des victimes ou des criminels, et observait ces quartiers comme des espaces dont il importait de comprendre la logique » (Simon, pp.24-25).. En 1993, il prit un autre congé annuel, cette fois-ci avec l’ancien détective devenu enseignant Ed Burns, pour se concentrer sur le point de vue des adversaires de la police. Le livre qui en est issu, The Corner : A Year in the Life of an Inner-City Neighborhood[1212][1212] Traduction française, pour le moment partielle : David Simon, Ed Burns, The corner, enquête sur un marché de la drogue à ciel ouvert. Volume 1 : hiver/printemps, Florent Massot, 2011 (ndt)., suit durant une année une famille élargie de Baltimore West (une mère accroc au crack, un père héroïnomane, un fils dealer ainsi que leurs amis, amants et associés). Ce lourd volume de 543 pages fut publié en 1997, après que Simon eut définitivement abandonné le journalisme[1313][1313] Voir Simon et Edward Burns, The Corner : A Year in the Life of an Inner-City Neighborhood (New York, 1997), désigné dans les pages suivantes par : « C »..
Les deux ouvrages de Simon reposent sur une méthodologie ethnographique : une longue étude de terrain – une année – lors de laquelle un système de relations sociales est étudié par un observateur extérieur qui suit des individus sélectionnés dans leur travail et leur vie quotidienne. L’enjeu de ces études au long cours était pour Simon de dépeindre et comprendre la logique fondatrice d’une culture à travers le point de vue situé d’un informateur particulier. Pour Homicide, cela avait impliqué des interviews avec des policiers du cru, de les accompagner sur les scènes de crime, d’interroger les témoins, et de regarder les cas non-résolus s’empiler sur le tableau. Cela signifiait aussi traîner dans les bars après le service. Pour The Corner, Simon et Burns, qui n’avaient pas la moindre autorisation officielle, arpentèrent le quartier de West Fayette Street en pratiquant ce qu’ils appelaient sans fausse modestie « le journalisme du reste-dans-le-coin-et-ouvre-l’œil» (C, p. 538). Ce journalisme devint de l’ethnographie dès lors que les deux hommes se fondirent dans le décor urbain et commencèrent à en comprendre les rythmes et les drames quotidiens. Les techniques de terrain se fondent toutes sur la notion d’un observateur participant qui considère son matériau comme un cadeau venant de ses informateurs. Simon n’était pas un ethnologue professionnel ; il étudia sans doute les flics avec trop d’enthousiasme et d’identification pour réaliser une ethnographie digne de ce nom. Il avoue d’ailleurs être fou de « ces types »[1414][1414] Simon, Homicide, p. 638., de leur langage, leurs procédures, leurs manières rudes et parfois douces. Dans l’approche des quartiers, il fit preuve avec Burns de plus de mesure qu’il n’en avait eu pour Homicide. Ils avaient pour modèle le Tally’s Corner : A Study of Negro Streetcorner Men d’ Elliot Liebow[1515][1515] Voir Elliot Liebow, Tallys’s Corner : A Study of Negro Streetcorner Men (Boston, 1967).. Simon et Burns adoptèrent la règle de Liebow : limiter le prêt d’argent ou toute autre faveur à un informateur à ce que celui-ci aurait reçu de la part d’un ami doté des mêmes ressources. Il arrivait ainsi qu’ils conduisent un toxicomane malade à l’hôpital ou dépannent un peu d’argent pour une dose.
George Marcus prétend qu’il y a un problème inhérent à la méthode ethnographique dès lors qu’elle s’applique à un seul et unique espace de recherche. Comment rendre compte de l’existence d’un macrosystème plus large et de la façon dont celui-ci affecte le microcosme étudié ? Pour y parvenir, affirme-t-il, les ethnologues du « site unique » ont immanquablement recours à un ensemble plus vaste dont il n’ont pas fait une étude aussi systématique. Marcus l’appelle « la fiction du tout ». Elle équivaut généralement à des entités abstraites, « l’État », « l’économie », « le capitalisme », et ainsi de suite[1616][1616] George E. Marcus, Ethnography through Thick and Thin (Princeton, N.J., 1998). p. 33. Ci-après désigné par l’abréviation E.. Cette fiction permet de penser le récit ethnographique comme un récit, elle lui donne une forme achevée : « Aussi imaginaire ou subsidiaire soit-elle (…), la fiction du tout (…) exerce un contrôle déterminant sur le récit dans lequel un ethnologue situe son microcosme » (E, p. 33). Même l’ethnologue qui s’en tiendrait scrupuleusement aux faits doit présumer de l’inscription d’un microcosme, comme celui des policiers ou des dealers de drogue, dans un système plus vaste. C’est la raison pour laquelle Marcus et d’autres ont encouragé une ethnographie multi-située, à même d’ébaucher un système global à travers l’étude de ses composantes locales et de ses sites concrets.
Depuis les années 1980, l’ethnographie multi-située a étendu le champ traditionnel de la discipline au-delà du terrain unique, conférant à celle-ci une plus grande amplitude, plus de profondeur et de portée. Au lieu de s’intéresser conventionnellement à la seule perspective des cultures locales, celle en particulier des études post-coloniales et subalternes[1717][1717] Les Subaltern Studies désignent un courant d’historiographie critique apparu en Inde et dans les pays anglophones au cours des années 1970 et inspiré du marxisme gramscien et de l’épistémologie foucaldienne. Elles dénoncent la méthode historiographique traditionnelle comme relevant d’une logique de domination, sinon d’impérialisme ou de nationalisme, et s’intéressent en priorité aux anciens mondes coloniaux (ndt)., certains ethnologues ont essayé de relier différents terrains en identifiant « un espace-temps diffus » de recherche, dont « une enquête de terrain focalisée sur un site unique ne peut rendre compte en termes ethnographiques valables » (E, pp. 79-80). Cette méthode fait apparaître la complexité des liens entre des processus culturels interconnectés dans un système global en réseau et en constant mouvement (E, p. 82). La découverte de ce système de relations amène les ethnologues à « inscrire ces sites multiples dans un même champ de recherche, et à considérer leur mise en relation comme un objet de recherche primordial » (E, p. 84).
Le seul problème, reconnaît bien volontiers Marcus, est qu’aucun ethnologue n’a de connaissance exhaustive de suffisamment d’espaces et de temporalités pour révéler les multiples facettes d’un système global. Considérant l’ethnographie multi-située comme un idéal plutôt que comme une réalité, Marcus et ses collègues s’efforcent néanmoins de promouvoir le rêve d’un « imaginaire » ethnographique. Il écrit : « Je cherche à formuler un autre espace de réception, moins stéréotypé et plus significatif, pour les savoirs ethnographiques produits dans divers formats académiques ou non-académiques… Dans un tel imaginaire de recherche multi-située, tracer et décrire les connexions et relations entre des terrains autrefois sans commune mesure fonde pour l’ethnographie une manière de produire des savoirs qui revêt un caractère essentiel » (E, p. 14). Comme le signalent le terme d’« imaginaire » et l’ambition d’aller au-delà des « formats académiques », il n’est pas surprenant que le terrain où il y ait « assez d’espace et de temps » pour formuler des arguments qui revêtent un caractère ethnographique « essentiel », s’avère être le mélodrame sériel, télévisé mais extrêmement documenté sur un plan ethnographique, de Simon.
Quand Simon trouva le moyen d’associer les savoirs ethnographiques factuels et détaillés de ses deux larges études micro-ethnographiques – sur le monde de la police et sur celui des dealers de drogue – avec un univers fictionnel plus vaste dans lequel ces savoirs convergeaient (comme il avait d’ailleurs commencé à le faire dans le scénario qu’il refourgua à HBO en 2000 : The Wire, A Dramatic Series for HBO), il découvrit les possibilités uniques offertes par les séries. Il y avait eu jusqu’alors quantité de polars d’envergure, sous la forme de cycles ou de séries. Et il y avait eu pléthore de films sur les flics ou les bandes des ghettos, mais à l’exception de l’adaptation sans passion du beau roman de Richard Price Clockers (1992) par Spike Lee en 1995, jamais un film ou une série télévisée n’avaient consacré un temps équivalent aux deux côtés de la loi et ne les avaient comparativement présentés comme des systèmes en eux-mêmes. Et même l’excellent roman Clockers n’était pas parvenu à saisir les mécanismes quotidiens et implacables d’application et de violation de la loi sur une si longue période.
Dans la première saison de The Wire, flics et truands incarnent les deux visages de l’univers institutionnel qui forme l’arrière-plan initial de la série. À la différence de la majorité des exemples du genre, dans lesquels les policiers sont moralement supérieurs (à l’exception de quelques brebis galeuses) aux délinquants qu’ils arrêtent, chaque camp est présenté de manière équivalente à travers les procédures et les codes de son travail. Les motivations des personnages de chaque monde apparaissent très complexes. C’est simplement qu’ils se situent sur des terrains ethnographiques différents, bien que remarquablement proches. Nous pouvons situer le moment exact à partir duquel The Wire cesse d’être une histoire de flics pour devenir multi-située. Au bout de 24:04 minutes dans le premier épisode de la première saison, le prévenu noir d’un procès pour meurtre, D’Angelo Barksdale, juste après son acquittement, est conduit à un club de strip tease par Roland “Wee-Bey” Brice, l’homme de main de son oncle, pour fêter sa liberté. Tandis que n’importe quelle autre série policière ne laisserait qu’entrevoir l’allégresse du retour de l’acquitté – mais néanmoins coupable – parmi les siens, avant de basculer à nouveau vers l’activité policière, une même attention est ici dévolue aux activités délinquantes. D’Angelo commet une erreur en enfreignant la règle de silence dans les véhicules qui pourraient être mis sur écoute. Il est immédiatement sermonné par Wee-Bey qui arrête le 4X4 et l’entraîne à l’extérieur pour lui rappeler la règle. Dans la scène suivante, deux fois plus longue que n’importe quelle autre du même épisode, nous faisons la connaissance de son oncle dans le club qui sert de couverture à son organisation criminelle, D’Angelo reçoit un nouveau sermon sur la discipline, en l’occurrence sur le meurtre inutile pour lequel il vient juste d’être acquitté. Deux scènes plus loin, nous comprenons que D’Angelo a été rétrogradé sur le marché de vente de drogue où il n’officie plus dans les tours mais dans la cour des petits immeubles. Les méthodes distinctes des flics et voyous se trouvent dès lors établies dans cette première saison comme les deux terrains fondamentaux sur lesquels se déploiera la série[1818][1818] Voir Simon, « The Target », réal. Clark Johnson, 2002, The Wire : the Complete Series, DVD, 23 disques (2002-2008), saison 1, épisode 1..
La connaissance ethnographique des policiers et des délinquants est issue de Homicide et de The Corner, mais l’entrecroisement des deux micro-sites rend possible une riche comparaison thématique des deux institutions : d’un côté des flics qui veulent surtout abattre des têtes et de l’autre des truands qui cherchent à consolider leur organisation. Le paradoxe de l’imaginaire ethnographique de Simon tient à ce que ce dernier a su déjouer les lacunes de la « fiction du tout » en abandonnant le format ethnographique au profit d’une série fictionnelle toujours plus complexe et capable de faire converger de plus en plus d’univers. Pour reprendre Lester Freamon, l’un des sages de la police qui sait comment monter un dossier, « toutes les pièces » (de ce monde interconnecté par la série) « comptent »[1919][1919] Simon, « The Wire », réal. Ed Bianchi, 2002, The Wire, saison 1, épisode 6. .
Une deuxième saison moins aboutie que la première en termes de connexions, se concentre sur l’union syndicale de dockers pour la plupart polonais. Une troisième saison plus convaincante retourne à l’univers des policiers et des dealers de drogue mais y adjoint celui du pouvoir municipal dont les tentatives de réforme sont réduites à néant par d’autres réformes, celles-ci engagées par les barons de la drogue – qui forment une coopérative efficiente – et quelques policiers, culminant dans l’expérimentation d’Hamsterdam. Une quatrième saison, absolument remarquable, s’intéresse à la nouvelle génération des guetteurs et dealers sur un nouveau terrain : l’école primaire de Tilghman, où un ancien policier est devenu enseignant. La cinquième saison tient tous ces éléments ensemble, à l’exception des dockers de la deuxième saison, et leur ajoute le Baltimore Sun, et son échec permanent à rendre compte de la véritable actualité de la cité, alors que les policiers tentent de contenir une jeune génération de dealers toujours plus impitoyables.
À mesure qu’elle circule d’un monde à l’autre, ne s’arrêtant que rarement pour faire le point ou se répéter, empilant chaque fois un nouveau degré de connaissance, la série réalise le rêve de tout ethnologue : un imaginaire ethnographique multi-situé qui n’a plus besoin de s’appuyer sur des concepts abstraits tels que l’État, l’économie ou le capitalisme, mais s’entend de manière plus concrète, vivante et compréhensible. Ce que la fiction permet, imbriquer des histoires de manière concrète et vivante, l’ethnographie ne peut qu’y aspirer, et le journalisme d’investigation rarement l’atteindre[2020][2020] Voir Sconce, « What if ? », p. 95.. Mais avant qu’il n’arrive à se défaire d’un journalisme factuel et qu’il n’ébauche sa version télévisée d’un imaginaire ethnographique, Simon, journaliste pur-jus, a dû mettre un terme à sa carrière de reporter et basculer des faits à la fiction. Il a gardé beaucoup d’animosité à l’égard du monde de la presse qui n’a pas accepté son style de journalisme, tout en étant sans doute aussi conscient que c’est la meilleure chose qui lui soit arrivée.
Journalisme coup de poing
Quand il était encore journaliste, Simon était en effet partisan d’un journalisme nouveau, et racontait les histoires « vraies » de sa ville dans un style plus inventif et romanesque. Cette nouvelle espèce de journaliste est tellement « saturée » – comme le dirait Thomas Wolfe – par l’environnement de son sujet, qu’il se croit autorisé à entrer dans la tête de ses personnages pour préjuger de leurs pensées. Les logiques fondamentales de ce type d’écriture, selon Wolfe, ne sont plus celles des cinq « W »[2121][2121] Emblématiques du nouveau journalisme, les cinq « W » questions (et un « H ») sont en anglais : who, what, when, where, why, et how ; autrement dit : qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Elles constituent la formule essentielle du journalisme d’information (ndt)., mais celles de « scènes entières et de sections dialoguées »[2222][2222] American Society of Newspaper Editors, « Thomas Wolfe: The New Journalism », Bulletin of the American Society of Newspaper Editors, 544, Septembre 1970, p. 22..
Des « scènes entières et de[s] sections dialoguées » forment précisément la trame de l’article sur les « Metal Men » que Simon publie en 1995 dans le Baltimore Sun. Il vaut la peine de revenir sur la censure de ce récit parce qu’elle l’amena à quitter le journalisme. Il commence avec la description de la scène de crime : « Kenny s’essuie la bouche, passe le vin et regarde le contenu du caddie, son esprit se livrant à de rapides estimations ». L’estimation consiste à déterminer combien son frère Tyrone et lui pourront tirer d’une certaine quantité de tuyaux de cuivre et autres morceaux de métal dans une maison inoccupée. Kenny et Tyrone sont présentés en plein milieu d’un vol, récupérant du métal dans une maison de Fulton Avenue à West Baltimore. Tyrone s’introduit dans le bâtiment avec une scie à métaux, en pensant : «Récupère le métal tout de suite ou bien quelqu’un viendra et le prendra ». Son frère et lui ressortent avec un caddie plein de métal. Avec leur chariot bringuebalant, « ils dévalent Fulton et traversent Fayette, où les dealers du coin sont en train de vendre un nouvel arrivage d’héroïne… Pas moyen de se rendre compte de leur vitesse à moins d’être avec eux, galopant derrière un chariot plein à ras bord, cherchant en toute bonne foi à faire pencher la balance de leur côté »[2323][2323] Simon, « The Metal Men », 3 septembre 1995, Baltimore Sun ; désigné ci-après par l’abréviation « MM »..
Et voilà notre reporter trottant à leurs côtés. Le voici dans le paragraphe suivant, se prononçant sur le sens de cette scène :
Regardez ces fourmis… jour après jour, elles tirent et poussent bruyamment leurs chariots, pieds de biche et marteaux à la main, dévorant Baltimore morceau par morceau… En ce moment-même, elles démontent les gouttières des logements sociaux de Westport, et les balustrades des maisons de Wilkens Avenue… Sur Lafayette Square, une église a fermé vendredi soir avec sur son toit un solin de cuivre étincelant ; le dimanche, il pleuvait dans la maison du seigneur. [« MM »].
Comme le suggère la métaphore des fourmis, notre reporter est plus qu’impressionné par la débauche d’énergie et la vitesse du démantèlement, bien qu’il en reconnaisse le gâchis humain :
Les hommes de métal savent bien que la partie est déjà jouée – que les ferrailleurs du coin ont déjà dépouillé le quartier des meilleures pièces. Maintenant, un bon après-midi de travail peut consister à aller récupérer une paire de radiateurs de plus de 100 kg à 12 pâtés maison de là sous le brûlant soleil d’été. C’est toujours 10 dollars. Et 10 dollars vous vaudront une dose d’héroïne et quelques lignes de cocaïne pour planer.
Les fourmis sont là ; nous sommes le pique-nique. [« MM »].
L’histoire se poursuit avec les répercussions sur d’autres terrains : le directeur d’une coopérative à but non lucratif engagée dans la réhabilitation de logements sociaux regarde les lieux dévastés d’un stand de tir abandonné où il ne reste rien à sauver ; la Commission des logements, en voulant se passer d’appels d’offre pour restaurer des immeubles, est poussée à la corruption et multiplie les coûts ; l’entreprise qui achète le métal volé semble peu soucieuse de son origine douteuse ; un officier de police, Ronald Daniel, manque d’hommes pour résoudre le problème. Une scène ultérieure introduit un nouveau personnage, Gary, un autre « metal man », absent de la scène initiale de rapine. Il survole l’histoire et surgit quand Simon a besoin d’une voix plus cohérente et morale, la voix de quelqu’un qui condamne les vols et voudrait gagner un peu plus honnêtement sa vie, mais qui, comme les autres, ne peut se contenter de « la-paye-qui-n’arrive-que-vendredi » parce qu’il a besoin de son fix quotidien.
La scène finale de ce récit en six parties retrouve les « metal men » du début, Kenny, Tyrone et d’autres, en train de se défoncer dans le sous-sol délabré de ce qui fut autrefois le club de loisirs de leur quartier. Mais là encore, bien que rien n’indique que Gary se drogue avec eux, Simon choisit de l’intégrer à la scène, comme s’il était présent. L’histoire se conclut ainsi :
Et Gary, ce n’est un véritable « metal man » que durant les mois d’hiver, quand le travail ralentit au restaurant de crabe et qu’il est mis au chômage un jour ou deux par semaine. Quand vient le redoux, il retourne en cuisine, où il est payé en espèce chaque jour, comme sur le marché de la dope.
Ils prétendent tous tirer des caddies parce qu’ils n’ont pas d’autre travail, parce qu’il n’y a plus de travail et que c’est un moyen comme un autre de faire de l’argent à partir de rien. Mais dans un même souffle, ils admettent qu’il ne peuvent attendre la paye de fin du mois. Ce sont des vies sans espoir ni structure, même si cela ne signifie pas que le jeu ne soit pas éphémère ou temporaire. Le vol de métal est désormais une pratique courante de la culture de la drogue dans cette ville, et elle ne cessera pas tant que les dealers continueront à échanger des doses contre des espèces, aussi longtemps que des quartiers de Baltimore laissés à l’abandon seront démantelés.
Les fourmis y veilleront. Reconnaissons-leur au moins la capacité de créer de la richesse en détruisant les richesses, et de contredire ainsi le stéréotype du toxico hébété et hirsute attendant au coin du mur. Le labeur n’effraie pas un « metal man ».
« Parfois », raconte Gary, « le plus dur est de se défoncer ». [« MM »].
Les spectateurs de The Wire auront reconnu le lieutenant Cedric Daniels sous les traits de l’impuissant officier Daniel, et ils auront certainement perçu dans Gary plus d’une ressemblance avec l’un des personnages les plus attachants de la série, Bubbles – un « metal man » hors du commun. Avec une persévérance de fourmi, cet indic occasionnel, ce fourrageur et philosophe amateur, sera amené, au milieu de la troisième saison, à reconvertir son chariot de métal volé en un commerce itinérant quasi-légal de vente de tee shirts et de portables d’occasion à Hamsterdam ; dans la quatrième saison il essaiera d’inscrire son dernier associé à la Tilgham Middle School. À la fin de la cinquième saison, nous le retrouverons « clean » depuis un an, en train de vendre à la criée le Baltimore Sun, un journal dont il fera alors l’actualité puisqu’un article lui sera consacré. Bubbles est l’alibi fictionnel et dramatique qui permet à Simon de poursuivre et d’étendre l’observation ethnographique de ses deux sites initiaux à un système multi-situé. Son pathos, son esprit d’entreprise, sa dépendance, ses relations vouées à l’échec avec des camarades plus jeunes, tout cela vient des longues descriptions du travail ethnographique de Simon. Et cependant, pas une figure de ce reportage ne porte la charge émotionnelle et idéologique de ce personnage. Bubbles appartient à la fiction, mais il est l’amalgame de deux personnes réelles : un indic d’une vingtaine d’années du nom de Possum et Gary – celui-là même dont la présence injustifiée à la fin des « Metal Men » allait mettre un terme à la carrière journalistique de Simon.
Gary a surgi dans l’article du Baltimore Sun « The Metal Men », parce qu’il faisait alors l’objet d’une étude approfondie dans The Corner. Il est le fils d’une famille très croyante, arrivée à Baltimore durant la Grande Migration[2424][2424] La Grande Migration des Afro-américains du Sud vers le Middle West, le Nord-Est et l’Est pour échapper à la ségrégation et au racisme dans les années 1910 à 1930 (ndt)., et qui prospéra un temps. Gary n’est pas la victime manifeste de circonstances sociales. Il ne manque ni d’éducation ni de moralité. Et par conséquent, il n’est pas non plus familier de la rue, et le quartier déshérité où il est cloué est donc le pire endroit où il puisse se trouver. Gary apparaît tôt dans le livre, il se défonce dans le petit immeuble victorien abandonné dont il était autrefois le propriétaire en se remémorant comment, un peu plus tôt ce jour-là, il a récupéré du cuivre dans le sous-sol d’une maison encore habitée. Les rapines de métal de Gary ponctuent la série, parce qu’elles incarnent tout ce qu’il reste de l’éthique du travail et de l’optimisme – un optimisme qui infusera la création de l’encore plus pétillant Bubbles.
Gary n’est pas Bubbles. Il a pour cela trop d’éducation et un peu trop tendance à s’apitoyer sur son sort. Il a aussi une ex-femme, une ex-maison et une copine, alors que Bubbles n’a qu’une sœur suspicieuse, des contacts avec la police et un attachement démesuré à des hommes plus jeunes dont il croit pouvoir faire l’éducation. Néanmoins, comme Bubbles, Gary se place moralement et intellectuellement un cran au-dessus de la plupart des gens qu’il fréquente et, comme Bubbles, il en vient à incarner l’âme de l’addiction. Son infortunée bonté combinée à son perpétuel besoin d’une dose, ses leçons de dessins et ses prédilections pour la philosophie, sans parler de ses rapines de métal ou de cette expression résumant à elle seule la banlieue où il doit aller pour sa peine – « Leave It to Beaver land[2525][2525] Leave it to Beaver est le titre d’une série diffusée entre 1957 et 1963 dont l’action se situait dans une banlieue aisée. Les sous-titres français font pour leur part référence à la Petite maison dans la prairie. il s’agit, en tout cas, d’un monde bien différent de celui qu’il habite (ndt). » – nous suffisent à reconnaître un prototype. La différence, bien sûr, c’est que si Gary représente à merveille son propre monde de ratés, il ne peut nous guider vers d’autres univers. Il ne peut circuler entre flics et dealers ; il ne peut poser des chapeaux sur les têtes des principaux dealers afin que les policiers les identifient. De toute évidence, Simon aime Gary, mais contraint par les faits, il ne peut le rendre aussi attachant, perspicace et clairvoyant que Bubbles. Il ne peut pas faire de Gary, comme il fait de Bubbles, un témoin silencieux de tout ce qui se joue dans la rue, entre les policiers, dans les écoles, ni même lui donner un rôle moteur dans le récit. Il ne peut pas conférer à Gary le statut de témoin de la folie et de la grandeur que fut l’expérience fictive d’Hamsterdam. Et bien sûr, il ne peut pas non plus racheter Gary. Celui-ci meurt d’une overdose de même que Possum, l’autre inspirateur du personnage, meurt du SIDA ; mais il appartient à Simon de raconter l’histoire de Bubbles comme l’une des rares marquées par un relatif espoir dans The Wire.
Cela ne revient pas à dire que Bubbles est une version plus optimiste et sentimentale de Gary et qu’en conséquence, la « liberté artistique » de The Wire amoindrit le réalisme social de son ethnographie. Un tel argument soutiendrait que seul un tableau irrémédiablement noir des différents espaces de la ville peut être véridique, comme si cette « fin heureuse » niait le réalisme de tout le reste. Cela équivaudrait à une définition du réalisme qui opposerait de manière irrévocable les choses telles qu’elles sont aux choses telles que l’on voudrait qu’elles soient et dissocierait tout aussi diamétralement le mélodrame du réalisme[2626][2626] Au lieu de quoi le mélodrame se modernise en permanence en s’attelant à des sujets sociaux nouveaux, plus réalistes, et en les reformulant sous la forme de victimes et de coupables dont les qualités ne sont pas toujours explicites à première vue. La série mélodramatique The Wire se distingue des mélodrames ordinaires dans la mesure où le mauvais rôle y est tenu par des institutions aussi bien que par des individus. Dès lors, alors que son imaginaire ethnographique multi-situé lui confère une ampleur et une profondeur originales et que son récit est par moments ponctué de tragiques rebondissements (les morts de Frank Sobotka et de Stringer Bell), son modèle opérant est bien celui du mélodrame. Voir Linda Williams, « Playing the Race Card » : Melodramas of Black and White from Uncle Tom to O.J. Simpson, Princeton, N.J, 2001.. Cependant Bubbles permet non seulement à Simon de faire le lien entre de multiples terrains ethnographiques mais aussi entre différents types de fiction, découvrant le réalisme à l’œuvre dans le mélodrame et le mélodrame à l’œuvre dans le réalisme.
Bubbles assume dans la fiction la fonction typiquement dickensienne du marginal social ; ce qui n’a pas seulement pour effet de nous le rendre sympathique en dépit de ses faiblesses mais aussi de connecter les différentes strates des multiples mondes sociaux qui se déplient dans la série à mesure qu’il les parcourt. À l’instar de Jo, le petit balayeur du carrefour dans Bleak House (La Maison d’Âpre-Vent), qui relie les mondes antagonistes de Lady Dedlock et d’Esther Summerson, Bubbles est un connecteur[2727][2727] Dans une interview avec Simon, Nick Hornby commence par décrire « le malheureux Bubbles » comme la version baltimorienne de « Jo le balayeur du carrefour ». Il entend par là le Jo de Bleak House (La Maison d’Âpre-Vent), celui-là même qui montre à Lady Dedlock le spectre de son ancien amant, le capitaine Hawdon, se lie d’amitié avec Esther Summerson, et transmet, avant de mourir, la variole à Esther et à son ami Charlie. Voir l’interview de Hornby avec Simon, The Believer, août 2007.. Cependant, l’imaginaire ethnographique de Simon ne l’enjoint pas à seulement voir en Bubbles l’orchestrateur des retrouvailles entre mères et filles ou entre pères et fils. Pas plus qu’il ne l’incite, comme le ferait sans doute Dickens, à abandonner ce connecteur une fois que celui-ci a accompli sa tâche en unissant les personnages plus « centraux » de la classe moyenne. Bubbles est un personnage aussi central qu’on peut l’être dans une série mélodramatique qui compte quelques trente-cinq personnages de premier ordre répartis dans cinq univers originaux. La forme dramatique tirée de cet imaginaire ethnographique multi-situé de plus de soixante heures répond au mieux à celle d’une série mélodramatique aux accents occasionnels de tragédie. Ce qui distingue cette série mélodramatique de la plupart des programmes télévisés aujourd’hui n’est pas tant qu’elle est basée sur des « événements réels » – après tout, le scénario de légalisation de la drogue d’Hamsterdam est assez peu crédible – mais le souci du détail des savoirs multi-situés qui assurent la construction du récit comme totalité.
De la diatribe engagée à la série (mélo-)dramatique et ethnographique
« The Metal Men » est une œuvre tardive et décisive dans la carrière de Simon au Sun. Elle commence avec la dénonciation du scandale des pilleurs de métaux par un citoyen indigné et néanmoins indiscutablement situé en termes d’origines sociales et ethniques (« les fourmis sont là, nous sommes le pique-nique »). Bien que l’histoire des fourmis fasse montre de beaucoup de sympathie, il ne peut y avoir de confusion quant à ce « nous » de la classe moyenne blanche dont se repaissent ces fourmis. Simon s’efforce de nous raconter l’histoire économique plus vaste du chômage et de la nécessité d’occuper ce vide avec une vocation quelle qu’elle soit. Et c’est précisément cette situation économique plus vaste – la complexité des relations entre les « metal men », la commission des logements, les flics et les ferrailleurs – couplée avec la sympathie évidente pour les « metal men » dont fait preuve le récit qui précipita sa censure par les éditeurs du Baltimore Sun[2828][2828] Remarquons leur désaccord sur cette question : Simon prétend que le rédacteur en chef John Carroll a « censuré le texte », tandis qu’une autre source affirme que celui-ci fit la une de l’édition du dimanche. La dispute est liée d’une part au refus d’une autre série d’articles que Simon avait proposée sur les questions de race et, d’autre part, à la conviction de Simon que son livre de reportage aurait dû lui rapporter plus d’argent et de reconnaissance (« S », p. 29)..
Aux yeux du rédacteur en chef du Baltimore Sun, John Carroll, l’article de Simon était trop proche de ce qu’il était en train de faire dans The Corner, par quoi il faut sans doute entendre qu’il faisait preuve d’une trop grande interprétation culturelle. Simon réfute cet argument et affirme qu’il a réalisé un reportage original à partir de sources de première main. Il apparaît néanmoins irréfutable que l’histoire est tirée de celle – alors en cours d’écriture – de The Corner et que la figure de Gary est présente dans les deux. L’autre chef de Simon au Sun, Bill Marimow, reproche au texte d’anoblir les voleurs qui dépouillent la ville de ses infrastructures (voir « S », p. 27). Marimow aurait préféré une histoire plus élémentaire sur le scandale des pilleurs. Simon ne décolère pas et dénonce la « vénalité » de ses chefs, les accusant de se rengorger au seul mot « Pulitzer » (« S », p. 27). La querelle avec ses anciens patrons pose la question de ce que le journalisme devrait être, mais, plus important, elle est aussi révélatrice de ce que deviendra The Wire. Selon Simon, les journaux devraient adopter « une approche sociologique d’ensemble » ; pour Carroll et Marimow, ils devraient au contraire se concentrer, comme un « coup de poing », sur des histoires et des problèmes individuels. Simon décrit ainsi cette logique du coup de poing: « Prenez un délit banal, faites-en un sur-événement et attribuez-vous d’office le mérite de cette révélation, assurez-vous de trouver un méchant, et prétendez ensuite que votre couverture a provoqué des rebondissements. Faites-en une série de cinq articles et n’oubliez pas d’écrire dans le deuxième paragraphe “le Baltimore Sun a appris…” » (« S », p. 26). L’enjeu relève du choix de donner la primauté à l’histoire individuelle – souvent réduite par nécessité à une histoire mélodramatique de victimes et de coupables – ou bien au système entier qui a rendu cette histoire possible. « The Metal Men » opte pour cette seconde option et s’avère effectivement plus ambitieux et plus complexe que l’habituel coup de poing « dénonçant-un-méfait», mais il ne laisse aucun doute quant à la sympathie qu’il témoigne : non pas à l’officier de police, ni même au responsable de la commission des logements, encore moins aux entreprises de ferrailleurs, mais à Gary, la voix éloquente derrière les actes que Kenneth et Tyrone commettent[2929][2929] Le compte-rendu de cette querelle entre Simon et ses chefs par Lanahan, à l’occasion de la diffusion de la cinquième saison de The Wire consacrée au monde de la presse, fait apparaître Lanahan luttant avec les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes, incapable de pratiquer lui-même le « journalisme coup de poing ». Lanahan suggère que Simon est furieux et peut-être bien jaloux que sa pratique du journalisme ait été exclue de la profession..
Simon se définit comme un observateur d’un monde tout en nuances avec « des êtres humains bien réels et complexes », alors que Carroll et Marimow conçoivent leur action comme un service public qui n’a pas à entrer dans les complexités de l’ethnographie quand il s’agit simplement de défendre une victime ou de dénoncer un méfait (« S », p. 27). Exposé de la sorte, le débat semble opposer le souci de complexité et de nuance de Simon à la vision manichéenne et mélodramatique de ses rédacteurs en chef. Avec le recul qu’offre The Wire, il est tentant de s’aligner sur la position de Simon contre un monde de la presse mu par la seule convoitise du Pulitzer, et de le placer, selon les termes de son ancien rédacteur en chef John Carroll, « du côté des anges » (« S », p. 30). Mais ce serait succomber à la condamnation simpliste du mélodrame, cette histoire de bons et de mauvais à laquelle Simon prétend avoir échappé mais qu’il ne peut cependant éviter s’il veut raconter une série d’histoires captivantes. Plus encore, ce serait méconnaître la valeur de ce nouveau genre télévisé, la série mélodramatique, qui juxtapose des situations dramatiques dans un temps long, les mûrissant et permettant aux personnages d’évoluer et au récit de se déployer. C’est du temps – ce temps supplémentaire que j’avais en 2007-2008 pour regarder la télévision, ce temps supplémentaire que The Wire consacre à enrichir son intrigue, à accorder de l’importance à un personnage et à sa place dans une institution, ce temps supplémentaire que Simon avait pour développer l’histoire de Baltimore en cinq saisons et cinq années de temps diégétique – qu’il lui a fallu, comme le formule bien Lorrie Moore, pour « transformer un type social en être humain, et de la démographie en dramaturgie »[3030][3030] Lorrie Moore, « In the Life of The Wire », critique de The Wire par Simon, in Tiffany Potter et C.W Marshall (dir.), The Wire: Urban Decay and American Television, et Alvarez et al., « The Wire », New York Review of Books, 14 octobre 2010, p. 2.. Avec du temps, affirme Michaels, il devient possible pour la série de dépeindre « le monde que le néolibéralisme a véritablement produit, plutôt que le monde dont notre littérature le juge responsable »[3131][3131] Michael, « Going Boom ».. Avec du temps enfin, Simon a pu apprendre à ne plus écrire des textes d’opinion.
Simon était un reporter tenace parce qu’il refusait de s’en tenir aux faits et de simplement dénoncer un crime. Il voulait dénoncer des crimes institutionnels et systémiques d’une plus grande ampleur. Dans « The Metal Men », ces crimes n’étaient pas seulement le vol de métaux, mais l’absence de travail, les marchands de ferraille corrompus au même titre que la Commission des logements ou encore un département de police débordé de toutes parts. On peut louer la manière dont Simon tenta de repousser les limites du Baltimore Sun, mais il faut néanmoins reconnaître que du journalisme, Simon a retenu un esprit de synthèse et une concision de l’écriture, des fondamentaux de la discipline du reportage qui l’ont aidé à bâtir le cadre général et la complexité institutionnelle de The Wire.
Malgré tout, les rédacteurs en chef de Simon avaient raison sur un point. Vous pouvez perdre votre lecteur si vous vous égarez – comme bien souvent Simon s’égare dans Homicide et dans The Corner, et même dans « The Metal Men » – dans de longs développements sociologiques concernant les dévoiements d’une société qui produit des toxicomanes plutôt que des citoyens. Vous pouvez perdre votre lecteur quand votre récit ethnographique bascule dans une interminable lettre ouverte – ou ce qu’on peut seulement appeler le goût de Simon pour la diatribe (voir « S », p. 31)[3232][3232] Bien des réflexions quant à la forme de The Wire et au type de journalisme en jeu sont évoquées par l’excellent texte non-édité de Christine Borden, « Cross Cutting in The Wire : The Journalist’s Editorial Comment ». Je dois beaucoup aux remarques de Borden.. Mais ces limites de Simon en tant que journaliste ont pu être surmontées à travers un nouveau type d’écriture propre à une série dramatique multi-située.
Dans toute l’oeuvre journalistique de Simon – aussi bien ses textes longs que courts –, ses remarques éditoriales sont formulées d’une voix ardente et érudite qui témoigne de son origine sociale et ethnique, le genre de voix qui peut s’enflammer d’indignation et d’admiration en même temps, « regardez ces fourmis… Nous sommes le pique-nique ». Étant donnée la dimension d’un livre comme The Corner, cette voix peut aussi s’emporter contre la futilité d’une « guerre contre la drogue » en utilisant un royal et passionné « nous » :
Nous ne pouvons l’arrêter.
Pas avec tous les hommes de loi, les armes et l’argent de ce monde. Pas avec la culpabilité, la moralité, ni même une juste indignation… Aucune victoire durable dans la guerre contre la drogue ne peut être acquise en doublant le nombre de policiers dans les rues, ou en triplant le nombre de lits en prison… En bas de Fayette Street, ils le savent bien… Dans le cœur asséché de nos villes, la culture de la drogue a créé une structure économique si élémentaire et si durable qu’elle peut légitimement être qualifiée de pacte social. Sur Monroe et Fayette, et sur tous les marchés de drogue à travers le pays, des vies sans autre motivation véritable trouvent du sens dans ce capitalisme basique et auto-suffisant. La rue leur réserve une place… Rabatteurs, livreurs, guetteurs, mules, braqueurs, cambrioleurs de planques, hommes de main, toxicomanes, artistes cramés, balances – tous sont nécessaires au monde de la rue… À ce lieu seul, ils appartiennent. Dans ce lieu seul, ils savent ce qu’ils sont, pourquoi ils sont là, et ce qu’ils sont censés faire… Ici, ils comptent presque pour quelque chose… Nous refusons de voir ça autrement que comme une simple histoire d’argent et de cupidité, quand vu d’en bas, il s’agit de trouver une raison d’y croire. Nous voulons nous persuader que c’est chimique, que tout est dans l’addiction, alors qu’en réalité il est question de certitude, celle d’âmes perdues s’assurant de disposer de leur pain quotidien à la pointe d’une seringue jetable. [« C », pp. 57-58]
Éloquente, passionnée, ironique, emportée : voilà la voix de David Simon dans un “éditorial” consacré à Gary et à son monde de la rue qui continue ainsi sur dix-huit pages, se livrant à l’historique de la consommation de drogue à Baltimore depuis l’époque de la frange dandy d’héroïnomanes à la fin des années 1950 jusqu’à la révolution de la cocaïne et, à l’orée des années 1990, le basculement des mères – autrefois bastions de la communauté – dans la toxicomanie.
Cette voix éditoriale parle au nom des victimes d’une société dysfonctionnelle minée par la drogue, mais ce n’est pas la leur. Parce qu’elle s’appuie sur un travail ethnographique, elle se sent autorisée à parler d’un royal « nous » que nous identifions distinctement comme étant celui de Simon (et Burns). Les autres essais argumentés de cette sorte incluent un remarquable morceau de bravoure sur « le génie silencieux » du « sac en papier » – « l’un des fondamentaux de la diplomatie du ghetto dans tous les grandes métropoles américaines ». Le sac dissimula de manière ostensible la consommation publique d’alcool et permit au gouvernement d’« ignorer la petite délinquance de la vie urbaine et de se concentrer plutôt sur l’essentiel ». Mais puisqu’il ne peut y avoir d’équivalent au sac en papier dans la lutte contre la drogue, poursuit notre éditorialiste, il n’y a pas d’« accord possible entre la sous-culture de la drogue et ceux qui la réprimandent… Au lieu de s’attaquer aux types vraiment dangereux… Au lieu de considérer la consommation de drogue comme une décision personnelle… – en cherchant une solution-sac-en-papier au nombre croissant d’usagers dans les rues – nous avons tenté de remédier au problème par des arrestations en masse » [« C », pp. 158-160].
D’autres « éditoriaux » traitent du scandale et du gâchis des prisons, du manque de formation de la police, de l’échec économique du rêve américain, des raisons pour lesquelles l’école, « autrefois un moyen de s’en sortir pour nous et pour nos parents », « ne peut plus rien pour nous ». Ces écoles publiques, « qui ont sorti les masses d’immigrés du ghetto et des charrettes pour les installer dans des banlieues impeccables occupent une place de choix dans la mythologie américaine », mais pas, poursuit cet éditorial, dans la réalité américaine de West Baltimore [« C », pp. 278, 277, 278]. Un autre « éditorial » propose un essai critique sur les grossesses adolescentes (« Accident n’est pas le mot juste pour ce phénomène » [« C », p. 233]) tandis qu’un autre compare la logique de « gonfler les stats » pour donner aux élèves de meilleurs résultats dans le système scolaire à la requalification des crimes pour les faire paraître moins nombreux dans les départements de police [voir « C », p. 283].
Un dernier éditorial marque l’apothéose de ce ton polémique et passionné d’un Blanc américain de la classe moyenne : et si « nous » étions à « leur » place ?
Nous persévérerions, n’est-ce pas ?… les jours de paye, nous ne claquerions pas notre chèque de revenu minimum dans une paire de Nike, un sweat shirt Fila, ou le film du vendredi soir à Harbor Park avec les filles du quartier… Nous laisserions derrière nous nos années de lycée, brillants comme un sou neuf, jurant de ne jamais remettre les pieds sur West Fayette Street… Nous nous élèverions au-dessus de la rue. Et quand nous nous persuadons de telles choses, nous présumons sans même y réfléchir que nous serions envoyés dans des endroits comme Fayette Street complètement équipés, avec le lot de grâces et de discipline, de talent et de formation que nous possédons aujourd’hui… Nous serions sauvés, et comme toujours en matière de salut, nous savons que c’est une question de foi absolue et intacte.
Pourquoi ? La vérité saute aux yeux :
Nous ne sommes pas nés pour être des négros [« C », pp. 478-79].
Les fans de The Wire auront reconnu dans cette diatribe polémique certains des thèmes cruciaux de la série, de même que la genèse de la plupart de ses grands procédés dramatiques : la comparaison réitérée dans le contexte de l’après 11 septembre d’une vaine « guerre contre la drogue » à une tout aussi vaine « guerre contre le terrorisme » ; le profond enracinement de la drogue dans un système économique où elle constitue la seule source de revenus viables et la seule alternative fiable ; et le sac en papier que le major Bunny Colvin brandira dans une réunion du district de police, en le qualifiant de « grand moment de compromis civique ». Le discours de Colvin pose les fondements moraux de l’expérience à venir d’Hamsterdam dont l’enjeu se résumera à trouver un équivalent au sac en papier pour la drogue[3333][3333] Simon, « All Due Respect », réal. Steve Shill, 2004, The Wire, saison 3, épisode 2. . La faillite de l’école ne sera jamais mieux exprimée qu’à travers l’exemple de l’école élémentaire de Tilghman dans la saison 4, quand l’ancien policier Roland « Prez » Pryzbylewski observe que les écoles gonflent leurs stats tout comme le font les chefs de la police[3434][3434] Simon, « Know Your Place », réal. Alex Zakrzewski, 2006, The Wire, saison 4, épisode 9.. Avec le journalisme ethnographique d’Homicide et de The Corner, les éditoriaux polémiques prennent vie et cessent de n’être que les diatribes d’un Blanc en colère.
Dans l’ultime scène de la saison 3, nous retrouvons Bubbles et son dernier protégé, équipés de leur caddie et fouillant les monceaux de ruines d’Hamsterdam. La ville a balayé l’expérimentation « sac en papier » d’une zone de tolérance de la drogue et la carrière du major Colvin est terminée. Bubbles enseigne à son associé de pillage la valeur de l’aluminium qu’il extrait des décombres. Il lui prodigue aussi ses conseils : « T’y connais encore rien ; j’espère que tu m’écoutes parce que j’essaie de faire ton éducation là ». Nous avons ici affaire avec Bubbles à une logique de répétition, tandis qu’il forme un autre jeune homme, excité à l’idée de réunir assez d’argent pour se payer une dose avec ce fourbi. (Il nous introduit également à la thématique de la saison suivante et au terrain nouveau de l’école).
Bubbles marque ensuite une pause, s’éloigne de son associé et du chariot, pour découvrir un peu plus loin Bunny Colvin, seul et en civil devant les décombres de son ancienne expérimentation. Bubbles et Colvin contemplent en silence la scène déserte. À la fin, Bubbles dit à Covin : « C’est quelque chose, hein ?… Comme si quelqu’un avait pris une gomme pour tout effacer ». Colvin, abattu, se contente de regarder Bubbles. Celui-ci poursuit : « mais juste avant, un toxico se pointe, pour récupérer un petit quelque chose, il n’y a pas une âme pour le déranger… On le laisse en paix ». Colvin demande avec précaution : « C’était une bonne chose, non ? », Bubbles avec autant de précaution, pas certain de celui à qui il a affaire, fait marche arrière : « Je dis ça comma ça », mais tandis qu’il s’éloigne pour rejoindre son compagnon et poursuivre son travail avec son caddie, il lui explique : «tu n’en as sûrement pas conscience mais c’est rude par ici petit, les flics te tabassent ; les petits dealers essaient de t’arnaquer ». Colvin, resté seul face aux ruines de son expérience alors que Bubbles s’éloigne, dit seulement : « Ouais, merci »[3535][3535] Simon, « Mission Accomplished », réal. Ernest Dickerson, 2004, The Wire, saison 3, épisode 12..
Si Simon avait encore été un journaliste, il aurait sans doute choisi cet instant pour se répandre sur les ruines d’une noble expérimentation sociale. Il se serait apitoyé sur le sort des infortunés drogués et aurait condamné l’esprit étroit des pouvoir publics, avant d’exposer ses vues sur l’absence systématique de justice sociale. Au lieu de quoi, nous avons simplement droit à cette brève reconnaissance de la « bonne chose » qu’était Hamsterdam par un officier de police et un toxico sans domicile. Mais nous devrions nous méfier de l’apparente évidence de la scène. Nous avons là l’une de ces remarquables coïncidences dickenseniennes, quand deux personnages que nous avons appris à aimer et à admirer, issus de deux univers sociaux différents, se rencontrent et se comprennent parfaitement. Le savoir ethnographique que nous avons accumulé en observant chacun des mondes dit le reste. C’est un « hommage à la vertu » qui n’a rien du mélodrame suranné mais qui remplit au contraire sa fonction. Ce n’est pas un « excès » de souffrance à effet de manches[3636][3636] Peter Brooks, The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama and the Mode of Excess, New Haven, Connecticut, 1995, pp. 24-25, 43.. C’est encore moins du journalisme-coup de poing. C’est un drame entre deux personnages, l’un des deux se méfiant de l’autre. En d’autres termes, et dans tellement de termes, Hamsterdam était une bonne chose. Nous comprenons que nous venons de voir la seule personne dans toute la série à même de se prononcer sur Hamsterdam et de dire que c’était une bonne chose – de dire aussi que l’ex-officier Colvin est bon.
Simon peut bien avoir quitté le journalisme, le journalisme lui ne l’a pas quitté. En lieu et place des cinq paragraphes d’un récit-coup de poing, il devait au final écrire une série à épisodes en cinq saisons dont le principal enjeu criminel – une vaine guerre contre la drogue – en contient une myriade d’autres. Ces enjeux ne sont jamais simples, ils sont multiples et entremêlés. Le crédit en revient à HBO au lieu du Baltimore Sun. Et au lieu du ton dissident d’un éditorial polémique, les voix des personnages fictionnels de tout le spectre urbain de Baltimore se dispersent dans un imaginaire ethnographique multi-situé dont la série mélodramatique montre, là où échouent la sociologie et l’ethnographie, à quel point « toutes les pièces comptent ».
***
Lecteurs et lectrices fidèles ou infidèles,
Débordements a le grand plaisir de vous annoncer la parution de son premier numéro papier. Celui-ci est en grande partie consacré au travail de David Simon. Pour en savoir plus, nous vous renvoyons à notre page de commande.
Toutes les images proviennent de The Wire.
Nous remercions amicalement Linda Williams de nous en avoir confié la traduction, à laquelle a également contribué Gabrielle Hardy.