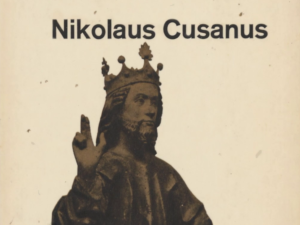Zinemaldia, 2022 (2/2)
Entretiens : Ann Oren & Laura Baumeister
Ann Oren, Piaffe con variazione
Le cheval de Muybridge piaffait-il ? L’animal continue d’hypnotiser les cinéastes, non plus seulement par la vue mais aussi par ses bruits. Si le mouvement de ses pattes est aussi décomposé que chaque image défilante d’un film, le son de ses coups de sabots saccadés contre le sol galope tout autant en rythme contre nos tympans.
Eva (Simone Bucio), bruiteuse professionnelle, cherche par tous les moyens à trouver les sons incarnant parfaitement le cheval pour une publicité de stabilisateurs d’humeur. Entre chaînes, colliers mastiqués, sable, chaussures en cuir et noix de coco, nous sommes plongés dans une fabrique à sons, rappelant l’importance d’un élément fait pour s’oublier, le bruitage. Ce travail, obsessionnel, devient une nouvelle peau pour Eva, jusqu’au jour où elle se réveille avec une queue de cheval, portée avec une élégance somme toute naturelle, lui conférant une nouvelle assurance. La rencontre avec un botaniste, Novak – dont le réemploi du nom de Kim Novak suppose un habile détournement des fétichismes incarnés par l’actrice dans Vertigo – poursuit cette identification cavalière.
Cristallisé dans ce moment d’excitation continue, où du cheval le trot est exigé mais le déplacement refusé, le film réfléchit sur la dialectique de pouvoir entre le cavalier et sa monture. L’un ne pouvant avancer sans l’autre, le contrôle est toujours une affaire de jeu où la domination est une affaire complexe. Oren déploie un magnifique ballet où les rapports de force dansent comme des champs de force magnétiques, entre attractions et répulsions, où ce duetto évolue dans un tema con variazione autour de cette allure de dressage. Un somptueux répertoire de nos Piaffe quotidiens.
Débordements : Piaffe peut être considéré comme un film queer, notamment à travers sa démarche de déconstruction des frontières du genre et de la sexualité. Cette portée politique était-elle à l’origine du film ?
Ann Oren : Le point de départ était purement artistique. Un jour j’ai rendu visite à un bruiteur, je trouve que c’est un métier passionnant et bien trop méconnu. Je me suis alors demandé ce qu’il adviendrait si mon personnage était une artiste-bruiteuse travaillant sur des sons non pour des humains mais pour un cheval. Tout ce qui arrive après, la relation amoureuse avec le botaniste, leur sexualité, tout cela est intrinsèquement queer. J’ai alors pensé au froeur non-binaire, Zara, qui était déjà le personnage de mon précédent court-métrage, Passage. Zara est un·e artiste bruiteur·euse en dépression nerveuse à cause de son travail. En rencontrant plusieurs bruiteurs pour mes recherches, l’un d’eux m’avait raconté qu’en débutant leur métier, il n’était pas rare de souffrir d’épisodes psychotiques. Ils travaillent seuls dans des pièces totalement silencieuses, créent des sons couche par couche, et lorsqu’ils sortent dans la rue cet excès de stimuli sonores leur paraît tellement brutal et violent.
Dans Piaffe, Zara tombe en dépression et c’est Eva, le personnage principal, qui doit le·a remplacer. Zara sert aussi d’alter ego, comme une sorte de gourou spirituel qui guide Eva. Elle cherche à trouver sa place dans le monde : ce ne pouvait être un homme ou une femme qui lui serve de mentor, j’ai donc songé qu’un alter ego non-binaire serait parfait.
Lorsqu’Eva commence sa liaison avec Novak, elle adopte une posture de soumission. En réalité, elle contrôle totalement l’échange. Je voulais justement jouer sur les rôles genrés dans les relations amoureuses, car ce sont des choses que j’ai très rarement vu au cinéma.
La queerness, c’est justement de pouvoir montrer tout le spectre que le désir peut revêtir.
D. : Piaffe est un film extrêmement ambitieux et singulier, comment avez-vous convaincu les producteurs de vous suivre ?
A.O. : Je viens des arts visuels, ce qui m’a compliqué la tâche car je ne connaissais pas bien l’industrie du cinéma. Le scénario est très proche du film : il comportait déjà des descriptions sonores assez poussées. Dès le départ, je savais que je ne voulais pas faire un film qui plairait à tout le monde, ça ne m’intéresse pas.
Mon court-métrage Passage était tourné en 16mm, et le personnage de Zara y apparaît pour la première fois : c’est un film plus abstrait. Il explore déjà cette idée du transfert entre l’animal à l’écran et le bruiteur, et toute l’obsession qui découle de cette recherche sonore. C’était un bon point de départ, même si en premier lieu je l’ai réalisé sans penser préparer un éventuel long-métrage. Passage constitue une sorte de prequel, un portrait de Zara. C’est un projet tout à fait indépendant de Piaffe. Mais cela m’a permis de le montrer à mes producteurs, les convaincant que Piaffe était la continuité logique.
Passage a beaucoup été montré en festival, ainsi que dans des expositions muséales où il tournait en boucle : je ne savais pas exactement à quel type de public ce film s’adressait, cela prend du temps de comprendre qui est son public. San Sebastián n’est que le second festival dans lequel nous montrons Piaffe – nous étions à Lorcarno avant –, mais j’étais persuadée que ce serait un film pour le cinéma : il est pensé pour être vu du début à la fin.
D. : Nous aimerions revenir sur les relations développées entre Eva et les autres personnages. Vous contrecarrez totalement le male gaze, et les relations de domination sont particulièrement singulières. On sent un héritage d’une culture BDSM, des pratiques à travers laquelle les individus s’attirent et se repoussent magnétiquement sans pour autant qu’une hiérarchie strictement verticale s’instaure.
A.O. : Tout à fait. Je parlais plus tôt de cette énergie, de ce désir circulant entre les êtres. Il y a quelque chose de magnétique qui attire ou repousse, un peu comme un aimant.
Les trois personnages principaux possèdent une connexion plus profonde.
D. : Autour de ces enjeux des relations de pouvoir et de domination, Foucault a-t-il été une inspiration ?
A.O. : Oui, je vois Foucault partout autour de nous. Notamment le médicament promu par la publicité sur laquelle travaille Eva, c’est un stabilisateur d’humeur. Ce genre de produit est très contemporain. Aux Etats-Unis passent à la télévision des publicités pour des produits disponibles sur ordonnance. J’ai vécu longtemps à New-York, et j’aimais regarder les publicités plus que je n’aimais la télévision. Mes préférées, c’étaient les pubs pour médicaments. Ça me fascinait de voir comment le bien-être était représenté afin de vendre davantage de produits. Ces comprimés, ce sont précisément une autre manière de contrôler les gens. Quand Zara fait une crise devant Eva, iel la blâme pour les effets secondaires que cause le médicament. On ne sait pas vraiment si Zara existe réellement et si iel est à l’hôpital à cause de sa dépression nerveuse, ou si le travail de bruiteuse pour cette publicité est en train de rendre folle Eva, la poussant à inventer ce frèr.oeur prenant lui-même ce médicament. Je souhaitais maintenir une ambiguïté.
D. : Sur ce sujet, nous souhaiterions encore creuser la relation entre Zara et Eva, qui se distingue totalement du lien qui se noue entre Eva et le botaniste. Zara apparaît comme un alter-ego, un double.
A.O. : Exactement, j’ai conçu Zara comme un alter ego. D’une certaine façon iels sont inséparables, d’où ces effets de surimpression à l’image réalisés sur le plateau. Cette scène est l’une de mes préférées. Dans une des scènes tournées à l’hôpital, on a fait des tests en filmant les deux acteurs principaux. L’éclairage rouge fait référence à Zara, et lorsque l’on voit Eva seule dans son appartement baignée d’une lumière rouge cela signifie la présence de Zara. Iels sont toujours lié.es. Beaucoup de films jouant sur le double m’ont marquée, c’est une thématique très visuelle. Je voulais qu’ils soient plus que des doubles, des sortes de dopple-gänger, presque comme des jumeaux.
D. : Le son est l’un des éléments centraux du film. Pour la musique vous choisissez des morceaux variés, allant de la techno à des mélodies acoustiques jouées au violoncelle. Pourquoi avoir choisi ces genres pouvant paraître diamétralement opposés ?
A.O. : Absolument. Je suis une grande fan de techno. Quand on regarde certains danseurs en club, cela m’évoque le mouvement de piaffer que les dresseurs apprennent aux chevaux. La musique techno provoque aussi une sorte d’euphorie, et le piaffer consiste à maintenir l’animal dans une frénésie constante. Les situations dans lesquelles Eva s’engage, notamment son histoire avec Novak, reposent sur une soumission apparente dissimulant son excitation. Toutes ces situations suscitent ces émotions que la techno condense à mon sens.
Quant au violoncelle, vous savez que l’archet est fait de crins de chevaux ? Cela m’amuse. Je voulais une bande son variée, le son des cordes me plaisait et je voulais quelques thèmes mélodiques. J’ai travaillé avec une violoncelliste. Elle a improvisé jusqu’à ce que ces mélodies s’approchent du personnage d’Eva.
Mis à part ça, ce sont les bruitages qui racontent le reste de l’histoire, et bien évidemment le silence. Le silence est tout aussi signifiant que les autres sons pour donner le ton.
D. : De manière générale, les sons avec lesquels vous travaillez étaient-ils enregistrés sur le tournage, ou s’agissait-il de bruitages réalisés dans le prolongement de ce travail sonore ?
A.O. : Le son a été enregistré sur place, c’était plus simple. Mais les bruits de train n’ont pas été pris en direct, il s’agissait d’autres enregistrements. Plusieurs sons sont en effet des bruitages, pour donner cette texture très particulière que je recherchais. Le travail avec mon chef bruiteur se rapprochait presque du travail de direction d’acteur pour obtenir ces résultats.
Je voulais que le spectateur prenne conscience de l’importance de cette profession : jusqu’aux années 1990, les bruiteurs n’étaient parfois même pas mentionnés au générique et peu de gens étaient au courant de l’existence du métier. Eva se tue à la tâche pour trouver ce son. Elle veut seulement faire du bon travail mais elle en devient presque folle. Quand on voit le rendu final, on se rend compte de la finesse de ce travail auquel d’ordinaire on ne prête même pas attention. Il m’était important de montrer la passion de mon personnage, la façon dont elle s’engage corps et âme dans la création.
J’ai beaucoup joué avec le souffle, notamment dans les scènes entre Eva et Novak, pour faire comprendre qui est le personnage principal. C’est un travail subtil, mais qui change totalement la façon dont les interactions entre les personnages sont perçues.
D. : La sexualité est montrée comme hybride, s’inspirant autant des végétaux que des animaux. Etait-ce une façon de réinventer les représentations du sexe au cinéma ?
A.O. : Oui, c’est ça. Il y a une dimension universelle, qui transcende les espèces. Nous sommes tous des êtres de désir. Depuis #metoo, les représentations de soumissions sont souvent mal interprétées, les gens en ont peur alors qu’il s’agît d’un jeu absolument consensuel. Dans ce cas précis, je n’ai pas voulu filmer une histoire d’amour : c’est une histoire de désir. Eva crée un fantasme autour de Novak. Au début toutes leurs interactions sont excitantes car sources de surprise.
Je trouve intéressant de montrer un personnage aimant la soumission, c’est une simple préférence. C’est aussi pour ça qu’elle accepte sa queue de cheval, comme si c’était la matérialisation de ce qu’elle est véritablement. Elle aime explorer son propre corps, et parfois l’acte sexuel consiste simplement à être regardée. Le shibari japonais n’est pas toujours lié à la sexualité, cela consiste plutôt à être attaché dans une position pendant une durée assez longue pour provoquer un semblant d’ivresse.
Concernant la sexualité au cinéma, on a l’impression d’avoir tout vu, plus rien ne choque. Je cherchais une nouvelle manière d’explorer le désir d’un point de vue cinématographique, de créer des scènes que je n’avais jamais vues avant. La queue est au cœur du désir, mais elle aurait pu être repoussante, tout dépend de la façon dont on la filme.
D. : Vous parliez plus tôt du rouge associé à Zara. La succession du bleu et du rouge saute aux yeux pendant le film. Est-ce toujours signifiant, ou s’agit-il parfois d’un choix purement esthétique ?
A.O. : Je crois qu’il s’agit plutôt d’un choix esthétique. J’aime beaucoup le rendu des films des années 1970, je trouve que certaines couleurs sont particulièrement vibrantes à l’écran. C’est vraiment mon imagination qui m’a dicté ce choix, tout comme la décision de tourner en 16mm pour l’atmosphère et le rendu très organique de l’image. Je voulais qu’on ait l’impression de pouvoir toucher ces images. Mon court-métrage Passage a déjà été tourné sur pellicule. J’avais bien perçu le changement radical d’ambiance sur le tournage. On ne peut pas se permettre de faire tant de prises que cela, toute l’équipe est encore plus concentrée.
D. : Comment le travail avec votre directeur de la photographie s’est-il déroulé ? Aviez-vous une idée très précise des plans que vous souhaitiez tourner, ou avez-vous accordé une place à l’improvisation sur le tournage ?
A.O. : Il n’y avait presque pas d’improvisation. Le train est un bon exemple d’élément que je désirais retrouver à l’écran dès le départ. J’avais des images mentales très puissantes, comme le plan où Eva court et sa queue oscille pendant le passage du train. J’ai été inspirée par la figure d’Isadora Duncan, une danseuse morte étranglée par son écharpe qui s’était prise dans les roues de sa voiture décapotable. J’avais des envies très spécifiques, et en tournant sur pellicule l’improvisation est d’autant plus compliquée. On s’en est beaucoup tenus au plan de tournage, et beaucoup de repérages ont été faits en amont. Six mois avant le tournage, j’ai commencé à chercher des lieux particuliers : c’est là que j’ai découvert ce jardin botanique à Berlin. J’ai eu beaucoup de mal à obtenir l’autorisation de tournage. Tout était compliqué, donc la plupart des éléments étaient prévus très à l’avance. Mais il y a des exceptions. Lors de la scène où Eva marche sur les quais près de l’eau avec des claquettes, nous devions initialement tourner dans l’autre sens, j’avais un cadrage particulier en tête. Mais lors du tournage, il y avait un sans-abri qui avait installé sa tente. Il a refusé de nous parler, alors nous avons changé le plan et cela fonctionnait encore mieux, avec ce grand graffiti.
Il paraît que Fassbinder ne se rendait jamais sur les lieux avant le tournage, parce qu’il considère que la rue et le décor changent sans arrêt, alors à quoi bon ?
Certaines choses étaient très précisément orchestrées. Pour le plan aérien, on a utilisé le plus gros modèle de drone disponible légalement en Europe : filmer sur pellicule suppose un matériel lourd. Je n’ai pas d’attrait particulier pour les plans au drone, mais pour capturer ce bâtiment en forme de fer à cheval il est nécessaire de prendre de la hauteur. Des moyens importants sont exigés : le temps de faire monter le drone on perdait déjà près d’une minute de pellicule.
D. : En termes d’effets spéciaux, la phase de post-production a-t-elle été déterminante dans la fabrication du film ? Ou avez-vous privilégié les trucages et effets pendant le tournage avec la caméra ?
A.O. : C’est une bonne chose que vous posiez la question, parce que ça signifie que ce n’est pas évident de voir les ficelles du film. C’est une artiste spécialisée dans l’univers des perruques qui s’est chargée de créer la queue – elle avait déjà travaillé sur Passage. Le personnage de Zara porte d’ailleurs une perruque, car iel est chauve dans le court-métrage. La queue a été faite à la main, pour être parfaitement adaptée à la morphologie des acteurs. On n’a pas utilisé tant d’effets numériques, j’avais dit à mon chargé d’effets spéciaux que si son travail se voit, c’est mauvais signe : on aurait perdu le public, le spectateur se sent trompé quand il peut déceler que c’est du numérique. J’ai aussi envisagé le recours à l’animation, mais une amie travaillant dans ce milieu m’a plutôt conseillé de le filmer physiquement et le plus près possible. Le rendu en serait bien plus convaincant. C’est intéressant de voir un travail d’artisan, fait à la main et non à l’ordinateur.
D. : Un peu à la façon de David Cronenberg ?
A.O. : Oui tout à fait ! Quand nous étions au festival de Locarno, certains membres du jury jeune m’ont fait une remarque qui m’a beaucoup touchée, en comparant Piaffe aux premiers films de Cronenberg. Ça m’a touchée parce que je ne savais pas quel accueil votre génération allait réserver à ces effets spéciaux un peu sans âge.
Je n’avais jamais conscientisé ce lien avec l’œuvre de Cronenberg, bien que ce soit une influence indéniable. On pense savoir où on se positionne avec son travail, mais cette posture est toujours perçue différemment et enrichie par le regard du public.
D. : Au début de votre film, le ton utilisé nous évoquait beaucoup le burlesque, comme dans les œuvres de Chaplin ou Keaton. Le peu de mots, la façon dont tout le sens et le comique sont véhiculés par le corps, cette construction était-elle intentionnelle ?
A.O. : Je vois ce que vous évoquez. Je n’imagine jamais des personnages bavards, j’ai coupé plusieurs scènes parlantes : je trouve que les scènes muettes ont une intensité très puissante. Et de manière personnelle, je suis lassée des films saturés de dialogues. C’est parfois très bien réalisé, mais ce n’est pas quelque chose qui m’attire. Ce qui me charme, c’est sentir un lien se nouer ou se rompre entre les personnages sans aucune parole superflue. On accorde plus d’importance au langage corporel, au regard.
L’influence de Jan Švankmajer a été fondamentale, notamment son film Les Conspirateurs du plaisir. Il travaille surtout avec de l’animation, mais ses films y mêlent aussi des prises de vue réelles. Ses personnages sont souvent travaillés par une obsession, et en tant que spectateur on s’identifie d’autant plus car chacun possède ses propres névroses. Ça a été une influence primordiale.
D. : Ce sentiment de burlesque vient d’une sorte d’intemporalité qui se dégage du film. L’histoire paraît à la fois hors du temps et contemporaine, avec la musique techno.
A.O. : Le film sera forcément marqué par ma vie, je ne peux pas m’extraire du monde qui m’est contemporain. Cette subjectivité initiale constitue un matériau premier qui ne peut être évacué. Mais je voulais créer des images qui n’appartiennent pas au registre visuel moderne. Je voulais aborder la façon dont la technologie nous isole, et ce que ça implique d’exister en étant différent.
Laura Baumeister, L’enfant des détritus
Avec La Hija de todas las rabias, Laura Baumeister signe un premier long-métrage qui marque une avancée indéniable pour le cinéma sud-américain en étant le premier long-métrage de fiction réalisé par une femme nicaraguayenne. Sociologue de formation, Baumeister filme le quotidien de Maria et de sa mère Lilibeth, qui habitent dans un taudis près d’une immense décharge à ciel ouvert. Lilibeth fait le commerce des déchets qu’elle ramasse et emmène jusqu’à la ville voisine, tandis que Maria explore ces montagnes de détritus pour y dénicher de rares trésors. La relation fusionnelle entre la mère et la fille constitue l’unique point d’ancrage de ce récit traversé de violence. Assoiffées de liberté et d’indépendance, les deux femmes renouent avec une animalité enfouie que le désastre écologique n’a pas encore anéantie. La mère lionne et la fille fauve errent entre le slum et la jungle, dans cet espace limite entre le réel et l’onirisme.
Débordements : Concernant l’aspect fantastique du film et la métamorphose de la mère, le voyez-vous avec une approche perspective chamanique en référence à un folklore en particulier, ou bien est-ce se situer dans le sillage du réalisme magique, à l’instar de Gabriel García Márquez qui développe le dialogue entre les vivants et les morts ?
Laura Baumeister : Non, il n’y a pas de référence directe à un certain folklore ou à des mythes propres à mon pays. L’hybridation entre animaux et humains est présente depuis la Grèce antique, l’Empire romain, les Celtes, les Mayas avec des hybridations de coyotes… Les mythes racontés par l’humanité ont à voir avec des êtres hybrides. L’hybridation est certainement dérivée de la plupart de nos relations avec les animaux, mais à mon sens, la modernité nous a complètement éloignés de cette relation dans notre rapport au monde. Nous avons tellement confiné la relation humain/animal au fantastique qu’elle nous est devenue étrangère. Ainsi je veux mettre à nouveau sur le devant de la scène, cette relation entre humains et animaux pour m’approprier ces hybridations qui ne sont pas uniquement réservées aux Marvel, Avengers et aux comics.
Bien au-delà du simple aspect de chimère, il y a quelque chose qui nous invite à penser notre apprentissage du monde en associant ceux des humains et des animaux. C’est un parti-pris qui refuse la pureté, où l’incorporation de l’humain et de l’animal produit une certaine richesse. Je prends les forces vitales de l’animal, et celles de l’humain pour créer le minotaure.
Mais actuellement, ce que je raconte est d’une manière intellectualisé, mais tout vient de ma fascination pour les êtres vivants, depuis mon enfance. Je me souviens des membres de ma famille et d’instants grâce aux êtres vivants qui les entourent : par exemple, l’arbre dans le jardin de ma grand-mère, son chien… Mon expérience personnelle est imprégnée par leur présence. Il fallait qu’ils soient protagonistes. Cela constitue certainement une ligne directrice dans mes films à venir.
D. : En effet, dans le film seuls les enfants communiquent avec les animaux.
L. B. : Bien sûr. Le monde moderne nous a tellement éloignés de la nature, qu’on oublie d’en faire partie. Nous sommes avant tout des mammifères. Avant d’être homo sapiens nous sommes mammifères. Il y a un grand nombre d’espèces qui nous ressemblent. Dans leur constitution, dans leur façon de se reproduire, la maternité et les façons d’élever nos enfants. Les enfants ont instinctivement ce lien avec les animaux, mais rapidement on apprend que le chien ne doit pas compter autant pour nous.
D. : Vous pensez donc que les images peuvent réhabiliter et réactiver notre lien avec le vivant ?
L. B. : Oui, je l’espère. Le plus important, à mon avis, est de montrer la destruction de la nature. Une image de décharge à ciel ouvert n’a pas d’équivalent. Cette décharge à la vue de tous, je la comparerais avec une mine à ciel ouvert ou une marée noire en pleine mer, des lieux et actions significatifs et alarmants quant à la destruction de la planète. Leur effet néfaste ne peut être mis en doute. Je voulais montrer cette destruction à l’œuvre, mais pour moi la seule manière de freiner cette destruction, c’est de renouer avec la nature. Renouer en ayant une connexion profonde et sensible avec le naturel, pas un simple « je vais arroser ma plante ». La mère de María veut atteindre ce stade bien plus profond, jusqu’à ce qu’elle puisse être en paix, se concevant mère en tant que femme-chat.
D. : Cette transformation se fait petit à petit, elle n’arrive pas d’un seul coup. Au vu de la portée écologiste du film, je me demandais si sa transformation ne pouvait pas être interprétée comme une mutation due aux déchets et aux produits toxiques qui l’entourent ?
L. B. : Figurez-vous que je n’y avais pas pensé ainsi, mais ça pourrait en effet être une voie d’interprétation ! La femme-chat est une raison justifiant la disparition de la mère de María. María doit croire que sa mère ne l’a pas abandonnée ou que sa mère est morte, c’est une information bien trop douloureuse pour une enfant de cet âge, en plus des duretés de son quotidien. Il est nécessaire de lui conférer cet aspect fantastique. Elle voir la mutation en femme-chat comme une forme de renaissance.
D. : En parlant de la fluidité des apparences, l’aspect androgyne de l’enfant était-il intentionnel ?
L. B. : Absolument. L’allure d’Ara m’a tout de suite plu, mais ce qui m’a fait chavirer, c’est sa voix. J’ai senti qu’elle avait déjà une dualité en son sein : elle a l’aspect d’une petite fille, avec une voix très grave. Elle est parfaite pour le rôle car elle-même est double, ce n’est pas un cliché pur de représentation de l’enfance. Il fallait qu’elle ne soit absolument pas canonique ou pure. Nous lui avons même coupé les cheveux, pour qu’elle puisse incarner à la fois des qualités habituellement liées au masculin et au féminin, toujours dans la dualité.
D. : Comment s’est déroulé le travail avec les actrices, y avait-il une recherche de fusion entre les deux ?
L. B. : C’était très intense, très intuitif et très physique. Une relation si intime entre une mère et sa fille, semblable à celle d’une jument avec sa pouliche, doit passer par les corps. Le corps de la mère est une extension de celui de l’enfant et vice-versa. Il n’y a pas de séparation entre elles. Seuls la confiance et le temps rendent cela possible. Elles ont passé beaucoup de temps ensemble. Nous étions là pour les accompagner et les guider, tout en supprimant certaines barrières qu’il pouvait y avoir. La préparation avant le tournage était intense : pendant deux mois on se voyait cinq heures par jour, du lundi au vendredi.
J’accorde une importance extrême aux gestes des actrices. Un roi touche les choses d’une certaine manière, un enfant d’une autre et un enfant dans un contexte sauvage et défavorisé le fait d’une autre façon. Je voulais qu’elles développent des gestes en accord avec la réalité de leurs personnages. Beaucoup de répétitions, d’improvisations en plus d’actions du quotidien comme regarder un film, cuisiner ensemble, prendre des cours de natation…
C’est particulier de travailler avec des enfants. Il faut toujours songer à sa position, quand intervenir, que dire, pour ne pas perdre l’enthousiasme apporté spontanément. Il faut toujours les maintenir en activité pour ne pas les ennuyer.
D. : C’est impressionnant, surtout au vu des difficultés que vous avez pu rencontrer pour produire le film et trouver des subventions, dans le contexte politiquement instable du Nicaragua…
L. B. : Je pense qu’un des grands enseignements de la réalisation de ce film, c’est à quel point les difficultés ont été un moteur essentiel dans sa réalisation. Plus on me met des bâtons dans les roues, plus mon envie grandit. Au fur et à mesure on commence à créer un ensemble de personnes qui croient en notre projet, d’où les nombreuses origines de subventions, venant de sept pays différents.
Concernant le Nicaragua, bien au-delà de l’instabilité politique, il n’y a ni industrie établie, ni structures de subventions claires et définies. C’était compliqué, car il fallait trouver des subventions externes, à l’international, en plein milieu de la pandémie. Cependant, l’idée du film a surpris les gens et les a poussés à mener à bien le projet.
Je me rassure en me disant que les pays européens, comme la Norvège ou la Finlande par exemple, n’avaient pas de structures propres de financement dédiées au cinéma, comme au Nicaragua aujourd’hui. Mais avec le temps elles ont fini par exister ! En cherchant des fonds à droite et à gauche je n’ai pas l’impression de faire quelque chose de nouveau dans l’histoire du cinéma ! (rires)
D’autant plus si on regarde le cas du Pérou où la filmographie nationale est aujourd’hui de plus en plus importante, des festivals existent avec des structures de production, certes modestes, mais fortes. Or, il y a une quarantaine d’années c’était le désert, comme au Nicaragua ! Il faut juste s’atteler à la tâche.
D. : Est-ce que votre film tente de faire écho avec la situation politique instable du Nicaragua, en instaurant un climat dystopique autour de l’abondance et la gestion des déchets ?
L. B : Oui, je voulais créer une ambiance dystopique, mais certainement pas pour mettre le spectateur en retrait du présent. C’est plus qu’actuel et le Nicaragua n’est pas le seul concerné, toutes les villes du monde ont leur décharge. C’est tragique.
D. : Y a-t-il une référence aussi au commerce de la poubelle qui par exemple est très significatif en Chine ?
L. B. : En effet, la Chine achète des cargos remplis de tonnes de déchets pour ensuite les réutiliser en matière première. La gestion des déchets est un secteur qui fait circuler beaucoup d’argent, à échelle mondiale. Au Nicaragua, le lac Cocibolca, un des plus grands lacs d’Amérique centrale est entouré de déchets. Tout le paysage est contaminé par les déchets. C’est tragique, mais une des choses qui unit l’humanité c’est la poubelle. Nous produisons tous des déchets. Donc la dystopie est présente uniquement dans le ton, avec une ambiance de fable, mais certainement pas pour que le spectateur pense que ce qu’il voit n’existe pas.
D. : Au-delà de la dystopie, il y a aussi la représentation de la rébellion et de mouvements de contestation, autour de la décharge et de la vente des déchets pour l’incinération.
L. B. : Je viens d’un pays avec une culture politique de profonde instabilité et d’injustices. Pour autant je ne voulais pas entrer spécifiquement dans le débat autour de la privatisation de la gestion des déchets, pas présent au Nicaragua, même si au Mexique cela a fait rage. Je voulais présente la contestation, mais je ne voulais pas non plus l’inclure dans une conjuncture particulière, car elle n’est pas permanente. Je cherche à avoir un discours et un propos au-delà de simples faits d’actualité.
D. : Je me posais la question de la symbolique attachée autour de la panthère et son association à la féminité. Il semble que vous renversez les clichés habituellement admis dans cette comparaison, pour au contraire présenter une prise de pouvoir ?
L. B. : La panthère est un félin puissant, solitaire. C’est un chasseur nocturne. Il y a une relation directe avec les façons dont on peut renaître, surtout dans un contexte semé d’embûches. On peut renaître avec force, dans un être qui fait face aux choses. L’association des femmes avec les félins est toujours en lien avec le sexe ou la sorcellerie. Ça n’est pas le cas pour moi. La féline, c’est la cheffe de meute, celle qui sort de l’obscurité pour chasser et se fondre dans la pénombre. Pour arriver à ces effets d’ombre nous avons peu recouru à des effets spéciaux numériques. Sa peau a été recouverte de cendres. Avec ma maquilleuse, Eva Rabina, nous avons fait énormément d’essais et quand on en est arrivées à trouver la technique de la cendre j’étais d’autant plus ravie, car cela faisait écho avec des idées de renaissance et la symbolique du phénix.