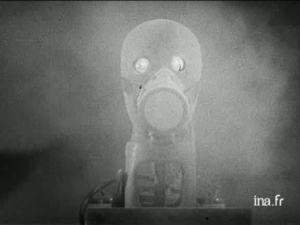À la vie, Aude Pépin
L'intime est politique
Après avoir été, selon les mots de sa réalisatrice, « un bébé gardé longtemps au chaud » à cause de la fermeture des salles, le premier film de l’actrice et journaliste Aude Pépin a commencé sa tournée en France, accompagné de la cinéaste et de sa protagoniste, l’époustouflante Chantal Birman. C’est lors d’une avant-première bordelaise, dans le cadre de la compétition internationale du Festival International du Film Indépendant de Bordeaux (FIFIB), dans une salle comble, peuplée majoritairement de femmes de tous âges, que j’ai rencontré ce film et celles qui l’ont fait. À ma gauche, une femme enceinte, à ma droite, une rangée d’étudiantes en puériculture. Toutes étaient venues découvrir des images et des mots longtemps tus, longtemps réservés aux conversations des concernées, longtemps gardés pour soi, et cette fois livrés publiquement sur un écran de cinéma. À la vie est de ces documentaires qui rappellent une indispensable vérité : l’intime est politique.
L’on y suit les visites à domicile d’une sage-femme proche de la retraite, Chantal Birman, chez des femmes en plein post-partum. Il est question de la santé de leurs bébés, mais surtout, et c’est là tout l’enjeu, de la santé de ces jeunes mères, de leur épuisement, leurs doutes, leurs douleurs, leur dépression. Aude Pépin et son équipe, Sarah Blum à l’image (secondée parfois d’Emmanuel Gras) et Claire-Anne Largeron au son, sont parvenues à saisir des moments d’une intensité rare, d’une intimité bouleversante. La caméra adopte une distance mesurée, se rapprochant souvent au fur et à mesure, ne voulant rien brusquer. Le sentiment d’avoir affaire à des images et des paroles rares, inédites, celles de femmes qui pleurent, en proie à une fatigue extrême, au vertige de leurs responsabilités et aux bouleversements infligés à leurs corps, nous met face à l’évidence d’un trop plein : celui des images d’une maternité allant de soi, épanouie, heureuse et auto-suffisante. À la vie capte et transmet de véritables images manquantes[11][11] Cette expression renvoie notamment à l’ouvrage collectif éponyme publié par Les Carnets du Bal (n°3) et dirigé par Dork Zabunyan en 2012, suite au séminaire organisé sur le sujet à l’EHESS en 2011. Dork Zabunyan y propose de distinguer les images manquantes ainsi : « les images qui n’ont jamais existé, celles qui ont existé mais ne sont plus disponibles, celles qui ont rencontré trop d’obstacles pour pouvoir être prises ou enregistrées, celles que notre mémoire collective n’a pas retenues »., l’angle mort des représentations de la natalité. Avait-on déjà vu au cinéma des gros plans de tétons pressés par les doigts d’une mère peinant à faire téter son enfant ? Probablement pas, et cela est d’autant plus frappant que dans notre environnement médiatique, les tétons de femmes disparaissent sous la censure d’algorithmes tels que celui employé par Instagram. Et pourtant, ce geste est aussi vieux que l’humanité… Toutes ces scènes ne nous sont néanmoins pas jetées au visage comme des cris de douleur : à chaque situation, les mots à la fois apaisants et fermes de Chantal Birman nous rappellent leur banalité sans jamais nier leur gravité. Le personnage de Chantal est une passeuse, elle passe de femme en femme, d’une maison cossue à une haute barre HLM, d’un discours sur la nécessité de penser l’enfant comme un être prochainement indépendant, à un autre sur celle de ne pas rester seule. De nombreuses séquences musicales où elle circule au volant de sa voiture permettent de digérer les émotions charriées par le film, de faire résonner les mots échangés, de se préparer pour les prochains.
Dans le dialogue qui s’établit entre Chantal Birman et ses patientes, la caméra se pose souvent à côté de la sage-femme, privilégiant la continuité par de longs plans plutôt que du champ contre-champ. Ce dispositif qui tend à faire passer souvent la sage-femme hors-champ permet de mettre en place la rencontre des spectateurices avec ces femmes. Ces plans souvent frontaux mettent en valeur l’effet des paroles de Chantal Birman sur ces mères, soulignant la diversité de leurs expressions et une commune dignité qui trahit la conscience de la caméra, mais surtout la force et la maîtrise de soi caractéristiques d’une socialisation en tant que femme. La caméra d’Aude Pépin capte ainsi les lèvres serrées d’une femme qui répète « ça va » alors qu’on lui retire les agrafes de sa cicatrice de césarienne, le sourire d’une autre qui avoue sans flancher « c’est dur, oui » alors qu’elle vient de dire que son mari est absent et qu’elle ne voit jamais ses deux premiers enfants, partis avec lui. Le portrait de Chantal Birman, dont on apprendra peu de la vie privée, se construit d’abord à travers la mise-en-scène de son métier de sage-femme comme témoin, au sens de « celle qui a vu et entendu » comme au sens de « ce qui se transmet ». Elle permet à Aude Pépin et son équipe, comme à nous, spectateurices, de voir à notre tour, et d’apprendre. Une figure d’apprenante est en outre fort utile à la dramaturgie du film : Hortense, la stagiaire de Chantal. D’observatrice, elle passe à actrice, osant prodiguer des conseils sur l’allaitement, et faire part à Chantal de ses interrogations concernant l’avortement.
Le film assume un point de vue admiratif, qui rend hommage à un travail indispensable et réalisé avec dévotion en permettant aux spectateurices d’en constater les bienfaits. C’est aussi par l’insistance sur les visages attentifs des apprenantes sage-femmes que le montage souligne la transmission d’une expérience et d’une parole. Chantal Birman, au seuil de la retraite, laissera désormais place à ces jeunes femmes séparées d’elle par plusieurs générations. La quasi-absence des hommes, si elle souligne l’inégale prise en charge de la natalité, construit toutefois un espace de non-mixité propice à la mise en circulation d’un témoignage et d’un savoir entre paires. Cette séquence face aux étudiantes met en scène une verticalité du savoir, puisque c’est Chantal Birman qui parle. Cependant la réalisatrice choisit d’isoler un moment où celle-ci rappelle que l’avortement est un acquis récent à protéger, mettant l’accent sur l’importance du chemin parcouru, la redevance des femmes à l’égard des luttes de leurs aïeules. Cette verticalité est en outre contrebalancée par deux moments : celui lors duquel trois étudiantes confient leurs difficultés, en particulier le manque d’effectifs en salles de naissance, l’absence de prise en compte globale de l’état de la mère dans leur formation, et de suivi post-accouchement ; et la séquence lors de laquelle Chantal tient à remercier Hortense à son tour.
Les déplacements de Chantal et son apprentie sont l’occasion d’échanges qui permettent d’opérer un recul sur les pratiques montrées dans les séquences avec les mères. Quand Hortense déplore l’absence de tout espace pour un commentaire sur l’état d’esprit de la mère dans les formulaires informatisés que les sages-femmes doivent remplir à l’hôpital, le film met en évidence la déconnexion entre la parole des praticiennes et les conditions qui leur sont imposées. Ces échanges avec Hortense, mais aussi avec d’anciennes collègues, montrent la ferveur militante de Chantal, l’insécable liaison entre son métier et la lutte féministe. Son engagement résonne lorsqu’elle déclare par exemple « lorsque j’ai vu, au début de ma carrière, des femmes risquer leur vie pour se faire avorter, j’ai su qu’entre la vie et la mort, les femmes choisissent toujours la liberté », ou encore lorsqu’elle raconte qu’elle-même avortait sur la table où quelques minutes plus tard, elle aidait une femme à accoucher, secouée des mêmes contractions. C’est cette flamme-là aussi, celle de la lutte, qu’Aude Pépin semble chercher à transmettre. Et c’est pourquoi elle clôt son film par une parole de remerciement, de colère et de courage, celle d’une patiente dont Chantal Birman écoute le message dans sa voiture. Cette parole, qui n’est pas celle de la protagoniste, semble traduire le point de vue de la réalisatrice et éclairer le projet du film. Le dernier mot de ce message sera d’ailleurs aussi le dernier du film : « sororité ».
Ce mot a résonné dans toute la salle lorsqu’une fois le générique lancé, une standing ovation de dix minutes a accueilli l’entrée sur scène de la réalisatrice et sa protagoniste. Natacha Seweryn, responsable de la programmation du FIFIB, émue par ce succès, confia à quel point ce geste de programmation avait semblé « nécessaire » lors du choix des films en compétition. Auréolé du prix du meilleur film à l’issue des délibérations, leur choix a semble-t-il été confirmé par le jury composé d’Anna Mouglalis, Ludovic et Zohran Boukherma, Charline Bourgeois-Taquet, Diane Rouxel et Marie Papillon. Programmer et primer ce film est une forme d’engagement féministe, c’est reconnaître le besoin collectif de montrer ces images manquantes, de reconquérir le territoire cinématographique trop longtemps (et encore largement) occupé par le male gaze. Sous l’impulsion de sa programmatrice en cheffe, le festival consacrait d’ailleurs une rétrospective (en sa présence) à celle qui inventait cette notion en 1975, Laura Mulvey. Défendre ce film, c’est aussi reconnaître la valeur d’un travail documentaire guidé par le respect et l’admiration pour une autre femme, une mise-en-scène guidée par la bienveillance et la conviction, et reconnaître ce travail comme tout aussi valide qu’un dispositif maniériste aux images léchées. La sélection et le prix décerné à À la vie semblent confirmer l’évidence suivante : la programmation est politique. Elle peut donc être assurément féministe.
Photographie : Sarah Blum, Emmanuel Gras / Son : Claire-Anne Largeron / Montage : Carole Le Page / Musique : Benjamin Dupont
Durée : 78 minutes.
Sortie le 20 octobre 2021.