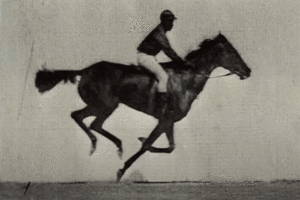À perdre la raison, Joachim Lafosse
Cause perdue
Partant d’un fait divers qui a « choqué » la Belgique, Joachim Lafosse et ses scénaristes ont construit une fiction (un carton y insiste à la fin – soit l’inverse de bien des films récents adaptés de faits divers, où l’on fait « témoigner » par leur présence les personnes réelles), une fiction, donc, qui semble guidée par cette idée simple : devenir fou, c’est devenir étrange pour les autres, et étranger à soi-même. Plus simple encore : étranger s’entend au sens de la nationalité ou de la culture. Murielle désire devenir Marocaine, nationalité d’origine de son mari, Mounir, avant son adoption dans des circonstances “mystérieuses” par le Docteur Pinget. C’est cela sa folie – c’est du moins ainsi qu’elle se manifeste.
Bien sûr, le film n’expose pas la chose de cette manière. Pas tout à fait, pas aussi grossièrement. Elle devient folle et elle se met à porter des habits marocains. Ces deux choses sont séparées, elles coexistent mais n’ont rien à voir. Comme dans tout fait divers, il y a un rapport de causalité troublé, un ordre des choses court-circuité et qui par là même provoque la stupéfaction : « Elle enfile une djellaba pour poignarder à mort ses quatre enfants. »[11][11] Voir, sur les rapports de causalité dans le fait divers, genre auquel le film emprunte : BARTHES Roland, “Structure du fait divers“, Médiations, 1962. Si Le Nouveau Détective faisait de la critique de films, voilà une accroche qu’il aurait pu trouver. Et, en cela, il aurait été plus perspicace que la plupart des critiques…
Comment ne pas prêter attention à ces signes qui sans cesse nous interpellent, s’imposent à notre attention ? Le film tente de gagner son rythme par l’ellipse tout en restant factuel. Comment alors faire passer l’information que doit recéler chaque scène, chaque plan si bref soit-il ? Par un geste, un regard, un mot. En somme, il faut guider le spectateur – lui faire voir ce qu’il y a à voir, et rien d’autre. C’est probablement l’une des fonctions de ses constantes amorces qui floutent les bords latéraux du cadre : concentrer l’attention, focaliser le regard. La subtilité narrative revendiquée ne masque pas très bien un didactisme de l’image, une attention constante à ce que le sens ne se perde pas. Plongé dans un monde soumis au paradigme indiciaire, pour reprendre le concept de Carlo Ginzburg, le spectateur jouera, selon son goût, à Sherlock Holmes ou à Freud. Et après tout, le quadruple infanticide est donné dès le départ : quatre cercueils blancs sont embarqués dans un avion pour le Maroc, à la demande de la mère. Il doit donc bien y avoir des signes avant-coureurs, des choses qui permettent de voir le drame venir.
Remontons, avec Joachim Lafosse, le fil des évènements. Tentons de combler cet « abîme d’horreur » que la succession des plans des petits cercueils immaculés et de Mounir et Murielle en pleine relation sexuelle n’aura pas manqué d’ouvrir (c’est ce qu’il convient d’appeler, le réalisateur y croit, une « audace narrative »). Mounir et Murielle se rencontrent, s’aiment, ils vont se marier. Pinget, perspicace mais a priori hors de propos, pose d’emblée la question : « Et la différence de culture, ça posera pas de problème ? » Mounir répond que non. Ils se marient donc. À l’église. Avec des youyous à la sortie. Mariage mixte, rencontre des cultures. Il faut néanmoins prendre garde au point de coupe du plan et de la scène : il s’appuie sur un mouvement de tête et un regard agacé de Pinget pour la mère de Mounir, qui fait durer ses youyous un peu plus que nécessaire.
Pinget a l’amour des Autres (on reviendra sur cette majuscule) un peu rugueux. Lorsque les enfants du couple deviendront trop bruyants, il n’emploiera pas par hasard le terme de « smala ». Il n’hésitera pas non plus, quand Murielle aura fait de la fatale djellaba son habit quotidien, à lui dire qu’elle est « ridicule là-dedans ». Sans doute n’est-il pas exagéré de voir une condescendance “coloniale” dans les rapports de Pinget à la famille de Mounir. Cela lui revient cher, mais ce dernier n’est rien de plus qu’un domestique comblant sa solitude en remplissant quelques tâches administratives. Là-où-c’est-donc-qu’est-l’os-hélas, c’est que le couple et les enfants vivent sous le toit et la dépendance affective autant que financière du Doc. Les rapports de domination sont dans un premier temps assez troubles. Mounir est montré comme l’élève de Pinget – il le fait réviser pour son diplôme -, mais Murielle est enseignante. Les deux scènes s’enchaînant, elles fonctionnent par contraste. Mounir est dépendant comme un enfant, Murielle autonome – elle aussi fait la leçon. Il y a de même une insistance quant à l’attrait – jamais tout à fait concrétisé – du docteur pour la jeune femme. Mounir, lui, la violera sur le lit de Pinget – trouvant sûrement là un moyen d’affirmer son autorité.
Ce noeud de relations perverses évolue, d’une manière globale, en se resserrant autour de Murielle. La relation Pinget-Mounir n’est jamais problématisée. Elle est problématique, certes, mais aucun conflit n’éclate. Mounir disparaitra d’ailleurs quasiment durant la dernière demi-heure. Murielle, donc, est le centre du film, c’est par et à travers elle que va s’exprimer le malaise. Anodins d’abord (mais c’est bien parce qu’il est anodin en comparaison de la « monstruosité » d’un acte qu’un signe fait signe dans le fait divers où, d’ailleurs, il ne saurait y avoir de simples objets, mais toujours des machines à susciter du sens), les signes sont tellement insistants que nous sommes bien obligés d’y prendre garde. C’est d’abord, au moment où Mounir ne souhaite pas s’occuper de sa fille, la présence massive d’une couscoussière en étain (très typique, usée, peut-être même bosselée). Murielle, deux enfants déjà (ou trois ?), devient la bonne épouse de son mari, toute entière dévouée aux tâches domestiques. Mari qui, sur les conseils de Pinget, décide de s’échapper du cocon familial quelque temps pour aller voir sa mère au Maroc. La discussion a lieu au hammam, bien sûr. À son retour, sans qu’on sache bien pourquoi, Mounir s’emportera contre sa fille. L’atavisme, probablement. Entre deux accouchements (la première s’appelle Jade, les suivants ont des prénoms arabes), Murielle lave le linge, astique le mobilier. Sa dernière tenue de grossesse hésite entre la robe de bure et la burqa. Un cadeau de la mère de Mounir règlera l’affaire, ce sera la djellaba.
Avec une constance jamais démentie, le film avance, un signe après l’autre, non l’existence commune des deux cultures, leur entrelacement et la négociation qu’il peut y avoir au sein d’une famille sur tel ou tel aspect de la vie quotidienne, mais l’acculturation (délirante) de Murielle. Mounir n’est pas traditionaliste, il ne l’incite à rien – et passés les quelques détails mentionnés, on pourrait dire qu’il devient simplement un beauf (assez violent). Le film pourtant construit ses moments forts sur des points de passage entre les cultures – comme autant d’indice de la progression de la folie de Murielle. Le premier survient lorsque celle-ci déballe le cadeau que lui a offert sa belle-mère. Malgré le repas qui a lieu sur la terrasse, elle s’isole, à l’intérieur. Le plan est fixe, long, sans zone de flou, l’ouverture du paquet dramatisée par la durée. Elle se déshabille alors, et lentement, comme malgré elle, enfile la djellaba qu’elle ne quittera plus ou presque. Le second passage, définitif en quelque sorte, arrive juste avant le meurtre des enfants, lorsqu’elle téléphone à sa psy pour lui demander de l’aide. Pour la seule et unique fois du film, son nom d’épouse est donnée – et donc aussi celui de Mounir, qui n’apparait au générique que par son prénom[22][22] Un nom arabe que nous ne parvenons pas à retrouver dans les génériques disponibles sur Internet….
Pourquoi prononcer ce nom à ce moment-là, si ce n’est pour en faire un sésame, le signe ultime de ce qui s’est détraqué ? Pourquoi faut-il que chaque étape de l’évolution du personnage féminin soit marqué d’un signe d’ « arabité » ? Deux scènes, en écho, insistent sur la limite de cette métamorphose. Au bled, Murielle invite la mère de Mounir à se baigner. Celle-ci se laisse entraîner, puis résiste, cède de quelques pas avant de sortir de l’eau. L’autre se déroule à l’aéroport. La mère ne se sent pas bien en France, elle a vu la mort en face la nuit précédente. Avant de prendre l’avion qui la ramène au Maroc, elle étreint sa belle-fille, l’embrasse, ne se résout à la quitter. Elle lui parle, comme d’habitude, en arabe. Pour la seule fois du film également, personne ne lui fera la traduction – Mounir insistant : « ça sert à rien, elle te comprend pas ». La mère comme Murielle font alors l’épreuve d’une altérité posée, par le film, comme radicale (le grand « Autre »). Peu importe ce qu’elle fait, Murielle ne sera jamais une “vraie Marocaine”.
Pourquoi cette fixation ? Pourquoi la folie emprunte-t-elle ce chemin (si tant est que, comme le suggère cette formulation, elle pré-existe à celui-ci) ? Il n’y a pas de réponse : la folie de fait divers laisse sans voix ceux qui se font fort d’en parler. Risquons cette hypothèse : il s’agit d’un moyen d’expulser, en devenant « étranger à soi », l’étranger qui soude et détruit leur famille, le docteur Pinget – une manière de résoudre le passif « colonial » que Mounir ne parvient pas à affronter. La première solution qu’envisage Murielle n’est-elle pas de déménager au Maroc ? Mais cela n’est, à proprement parler, pas dans le film, et ce serait encore une manière insidieuse de “culturaliser” Mounir, qui ne revendique pas son origine. À perdre la raison préfère s’achever sur une disjonction du son et de l’image : un plan fixe de la maison, avec la voix, proche, de Murielle téléphonant à la police pour avouer ses meurtres. Derrière l’apparente banalité se cachent donc des drames invraisemblables. Cette morale de journal télévisé se décharge des représentations avec lequel le film a joué durant toute sa durée, laissant un amas de signes tout prêt à se raccorder à des allégories plus ou moins douteuses. Il ne s’agit pas d’accuser les auteurs de racisme latent, mais de poser des questions simples et concrètes sur la manière dont ils ont construit leur récit, dont ils ont fait de cette histoire un champ de signes, et de celui-là un champ de significations potentielles. Et, enfin, de constater que la fiction[33][33] Nous insistons, à l’instar du carton final : non le fait divers dans sa supposée objectivité, mais ce que Lafosse y a vu et ce qu’il a construit à partir de ce matériau. aura écarté toute possibilité d’action émancipatrice pour le principal concerné, Mounir. Un homme qui, faut-il le rappeler, n’a pas de nom.
Scénario : Thomas Bidegain, Joachim Lafosse, Matthieu Reynaert / Image : Jean-François Hensgens / Montage : Sophie Vercruysse
Durée : 114 min.
Sortie : 22 août 2012.