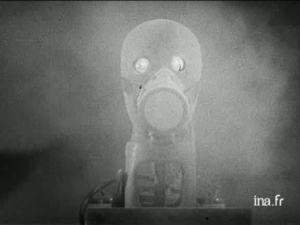Au-delà de l’éthique
Sur quelques documentaires récents

Entorse, rupture, fracture. Lorsque l’on mentionne les écarts à l’éthique documentaire, on bascule immédiatement dans l’ordre physiologique. La déontologie du documentariste s’inscrirait dans le corps même du film et en deviendrait l’un des principaux critères évaluatifs. On ne se défait pas, dans les cercles critiques et ailleurs, de l’idée qui consiste à fixer une norme morale fixe à l’aune de laquelle on qualifierait la démarche d’un·e documentariste. On saurait a priori ce qu’il convient de montrer ou non, comment le montrer et avec qui porter ce regard et, eu égard à ces critères, de constituer des indépassables : Shoah de Claude Lanzmann ou l’expérience des groupes Medvedkine, par exemple. Sans rejeter ces gestes, au contraire, je crois que leur panthéonisation, c’est-à-dire le fait que ces expériences soient hypostasiées comme normes, affaiblit la lecture que l’on peut porter à l’égard de ces films, et des autres [11][11] Voir ici le débat sur les « images malgré tout » des centres de mise à mort lors du génocide juif qui opposa Georges Didi-Huberman à la revue Les Temps modernes et Claude Lanzmann à la fin des années 1990..
Quelles sont ces normes que l’on ne saurait que trop voir ? Dans un premier temps, la loi fixerait des principes inaliénables à commencer par le droit à l’image, garanti juridiquement en France. Ailleurs, certaines dispositions de la loi, à la manière du premier amendement à la Constitution américaine, protègent le documentariste qui dérogerait à cette norme, la liberté d’expression primant sur tout. D’ailleurs, deux de nos films font fi de cette règle essentielle. Dans L’Homme aux mille visages et Une famille, la loi apparaît justement au fil du film par l’intermédiaire de la parole juridique.
Après avoir consulté l’une de ses amies avocates, Sonia Kronlund décide de révéler le visage d’un escroc qui vit avec plusieurs femmes en même temps et ment à chacune d’elles sur son identité. Structurée autour d’une image absente ou interdite, la première partie du film masque le visage de cet homme sur les photographies où il pose avec ses victimes. À la suite de cet échange, aidée par une musique comique, Kronlund affiche joyeusement la face de cet homme malgré les réticences de son avocate. S’amorce ainsi une enquête à l’occasion de laquelle Kronlund va engager un détective privé pour débusquer cet homme qu’elle sait habiter en Pologne.
Une famille de Christine Angot rompt dès son ouverture avec les principes sur lesquels se fonde le cinéma documentaire. Alors qu’elle est invitée à Strasbourg, Angot va se rendre chez la femme de son père – celui qui l’a violée à partir de ses treize ans – pour la confronter devant la caméra. Après avoir sonné, elle entre presque par effraction chez cette femme qui refuse de l’accueillir. Sur le seuil de la porte, la caméra, portée par Caroline Champetier, refuse de s’avancer et Christine Angot oblige l’équipe à entrer dans l’appartement de la vieille femme. Les interdits cinématographiques et légaux se concrétisent spatialement dans l’introduction d’Une famille par ces seuils si difficiles à franchir (la rue, la sonnette, la porte) dont la réalisatrice finit par s’affranchir. Angot ne prend aucune précaution : par exemple, elle révèle l’adresse de la femme de son père (filmant le trajet virtuel sur Google Maps) et elle en vient presque aux mains pour s’introduire dans ce logis. Plus tard, cette scène conduira Angot à être mise en demeure par la famille de son père.
Si Kronlund et Angot s’arrogent le droit d’envoyer paître la loi, c’est par un transfert de légitimité. Dans L’Homme aux mille visages, les victimes peuvent être interprétées par des comédiennes si elles ne souhaitent pas apparaître à l’écran quand cette possibilité n’est pas laissée à leur abuseur. Indéniablement, Kronlund prend le parti des victimes. D’une part, afficher son visage lui permet de prévenir que ces actes se reproduisent. D’autre part, à la fin du film, alors qu’elle finit par rencontrer cet homme par les moyens d’une fausse interview sur la course à pied, elle le prend à son propre piège en lui demandant de courir autant que possible pour le filmer. Elle conscientise elle-même cette cruauté, vue comme un moyen de venger les victimes d’un homme resté impuni. Il n’en demeure pas moins que cette vision d’elle-même comme instance de légitimité teinte le film de Kronlund d’un certain égotisme mal placé, l’affirmant comme seul relais de la parole de ces femmes.
Dans le cas de Christine Angot, la confrontation avec la femme de son père cherche à rétablir un contre-discours, celui d’une victime que l’on a accusée de menteuse. C’est en professionnelle de la parole que Christine Angot arrive devant les personnes avec qui elle s’entretient et la discussion va se dérouler selon ses termes. Selon les mots de son avocat, le caractère public de l’inceste dont a été victime Christine Angot rend légitime son intrusion chez sa belle-mère. Il y a un parallèle dans Une Famille entre l’inceste et l’antisémitisme vécu par Christine Angot et il se joue, dans ce film, une sorte de liens entre deux dynamiques collectives de collaboration. Les violences intra-familiales se fondent, autant que l’antisémitisme, sur un système de justifications, d’omissions et de contre-récits à celui de la victime. Comme Marcel Ophüls dans Le Chagrin et la pitié, Christine Angot se charge d’élucider un système et de rétablir une vérité, par l’entretien.
Si, pour les deux réalisatrices, le cinéma est la continuation d’un travail antérieur – un livre et un podcast pour Sonia Kronlund et une longue carrière littéraire pour Christine Angot, c’est bien que, par l’image, elles trouvent une manière différente d’incarner leur discours, en l’occurrence dans la concrétisation de leur antagoniste, de leur donner un visage. Là où Kronlund pèche et où Angot réussit, c’est moins dans la façon dont la construction de cet adversaire s’affranchit des règles du droit à l’image que dans l’usage fait de cet affranchissement. Quand Kronlund trompe Ricardo, qui s’attend à être interviewé sur sa pratique du jogging et qui n’est jamais confronté, Angot force le dialogue, essaie de communiquer avec sa famille malgré leurs justifications. En dépit des règles du dialogue documentaire, la romancière se permet de couper son interlocuteur, de lui asséner son récit et, parfois, de le réduire au silence. En définitive, c’est par un rapport au corps que se distinguent les deux démarches plus précisément, du rapport entre le corps des documentaristes à celui des agresseurs et leurs supplétifs. Là où, à son corps défendant, Christine Angot va prendre en charge seule la violence de la confrontation – physique et discursive – avec sa belle-mère, Kronlund reste en retrait et offre à son spectateur le spectacle – prétendument jouissif – de la souffrance d’un oppresseur.
Outre la légalité, l’éthique documentaire prescrit un respect à l’égard de la personne filmée : il n’est pas question de la malmener comme Sonia Kronlund se le permet. Ce respect correspondrait à l’idée qu’intégrer quelqu’un dans un film documentaire ne formerait pas un acte anodin, qu’on en « ferait un immortel » selon le mot de Chris Marker, non sans ambiguïté. Ce présupposé conduit parfois à une démarche qui considère que l’un des rôles du documentaire consiste à donner la parole à ceux qui ne l’ont pas et qu’il est impératif de les associer à la mise en scène de cette parole. L’idée sous-jacente consisterait donc à appréhender le film comme une prédation, que la frontière entre l’équipe technique et le personnage filmé spolie celui-ci de son image, frontière qu’il conviendrait de dépasser. Ce constat cherche à pallier les travers d’un cinéma documentaire vertical, impérialiste quant au sujet filmé : voyeurisme, paternalisme, fétichisme voire mise en danger des personnages[22][22] J’ai eu ces quelques réticences face à La Belle de Gaza de Yolande Zauberman dont la première partie consiste en une enquête visant à retrouver une femme trans qui se serait « échappée » de Gaza, en dépit du risque qu’elle encourerait si elle était retrouvée par l’équipe du film.. Mais ces considérations doivent-elles nous mener à retirer au cinéma documentaire toute cruauté vis-à-vis du sujet filmé ? Dans ses deux films, Mon pire ennemi et Là où dieu n’est pas, Mehran Tamadon cherche à élucider le fonctionnement des interrogatoires en Iran, dispositifs de torture des opposants politiques. Avec pour vœu de confronter un tortionnaire aux images qu’il va tourner, il demande ainsi à des rescapés de l’aider à reproduire les pratiques d’interrogatoire du régime. Ce principe naïf, celui selon lequel le tortionnaire répugnerait au spectacle de sa propre violence, s’étiole au fil des discussions et des expériences de Mehran Tamadon par le biais d’un curieux dispositif de parole.


Tout d’abord, Mon pire ennemi cible une pratique particulière d’interrogatoire : celle des exilé·e·s iranien·ne·s enfermé·e·s lors de leur retour sur le territoire national. Mehran Tamadon, privé de passeport en 2014, sonde la diaspora iranienne en France avec ce projet bancal de rétablir la discussion avec les tortionnaires. Lui qui côtoyait les mollahs comme les opposants politiques formule ce vœu pieux qu’un film ramènerait l’interrogateur à la raison. Alors qu’il rencontre plusieurs victimes iraniennes de ces pratiques dans le décor d’une maison vide, louée pour l’occasion, l’une d’entre elles, Zar Amir Ebrahimi, se prête particulièrement au jeu et interroge Tamadon pendant près de deux jours. Zar oblige très vite Mehran à se déshabiller puis invente des supplices humiliants : après l’avoir arrosé d’eau froide, elle conduit Mehran, vêtu seulement d’un slip, devant l’école de ses enfants puis dans un cimetière. Puis, pendant presque trente minutes, elle assène force insultes et invectives à Mehran Tamadon, contraint, toujours à demi-nu, de monter et descendre inlassablement des escaliers. Paradoxalement, aussi dures ces images soient-elles, Zar rappelle qu’elles n’ont rien en commun avec l’expérience réelle des tortures iraniennes et en vient à faire la critique du projet de Tamadon : rétablir le dialogue relèverait de la gageure d’un cinéaste malade de n’avoir jamais connu les sévices dont les autres opposants politiques ont été victime, d’un cinéaste qui, à proprement parler, n’a jamais été vraiment un opposant politique.
Au fur à mesure de Mon pire ennemi puis de Là où dieu n’est pas, l’enjeu change : il ne s’agit plus de rétablir un dialogue mais de prendre acte que celui-ci est impossible. Le reenactment que dirige Tamadon situe justement cette impossibilité dans l’ordre de l’illusion, médiant irrémédiablement le rapport entre l’interrogateur et sa victime. Pour la personne interrogée, le vrai n’a plus de valeur : céder c’est se conformer au récit de l’interrogateur pour amoindrir ses souffrances. L’un des personnages de Là où dieu n’est pas, Mazyar,a dû admettre à la télévision qu’il a fait partie d’un réseau terroriste inventé de toute pièce par le pouvoir et dénoncer des gens qu’il n’a jamais rencontré. En réalité, il s’est vu emprisonné pour avoir dénoncé des faits de corruption lors d’un appel d’offres. Zar le dit à la fin de Mon pire ennemi : le récit de l’interrogateur l’a persuadée et l’a conduite à exercer de tels sévices sur Mehran. Si Mon pire ennemi confond le partage entre l’illusion et le réel, présentant in extenso une séance d’interrogatoire, Là où dieu n’est pas prend plus de précautions. Tamadon dirige plusieurs fois ses techniciens en français, rompant avec le farsi, langue par laquelle il recueille les témoignages. Lorsque ses témoins se retrouvent submergés par l’émotion, Tamadon arrête l’entretien et demande à ses personnages s’ils·elles souhaitent continuer. Surtout, les trois témoins de Là où dieu n’est pas sont associés à l’élaboration du dispositif du film, à commencer par les décors. Mazyar reconstitue lui-même le lit sur lequel il a été torturé et soude chaque pièce de métal. Par cette collaboration au dispositif du film, Mehran Tamadon réactive une mémoire des gestes et de l’espace. Homa, incarcérée dans une prison pour femmes, se souvient exactement de l’étroitesse du couloir de la cellule qu’elle partageait avec trente autres filles.
Ce qui saisit dans les deux films de Mehran Tamadon, c’est la manière dont le corps du documentariste-intervieweur se met à l’épreuve et prend en charge la reproduction des pratiques de torture du régime iranien. En offrant son corps, Tamadon offre aussi à ses témoins la possibilité d’édifier avec lui ou contre lui la démarche de son film. Prêt à subir les pires sévices, Tamadon veut suivre un apprentissage par la douleur contre l’avis des personnes qu’il filme. Alors qu’il explique une technique dont il a été victime, Mazyar refuse catégoriquement de l’expérimenter sur Mehran, quitte à reproduire lui-même la posture qu’il avait lors des années où il a été torturé. Ces enjeux noués autour du reenactment signalent un partage de la déontologie, où le témoin co-construit la mise en scène de la torture et la réflexion. À l’inverse, la façon dont Zar assume sa fonction fictive de tortionnaire dans Mon pire ennemi pourrait aller à l’encontre du refus de Mazyar dans Là où dieu n’est pas mais elle participe en fait d’un même mouvement de contestation et de problématisation des principes naïfs et illusoires de Mehran Tamadon.
Mon pire ennemi et Là où dieu n’est pas suivent des démarches complémentaires. Là où le premier affirme une certaine forme de cruauté immersive, le second se construit sans cesse dans le dialogue avec les témoins. Tamadon semble, pour ses deux dispositifs, trouver ses sources dans la théorie des arts vivants. La conception du théâtre chez Antonin Artaud se loge précisément autour de la notion de cruauté vue comme « agitation[33][33] « Tout ce qui agit est une cruauté. C’est sur cette idée d’action poussée à bout, et extrême que le théâtre doit se renouveler. Pénétré de cette idée que la foule pense d’abord avec ses sens, et qu’il est absurde comme dans le théâtre psychologique ordinaire de s’adresser d’abord à son entendement, le Théâtre de la Cruauté se propose de recourir au spectacle de masses ; de rechercher dans l’agitation de masses importantes, mais jetées l’une contre l’autre et convulsées, un peu de cette poésie qui est dans les têtes et dans les foules, les jours, aujourd’hui trop rares, où le peuple descend dans la rue. » Artaud, Antonin, « Le Théâtre de la Cruauté », Le Théâtre et son double, Paris, Folio, 1985. » c’est-à-dire la dilution des barrières qui séparent l’acteur de son public et la provocation d’effets spectatoriels au-delà de la bordure de la scène. Le sujet documentaire se fond avec la démarche de Mon pire ennemi quand il éprouve celle de Là où dieu n’est pas qui suit une perspective plus distancée et réflexive. Pour autant, les deux films ne forment, à mes yeux, aucune contradiction : au contraire, ils déploient chacun une manière d’activer un témoignage, de recueillir la parole.
Pour résumer mon propos à l’aune de ces quatre exemples : je crois qu’il n’y a de norme déontologique certaine dans le cinéma documentaire que celles rattachées au système de valeur du film lui-même, c’est-à-dire à ses intentions propres et ses principes axiologiques. L’exercice critique à l’égard d’un film documentaire ne me semble pas se constituer à partir de catégories fixes, préétablies, sorte d’impératif catégorique du cinéma. Au contraire, il relève plutôt de l’analyse des moyens spécifiques obtenus pour atteindre une fin particulière et ces deux pôles demandent une attention similaire. À mes yeux, la constitution de normes indépassables en termes d’éthique documentaire remplace régulièrement la cause par le symptôme : par exemple, le sensationnalisme et le voyeurisme d’un mondo est issu des volontés mercantiles de ses producteurs qui charrient une conception raciste et impérialiste du monde. Une image en soi – image de détresse, image de violence – ne peut être comprise que selon le cadre général de l’œuvre dont elle participe[44][44] C’est un élément que l’on peut apercevoir dans le cinéma de Frederick Wiseman. Dans Domestic Violence (2001), le cinéaste n’épargne pas le spectateur de la présentation crue d’une femme atrophiée après avoir été battue par son compagnon. Si Wiseman use de cet effet avec parcimonie, le choc donné par ce cut brusque et ce visage sanguinolent rappelle avec clarté l’état des femmes qui trouvent refuge dans le foyer qui fait l’objet du film, manière précise de montrer de quoi on parle. Là, il ne s’agit pas d’un écart à la morale qui veut empêcher de filmer la détresse mais d’une épiphanie – au sens lévinassien – où la violence se perçoit sans médiation..
Mais par leur matière-même, l’altérité, trois des quatre films dont j’ai parlé s’insèrent dans une dynamique. Ainsi se rappelle-t-on de la pensée de Georges Canguilhem. En réfléchissant la médecine dans Le normal et le pathologique, le philosophe français perçoit la maladie non comme anormalité vis-à-vis d’une santé physique mais comme normativité, c’est-à-dire une requalification des normes de l’organisme qui s’adapte à ces altérations. Ainsi introduit-il une conception dynamique de l’organisme et de la nature qui peut facilement s’étendre à d’autres domaines : il n’y a pas de norme fixe car toute norme est le produit d’altérations. Revenons à nos considérations physiologiques : un film documentaire, parce qu’il constitue un art intrinsèquement vivant donc imprévisible, ne peut se faire à partir de conceptions statiques. À tout le moins, le·la documentariste peut se fixer une propédeutique, une théorie qui le·la guide lors de sa pratique mais qu’il·elle essaie sans cesse de mettre à l’épreuve.