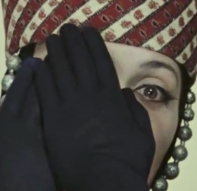Bono: Stories of Surrender, Andrew Dominik
Bonhomie

Andrew Dominik a toujours porté son regard sur des figures d’exception – hors-la-loi, prophètes brisés, artistes confrontés à leur propre reflet – pour en dévoiler l’étrangeté fondamentale, l’altérité qui les ronge et les traverse. Ces hommes ne sont plus maîtres de leur image, et c’est précisément cette fragilité qui rend leur présence si troublante : au croisement du sacré et du trivial, de la pose et de la perte. Chez Jesse James, chez Marilyn Monroe, comme chez Nick Cave, surgit une angoisse : comment continuer à exister quand votre image vous précède, vous trahit, vous habite avant même que vous ne preniez la parole ?
Avec Nick Cave, cette dynamique atteignait une forme d’incandescence. One More Time with Feeling (2016), tourné après la mort accidentelle de son fils, était une traversée spectrale, hantée par l’impossibilité de faire sens. Cave, ramené au studio comme à un refuge fragile, tentait de reprendre la parole sans y croire tout à fait. Dominik transformait ces silences et balbutiements en un poids d’image presque palpable. La musique ne célébrait rien : elle surgissait, brute, en train de naître. This Much I Know to Be True (2022), filmant à nouveau Cave, cette fois aux côtés de Warren Ellis pour les albums Ghosteen et Carnage, prolongeait ce vacillement. Le film adoptait un dispositif plus stylisé, presque cérémoniel : caméra circulaire, studio hors du temps et lumière laiteuse, musique dense et incertaine, rares entretiens où affleurait le doute. Dominik filmait le travail du sens, toujours suspendu, jamais assuré.
Dès le premier quart d’heure de Bono: Stories of Surrender, un moment cristallise la nature du projet : le récit de la mort de la mère de l’artiste, foudroyée par un anévrisme lors des funérailles de son père. Événement fondateur, longtemps tu dans le silence familial, il revient sur scène sous forme de monologue grave et touchant. L’instant est sincère, mais rigoureusement mis en scène : Bono annonce lui-même que débute la « tragic part » du show, la lumière se modifie, la voix se brise au bon moment, avant qu’un geste de la main ne lance Glad to See You Go des Ramones pour chasser la mélancolie. La mémoire n’est pas à vif : la douleur est déjà scénarisée.
Bono, figure pop majeure et narrateur chevronné, livre un récit tiré de ses mémoires, mis en scène pour la tournée puis filmé par Dominik. Le dispositif est familier : un homme seul sur scène, quelques musiciens, un micro, et un récit d’apparence intime. Mais là où Dominik avait jusqu’ici cherché l’accident, la faille, il se retrouve face à une structure fermée, étanche, où même les silences – une pinte bue, une pause calculée – paraissent programmés. L’émotion est toujours rattrapée par l’anecdote, la contradiction absorbée dans le charme. Bono performe sans jamais vaciller. One More Time with Feeling ouvrait des brèches dans le réel, Stories of Surrender lisse toute dissonance. Le paradoxe est cruel : Bono prétend se livrer, mais dans un cadre précisément pensé pour éviter toute perte de contrôle. Cette maîtrise n’exclut pas une part d’authenticité, peut-être même en constitue-t-elle la condition dans un tel dispositif. Cabotin assumé, Bono ne masque jamais le caractère performatif de sa confession. Il rit avec le prompteur, se moque de son propre dispositif, mime la solitude de scène en désignant les sièges vides de ses compagnons de U2. Par moments – rares mais perceptibles – il expose quelque chose de lui-même, sans effondrement, avec une forme de lucidité. Le théâtre est connu, le spectateur n’est pas dupe, mais cela ne produit ni décalage ni vertige. Seulement une adhésion bonhomme, sans heurt, fondée sur une complicité partagée autour de la maîtrise narrative.
Là où l’image pourrait se détacher de la scène, elle s’insère dans le prolongement du livre et du spectacle, suivant une logique de continuité transmédiatique. L’écart avec les films réalisés autour de Nick Cave devient frappant : dans ceux-ci, la parole creusait le plan, risquant l’interruption, l’inachèvement. On est également loin d’un film comme Stop Making Sense (Jonathan Demme, 1984), qui réinventait le concert des Talking Heads (construction progressive du plateau, dramaturgie visuelle et sonore, redéfinition du rapport entre corps et musique), ou de The Last Waltz (Martin Scorsese, 1978), qui, à partir de l’ultime concert de The Band, ne se limitait pas à la captation live mais construisait un récit visuel rigoureux (entre lumières étudiées, compositions soignées et alternance de scènes en studio) pour offrir à l’événement une portée intime, cérémonielle et quasi mythique : la solennité d’une fin de règne. À l’autre extrémité, les captations de Beyoncé (Homecoming, 2019) ou Taylor Swift (The Eras Tour, 2023) assument dès le départ leur statut d’objet total : chaque plan est conçu comme une extension de la scène vers d’autres supports (streaming, réseaux sociaux, culture fan). Plutôt que d’ouvrir une brèche, le cinéma sert ici de vecteur : il fait circuler le spectacle dans les canaux médiatiques, en lissant le récit pour maintenir son unité et sa continuité sensible. En cela, le geste d’Andrew Dominik s’inscrit moins dans une logique d’auteur que dans celle d’un cinéma de service – reproche déjà adressé par certains critiques, malgré la singularité de ses films avec Cave. Cette posture reflète un état contemporain de l’image, de plus en plus prise dans les flux transmédiatiques de la culture populaire, et transforme en profondeur le regard porté sur l’artiste filmé. Dans un monde saturé d’auto-représentations, la sincérité se construit comme un artifice sophistiqué, où l’émotion devient à la fois objet de révélation et outil de connexion avec un public complice et averti.
Cette contradiction est féconde : elle interroge la nature même de la vérité dans le cinéma documentaire quand il est confronté à des figures publiques qui ont intégré la mise en scène comme mode d’existence. Elle révèle moins un échec qu’une transformation : face aux stratégies contemporaines de gestion de l’image – et à l’impossibilité de surprendre l’individu au-delà de sa persona – le cinéma s’adapte, s’efface parfois, pour mieux documenter non plus une vérité brute mais la performance de la vérité, soit la manière dont l’interprète habite son masque, le travaille, le met au service de son récit. À la rigueur, ce travail pourrait être fascinant – on pense aux comédiens filmés par Frederick Wiseman dans La Comédie-Française (1996), eux aussi conscients de ce qu’ils donnent à voir, mais pour qui la mise en scène de soi relève d’un savoir-faire collectif, vivant, sans cesse remis en jeu. Rien de tel ici mais une image médiatique durablement installée, dont le film prolonge les traits plutôt qu’il ne les reconfigure. Le titre du film lui-même suggère le paradoxe : l’abandon n’est pas une épreuve, il s’inscrit dans une dramaturgie déjà écrite, une histoire que Bono (se) raconte. Le film devient ainsi une variante désenchantée de la quête de vérité de Dominik : l’effondrement cède la place à la persistance d’un jeu où l’intime n’existe plus que dans l’économie de sa propre représentation.

Scénario : Andrew Dominik / Image : Erik Messerschmidt / Montage : Lasse Järvi / Musique : U2, Bono
Durée : 1h26.
Mise en ligne sur Apple TV+ le 30 mai 2025.