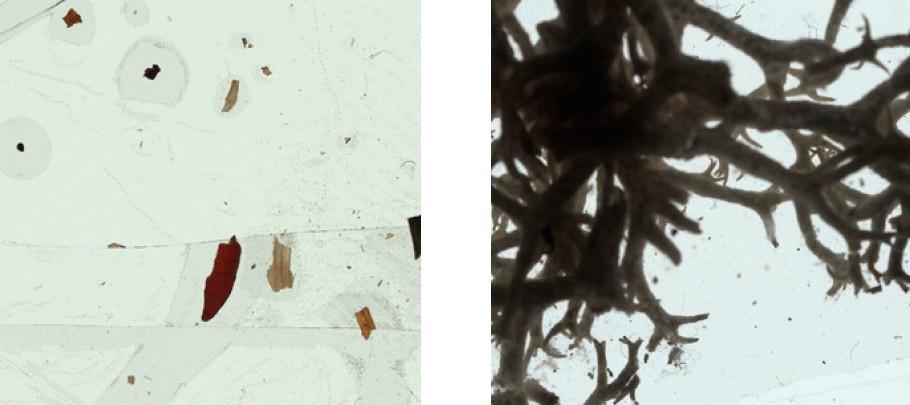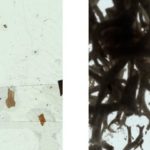Cinéma du réel, 2023 (atelier 2/2)
Archipel de violences
La compétition a été marquée par un certain nombre de films traitant des massacres ou des crimes perpétrés par des États d’Amérique latine contre leurs populations. Quand des images enregistrent des témoignages de torture avérés, que faire des vices d’États ? Des films comme El Juicio, Ana Rosa ou Adieu Sauvage se sont présentés sous forme d’enquête, toujours motivés par une quête de preuves et d’informations pour corroborer des faits. Au cœur de la compétition s’est ainsi déroulée une interrogation autour de la violence d’État. La programmation s’est fait rattraper par la réalité : deux journées de grève ont provoqué l’annulation de toutes les séances. Le communiqué de presse précisait : « À travers cette journée banalisée, nous n’entendons pas seulement rappeler notre solidarité (…) mais notre plein engagement aux côtés des personnes opposées à la réforme des retraites et inquiètes des atteintes portées au débat démocratique ces derniers mois. (…) C’est en conscience que nous faisons le choix difficile de ne pas montrer les films programmés en ce jour de grève nationale : on ne saurait se retrouver dans une salle de cinéma quand l’événement a lieu au dehors. » Le 28 mars, 78 personnes sont interpellées en marge des cortèges parisiens.
Mais le Réel a rapidement retrouvé la salle de cinéma. Le jour de la manifestation, un e-mail discret prévient les festivaliers alors que le cortège descend vers Nation : la projection d’ El Juicio d’Ulises de la Orden est maintenue. En présentant un remontage d’archives du procès de généraux ayant gouverné par la terreur en Argentine, le festival a voulu s’affirmer comme lieu de réflexion sur les monopoles de violence physique légitime et rappeler, par le cinéma, de débordements passés.
Ulises de la Orden compose son film à partir de 600 heures d’enregistrement d’un procès hors norme contre des militaires ayant participé activement au gouvernement autoritaire du « Processus de restructuration nationale » entre 1976 et 1983. Hors norme, car avec l’arrivée de la démocratie, c’est la première fois que le tribunal civil d’un pays juge les crimes contre l’humanité d’un de ses précédents gouvernements. Après une tentative de montage et de diffusion télévisuelle avortée, ces images étaient tombées dans l’oubli. Avec des cartons numérotés titrés avec quelques paroles reprenant des propos énoncés par les victimes, la structure rappelle les différents cercles de l’Enfer de Dante. Si Dante est parfois rappelé par le procureur, les témoignages dépassent souvent l’entendement. Des disparitions systématiques dans l’océan de corps emprisonnés, des accouchements à même le sol où la mère nettoie son propre placenta, ou bien avec l’invention de la parilla – le grill, un brasier de chairs constamment alimenté en gazole – , l’Enfer de Dante paraît bien en-deçà.
Dans un huis-clos complet, le spectateur se trouve enfermé. Les témoignages montent en intensité, jusqu’à nous forcer à détourner les yeux, alors que nous n’entendons qu’un·e témoin, de dos. Ulises de la Orden ravive d’une certaine manière l’opposition entre Lanzmann et Godard. Il ne s’agit plus seulement de montrer ou de ne pas montrer, mais de proposer une parole construisant sa propre image. Exprimée dans un lieu où règne une performativité de la parole, pouvant condamner ou disculper, ces témoignages n’ont pas seulement un aspect mémoriel, ils servent de preuves pour des actes dissimulés.
S’il est d’usage que dans un tribunal, chacun campe un rôle défini, rapidement la vie du procès révèle certaines postures sociales vis-à-vis de l’histoire du pays : une parole de victimes en quête de réponses étouffées face à la somme faramineuse de disparition et celle d’une défense d’accusés en excès de confiance, niant presque les crimes commis, ou les assumant sans trop de remords. Des généraux responsables des actions de torture se plaignent des horaires nocturnes du procès, presque à crier d’un traitement inhumain…
La position du documentariste dans Adieu Sauvage (Prix des bibliothèques) joue sur cette position entre une parole énoncée et un fait qui la contredit. Exilé en Belgique, mais dernier représentant d’une des lignées royales d’un peuple autochtone, Sergio Guataquira Sarmiento ne sait pas sur quel pied danser, espérant trouver une place chez les Cacua en enquêtant sur l’épidémie de suicides qui sévit au sein de la communauté.La séquence d’ouverture illustre ce flottement. Du hublot d’un avion, nous traversons les nuages jusqu’à ce que l’objectif de la caméra s’écrase presque sur la piste d’atterrissage. Dans un noir et blanc chromé, extrêmement soigné : entre deux eaux, entre deux mondes, nous ne savons où nous arrivons.
La violence se manifeste toujours dans un entre-deux. Ne sachant parler espagnol, la parole de la femme du chef ne peut être transmise que par son mari, seul hispanophone. L’intermédiaire de traduction rend la parole pleine de violence. Il est impossible de savoir si la traduction est fidèle, surtout lorsque bien des suicides sont dus à des pressions domestiques fortes, dans une culture où la langue ne peut exprimer de sentiments comme l’amour ou la tristesse, selon le discours du réalisateur. De même, la photographie propose une autre représentation, pour s’éloigner de la forêt luxuriante, avec un monochrome léché. L’esthétisation ne rime plus avec tropicalisation, certes, mais propose des plans accentuant les ombres, où corps, objets, feuillages sont au premier plan. L’esthétisation se déplace sur le mode de vie et les habitants. En refusant la couleur au bénéfice du chromé, il ne souscrit pas à la classique « beauté coloniale exotisante », mais propose une logique d’embellissement. Leur quotidien est constamment sublimé et vient contaminer une enquête cherchant à démontrer le contraire. L’enquête s’enveloppe malgré elle dans des accoutrements paysagers.
Ana Rosa , à l’inverse, tente d’adapter la forme à l’ambiguïté de sa situation. Cherchant à pallier un manque, à obtenir des informations sur la lobotomie de sa grand-mère, Catalina Villar confronte différents régimes d’images pour faire de son film un matériel hybride, réfléchissant à chaque fois sur les façons de faire dialoguer les archives et la parole des interrogés. Face aux lobotomies commises sur les femmes manquant de « docilité », les paroles divergent sur l’emploi d’une pratique tabou. Le travail de composition s’efforce de faire vivre à la fois des images publicitaires prônant la lobotomie, des entretiens et des lieux complètement à l’abandon, pourtant porteurs de la mémoire de crimes médicaux, contraignant les corps féminins de la population.
Dans l’enquête, le montage est essentiel, à savoir par quel fil tirer les révélations ou l’absence d’informations. Curieusement, les trois films usent d’un même procédé, intercalant quelques cartons noirs à l’image, pour des résultats somme toute différents. Dans un chemin de croix s’empirant avant une rédemption finale pour El Juicio, Adieu Sauvage conserve dans sa scène finale cette pénétration lente au travers des différentes couches de la peau du témoignage. Encore au-dessus des nuages, nous n’arrivons cependant à saisir la violence de l’ultime confession. Les pauses au noir nous plongent dans une distance vaporeuse, soulignant l’onirisme de la photographie, alors que l’ultime geste de Catalina Villar et sa monteuse dans Ana Rosa, nous retiennent des effets de la violents des actes médicaux. Sans imposer, ni dissimuler, le montage d’une séquence de lobotomie entrecoupée de cartons noirs suit le rythme et les limites du spectateur. Dans une salle ayant unanimement détourné les yeux de l’écran face à la violence de l’action, les pauses permettent de quitter momentanément le film, pour pleinement y revenir. Ces coupes permettent, me temps d’une seconde de prendre un pas de recul sur la situation. D’une continuité perdue, l’édulcoration est refusée, la visibilité : pleine. L’image blesse. Encore faut-il trouver la distance à laquelle se manifestent les violences de nos états.
Thomas Bingham
Derniers îlots d’attention
En déambulant d’une salle à l’autre, en mélangeant les sections du festival au sein d’une journée, il arrive que des films éloignés trouvent des échos surprenants. Plutôt, ceux qui nous plaisent restent à la surface de notre mémoire et forment des archipels, subjectifs et poétiques. Voici un pont inattendu entre deux de ces îlots filmiques : Je ne sais pas où vous serez demain , d’Emmanuel Roy et Geographies of Solitude , de Jacquelyn Mills. Dans la continuité de la réflexion sur les violences systémiques, ces documentaires ont en commun de proposer des gestes d’attention. Ils brossent le portrait de deux femmes de science, Reem Mansour et Zoe Lucas, dont la puissante présence au monde et aux êtres se manifeste par l’écoute. Elles sont témoins de catastrophes en cours. Leur attention se transforme en geste : prendre soin. En écho, alors que ces femmes se laissent traverser par ce qui les entoure, les réalisateur·ices et les dispositifs se voient transformés par leurs sujets, faisant de ces deux films le lieu précis d’un enjeu politique.
Avec Je ne sais pas où vous serez demain , l’attention est une question de place. Le choix du lieu depuis lequel on parle, on soigne, on filme, permet au moins de savoir où l’on se situe politiquement et humainement, au présent. Le huitième long-métrage d’Emmanuel Roy est un film simple à raconter : dans le cabinet de Reem Mansour, médecin généraliste dans le Centre de Rétention Administrative (CRA) de Marseille, des détenus se succèdent en consultations. La médecin essaye de les aider malgré la précarité de leur situation qui ne permet jamais d’envisager un soin sur le long terme. Ce documentaire poursuit la réflexion sur les violences d’État, en s’ancrant au sein d’une institution répressive comme métaphore amère de notre société. Austérité du cabinet, cinéma direct, dispositif de huis-clos tenu tout au long du film. Mais c’est précisément cet ancrage assumé qui lui permet, plus que de dénoncer un état de fait, de devenir un lieu politiquement actif.
Comment Emmanuel Roy a-t-il bien pu rentrer dans le CRA ? L’infiltrée responsable du miracle n’est autre que Reem, la médecin dont l’engagement consiste à réparer les hommes, là où on les brise. C’est parce que la demande d’autorisation de filmer dans le CRA est passée par elle qu’elle a été acceptée. Il faut croire qu’il reste encore un peu de respect pour le soin. La position politique de Reem se construit depuis cette enclave décourageante, où le principal remède reste le doliprane. Cette solution, souvent proposée pendant les consultations, semble dérisoire par rapport à la gravité de l’état des détenus. Ces derniers ne sont pas dupes : plusieurs refusent l’anti-douleur. Dans cette réticence à se prêter au jeu du soin en dépit de leur santé, se situe aussi la résistance. Une forme de contestation dans le refus d’apaiser les maux, car la douleur devient criante.
La mission principale de Reem est d’entendre ce cri. Mais c’est dans sa capacité toute particulière à l’entendre également que le film d’Emmanuel Roy se distingue. Parmi les éléments du dispositif de tournage, le point central semble être la place précise où a été posée la caméra. Emmanuel Roy et son équipe se trouvent face à Reem, dos à tous les patients. Ainsi, le film assume tout d’abord de donner de l’importance à la soignante, qui se distingue, par sa présence et son attention, de beaucoup de médecins dans ces centres de soins précaires. Deuxième effet concret, non des moindres : les patients, aussi détenus, sont protégés. Leurs identités ne sont pas exposées, évitant par la même le pathos de la contemplation. L’éthique du réalisateur se construit dans la protection et la pudeur, refusant la fascination dérangeante pour le gros plan sur des visages fragiles, en souffrance. La réflexion politique ne vient pas de l’émotion facile.
Ces choix simples ne sont pas des précautions morales. Les paramètres du dispositif, les places tenues de chacun des protagonistes, créent un nouvel espace, qui n’existe que grâce au film. Les patients ont accepté d’être filmés et certains reviennent même plusieurs fois. La conscience de la caméra transforme la consultation. La particularité d’un CRA est de briser toute perspective pour les personnes qui y sont enfermées : leur séjour peut être prolongé trois fois, jusqu’à 90 jours. Et une fois libérées, elles peuvent être arrêtées de nouveau, renvoyées au CRA, leur vie encore suspendue. « Je ne sais pas où vous serez demain », dit Reem. Pour le moment, vous êtes tout particulièrement ici où il y a une caméra. Elle vous protège et vous écoute. Et une chose est sûre, ces images demain seront hors du CRA. Une brèche se crée, qui ouvre un horizon.
Le film devient alors une tribune. Les détenus prennent la parole sur leurs conditions d’enfermement, sur les violences policières, sur les effets destructeurs de ce système sur leurs vies. Tout comme Reem ne prend pas une position de médecin savante face à des ignorants, le film fait confiance à ces hommes qui sont les seuls à connaître leurs conditions de détention. Un geste : un homme se lève, se tourne et soulève son t-shirt pour montrer à la médecin les bleus qui couvrent son dos. Avant de se rassoir, il soulève une nouvelle fois son t-shirt, pour montrer ses blessures à la caméra. Le dévoilement devient un acte. Le hors champ du huis-clos, le CRA, se met à exister, à nous étouffer. La violence dont ils témoignent est saisissante, mais elle s’expose dans le choix, parfois avec colère, toujours avec force.
Dans Je ne sais pas où vous serez demain les horizons sont bouchés, la caméra fixe et personne ne peut bouger de sa place. Emmanuel Roy transforme la contrainte en possibles. Il révèle l’obstination et la bienveillance de Reem. Il crée un temps, proprement cinématographique, de prise de position qui protège les détenus et fragilise le spectateur en le prenant à partie. Ce film est politiquement un acte, éphémère. Il permet à des hommes de récupérer le récit de leur condition. En ne sachant plus où ils seront demain, aujourd’hui ils étaient là. Face à l’angoissante fatalité de ce qui se profile, c’est dans une même temporalité au présent que s’opère le geste minutieux d’inventaire de la protagoniste de Geographies of Solitude.
Ailleurs, sur une île au large de la Nouvelle-Écosse, une témoin solitaire enregistre les données de notre perte. Cette femme s’appelle Zoe Lucas, elle est scientifique autodidacte et vit seule sur L’Île de Sable depuis des dizaines d’années. Elle est en quelque sorte la médecin de cet îlot. Pendant quelque temps, la réalisatrice Jacquelyn Mills va l’accompagner, observer cette existence avec sa caméra, détériorer sa pellicule au contact du vivant. Geographies of Solitude, (section « Front(s) Populaires ») doux et mélancolique, offre un rare moment de présence organique aux choses.
Ce film déclenche étrangement en nous des sentiments très opposés. D’abord, une angoisse de l’ordre de la solastalgie[11][11] La solastalgie désigne une détresse psychologique due à la perception d’un changement dans notre environnement. Le mot a pris une connotation particulière en lien avec l’urgence climatique et la conscience du caractère irréversible de la situation. C’est en somme une forme de nostalgie de notre monde écologique en train de disparaître… grandit au fur et à mesure du récit, nous plongeant dans une grande solitude. Zoe énumère. Elle enregistre les taux, compte les spécimens, classe les espèces par couleurs, tailles, matières. Le nombre de chevaux sauvages a été multiplié par dix. Des tableaux Excel se remplissent à l’infini. Dans les relevés, les déchets humains sont de plus en plus présents : les micro-plastiques, les sacs, les ballons, les câbles électriques gigantesques. L’esprit d’enquête la maintient en éveil, en itinérance sur un bout de terre long de vingt kilomètres. Cette minutie scientifique, mue par l’urgence écologique, pourrait sembler maniaque, étourdissante. Terrifiante surtout, tant le geste de soin est vain, là encore. Mais l’élan vital et la douceur de Zoe prennent le dessus et retournent la tonalité du film. Elle énumère tant que l’île se peuple, et il semble finalement bizarre de parler de solitude.
Ou bien une solitude bruyante de présences. Tout comme Zoe Lucas s’est laissée happer par la vie de l’île, Geographies of Solitude se laisse contaminer par ses forces organiques. Le travail de Jacquelyn Mills frôle l’expérimental, et la réalisatrice intervient sur les matières du film. Mills et son ingénieur du son Andreas Mendritzki ont composé une bande sonore fourmillante. L’utilisation du micro-contact sur les arbres, les insectes, le sable et l’eau donne un résultat fascinant, détaillé, pointilleux qui pétille aux oreilles. À l’inverse, l’enregistrement des basses de chants longs et graves des phoques nous tirent vers les profondeurs. L’utilisation de la pellicule 16mm vient doublement faire écho à l’île. Les grains photosensibles sont autant de particules que le sable, les plantes, la chair en décomposition des poneys ou les microparticules de plastique. Ils bougent, entrent dans un cycle, subissent eux aussi une altération. Elle expose sa pellicule à la lumière des étoiles, l’enterre dans la mousse ou le crottin de cheval, la développe dans du jus d’algue. Geographies of Solitude s’abîme au contact d’une nature que l’homme abime. Une fusion est à l’œuvre, trouvant son écho dans un savant enchevêtrement du montage qui croise des séquences de natures diverses, et dans les surimpressions visuelles et les disjonctions sonores.
Avec un travail si proche de l’organique, sommes-nous en train de conserver ou d’altérer ? Zoe Lucas, la réalisatrice et le film sont témoins d’un monde en train de disparaître. La science et ses outils, le cinéma, sa pellicule et sa chimie, détiennent-ils le mouvement ou l’accélèrent-ils ? Très certainement, le temps est compté. Quelle merveille que ces images d’un monde qui scintille. Quelle douleur et quel plaisir d’assister un instant de plus à cette beauté qui participe à notre perte. Jacquelyn Mills l’annonce, « c’est la dernière bobine ».
Deux films comme deux îlots au milieu de la violence des hommes sur ce qui les entoure. Des protagonistes et des cinéastes qui se rendent disponibles pour contrer l’indifférence, pour se laisser eux aussi un peu altérés par autrui. Les films deviennent un échange, ils prélèvent et reçoivent. L’attention politique réside dans l’écoute, la transmission de la douleur et de la colère. Malgré la fatalité, ces gestes de soin restent mus d’une tendre attention.
Eve Le Fessant Coussonneau
Animalité(s)
Face à la destruction du vivant et à l’insidieuse dégradation de la terre, la section « Front(s) Populaire(s) » vise à ouvrir un espace de réflexion pour construire de nouvelles manières d’entrer en lien avec l’environnement. Le regard porté sur l’animal est chargé de cette ambigüité, entre sauvegarde et prédation. La pratique documentaire décentre la vision humaine et confronte le spectateur à d’autres réseaux de représentation, laissant libre cours à cette altérité animale qui fait le récit d’un monde différent. Les questions que ces films soulèvent sont analogues aux interrogations que formule Nastassja Martin dans Les Âmes sauvages : « Comment se protéger de cette part de risque qui existe dans l’environnement et dans les êtres qui le peuplent ? Comment se positionner face à ces êtres, comment entrer en relation avec eux alors qu’ils nous échappent ? Comment faire fleurir la rencontre pour qu’elle entraîne un devenir et permette une transformation ? »[22][22] N. Martin, Les âmes sauvages: face à l’Occident, la résistance d’un peuple d’Alaska, Paris, La Découverte, 2016. Cet enjeu s’incarne de manière particulièrement vivace dans certains films de la compétition, qui abordent de plein fouet la représentation du vivant et des relations que nous nouons avec lui.
Certains documentaires adoptent un ancrage anthropologique, établissant le contact avec l’animalité par le prisme humain. Piblokto d’Anastasia Shubina et Timofey Glinin relève de cette approche : les documentaristes retracent le quotidien d’une communauté humaine sur les rives de la mer des Tchouktches. L’ensemble des pratiques et des rites pour assurer la survie des villageois constitue la porte d’entrée vers le monde des bêtes. Humains et animaux se croisent et s’entremêlent dans un ballet où la chasse, la nature et la mort deviennent indissociables. Le court-métrage Kaiserling III de Philippe Rouy se concentre sur l’enjeu de la conservation, établissant un pont entre le stockage dématérialisé de nos données et les anciennes méthodes qui préservaient les reliques du vivant dans du formol. Enfin le long-métrage de Sylvain L’Espérance Animal Macula naît d’une vertigineuse archéologie d’images : dans ce film de montage, le cinéaste traque les représentations animales dont le médium cinématographique est porteur pour composer cette fresque vive et violente. Par sa puissance de signification, le cinéma serait porteur d’une mémoire inconsciente qui, une fois recomposée, révélerait les paradoxes dont nos rapports au vivant non-humain sont chargés (voir notre entretien avec le réalisateur).
C’est d’abord l’omniprésence de la violence qui marque le spectateur au sortir de Piblokto et d’Animal Macula. L’image documentaire confronte le spectateur à une réalité souvent invisible, celle de la chasse, de l’élevage et de la mort qui sous-tendent le système de survie de l’humanité. Dans une longue séquence que le découpage du montage rend récurrente, comme un mauvais rêve dont le souvenir reviendrait hanter le dormeur, Piblokto montre le dépeçage d’une baleine dont l’immense corps martyrisé est hissé sur une sombre plage de galets. La caméra capture ces images impossibles, montrant l’interminable succession de morceaux de chair prélevés sur l’animal, alors que des enfants jouent à deux pas de ce charnier à ciel ouvert. L’absence de discours – ni voix-off, ni commentaires des chasseurs – produit un effet de dénuement qui accentue la portée de chaque image. Après une nerveuse ouverture montrant des hardes animales fuyant un danger invisible, Animal Macula fait de la violence le résultat inévitable de nos rapports au vivant. Comme dans Piblokto, la logique du film conserve un hermétisme qui désarçonne et surprend constamment : la violence surgit par éruption, avec une brusquerie qui réactive à chaque visionnage l’actualité de la mort animale qui s’accomplit à l’écran. L’abattage du cheval blanc de Franju, les mustangs étranglés au lasso au détour d’un western, ou l’extermination par balles des kangourous, sont autant d’îlots de violence qui s’agglomèrent et résonnent dans la fresque des représentations animales que le cinéma porte enfouies en lui. Aucun mot n’accompagne ces séquences, évitant la lourdeur d’une mise en scène explicative et prescriptive.
Face à la réalité de cette violence souvent occultée, l’empathie ressentie pour le vivant meurtri met en avant la complexité du lien entre humain et animal. Les relations de l’homme au vivant non-humain oscillent donc entre la réalité de cette violence infligée et des élans profondément affectifs et fusionnels. Piblokto représente cette bizarrerie qui sourd de notre connexion à l’animal en capturant les jeux des enfants tchouktches qui, sur la plage où les chasseurs déposent leurs proies, se sont emparés des cadavres d’oiseaux marins qu’ils animent comme des figurines. Les corps désarticulés miment des simulacres d’envols et de batailles, devenant les réceptacles de l’imagination enfantine. L’enthousiasme d’un invisible enfant dans Kaiserling III fait écho à ce rapport fasciné à l’animal. Alors qu’un cochon se vautre somptueusement dans une mare de boue, une voix enfantine répète avec ravissement : « Le cochon ! », traduisant par cette ritournelle obsessionnelle l’attraction que l’animal peut exercer sur l’homme. C’est, dans Animal Macula, le motif de la longe qui condense le caractère inséparable des existences humaines et animales. Le montage assemble des scènes où homme et bête marchent côte-à-côte, avec entre eux le balancement d’un fil. À la fois matérialisation d’un lien affectif et d’un joug imposé à l’autre, la laisse évoque un cordon ombilical qui établit en dépit de la violence un rapport presque fraternel.
Les structures narratives non-conventionnelles adoptées par les trois documentaires se traduisent parfois par une expérimentation dans le corps même de l’image. Comme Geographies of Solitude, une forte identité du travail de l’image se traduit par le recours à l’expérimental, altérant la matérialité de la vision construite par le documentaire. Ce choix esthétique devient, dans Kaiserling III mais encore plus nettement dans Animal Macula, la porte d’entrée vers l’altérité du vivant. Les séquences d’ouverture et de clôture du film de Sylvain L’Espérance déstructurent les images typiques du film animalier en haute définition. Les couleurs vivement saturées, le recours au négatif et à la solarisation, ainsi que des fractures rythmiques entre ralentis, saccades et accélérations, sont autant de procédés qui métamorphosent l’image, la rendant profondément méconnaissable. Si la reproduction d’un regard animal par ce dérèglement du visuel pendant l’ensemble du long-métrage aurait été empreinte d’une certaine lourdeur, ces deux séquences circonscrivent nettement le procédé et constituent des antichambres expérimentales qui préparent le spectateur à décentrer son regard. La vision devient un objet de question et l’évidence de nos perceptions se fissure pour laisser entrevoir un arrière-monde qui correspond à l’univers animal, inaccessible mais dont l’existence se laisse intuitivement deviner.
On constate enfin une élasticité qui étire les cadres et les échelles, afin de produire un décentrement de la perception humaine de grandeur. La longue scène de dépeçage de baleine de Piblokto est fortement découpée, allant de la masse du rorqual saisi dans son écrasante globalité jusqu’à des inserts sur sa peau couverte de balanes, sa chair et ses fanons ensanglantés. Un insert énigmatique sur l’œil mi-clos de la bête morte constitue l’acmé de cette vision animale, à travers la transparence laiteuse de ce globe que l’on peine d’abord à identifier et qui, progressivement, rend au spectateur son regard. Le film fait ainsi advenir une rencontre entre les traces de cet esprit animal et la conscience humaine qui les perçoit.
La question animale à laquelle ces films se confrontent courageusement révèle les profonds paradoxes dont est chargé notre rapport à l’animalité. La difficulté du visionnage et la viscéralité de ces films en témoignent : l’animalité éclabousse notre humanité, et ravive en nous les bribes du sauvage.
Johanna Pataud
Images : El Juicio, 2023, Ulises de la Orden ; Adieu Sauvage, 2023, Sergio Guataquira Sarmiento ; Ana Rosa, 2023, Catalina Villar.
Je ne sais pas où vous serez demain, 2023, Emmanuel Roy ; Geographies of Solitude, 2023, Jacqueline Mills.
Animal Macula, 2023, Sylvain L'Espérance ; Piblokto, 2023, Anastasia Shubina et Timofey Glinin ; Kaiserling III, 2023, Philippe Rouy.