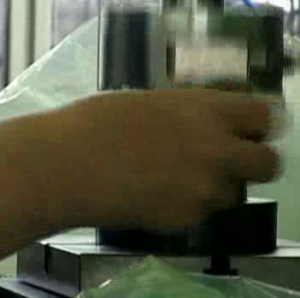Daaaaaali !, Quentin Dupieux
Ça, c’est Judiiiiiith !

Le rejet par certains du cinéma de Quentin Dupieux – et il n’est nullement question, ici, de jeter la pierre à ses détracteurs ; on aurait même plutôt envie de le faire envers ses adorateurs trop insistants – semble s’accentuer à mesure qu’il accélère sa cadence de tournage. Disons plutôt, c’est une impression, que ceux qui détestaient détestent toujours autant, et que ceux qui appréciaient ne cessent d’être déçus : films concepts, idées de courts-métrages, immaturité narrative. À ce titre, Daaaaaali !, avec son biopic en miettes aux multiples interprètes, énième ritournelle bouclée sur elle-même, ne déroge pas à la règle. Mais il ne faudrait pas passer trop rapidement sur ce qui fait la beauté de son cinéma, et qu’il semble creuser patiemment : le plaisir et la crainte de l’amateurisme, seulement capable de produire des micro-fictions morbides. La mort au travail dans ses récits, au sens propre dans Fumer fait tousser (2022), avec ce barracuda qui, carbonisé, ne pouvait aller au bout de son histoire, s’affirme au-delà de concepts tape-à-l’œil – exemplairement le pneu tueur de Rubber (2010). Lorsque ces amas d’incongruités frelatés trouvent une cohérence d’ensemble, ils débouchent sur un réel vertige mélancolique, celui d’un créateur en crise. Dans Daaaaaali !, les écarts figuratifs et les bifurcations rêvées sont autant de trucages qui déstabilisent une fiction en somme toute bête : un artiste qui essaye de faire un film sur un artiste.
On ne saurait être de trop pour se confronter à la figure si fantasque de Salvador Dalí. Quentin Dupieux ne s’y trompe pas et fait appel, pour incarner le peintre, à un sextet de comédiens – composé d’un quatuor principal (Edouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaï et Gilles Lellouche), d’une version plus âgée (Didier Flamand) et d’une apparition furtive (Boris Gillot). Sur le modèle de la trouvaille surréaliste de Luis Buñuel – comme il se plaisait lui-même à la nommer –, à savoir les deux Conchita (Carole Bouquet et Ángela Molina) de Cet obscur objet du désir (1977), les interversions au sein du quatuor se font sur un mode arbitraire. Aucun Dalí n’est caractérisable par rapport à un autre et chacun cède sa place sans justification narrative ou explication psychologique : peignant en extérieur une version, légèrement modifiée, de La Harpe invisible, fine et moyenne (1932), Pio Marmaï emprunte un conduit pour regagner la villa de Cadaquès ; à sa sortie, Jonathan Cohen lui a succédé ; lors du chemin inverse, c’est finalement Edouard Baer qui s’extirpe du tuyau et prend place devant le chevalet. Ces glissements poétiques, en se détachant de toute rationalité, redoublent le court-circuit opéré par les choix de casting. La biographie n’existe pas, Dalí n’est qu’un ensemble de signes (moustache, canne, chemise, accent) qui se transmet de main en main ; un héritage ne pouvant, par son poids, qu’être la propre caricature de lui-même, une devanture publicitaire – en écho aux rapports mercantiles qu’il a savamment entretenu avec elle. En somme, une signature réplicable en série, comme celle apposée par le peintre sur un tableau dont il n’est pas l’auteur, et qui constitue une parodie de son œuvre.
Diane Arnaud notait que les « changements de têtes en décalage avec le récit filmique sans qu’il y ait pour autant de raison conventionnelle établie ni d’explication allégorique fixée a prori[…] se retrouvent quasi-exclusivement dans des histoires d’amour malheureuses [11][11] Diane Arnaud, Changements de têtes De George Méliès à David Lynch, Pertuis, Rouge Profond, « Raccords »,
2012, p. 126. ». C’est à travers le personnage de Judith (Anaïs Demoustier), journaliste décidée à tirer le portrait de Dalí, que l’admiration et la fixation amoureuse s’entremêlent. Le recours à un vocabulaire sentimental n’est, à ce titre, pas anodin : elle explique, face caméra, qu’elle s’est comportée « comme après une rupture » suite au refus d’un nouvel entretien, le harcelant chaque jour au téléphone. L’éventail des six têtes permet à la figure de Dalí de ne pas rompre sous le poids d’un désir – platonique, rappelons-le – qui n’a dès lors comme horizon que d’être contrarié. Ces dérobades figuratives, forme de régénération permanente, lui (leur) permet(tent) de résister aux assauts de Judith, et par ricochet aux velléités biographiques.
Cette impossibilité à faire biopic – qui pouvait imaginer Dupieux mettre en boîte une biographie romantique ? – se conjugue donc à celle de Judith à faire entretien. Dès leur première rencontre, leur relation fonctionne sur un mode différé : alors qu’il sort de l’ascenseur pour la rejoindre, Dalí arpente un couloir qui se transforme en tunnel infini, où le temps s’étire de façon disproportionnée. Artiste et admirateur semblent voués à vivre cloisonnés, le second ne pouvant que se subordonner au premier, afin de ne pas froisser le projet esthétique de son illustre modèle, à savoir sa mégalomanie provocante. Cette dernière creuse la distance entre eux, nourrie par ses délires verbaux et, surtout, par l’attention qu’il porte à la mise en scène de lui-même – « Moteur ! », crie-t-il en ouvrant la porte. L’impératif d’une captation se double d’une surenchère technique, qui prend corps avec la « caméra gigantesque » exigée à Judith, seule à même de pouvoir restituer son image exubérante. Or, les efforts de la journaliste – jamais découragée – pour résorber l’écart entre eux sont aussitôt mis à sac par le peintre, qui renverse avec sa voiture l’une des caméras.

La déprise de Judith vis-à-vis de son projet ne tient pas seulement à une série de faux-bonds, elle passe avant tout par un parasitage de l’esprit. S’il est une présence fuyante, Dalí s’insinue inconsciemment dans sa tête, bug invisible faisant dérailler la machine. Tandis qu’elle patiente dans sa chambre d’hôtel, Judith aperçoit une chèvre – écho aux animaux empaillés aperçus en ouverture dans la villa ? – s’attaquer à un bouquet[22][22] La (Carole) Bouquet de Buñuel ? de fleurs, avant d’être réveillée par quelques coups à sa porte. Cette remise en cause, presque immédiate, du réel par le songe – comparable aux cauchemars en réseau de Réalité (2015) – l’éloigne d’emblée de son obscur objet du désir. Autant de réveils – l’effet par deux fois se reproduit – à la fausseté supposée, qui « sont avant tout des passerelles d’une bribe de surréalité à une autre [33][33] Diane Arnaud, Glissements progressifs du réel. Les faux réveils au cinéma, Aix-en-Provence, Rouge profond, 2018, p. 23. » et provoquent une porosité totale entre les différentes strates du récit. Judith se débat donc non seulement avec l’image de Dalí mais aussi avec son esprit, qui régit désormais le sien – une « crise d’eczéma, mais à l’intérieur » serait-on tenté de dire, comme dans Réalité. Elle est cantonnée à un statut de poursuivante, en témoignent ces plans, négatifs de ceux du couloir, où elle lui court après, dans une lumière rouge qui se conjugue à des dialogues rembobinés – façon black lodge de Twin Peaks. Son imaginaire est nul et non avenu, incapable de produire ses propres images.
Daaaaaali ! s’approche au plus près de son modèle non pas par son humour absurde[44][44] J’ai souvent l’impression que certains attendent de Dupieux d’être un génie des formes burlesques, alors qu’il est surtout un chantre de la pochade à froid., qui parfois fait mouche – le couloir, une pluie de chiens morts et, surtout, du tir au pigeon, au sens propre –, mais par ces déplacements provoqués par les songes. Lors d’un repas aux relents putrides – une soupe de vers, de boue et de crânes –, le père Jacques (Éric Naggar) se permet de raconter son rêve au maître : le voilà en Enfer, sur sa bicyclette, avec son panier de légumes ; puis à dos d’âne dans le désert, sans son panier, avant qu’un cowboy ne lui tire dessus ; puis, vivant, sur un bateau à moteur, retrouvant son panier sur l’eau ; puis dans une voiture de luxe. « À ce moment-là, je me suis réveillé », conclut-il. Le film fait sien cette logique de mouvement constant mais buté – l’accrochage entre la voiture du peintre et un camion, en sortie de rêve –, pour moduler autour de ses propres motifs : le dîner se termine, le jeu du chat et de la souris entre Judith et Dalí se poursuit et voilà que le père Jacques clôt, de nouveau, avec son réveil. Les plans précédents prennent de fait le statut d’images mentales, tandis que s’instille une présomption de surréalité vis-à-vis de ceux à venir. Alors qu’on pouvait craindre une sclérose dans l’univers figé de l’artiste – du moins de l’idée qu’on peut s’en faire –, les rêves en cascades réinventent la fiction, jouent avec les pièces du puzzle pour constituer toute une multitude d’agencements. Les faux réveils en boucle – certes ils ne sont pas figurés, seulement énoncés par quatre « Et là je me réveille » –, dans lesquels se confondent l’épopée de Judith, se présentent ainsi tels des lignes de fuite.
Il n’est pas question de s’ébaubir devant la virtuosité d’assemblage du film – même si s’y abandonner procure un réel plaisir –, mais de s’attarder sur ce qu’elle produit, véhicule : une esthétique du surmenage créatif. Daaaaaali ! n’est pas ivre de lui-même, ne se gargarise pas de sa malice. Il faut voir la fatigue qui habite progressivement le père Jacques, au bord de la rupture au moment d’évoquer son ultime – du moins il l’espère – réveil. De telles fictions, aussi tarabiscotées et habitées par la mort, ne peuvent que laisser groggy. On pourrait croire Dalí tiré d’affaire, lui qui, changeant de têtes, resterait à l’abri de toute défiguration. Mais la dernière épopée du prêtre voit s’opérer une dernière transformation, avec l’arrivée d’une version vieillie de Dalí. Avec ce saut dans l’âge, Dupieux se confronte par là même à la vanité de son art. Dalí, qui aura tout du long piégé Judith, est désormais victime de l’art des autres, du « rêve le plus long du monde ». Son reflet aux traits ridés, aux cheveux et à la moustache blanchis, contemple son image dans la galerie des glaces, perdu dans une temporalité qu’il ne maîtrise plus ; désormais « nourrisson ou vieillard, ou un mélange des deux », pense-t-il pour lui-même. Car les effets de mise en abyme ne préservent personne.
L’enchaînement des dernières séquences assoit Daaaaaali ! comme un triple portrait d’artistes, autant de voies créatives plus ou moins sereines. Il y a Dalí, qui poursuit son entreprise de destruction et évince Judith de son propre projet, son documentaire pourtant célébré dans une salle de cinéma. Dans un effet de mise en abyme où plan final et image télévisée ne cessent d’être enchâssés, le peintre manipule le cadre, jusqu’à exiger la disparition de Judith. Mais il ne se contente pas de l’extatique « Ça, c’est Dalí ! » adressé à la caméra ; Baer prend le relais de Cohen et s’accroche au plan, rattrape une caméra embarquée dans un panoramique vers le ciel. Puis c’est le père Jacques, qui, assis à son chevalet, tente de reproduire cette vision ouvrant le film – rien moins que l’illustration d’une toile de Dalí (Fantaisie nécrophilique coulant d’un piano à queue, 1932) – ; tentative apaisée de reproduction d’un imaginaire en libre-service. Mais le véritable sujet du film, c’est Judith, dont l’énergie vitale contre la mort au travail diffuse tout du long, lui permet de s’affirmer au milieu de la confusion des subjectivités – les images mentales du dîner, dont on ne sait plus, au fond, si elles sont celles du prêtre ou du peintre. Le dernier plan ne pouvait dès lors être que pour elle. Non dans l’euphorie de la projection, mais plutôt dans sa chambre d’hôtel, peut-être encore prisonnière des rêveries angoissées, et interviewée par un vieux moustachu qui lui demande de raconter son parcours, « d’inventer [son] début de carrière ». Daaaaaali ! n’aura été que cette quête de légitimité, l’humble trajectoire d’une apprentie cinéaste à qui il ne reste plus, pour inventer sa vie davantage que sa carrière, qu’à franchir le seuil de cette chambre. Plus question de se laisser dicter le tempo par des embryons de récits morbides, mais de prendre le contrôle du processus artistique. Cette crise bégayante aura eu le panache de prendre la forme de songes entêtants et récréatifs, pour qu’enfin chacun puisse s’exclamer : Oui, ça, c’est Judith !

Scénario : Quentin Dupieux / Image : Quentin Dupieux / Montage : Quentin Dupieux / Musique : Thomas Bangalter
Durée : 1h18.
Sortie française le 7 février 2024.