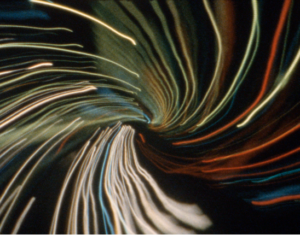Dominic Gagnon
Vers un cinéma-Frankenstein
Né en 1974 au Québec, Dominic Gagnon est le réalisateur depuis 1996 d’une vingtaine de courts et de longs métrages. A partir de 2009 et RIP in America, il développe un dispositif qu’il a baptisé lui-même « saved footage ». Pour le dire en quelques mots, il s’agit du montage de vidéos non-virales récupérées essentiellement sur YouTube en ciblant un sujet précis. « Saved », tant pour le caractère extrêmement marginal de ces vidéos que pour le fait, comme il l’explique fréquemment, que leur sauvegarde est en partie motivée par la forte probabilité de leur suppression par l’hébergeur. Avec of the North, sorti en 2015, Gagnon a entamé un cycle consacré à l’imaginaire des points cardinaux qui a trouvé un récent prolongement en Going South, présenté le 18 avril 2018 au festival Visions du réel à Nyon. Encore peu connu, le travail de Gagnon est essentiellement diffusé en festivals sous la catégorie « documentaire expérimental ». La majeure partie de ces films est cependant visible sur sa chaîne YouTube.
Débordements : J’aimerais commencer par parler de ta société de production, Film 900, et de la façon dont tu finances tes films ?
Dominic Gagnon: J’ai fondé Film 900 parce qu’il fallait que je sois enregistré comme une entreprise pour recevoir des sous. C’est un nom que j’utilise quand on me force à me professionnaliser, à avoir des numéros de taxes, etc. Mais ce n’est rien, juste une compagnie enregistrée comme ça, qui n’a pas d’adresse, qui n’a pas vraiment pignon sur rue. C’est moi, mais en entreprise [rires].
D.: Plusieurs de tes films ont été financés par le Conseil des arts du Québec. Quand un organisme comme celui-là donne de l’argent à Film 900, peux-tu te le reverser ? Est-ce ainsi que ça fonctionne ?
D.G.: Voilà. C’est donné à Film 900 ou à moi. Ce sont souvent des bourses de recherche qui ne dépassent pas 50 000 dollars canadiens [environ 33 000 €, ndlr]. Ce n’est pas nécessairement de l’argent pour la production elle-même, donc je ne suis pas tenu de terminer un film avec ça, mais moi j’arrive à tricoter… Avec ces bourses, je n’ai pas de compte à rendre à un producteur ou à un organisme. Je suis libre. C’est comme ça que je m’en sors, administrativement parlant. Et c’est aussi comme ça que j’arrive à payer le loyer, la bouffe, etc.
D.: Qui te donne ces bourses ?
D.G.: Le conseil des arts du Québec, et le conseil des arts du Canada… Je peux jouer sur les deux échiquiers, étant québécois.
D.: Tu arrives donc à vivre de ce que tu fais.
D.G.: Oui. Je vis très humblement mais j’ai toutes mes journées pour moi, personne ne m’impose rien. Je reviens de Chicago, où j’ai passé une semaine. J’ai gagné à peu près 2 000 dollars, ce qui me permet de payer deux-trois loyers. Je vis au compte-goutte. Mon budget, c’est quoi ? 20 000, 25 000 dollars par an. C’est sous le seuil de pauvreté… Ouais, je suis créatif ! [Rires.]
D.: Tu n’as plus du tout besoin de travaux alimentaires ?
D.G.: Je suis assez habile de mes mains donc je fais de la menuiserie quand j’ai besoin d’argent. J’ai des amis qui font ça à longueur d’année. Quand je suis vraiment dans la merde, je les appelle et ils me trouvent un petit emploi par-ci par-là. Mais ça fait au moins six ans que je n’ai pas fait ça.
D.: Tu as parlé de « recherches ». Es-tu parfois financé par des universités ?
D.G.: Non. Je n’ai pas poursuivi mes études, ça ne m’intéressait pas. J’ai fait ce qu’on appelle ici un « bac ». J’ai terminé l’école à 21 ans à peu près. Je ne suis pas « gradué » ni rien. J’allais dans une université anglophone alors qu’à l’époque, je ne parlais pas du tout anglais… [rires.] En fait, c’était plus pour avoir accès à de l’équipement, et puis quelques profs et quelques étudiants m’ont beaucoup inspiré. Cela dit, je me considère comme un autodidacte. Ce ne sont pas mes profs qui m’ont appris à faire ce que je fais. Plutôt l’inverse. Ils nous forçaient à travailler avec du film et des affaires complètement dépassées. Avec mes trucs d’ordi, d’internet et tout ça, ça ne calait pas trop bien avec leur plan de cours.
D.: Le web était-il présent dans ta pratique dès le début ?
D.G. : Non, c’est venu plus tard. Vers 2008, à peu près. En 2005, YouTube a été introduit dans nos vie. A ce moment-là, il n’y avait pas de contenu original. Les gens avaient juste uploadé leurs collections de VHS. Ça a pris au moins deux ou trois ans pour qu’il y ait une culture de vlogging, que les gens se présentent vraiment, parlent de leur vie, essaient de créer des communautés d’intérêt… Là c’est devenu intéressant pour moi, c’est devenu documentaire.
D.: Par quel biais sauvegardes-tu les vidéos que tu trouves ?
D.G.: Chaque année, il faut développer une nouvelle technique parce que les algorithmes de compression changent. YouTube essaie aussi de sécuriser sa plateforme avec de nouveaux trucs. Au début, je filmais l’écran, puisqu’il n’y avait pas vraiment d’autre moyen. Après je les ai downloadées. C’était un petit peu plus simple. Aujourd’hui, je dois chercher des logiciels qui trainent un peu partout au point de source, et qui permettent d’extraire à peu près n’importe quoi de n’importe quelle plateforme.
D.: Tu es paraît-il à l’origine de l’expression « saved footage ».
D.G.: Les vidéos sont souvent perdues à cause de la censure, mais aussi de l’accumulation. Il y en a tellement… Hier, j’étais avec le directeur de la Cinémathèque de Montréal et il me disait : « Les gens ont été fâchés par of the North mais dans 50 ans, ils te remercieront. C’est à cause de toi qu’on aura aussi voulu préserver ces images-là. Internet sera peut-être ailleurs, payant, je ne sais pas… il faudra qu’ils te remercient d’avoir sauvé un petit peu de leur patrimoine, puis leurs vidéos. Il n’y a pas que des choses négatives dans le film, il y a aussi de belles musiques, de belles chansons, etc. » Quand quelqu’un me demande une copie, je lui envoie souvent gratuitement. Pour moi, c’est une manière un peu plus simple d’envisager la consommation du cinéma. Et puis plus il y a de copie, plus le film est en sécurité. Nous ne sommes plus à l’époque où on protège un film en rangeant le négatif dans un calice de métal quelque part dans le sous-sol d’une cinémathèque. Si ça avait été le cas, of the North aurait été détruit ! [Rires.] Des gens ont appelé à sa destruction en pensant qu’il y avait une copie unique du film. C’était vraiment idiot de leur part. On vit à l’heure d’internet, plus des mines. of the North est même devenu viral à un moment. Je ne sais pas combien il y a de copies dans le monde, mais ça dépasse le millier, c’est sûr.
D.: À cause de la polémique…
D.G.: Exactement. Tout le monde a voulu voir le film. C’est mon plus gros succès. [Rires.]
D.: Est-ce que ça n’a pas été difficile pour toi, malgré tout ?
D.G.: Oui, ça a été très dur. J’ai presque perdu tout ce qui constituait ma vie à l’époque, que ce soit des contrats, des amitiés… La pression était très forte sur les gens autour de moi. Moi, j’étais un peu plus franc : si vous aimez ça, vous aimez, si vous n’aimez pas, ce n’est pas grave. Mais les gens autour de moi ont cru que j’étais fini, qu’il n’y aurait plus rien de possible pour moi… En fait, j’ai eu beaucoup plus de soutien qu’on pourrait le croire. Que ce soient des amis professeurs ou des directeurs de cinémathèques… Ça a été très inspirant pour moi de me dire : « Oui, on peut faire des films difficiles, controversés, mais on ne se fait pas complètement lâcher par le milieu. » Il y a des festivals qui ont continué à programmer mes films, comme Visions du réel cette année. Je pense qu’en Europe, les gens sont beaucoup moins puritains sur ces questions-là. En Amérique, on vit vraiment un mouvement de rectitude politique assez hallucinant. Tu ne peux plus parler des autres, tu ne peux plus faire le portrait des autres, tu ne peux plus même faire une blague sur quelqu’un d’autre… Les gens osent juste parler d’eux. Pour moi, la caméra doit aller vers les autres. Je ne veux pas commencer à faire des films sur moi.
D.: Tu avais conscience, avant la diffusion aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal, qu’of the North allait faire polémique ?
D.G.: Non, pas du tout. Faire des films comme je le fais, même si ça a l’air de bien fonctionner, ça n’attire pas tant les masses que ça. J’ai souvent été très marginalisé, rangé dans les petites catégories… Quand personne ne se préoccupe de ce que tu fais, tu deviens très libre, tu ne te censures pas. Mais quand les gens ont vu le film, ils se sont alarmés sur les réseaux sociaux. J’ai reçu énormément d’attention. Trop. Je n’étais pas prêt. Au Canada, on en parlait à la télé, à la radio, dans les journaux, un peu partout… C’était une bombe médiatique. J’ai été pris dans un tourbillon auquel je n’étais pas préparé. Je n’avais pas d’attaché de presse… Ça a nourri beaucoup la polémique dans le sens où, si tu essaies d’être autoritaire avec moi, tu vas voir le diable.
D.: Certaines personnes t’ont demandé de retirer les passages qu’ils avaient filmés.
D.G.: Au début, je me suis dit : je vais être de bonne foi. S’ils ne veulent vraiment pas être associés à moi et à mon film, je vais les retirer. Mais les seules demandes que j’ai eues concernaient des images très positives : les petits jeunes qui font des tours de magie, la chanson de rap Don’t call me an Eskimo, toutes ces choses-là… Il ne restait que le côté sombre, exactement ce qu’on m’avait reproché. C’était comme contre nature. J’ai d’abord cru qu’ils ne voulaient pas être associés avec les autres images… Puis je me suis rendu compte que ce n’était pas vraiment sincère. La plupart des gens n’avaient pas vu le film. Une seule personne – l’artiste Stephen Puskas – avait orchestré tout ça. C’est-à-dire qu’il a contacté chaque personne en disant : « Vous faites partie d’un film raciste. » Et c’était déjà jugé, avec aucune possibilité de le voir… Les mails de retrait étaient tous écrits de la même main. Le mec est vraiment parti en campagne contre moi, il a complètement utilisé la porte que j’ouvrais : « Si quelqu’un a un problème, je retirerai son contenu… » Et là c’était tout le film qu’il fallait retirer. A un moment, je me suis dit : c’est comme un suicide de ma part parce que ma seule défense, c’est le film. Je ne le trouve pas raciste, je ne le trouve pas si offensant que ça, puis plein d’autres gens aussi… Continuer à le montrer était ma seule défense. Ceux qui l’ont vu après disait : « Ah, c’est juste ça ? On s’imaginait que c’était la pire affaire alors que, pour le web, c’est assez soft. »
La décision a été difficile mais j’ai repris la distribution du film original. En trois ans, je n’ai jamais vu personne sortir du cinéma en se disant : « Oh, les Inuits c’est des salauds ! » Au contraire, c’était plutôt : « Qu’est-ce que fait le gouvernement canadien ? Laisser vivre des gens dans une situation pareille… C’est le tiers-monde, calice ! Qu’est-ce qu’il fait votre gouvernement ? Pourquoi c’est comme ça ? » Les stéréotypes qui devaient être cassés, c’est bien ceux à la Nanook of the North, c’est-à-dire que les gens pensent encore qu’ils vivent dans des igloos, qu’ils n’ont aucune technologie, etc. Le film détruisait plus de stéréotypes qu’il n’en créait.
D.: Avant of the North, avais-tu déjà reçu des demandes de retraits de vidéos ?
D.G.: Non. Jamais, jamais, jamais.
D.: Prends-tu contact avec tout le monde ?
D.G.: Il est très difficile de prendre contact avec tout le monde. La façon la plus simple que j’ai trouvée, c’est de remettre le film en ligne une fois terminé. YouTube envoie des notes à tous les auteurs en leur disant : « Il y a un troisième parti qui utilise votre contenu et voici la vidéo en question. » Alors les gens me disent s’ils sont d’accord ou ci ou ça… Mais la plupart du temps, les gens abandonnent leur channel : ils vont mettre quelque chose en ligne, puis ils perdent leur mot de passe, etc. Des fois il y a aussi des re-posts : quelqu’un met quelque chose en ligne, quelqu’un d’autre va le rediffuser avec un autre nom, un autre site. Je dirais que j’ai pu avoir un contact avec 30% des auteurs originaux. Comme il est impossible d’avoir le consentement de tout le monde, je me suis dit que j’allais essayer de faire des films corrects, éthiques. C’est-à-dire qui respectent plus ou moins la volonté des gens. Je ne veux pas déformer les choses, ou écrire des commentaires par-dessus l’image en imposant ma voix. On reste plus dans l’archive. Mais si tu es chez toi, dans un restaurant chinois ou je ne sais où à regarder des vidéos YouTube, tu ne vas pas demander la permission aux gens avant de les jouer… C’est public, ça fait partie du domaine public. Donc légalement, je suis correct. C’est pour ça qu’un festival comme Visions du réel joue mes films. Quatre avocats ont été consultés pour s’assurer que je n’enfreignais aucune règle, aucune loi, en vérifiant ensemble le copyright, la propriété intellectuelle, le droit à l’image. Ils m’ont dit : « T’es gonflé, mais t’es correct. » [Rires.]
D.: Tu n’as pas peur que la législation évolue ?
D.G.: Ça se peut. On est dans une zone grise. Dans un pays c’est permis, dans l’autre ça ne l’est pas. Personne ne s’entend, c’est un gros débat…
D. : Cette confusion est à ton avantage.
D.G.: Bien sûr. Et ce qui me sauve, par-dessus tout, c’est que je ne vends pas mes films. Ce serait de la grosse appropriation sale si je me faisais de l’argent avec ça. Tandis que là, ils ne peuvent pas m’attraper. Personne ne peut me faire une poursuite pour partager mes dettes avec moi.
D.: Penses-tu avoir été plus critique avec of the North que dans le cycle précédent ?
D.G. : Non, plus soft. Faire un film sur l’Amérique – qui est la première puissance mondiale et qui a tous les droits –, ce n’est pas du tout comme faire un film sur un peuple génocidé. Les Premières Nations au Canada ont une situation tellement difficile dans l’histoire qu’il n’est pas question de se moquer d’elles. Même s’il y a des images un peu sensationnelles, dérangeantes, je trouve ça relativement soft. Des gens qui vomissent, des vagins, ça ne me fait pas peur. 80 % des communications internet aujourd’hui sont faites de pornographie. On ne va pas jouer aux vierges offensées : « Oh, un vagin, cachez ça ! » Ils ont une sexualité, ils font du porno comme tout le monde… Ils font la fête, puis ils vomissent, puis ils trouvent ça drôle, puis ils filment ça, puis ils mettent ça sur internet. Comme dans toutes les vidéos jackass que tu peux trouver. Ils ont le droit à leur propre accès à cette culture-là.
Beaucoup de femmes filment sur la banquise, mais elles sont plutôt professionnelles. Ça, ça ne m’intéresse pas, je ne peux pas piquer le travail d’un autre. Mais quand c’est amateur… C’est comme des bouteilles à la mer… J’ai pris le temps d’y regarder, de le considérer, pour réellement voir ce que c’était. Je ne vois pas ça comme une traîtrise, plutôt comme une nouvelle chance pour ce matériel qui ne serait pas vu sinon. Personne n’a le temps d’aller voir des vieilles vidéos d’il y a 10 ans, sur YouTube, en résolution de 140p. Tout le monde regarde les trucs des Kardashian, de Rihanna… Ils regardent les fesses de Rihanna, ils n’ont pas le temps de regarder ces affaires-là.
D.: Tu as parlé d’une évolution forte entre le cycle américain (de RIP in Pieces America jusqu’à Hoax_Canular) et of the North. Y a-t-il également une différence marquée entre of the North et Going South ?
D.G. : Oui, énorme. Par exemples, les Inuits utilisent plutôt des téléphones intelligents. RIP in Pieces America, c’est plutôt des desktop computer (de grosses machines avec la webcam intégrée), donc il n’y a pas de mouvement dans ce film-là – je pense qu’il n’y a pas un seul pan. Dans Going South, c’est comme un mélange des deux. Beaucoup de gens se confient à la caméra en mode frontal, mais il y a aussi beaucoup de GoPro et d’images HD. Ça crée une grande différence dans le sens où il n’y a plus de médiation par l’ordinateur : on voit les pixels, les artefacts et puis on se dit : « Ah, ça a été downloadé d’internet. » Là c’est aussi beau que si je l’avais fait moi-même. Ce qui crée plutôt une confusion. Je sens que j’entre dans une autre ère. C’est comme le Ciné-œil de Vertov, l’œil collectif digital, le panopticon total, ça me fait vraiment tripper.
D.: Dans le texte que tu as écrit, « L’épuisement du réel », on peut lire : « Le talent est de savoir quand s’arrêter. Mais c’est aussi accepter les incidents, les imprévus. Surtout les incidents parce que dans mon cas, je tiens à demeurer le plus économe possible. » Comment sais-tu que tu dois arrêter un montage ?
D.G. : Quand je ne suis plus capable mentalement, physiquement. C’est souvent là que ça se termine. Je n’ai pas encore appris à être plus raisonnable que ça. Épuiser les potentiels, épuiser les ressources, épuiser mes énergies, épuiser la force d’évocation des images. Épuiser aussi la patience des spectateurs ! [Rires.] Mes films ne sont pas si faciles que ça à regarder.
Pour moi, c’est un peu comme faire des casse-têtes, sauf que je n’ai pas l’image de départ et qu’il y a un nombre infini de pièces. Il faut beaucoup d’essais pour trouver les bonnes compositions, les bonnes associations. Quand je sens que j’ai un cadre, qu’une image commence à apparaître, que ça se tient bien en équilibre, j’ai l’impression de découvrir une image que personne ne connaissait. Alors un sujet de film apparaît. Quand j’ai fait la trilogie américaine, je n’avais aucune idée que Trump allait apparaître dans l’actualité huit ans plus tard. Mais c’est sa base électorale, c’est à ces gens-là qu’il parlait. Ils existaient, mais personne ne le savait. Le film aujourd’hui sert un petit peu à documenter l’ère pré-Trump. Comment et pourquoi cette pensée-là a pu faire surface à grande échelle… Ça je ne le savais pas quand j’ai commencé à faire le film. On était dans Obama, tout était beau, parfait, un Noir à la tête des États-Unis… Il y a eu un revirement, et je me suis trouvé à le documenter un peu par accident. C’est pour ça qu’il est important de pousser les exercices jusqu’à leurs limites. C’est le matériel qui dicte souvent la voie à prendre. Moi, je fais juste quelques coupes dans le fond. Je ne tiens pas tant, après, à dire que ce sont mes films, ma propriété. Je fais plus un travail de commissariat, un peu comme quelqu’un qui ferait une exposition. Je collectionne les peintures dans un garage : l’art naïf, l’art brut… Puis je vais faire une belle exposition avec tout ça. L’exposition, oui, je la revendique. Je vois mes films plutôt comme ça. Ce ne sont pas mes films mais ce sont mes montages.
D.: Tu parlais aussi d’ « incidents » dans ce texte. As-tu des exemples ?
D.G. : C’est des petites affaires… Tu enlèves l’image d’un tracteur et deux nouvelles images se recollent et puis là : « Wouah ! C’est beau ! » Je travaille par soustraction. Ce qui ne me plaît pas, je l’enlève. Souvent les associations se font de manière très chaotique parce qu’il y a tellement d’images qui tournent… Je ne sais pas si tu es familier avec le jeu du bingo. Un boulier avec des balles, et on fait des séquences de lettres et de chiffres… Je suis un peu comme ça. J’ai ma boule… Puis à un moment je vois des choses, je les aime, je les garde…
D.: Pour RIP, tu avais téléchargé 10 heures de vidéos. Pour of the North, plus de 500. Pourquoi cette différence ?
D.G. : Au début, je re-filmais les images. Il fallait quand même que je les écoute en les filmant. Et puis les durées permises sur YouTube ont augmenté avec les années. En 2007-2008, les vidéos faisaient 3 minutes maximum. Aujourd’hui il n’y a plus de limite. Je peux downloader une vidéo d’une heure et demie en 10 secondes. Ensuite, il faut que je la regarde. [Rires.] Je récupère de plus en plus de choses, mais de plus en plus de merdes aussi. Les gens se filment, puis ils vont aux toilettes sans même prendre le temps de fermer la caméra. Pleins de moments un peu ridicules… des gens qui s’endorment. J’ai dix minutes d’images que je n’ai pas utilisées parce que je ne trouvais pas ça correct pour la personne. Elle s’endort réellement dans sa chaise et puis ça tourne. J’accumule de plus en plus mais ce n’est pas nécessairement plus intéressant. Il faut plus de travail pour trouver les petites perles…
D.: Combien d’heures auras-tu pour Going South ?
D.G. : Pas loin d’of the North, je pense. Peut-être un petit peu plus. Je commence à envisager d’avoir un assistant virtuel. Étudier un peu l’intelligence artificielle, essayer d’entraîner un ordinateur à faire des films comme moi pour qu’il puisse m’aider à déterrer des trucs. Parce que c’est devenu trop impressionnant : les gens produisent de plus en plus… Ça se « spectacularise » beaucoup aussi. C’est-à-dire que les gens sont devenus plus professionnels. Ils sont davantage à la recherche de clips, de reconnaissance sociale, etc. Ils veulent des likes, des subscribers, de l’argent… Ça devient moins intéressant pour moi.
D.: Il est de plus en plus difficile de trouver du non-viral.
D.G. : Exact. Les moteurs de recherche sont aussi contre moi parce qu’ils veulent toujours me montrer le plus populaire. C’est très rare maintenant que je trouve des 0 view, comme ça m’est arrivé dans le temps. Avant je trouvais des vidéos marquées 0 view, et je me disais : « Bon, c’est juste pour moi ! » [Rires.]
D.: Combien de temps as-tu consacré à Going South ?
D.G. : Ça a été long. C’est le plus long. J’ai presque pris deux ans et demi pour le monter. C’est aussi parce que j’étais en pleine controverse et puis j’avais beaucoup de problèmes personnels… Me réinstaller, divorcer. J’ai une fille de huit ans, j’ai passé beaucoup de temps avec elle à essayer de réorganiser ma vie correctement. Répondre à toutes les entrevues aussi, toutes les accusations… Les chicanes aussi. J’ai des amis qui se sont chicanés parce qu’ils n’étaient pas d’accord… Mais là je suis content, j’arrive avec les coudes super solides. Je suis très fier de Going South. C’est vraiment comme un « Fuck you all ! » [Rires.]
D.: Tu as déjà commencé à travailler sur le suivant ?
D.G. : Ouais, c’est « Est ». La Chine, la Russie, la Corée du Nord… Je vais travailler avec le dark web cette fois. Comme il y a beaucoup de censure dans ces pays-là, c’est le seul endroit où je peux trouver des trucs un peu marginaux, un peu dissidents, qui défoncent, qui sont contre le pouvoir… C’est ça ma nouvelle plateforme, mon nouveau terrain de jeu. Si je bosse sur les plateformes populaires comme Youku ou Rutube – des copycats de YouTube : ils ont copié les plateformes, ils ont gardé les serveurs à Pékin – il n’y a pas de contenu subversif, il n’y a rien. En changeant de plateforme, en changeant de méthode, ça va donner une esthétique différente.
D. : Penses-tu déjà à « Ouest » ?
D.G. : « Ouest », je me suis rendu compte que je l’avais déjà fait. [Rires.] C’est pas mal, hein ? C’est RIP et compagnie. Hoax… C’est loin ça.
D. : J’ai lu que tu te verrais bien prof à 60 ans…
D.G. : Je vais souvent dans des écoles. J’adore ça, le contact… ça me stimule bien plus d’avoir un entretien avec toi aujourd’hui qu’avec un journaliste crotté qui veut juste me poser un piège. C’est ma manière d’échanger, de partager sur ce que j’aime. Je n’arrêterai jamais de faire ça. Si un jour on veut me payer pour le faire, je serais bien content ! C’est parfois déjà le cas.
D.: Y a-t-il des éléments de ta pratique que tu considères comme une façon de recycler le cinéma hégémonique ?
D.G. : Quand j’étais étudiant, tous les grands maitres ont déclaré que le cinéma était mort… Alors je me suis dit qu’il devait y avoir un cadavre quelque part. Comme je ne le trouvais pas, j’ai pensé qu’il avait peut-être été démembré… La production de vidéoclips aujourd’hui, c’est très cinématographique… La manière dont on se présente sur les réseaux sociaux aussi – Instagram, etc. Beaucoup d’éléments de mise en scène… Même dans la production de vidéos YouTube, on utilise des éclairages, du maquillage… Tout ce qui faisait le cinéma à une certaine époque. Mon job serait finalement de retrouver tous ces morceaux-là et de les recoudre ensemble pour créer une sorte de cinéma-Frankenstein, qui est très inspiré par le cinéma classique – le cinéma hégémonique, comme tu l’appelles. Qu’est-ce qui fait cinéma pour moi ? J’essaie de retrouver ces petits moments où je sens des idées de cinéma. De vraies idées de cinéma, des trucs qui font référence au cinéma d’avant-garde, au cinéma classique, au cinéma populaire… Je travaille avec une mémoire de ce qu’a déjà été le cinéma, pour le recréer, mais avec des matériaux complètement nouveaux.
RIP in Pieces America est plus près de l’art vidéo, dans le sens où c’est plus statique, il y a beaucoup de répétitions, de compilations, etc. Là je bouge de plus en plus vers des formes très cinétiques, avec beaucoup de mouvements, de lumières, de contrastes… Je ne veux pas rajouter des images sur la pile, mais plutôt essayer de faire quelque chose avec ce qui existe déjà. C’est quasiment une mission écologique, mentale… Ça sert à quoi de faire des images si on ne les monte pas ? Ça sert à quoi de faire des images si on ne les réfléchit pas ? Ça sert à quoi de toutes les emmagasiner dans des serveurs, dans des data centers, si on ne les consulte jamais ? Les gens accumulent, accumulent, accumulent… Ce qu’il faut, c’est faire un petit montage, articuler tout ça, synthétiser tout ça. C’est comme ça que je vois mon travail. C’est très cinéma, mais en même temps je n’ai pas envie d’en rajouter. J’ai plus envie de faire du sens avec ce qui existe déjà.
D. : Est-ce que l’affiliation avec le cinéma direct te paraît pertinente ?
D.G. : J’appellerais quasiment ça du cinéma hyper-direct. Dans le cinéma direct, il s’agit d’entrer en relation avec les gens, d’être au plus près d’eux. Je n’ai jamais été à l’aise avec ça. Ce que j’ai vu autour de moi, c’est souvent des gens qui créaient de fausses amitiés… Comme je ne suis pas en relation avec les gens, on pourrait plutôt parler d’archéologie que d’anthropologie. Mes films sont des études d’objets – en l’occurrence, de vidéos. C’est un peu comme recoller un vase cassé qu’on aurait trouvé dans la terre. Moi, je ne veux pas entrer en relation avec les gens, je préfère les mettre en relation. C’est-à-dire faire naître les communautés dont ils rêvent. S’il y a une constante dans les films que j’ai utilisés, c’est bien celui de « faire partie de » – to belong. Souvent c’est casse-cou, ils n’y arrivent pas. Avec des 2, 3 views, il n’y a pas de communauté. J’ai l’impression de leur en donner une. Ça les contextualise. On comprend mieux la personne qui montre ses guns parce qu’on a entendu l’autre s’exprimer contre le gouvernement américain. Les vidéos sont éparpillées sur le web, dans des compartiments… Soit porno, soit sensationnaliste, cascades, jackass… Les regrouper, c’est leur redonner leur vrai contexte. Toutes les accusations de décontextualisation qu’on m’a servies… J’ai plutôt fait l’inverse.
D.: Ton approche de la musique a-t-elle évolué ?
D.G. : Mon cinéma est très musical depuis le début… Les images, la façon dont elles s’imbriquent les unes dans les autres… Il faut que ça fonctionne musicalement. Il y aura toujours de la musique, je pense, dans mes affaires, même si c’est plus la musique noise qui m’intéresse, la musique concrète, industrielle… J’aime les moteurs, les sons industriels, les artefacts de compression…
D.: As-tu songé à faire des clips en saved-footage ?
D.G. : Non. J’en ai déjà vu pas mal. En Allemagne, en Corée du Sud… c’est souvent des compilations : on se donne un sujet, un mot-clef et on va faire le tour… Si quelqu’un me donnait de l’argent, peut-être que je me laisserais séduire. Mais je préfère les fresques, quand c’est épais, quand on a le temps de construire des trucs plus narratifs. Et puis les clips sont consommés sur le web aujourd’hui, donc il n’y a plus de détournement. Ce que j’aime, c’est détourner des images du web et les présenter dans un cinéma. Là ça devient politique. On est un groupe qui regarde des images, on n’est pas une personne derrière un poste informatique. of the North est un très bon exemple. Toutes les images existaient avant le film. Personne n’en parlait, ce n’était pas un problème. Mais quand tu les amènes au cinéma : POUM ! explosion. Toutes les pierres ont été retournées, tout le monde a été obligé de se positionner, de se définir par rapport à ce film… En ce sens-là, c’est un succès. Très peu d’œuvres d’art arrivent à faire ça aujourd’hui, à mobiliser les gens autant. On en parle encore ici. C’est le film le plus controversé de toute l’histoire du cinéma canadien. [Rires.]
D.: Quelle est ta relation aux réseaux sociaux ?
D.G. : Je n’ai pas internet à la maison, ni dans mon studio… Je vis en circuit fermé. De temps en temps je pars à la pêche, je remplis un disque dur puis je vais analyser ça à la maison, sans distraction. Parce que, putain, l’internet, ça peut te draguer toute ton énergie, ton attention. Je préfère laisser ça aux autres. Moi je suis un observateur. Un peu comme un documentariste classique qui se promène et qui observe le monde autour de lui. Dans les années 1960, j’aurais cogné aux portes pour demander : « Est-ce que je peux filmer votre chat sur le divan ? Est-ce que je peux le filmer pendant sa toilette ? » Les gens m’auraient dit : « Non, t’es fou ! Tu n’arrives pas comme ça, là… » Mais là je découvre ce que les gens veulent bien partager. C’est déjà dans le contrat.
D.: Y a-t-il eu un moment où tu avais internet chez toi ?
D.G. : Non, je ne suis jamais tombé dedans. J’ai une adresse hotmail qui date de 20 ans. Skype me permet de parler à ma famille, faire des entrevues. C’est ma façon de partager sur le web depuis 25 ans.
Filmographie de Dominic Gagnon :
Going South (2018)
of the North (2015) – 74’
Hoax_Canular (2013) – 92’
Du Rouge à Lèvres (2013) – 1’
Big Kiss and Goodnight (2012) – 62’
L’Espace de la Société (2012) – 60’
Pieces and Love All to Hell (2011) – 61’
Data (2010) – 61’
Rip in Pieces America (2009) – 61’
Haute Vitesse (2007) – 47’
Blockbuster History (2005) – 22’
The Matrix (2004) – 4’
Total Recall (2004) – 5’
Iso (2002) – 75’
Du moteur à explosion (2000) – 41’
Anchorage (bande-vidéo) (1998)
Beluga Crash Blues (1997) – 19’
Parapluie Bomb City (1996) – 12’
Toutes les images proviennent de films de Dominic Gagnon : Rip in Pieces America (2009) / Data (2010) / L’Espace de la Société (2012).