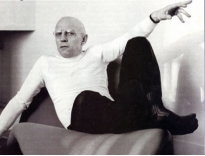Dork Zabunyan
Pour ne pas en finir avec les Cinémas de Deleuze
Dork Zabunyan est maître de conférences en études cinématographiques à l’université Lille 3 et dirige la collection « Logique des images » aux Editions Bayard. Depuis plusieurs années, sans que la rigueur ne s’émousse, il mène un travail d’analyse autour de L’image-mouvement et L’image-temps, les deux ouvrages de Gilles Deleuze consacrés au cinéma. Les confrontant à d’autres textes, du philosophe ou d’autres auteurs (philosophes autant que théoriciens du cinéma), en isolant et déroulant certains motifs, il compose aussi bien une genèse que de possibles extensions, dans le souci de donner à la réflexion deleuzienne une actualité. À notre tour, nous avons voulu prolonger le fruit de ce travail, Les Cinémas de Gilles Deleuze [11] [11] Paris, Editions Bayard, collection “Logique des images”, 2011. , publié en septembre dernier, par un entretien avec son auteur. Le personnage du voyant, l’expérience du spectateur sont, issus du livre et entre autres, ce qui irrigue la discussion suivante.

Cinéma et philosophie
Débordements : Comment, à travers les textes de Deleuze sur le cinéma, aborder les rapports qui se nouent entre cinéma et philosophie ? Vous mentionnez dans votre livre certaines approches assez critiques sur ce point vis-à-vis de Deleuze : Badiou lui reproche de faire un simple détour par le cinéma pour mieux retrouver sa philosophie, tandis que Rancière voit dans le passage de L’Image-temps à L’Image-mouvement un épisode théorique bâti par Deleuze, qui ne renverrait à rien dans le « concret des œuvres ». Il y aurait chez les deux l’idée que la philosophie de Deleuze ne rend pas vraiment compte des images, des films.
Dork Zabunyan : Personnellement, je connaissais la philosophie de Deleuze avant d’en venir au cinéma, et je suis entré dans ses livres sur le cinéma par la description qu’il propose des films. Je venais de voir L’Eclipse, d’Antonioni ; sachant que Deleuze avait écrit sur le cinéma, je suis allé voir « Antonioni » dans l’index à la fin de L’Image-temps, et j’ai commencé à lire. C’est pourquoi ces idées de Badiou et Rancière m’ont toujours posé problème. Positivement, j’ai cherché à comprendre comment la dimension descriptive, constante tout au long des 700 pages du diptyque, se concilie avec une entreprise qui se veut explicitement philosophique. Autrement dit, l’interférence cinéma-philosophie, je l’ai d’abord abordée depuis la dimension d’analyse d’images, pour ensuite aller vers la création conceptuelle de Deleuze. C’est dans ce second temps que je me sentais armé pour répondre à ces critiques, pas frontalement mais en essayant de montrer en quoi consiste l’économie générale de la description dans l’entreprise de Deleuze. Lui-même la théorise ensuite, dans Qu’est-ce que la philosophie ?, quand il présente sa « trinité » : le concept, l’affect et le percept, en précisant qu’un concept qui ne fait pas voir ou sentir quelque chose est plat ou vide. Cette idée anime toute la démarche de Deleuze dans ses livres sur le cinéma : c’est une classification des images qui renvoie à des concepts de cinéma, lesquels sont supposés donner à voir quelque chose des images des films. Si le concept ne se lie pas à des percepts, ce n’est pas la peine d’extraire des concepts des films. Le fonctionnement des concepts chez Deleuze est directement imbriqué à la description de séquences de films.
D : Il y a un rapport, une rencontre entre concept et percept ou affect, mais ils restent de natures différentes tout de même. Le rapport n’implique pas de confusion.
DZ : En effet. Le deuxième point qui m’est apparu clairement est que le cinéma sert d’embrayeur ou d’intercesseur. Il permet à la philosophie de repenser, de réinvestir des problèmes à partir du cinéma, grâce au cinéma. C’est une manière de dépasser l’idée d’un rapport hiérarchique entre philosophie et cinéma. Les cinéastes posent des problèmes avec leurs films, très concrètement, et Deleuze les reprend en les rejouant sur une autre scène conceptuelle. Par exemple, Deleuze avait construit un concept de « visagéité » dans Mille Plateaux (avec Félix Guattari) ; avec le cinéma, il retrouve cette question du visage à travers sa représentation dans des films de cinéastes très différents (Griffith, Bergman, etc.). Il y a là une espèce de court-circuit entre pratiques. Un philosophe avait travaillé une notion à partir d’un corpus philosophique, littéraire, pictural ; le cinéma arrive et lui permet de poursuivre autrement son exploration philosophique. Se crée de ce fait un embranchement très fécond, en dehors de toute supériorité présumée de la philosophie sur le cinéma. Il y a une autre chose importante : il y a les percepts et les affects propres au cinéma, nous l’avons dite, et il ne faut pas perdre de vue que Deleuze part aussi de ce qu’on dit ou écrit sur le cinéma. Pour lui, un entretien de cinéaste est chargé de percepts et d’affects. Par la parole, qui n’est pas délibérément théorique, des percepts et des affects émergent, qui existent par ailleurs dans les films à travers les images.
D : Dans Qu’est-ce que la philosophie ?, on lit que le concept est le propre de la philosophie, tandis que percept et affect sont le propre de l’art. Par contre, puisque vous dîtes qu’un cinéaste peut traiter des problèmes dans ses films, le « problème » appartiendrait aussi bien à la philosophie qu’à l’art. Est-ce que l’identification du problème se fait par le cinéaste lui-même, ou est-ce que c’est un travail qui se fait après, par un philosophe, un théoricien, un critique ?
DZ : Cela se fait après. Je parlais des propos de cinéastes, mais ça peut également être des écrits de critiques. On le voit d’ailleurs dans les notes de bas de pages – dans lesquelles peu de philosophes sont cités, d’ailleurs. Deleuze lisait surtout deux revues, Les Cahiers du Cinéma et Cinématographe (qui n’existe plus). Après avoir vu les films, il partait de ce qu’il lisait et essayait d’identifier le problème d’un film, ou l’idée, puisque les deux sont synonymes pour lui comme il le montre différemment dans Différence et répétition (chapitres 3 et 4) et dans son Abécédaire (« I comme Idée »).
Le voyant, la voyance
D : Abordons un point plus précis : le personnage du voyant, qui est récurrent dans les Cinémas mais aussi dans la philosophie de Deleuze en général. On peut y trouver différents voyants, et s’amuser à faire une liste : il y a des personnages de films, les images (Deleuze écrit que la voyance est une qualité des images elles-mêmes, et non du spectateur), les artistes, des philosophes (Foucault), et Deleuze décrit également Mai 68 comme un événement où les gens étaient voyants. Comment articuler ces différentes occurrences et en quoi peuvent-elles être dites productives en ce qui concerne la réflexion de Deleuze sur le cinéma ?
DZ : Je vais commencer par la fin : la voyance permet entre autres à Deleuze de périodiser l’histoire du cinéma. L’histoire du cinéma possède chez lui plusieurs âges et le cinéma moderne est une construction – Deleuze le déclare explicitement : « moderne » est une catégorie construite, qui peut recouper celle que l’on trouve diversement chez Bazin ou Daney, mais qui est construite à partir de cette notion de voyance. Quant au « voyant » comme tel, on n’est plus dans le problème de la périodisation, mais dans celui d’un personnage récurrent, que Deleuze perçoit dans le cinéma néo-réaliste mais qui est déjà à l’œuvre selon lui chez Ozu, et que l’on retrouve dans tout le cinéma moderne, dans tout le cinéma de l’Image-Temps. Il faudrait faire une typologie des personnages de voyants, issus de cinématographies très différentes : chez Ozu, dans le néo-réalisme, la Nouvelle Vague, chez Resnais, chez Syberberg. Par ailleurs, ces personnages de films, ces « figures esthétiques » du cinéma, deviennent aussi des « personnages conceptuels ». Dans les ouvrages qui suivent, dès le Foucault, le voyant devient un personnage conceptuel qui permet à Deleuze de cerner la personne de Foucault. Dans Critique et Clinique, il permet d’expliciter des types d’écriture. Ça se déplace sans cesse : je crois que la première occurrence est dans L’Anti-Œdipe, publié en 1972, puis la figure esthétique se développe dans L’Image-temps, et elle se dissémine dans les ouvrages postérieurs.

D : Alors est-ce qu’il peut y avoir de la voyance sans qu’il y ait de figure esthétique, de personnage de voyant ? Dans les films de Straub, il y a parfois des plans de paysages déserts, or c’est un cinéma qui va être dit « de voyant ». Puisque la voyance n’est pas une qualité de spectateur mais des images, on peut se demander où se trouve le voyant. Où est-ce que le personnage conceptuel intervient puisqu’il ne semble plus être dans le film ?
DZ : Le spectateur est pour Deleuze une catégorie tout à fait secondaire. Pour lui, ce qui se passe chez le spectateur dépend de ce qui se passe dans l’image. Je pense qu’il faut distinguer entre « le voyant » qui renvoie à un personnage, une figure, et « la voyance » qui renvoie à un type de cinéma, composé de temps morts, d’espaces déserts, de suspens narratifs. Ozu fait un cinéma de la voyance, car il arrive que des personnages n’interagissent plus avec une situation en la faisant évoluer. Il ne se passe rien en apparence, et même les personnages ont disparu. Ça peut être le plan fixe d’une nature morte, dans un intérieur vide. La présence de figures ou de personnages n’est pas absolument nécessaire pour cerner la catégorie de voyance ou le cinéma de voyant.
D : Dans un ouvrage précédent [22] [22] Gilles Deleuze. Voir, parler, penser au risque du cinéma, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2008. , pour cerner et approfondir cette catégorie, et déboucher sur l’image « audio-visuelle », vous faîtes également appel à la doctrine des facultés. Le voyant est celui qui ne réagit plus mais aussi celui chez qui la faculté de voir va être portée à un exercice supérieur.
DZ : La voyance renvoie en effet à ce que Deleuze appelle une vision « supérieure ». C’est une expression qui apparait dans L’Image-temps, mais la notion de « supérieur » renvoie au commentaire que Deleuze fait de Kant, et en particulier à l’analyse qu’il propose de l’imagination dans le sublime chez Kant : cette faculté qui atteint à sa limite et qui en atteignant sa limite en sollicite une autre (en l’occurrence, la raison). Cette idée est reprise dans L’Image-temps avec la rupture du schème sensori-moteur (schématiquement, un système d’action et de réaction, qui correspond à une situation donnée, et à sa modification potentielle). L’équivalent d’une limite atteinte par la faculté de voir, on la retrouve dans les Cinémas, déplacée au niveau de la périodisation de l’histoire du cinéma, puisque cette limite de la vision entre en jeu au moment où l’image-mouvement entre en crise. Il y a un lien entre la voyance qui renvoie à l’exercice supérieur d’une faculté et un nouveau cinéma qui repose sur le voir plus que sur l’agir.
Agir / Voir
D : À ce propos, j’ai relevé dans votre livre deux phrases qui peuvent sembler a priori contradictoire. On peut lire d’un côté que le voyant atteint un monde où il « dépasse les limites du savoir mais aussi bien les conditions de l’action ». Et, d’un autre côté, on peut lire que la vision pure peut devenir « un moyen de connaissance et d’action ». De quelle connaissance et de quelle action peut-il s’agir pour ce voyant qui peut sembler incapable d’agir ?
DZ : La « limite du savoir » renvoie à une approche qui, depuis la pensée de Blanchot, a marqué toute la philosophie française contemporaine sur le rapport entre savoir et non-savoir. On la retrouve chez Deleuze dès l’avant-propos à Différence et répétition, dans lequel il écrit que le philosophe doit se pratiquer à la limite de son propre savoir. Avec le voyant, Deleuze rejoue cette question au regard du cinéma. Pour ce qui est de l’apparente contradiction, ici l’action est une conséquence indirecte de la vision supérieure, une action complètement indéterminée. L’hypothèse que je défends est que Deleuze relit les romantiques anglais, parce qu’ils sont contemporains d’une trahison de l’action révolutionnaire. Des poètes comme Blake ou Coleridge essaient de dire, dans le passage du 18e siècle au 19e, que la révolution ne relève plus d’une action mais d’une perception, d’une vision. Blake dit : « il faut percevoir la misère », et non, comme le fera Marx, qu’il faut transformer le monde. Il suffit de percevoir ce qu’il y a d’intolérable dans le monde. Ce que Deleuze veut dire, quand il affirme que la perception est un moyen d’action, c’est que l’on peut, lorsqu’on voit quelque chose d’intolérable, entraîner directement ou indirectement des modifications au niveau des manières d’agir et de penser. Mais c’est par-delà la vision romantique qui consiste à croire qu’une révolution doit s’actualiser immédiatement, qu’une révolution est faite d’actions qui doivent immédiatement modifier une situation donnée. Je pense que Deleuze allait à l’encontre de cette vision romantique de la révolution qui aujourd’hui encore est diffuse : on dit que les révolutions arabes ont échoué, qu’elles n’incarnent plus l’élan de liberté qui était le leur au début, mais c’est au fond une vision romantique. Deleuze, comme les romantiques anglais avant lui (qui justement étaient des romantiques d’un type particulier) renverse cette idée. Il dit qu’il nous appartient d’apprendre à voir des choses intolérables, et qu’il faut transmettre cette perception. D’où l’idée d’une « pédagogie de la perception », que Deleuze reprend à Daney mais avec, je pense, ce fond venu des romantiques anglais. La perception entraîne un effet, une action, mais de manière indéterminée. On ne peut rien dire d’avance. Il n’y a pas d’anticipation de l’action, mais il y a une action possible malgré tout.

D : On peut, pour appuyer cette idée, dire que la voyance s’articule également autour d’un thème important : celui de la rencontre, face à laquelle il s’agit de rester ouvert, sans direction préétablie. S’il y a pour le voyant un moyen de connaissance et d’action, ce qui change tout ce serait alors l’ouverture préalable à une rencontre, dans laquelle la sensibilité mènerait au savoir, alors qu’auparavant c’était déjà le savoir qui menait au savoir, par-dessus la rencontre en quelque sorte – on ne faisait que la lire dans un sens attendu. Il y a ce passage par la sensibilité qui est primordial chez Deleuze, comme chez Rancière (le libre jeu des sens).
DZ : Je ne pense pas qu’il y ait d’opposition entre les philosophes et les non-philosophes chez Deleuze, et la figure de l’intellectuel n’est pas au-dessus des non-intellectuels. Je crois qu’il reprend à son compte sur ce point la figure de l’intellectuel spécifique selon Foucault. C’est-à-dire qu’il faut intervenir depuis un domaine de savoir précis, sans que le philosophe ait à dire le dernier mot. La philosophie n’a pas le privilège du diagnostic d’une situation donnée. Je pense aussi qu’il serait assez proche de certaines déclarations de Rancière : que la compétence n’est pas le fait d’un savant, d’un savoir préétabli qui surplomberait tous les autres. Un ouvrier a une compétence aussi grande, plus grande même, qu’un intellectuel qui aurait à dire en quoi la condition de l’ouvrier est mauvaise ou aliénée. Quand Deleuze parle de savoir, cela ne renvoie aucunement à une posture de surplomb.
Les âges du cinéma
D : Vous pointez qu’il y a toujours chez Deleuze un horizon éthico-politique, avec notamment l’idée que le cinéma est inséparable d’un certain état du monde. Un exemple serait la pensée que le fascisme rend impossible un certain type de cinéma, ce qui établit un rapport entre un élément historique et une évolution esthétique. Je reprendrai ici une critique de Rancière qui dit que, finalement, la grande raison de la coupure instaurée par Deleuze entre deux types de cinéma serait un événement historique, et donc extrinsèque au cinéma : la Seconde Guerre Mondiale. Selon vous cette surdétermination historique n’existe pas au niveau des livres sur le cinéma…
DZ : Premièrement, par rapport à ce que dit Rancière, il n’y a pas de coupure franche. La seconde guerre mondiale est une cause externe importante, mais il y a dans le cinéma une multitude de causes internes qui font que, pour Deleuze, ce changement d’âge est effectif. Ce n’est pas une ligne homogène avec une coupure au milieu. Un élément anachronique contrarie cette lecture : le chapitre consacré à Ozu au début de L’Image-temps, avec plusieurs mentions faites à des films qui précèdent la seconde guerre mondiale. Surtout, Deleuze soutient que l’image-temps existait avant, qu’elle était annoncée par Epstein, par exemple, même si elle n’était pas encore constitutive du cinéma. La temporalité est trop brisée pour que la lecture de la Seconde Guerre Mondiale comme cause unique de la coupure tienne. Il y a autre chose, en outre, qui permettrait de répondre à la question posée : l’idée d’un lien entre le cinéma et un état du monde est très importante pour Deleuze, et qui permet de surcroît de repousser les critiques de formalisme qui lui ont été parfois faites, comme si l’esthétique était coupée du social ou du politique. Pour Deleuze, esthétique et politique sont indissociables et cette indissociabilité est manifeste dans ce geste de périodisation. Il faudrait poursuivre le geste de Deleuze. Ce qu’il fait d’ailleurs lui-même dans la Lettre à Serge Daney, puisque la fin de L’Image-temps y est comme prolongée. Il a toujours été soucieux de la nouveauté des images, et des âges qu’elles esquissent, sachant toutefois que pour lui, il n’y a pas d’au-delà de l’Image-temps : il n’y a rien au-delà du temps. Un Cinéma 3 serait aberrant en ce sens.
D : Le terme de « symptôme » est utilisé.
DZ : Oui, Deleuze parle de symptomatologie, à propos d’Antonioni. Antonioni est pour lui un cinéaste qui à la fois invente des formes et mène une critique forte du monde moderne, alors même qu’Antonioni ne se réclame pas d’un cinéma politique ou militant. Donc, la coupure historique avec la seconde guerre mondiale peut être contestée, notamment parce qu’elle absolutiserait un événement historique au détriment d’autres. Il y a une myriade d’événements minuscules, dans l’actualité, qui ne sont pas peu importants, que les cinéastes diagnostiquent à leur manière, parfois de manière complètement indirecte, non explicitement politique.
D : D’ailleurs ce qui se joue dans le cinéma d’après-guerre, à travers le voyant, ce n’est pas la rencontre avec des événements majeurs. Le schème sensori-moteur se rompt parfois sur des choses très banales. Ce qui va dans le sens de ce que vous dîtes : dans le cinéma, un événement historique isolé ne prend pas toute la place et ne surdétermine pas le cinéma en entier.
DZ : Oui, c’est dans le plus quotidien que quelque chose se passe et qu’on peut devenir voyant.

L’expérience cinématographique
D : Toujours par rapport à cette idée que le cinéma n’est pas coupé du monde, il y a une chose assez surprenante chez Deleuze, parce qu’il ne s’y intéresse pas : la question du spectateur et de la réception. On pourrait justement être inquiet au sujet de cette absence, et se demander si celle-ci ne mènerait pas à une coupure entre le cinéma et le monde, et raviver les critiques envers un Deleuze « formaliste ». En lisant le texte « Dans la tête du spectateur », on se rend alors compte d’un paradoxe : si Deleuze tient à couper l’expérience cinématographique du reste du monde – selon le schéma de la rencontre à mon avis -, c’est peut-être finalement pour mieux renforcer la portée de cette expérience en dehors de la salle. Est-ce que, quand le cinéma s’autonomise, puisque c’est d’une autonomisation de l’expérience cinématographique qu’il s’agit, c’est en définitive pour s’inscrire encore davantage dans un horizon éthique et politique ?
DZ : Vous avez bien résumé la question du spectateur chez Deleuze. Il est vrai qu’il ne pense pas le cinéma en dehors des conditions de la salle. Je pense, outre le fait qu’il n’avait peut-être pas le temps de s’y intéresser, que Deleuze est comme résistant à l’art vidéo, aux premières installations vidéos dont il était le contemporain (elles se font dans les années 70-80). Car cela suppose un spectateur mobile, qui se déplace d’un espace à un autre. Cela devait contrarier chez lui l’idée que le cinéma est un art du temps. L’exposition du cinéma, qui opère un prolongement du côté de l’espace, le gênerait peut-être parce qu’il reste fondamentalement un philosophe du temps. Il est bergsonien en ce sens. La question de l’espace, non pas celui représenté dans les films, mais l’espace qu’un spectateur arpenterait dans un musée ou une galerie, l’intéressait peu à mon avis. La question de la spatialisation des écrans chez quelqu’un comme Nam Jun Paik, qu’il cite à la fin de L’Image-Temps et qu’il découvre en lisant Les Cahiers du Cinéma, ne semble pas éveiller sa curiosité. Il parle de juxtaposition des écrans, mais la question spatiale, qui est pourtant essentielle, n’est pas soulevée. Deleuze parle de « ciné-spatial », mais c’est un « ciné-spatial » qui est toujours éprouvé dans les conditions de la salle.
D : L’expérience cinématographique est toujours liée à la salle mais vous notez également l’idée qu’il n’y a pourtant pas, pour lui, de « spectateur originel ». S’il s’agit dans la salle d’être ouvert aux images, à ce qu’elles peuvent avoir de nouveau, on ne peut pas tout à fait ignorer qu’un spectateur arrive avec une certaine mémoire, vient d’un extérieur. À ce niveau, on trouve l’idée que la nouveauté s’apprécie, qu’il y a devant un film un exercice de la pensée à faire. Donc comment lier à la fois l’ouverture nécessaire aux images et le besoin de penser ? Et l’on peut difficilement penser sans se relier à quelque chose…
DZ : Je pense qu’on peut lier cela à ce que l’on disait sur l’association entre le concept, le percept et l’affect. Quand Deleuze dit qu’il n’y a pas de « spectateur originel », il ne veut pas dire que l’on est coupé de toute forme d’émotion. Chez lui, l’émotion reste l’élément premier. Après, à partir de là, on creuse. On essaie de savoir ce qu’il se passe. Mais le cinéma n’est pas plus compliqué qu’un autre domaine. Quand on regarde un match de football, c’est très compliqué. C’est un autre type de spectacle, mais ça n’est pas parce que c’est du foot que c’est moins compliqué qu’un film des Straub. L’entraîneur voit des choses que moi je ne vois pas : ça ne veut pas dire qu’il n’a pas de plaisir, ni que j’en ai moins que lui quand je regarde le match. Seulement, si on veut creuser ce plaisir, il faut faire un effort, apprendre à regarder les choses… Les cinéastes qui créent leur films traversent parfois des tourments réels, en cherchant une image, un plan, une couleur, etc. Ce n’est pas simple. Les films sont des objets de création et pour les comprendre, il faut essayer d’épouser le point de vue du créateur, tout en sachant que la compréhension ne sera jamais totale. Il faut essayer de trouver des médiations, comme des entretiens, des critiques, pour essayer d’approfondir une émotion première.
D : Il y aurait donc une expérience cinématographique, la rencontre d’une forme, puis des textes qui accompagnent, rendent compte, mais sans se confondre totalement avec cette expérience. Alors, on peut dire aussi que ce qu’on lit n’a pas à déterminer entièrement notre vision. Par exemple, si on lit un propos de cinéaste, ce n’est pas nécessairement pour retrouver tout ce qu’il dit dans le film… On peut parfois légitimement, en tant que spectateur ou critique, prendre à contrepied une déclaration d’un cinéaste.
DZ : Bien sûr. Ce n’est pas une relation linéaire, de cause à effet. Souvent, d’ailleurs, les cinéastes ne disent pas ce qu’ils ont fait. Il y a tout un écheveau de significations dans les entretiens. C’est le travail de la critique d’extraire les idées, de les travailler. Et la critique a un rôle très important de passeur, de médiation. Les cinéastes eux-mêmes le disent, pour faire un lien entre leurs films et le public. Rohmer écrivait, dans ses premiers textes pour Les Cahiers du Cinéma, qu’il s’agissait de façonner le regard du public, pour l’amener, non pas à diriger son regard, mais à l’orienter vers une nouveauté, une chose invisible auparavant et qui surgit dans un film. Et, encore une fois, elle ne se situe pas dans un rapport d’infériorité avec la théorie. Il y a encore en France cette idée massive que la critique se situe du côté de la presse spécialisée, des revues, et que la théorie est faite par des universitaires. C’est une idée tout à fait ruineuse : il suffit de voir que Bazin était critique de cinéma et qu’il est maintenant un théoricien important dans les études universitaires, ce que deviendra également Daney. Et la critique est aussi liée à une actualité, une fraîcheur. Il y a toujours de grands films qui sortent, et, si personne n’en rend compte, ils passeront inaperçus. S’il y a de nos jours une crise de la critique, c’est également néfaste par rapport à ce que l’on peut élaborer et penser du cinéma aujourd’hui. Il n’y a pas de hiérarchie entre critique et cinéma, de même qu’il n’y a pas de hiérarchie entre critique et théorie pour Deleuze. Ce sont deux métiers différents mais pour lui, les critiques « se retrouvent » ou « deviennent » théoriciens, même s’ils ont des préjugés négatifs à son égard. Inversement, les théoriciens peuvent inspirer les critiques. Il n’y a qu’à voir comme Deleuze reprend des analyses de Daney issues de Ciné-Journal, sur Ginger et Fred notamment. La critique a aussi pour fonction de combattre un certain désenchantement sur l’état du cinéma, moins dans sa lutte contre la vieille lune de la « mort du cinéma » que contre l’idée qu’il y aurait en définitive moins de bons films qu’auparavant : une manière commode de se délester de l’exigence critique, justement.

Images : 1. Europe 51, Roberto Rossellini, 1951 / 2. Voyage à Tokyo, Yasujiro Ozu, 1953 / 3, 5. L'éclipse, Michelangelo Antonioni, 1961 / 4. Miel, Semih Kaplanoglu, 2010