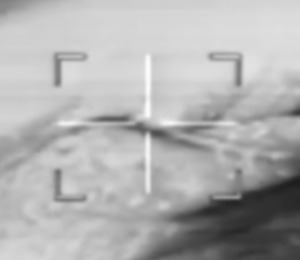Eau argentée, Syrie autoportrait, d’Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan
Yeux sales, mains propres
Il est des films dont on aimerait ne pas parler, pour mieux précipiter leur retour vers un néant dont ils sont indûment sortis. Hélas, il semblerait que certains d’entre eux demandent un coup de plume pour aller au tombeau, tant le concert de hourras qui les entoure risquerait de les propulser sur un podium où ils feraient briller toute la honte de notre époque. Celle-ci, apparemment, tient l’infamie pour un titre de gloire. Eau argentée, Syrie autoportrait compte parmi ces ovnis négatifs sur lesquels on voudrait tirer à vue. Mais comme, en matière de justice critique, Débordements prône l’équité, on ne l’exécutera pas sans procès.
Ossama Mohammed, Syrien exilé, se languit en cette France depuis laquelle il assiste impuissant à l’hécatombe orchestrée par Bachar Al-Assad. Il ne peut filmer que sa propre absence à l’événement, la désespérance entretenue par la lointaine monotonie des massacres. Dans le film, cet être-pas-là sera rendu par des plans sur les vitres du métro parisien où se réverbère la mort, les images du lointain défilant sur un écran d’ordinateur reflété sur le plexiglas. Structure spéculaire qui pourrait s’entendre comme figuration d’une médiation, aveu visuel du fait que l’accès au désastre passe par une séparation préalable fournissant le moyen d’une réflexion – c’est la fonction d’une vitre, réfléchir en séparant. Mais la structure spéculaire est aussi le propre du narcissisme, et alors ce geste se chargerait d’un autre aveu, involontaire cette fois, celui d’une posture mettant au centre du film, non ces carnages désolants, mais la désolation toute empruntée dont se drape un cinéaste à l’ego fortifié, si bien qu’elle finit par voiler l’objet premier, vite enseveli sous le lamentable spectacle de l’apitoiement qu’il suscite.
D’une médiation à l’autre : celle d’internet, qui introduit la politique dans le domestique, rappelle aux chaumières que l’orage bat dans le lointain, recouverte par celle du Moi, qui gomme le réel sur lequel son âme se déverse. Le cinéaste déclare d’ailleurs sans rougir de cet orgueil digne d’un Louis XIV que « le film, c’est moi », et non la ribambelle de cadavres que son cœur endeuillé se croit de devoir soumettre à nos consciences endormies. À vrai dire, le film est le fait de deux personnes, le produit d’un dialogue internautique. Mohammed a été contacté par une jeune Syrienne restée à Homs au plus fort de la bataille. Elle palliera à son manque d’images, sera ses yeux et, pour le film, la garantie d’un réel minimal. L’ensemble se construit sur cet échange inégal. L’une envoie à l’autre ce qu’elle filme, et lui pérore dessus. Certes, elle aussi parle à l’occasion, elle aussi a droit à sa part de tristesse (on soupçonne que la voix-off a été enregistrée plus tard, une fois la cinéaste en herbe arrivée en France, mais Mohammed tient à donner à ces paroles le vif de l’urgence et la réalité de l’immédiat, et laisse croire, sans trop s’inquiéter de ce que ce trucage implique, qu’il y a là dialogue vivant plutôt que réécriture a posteriori). Mais jamais elle ne sera autre chose qu’une sympathique adjuvante, la caution morale d’un réalisme plus existentiel qu’esthétique.
L’idée, sur le papier, avait de quoi séduire : belle figure d’une transmission réciproque, celle de l’expérience du temps (le cinéaste aguerri), celle de l’expérience de l’événement (la jeune fille au cœur des choses). Morceau éthique reposant sur la rencontre et le partage, interrogation sur ce que signifie être au bon endroit, ne pas y être, se soumettre à l’Autre, sur ce que peut le cinéma. Seulement, Mohammed ne se pose pas la question d’un pouvoir mais d’un être. Et il la pose au mauvais endroit : chose troublante, sinon choquante, que d’écouter une voix-off se demandant « Qu’est-ce que le cinéma ? » alors que défilent à l’écran des rangées de dépouilles amochées. On oublie souvent que la question bazinienne ne justifiait sa pente ontologique que de s’articuler à une réflexion sur la valeur de révélation propre à l’image. Or, qui dit révélation dit mouvement de donation, levée. Mais les images d’Eau argentée ne sont pas données, plutôt balancées, jetées aux yeux sans que la violence du choc ne semble faire problème. La médiation est mal pensée. Le Moi aurait dû s’absenter, et l’accès aux images être négocié. Offrir ainsi, jusqu’à la saturation, un catalogue de cadavres, c’est croire qu’ils parlent d’eux-mêmes, croire aussi qu’ils s’accueillent comme n’importe quelle image, quand la mort est le point extrême et souvent aveugle du visuel. La démarche est l’inverse de celle du récent The Uprising de Peter Snowdon. Celui-ci a glané et monté deux ans durant un immense ensemble d’images des révolutions arabes extraites de youtube. On pourra lui reprocher son messianisme révolutionnaire parfois trop appuyé, on lui sera néanmoins gré d’avoir eu l’intelligence de ne pas déballer une morgue géante sans aménager, à côté du désastre, l’espace résiduel laissé à la joie de la libération et à tous les moments où la vie ne se trouve pas mariée à la mort. C’est aussi un droit pour les Syriens que d’être montrés autres que souffrants, que d’être arrachés à leur statut de victimes dans lequel Eau argentée les maintient jusqu’à les noyer. The Uprising montre la mort comme conséquence d’une révolte. Mohammed occulte la colère pour ne laisser que la misère. La pitié est son seul affect. Il n’a cure du respect. Snowdon, lui, se demandait justement ce que peut le cinéma, ce qu’il en était de son devoir à l’égard des images produites par d’autres à l’instant du danger. Mohammed, en s’interrogeant benoîtement sur ce qu’est le cinéma, tombe dans des raisonnements qui frisent le pire esthétisme. Car leur issue est tout indiquée : le cinéma, c’est le spectacle impuissant des horreurs, le pieux témoignage, la rédemption mémorielle par l’image arrachée au désastre. Une pierre tombale. Eau argentée est un film-cercueil, mais tourné vers le croque-mort s’improvisant détrousseur de cadavres.
Car le film consiste en une gigantesque opération de confiscation du témoignage. Celui-ci s’étage sur quatre niveaux. D’abord les martyrs (mot qui, étymologiquement, désigne le témoin). Pas d’autres images dans le film que les leurs. Les êtres n’ont le droit d’apparaître à l’écran qu’à la condition d’une mort prochaine qui permettra de les transformer en symboles (surtout s’ils sont gamins – on n’insistera pas sur l’abusive manipulation des images d’enfants décédés, ni sur cette insupportable séquence avec un orphelin cueillant des fleurs au milieu des ruines). Aucune place n’est faite pour la résistance des vivants ; Mohammed ne veut que des victimes. Les martyrs témoignent malgré eux, cadavres éloquents. Il y a ensuite cette jeune femme, Simav, la passeuse, le relais, celle qui a eu le courage de sauvegarder l’effigie visuelle de ceux qui sont tombés. Puis le film lui-même, entendu comme pur réceptacle, assumant une identique fonction de document, preuve devant le monde que la chose a eu lieu. Eau argentée, s’il s’en était tenu à cet enchâssement, aurait pu avoir la modeste mais juste valeur d’archive de la catastrophe possiblement « enrichie » par l’interrogation modelée à travers l’agencement des images (par exemple, cette question que le film pose sans poser : qu’est-ce que voir la mort nue, qu’est-ce que montre une telle image, à quelle vérité fait-elle référence – b.a.ba d’éthique cinématographique, pour qui sait qu’une image n’est pas un fait et que le brut est toujours bête, que la mort ne dit rien et que c’est justement à cela que tient son obscénité dès lors qu’on ne l’articule pas à ce dont elle est le négatif).
Mais un quatrième témoin vient parasiter l’ensemble, Ossama himself. Seulement, le pauvre ne peut témoigner de rien. Il ne lui reste, pour s’arroger une place dans un film qui aurait très bien pu se passer de sa présence, que la seule fonction de témoin du témoignage, c’est-à-dire, en l’occurrence, de commentateur moral – la morale s’entendant ici comme spectacle d’une indignation complaisante et sirupeuse. Le chantage affectif n’est pas loin, puisqu’il serait criminel pour le spectateur de ne pas accorder sa voix aux lamentations d’un cinéaste qui flèche si bien l’émotion – le public est privé de ses affects comme les morts sont privés de leur mort. Mais l’opération de recouvrement ne s’arrête pas là. Mohammed se doit de supplémenter le spectacle initial. En plus de ses interrogations oiseuses, il inflige aux images une musique penchant vers le lyrisme suranné, sans trop s’inquiéter de ce qu’il y a un véritable paradoxe à, d’un côté, vouloir imposer la mort telle quelle, dans une image sans apprêts, et, de l’autre, l’agrémenter d’une soupe musicale qui ne peut que jurer avec le contenu auquel elle se surajoute au point d’en désamorcer les effets propres. On trouvera dans les répétitives images de nuage qui parsèment le film la formule de ce problématique déplacement. Pourquoi de telles nuées ? Peut-être le cinéaste a-t-il tenu à figurer, aux côtés d’un ici-bas voué aux humiliations de l’homme par l’homme, la splendeur du céleste et l’espoir de paix qu’il convoie. Ou bien, plus innocemment, a-t-il voulu accompagner la musique accompagnant les images, pincer un peu plus sa lyre sublime pour introduire un minimum de beauté dans ce lot d’horreurs. Mais les nuages, en fin de compte, ne font que signaler le surplomb dans lequel s’installe confortablement un cinéaste qui jamais ne prend le risque de mettre en défaut son regard, jamais ne se demande ce que cela signifie que de soutenir la vue de l’extrême, ce que cela veut dire que de voir de loin, ce que cela implique comme responsabilité que d’être légataire et donateur. Et, aveugle à force de croire voir parfaitement, il finit par se faire écran masquant ce qu’il prétend montrer. L’ensemble ne vole pas plus haut qu’un cinéma de la dénonciation à la Michael Moore. Même présence envahissante, même sensationnalisme, même prétention, même racolage et donc, logiquement, même innocuité.
Honte cinématographique qui ne mériterait pas tant de mots si elle n’avait pas rencontré un succès des plus inquiétants. Pourquoi, parmi tant de films sur le conflit syrien, est-ce celui-ci qui reçu l’insigne honneur d’une projection à Cannes suivie par une tournée dans les festivals et un accueil critique dont l’enthousiasme immodéré ne laisse pas d’étonner ? Son intérêt réside moins dans ce qu’il montre que dans ce qu’il cache. Il camoufle ce que l’Occident ne veut pas voir, la réalité d’une colère populaire qui n’est pas loin de se tourner vers l’impérialisme rémanent de notre continent, colère qui de toute façon est toujours mal reçue en haute place par un pouvoir y voyant le juste motif d’une contamination de la rage du peuple. Eau argentée, de ce point de vue, est inoffensif. Aucun des affects qu’il appelle ne risque de se transformer en engagement, en combat. Il ne fait qu’alimenter le consensus des belles consciences outragées. Sa stratégie est de réduire le champ, de s’orienter vers ce qui ne fait pas problème, ce qui renforce l’unanimisme, une droitdelhomminasserie puante tirant tous les profits possibles de ce facile portrait de l’iniquité des tyrans. Idéologie victimaire dont on sait qu’elle constitue le socle de l’humeur humanitaire, humeur dont on sait qu’elle a pour visée principielle l’escamotage de la question politique, remplacée par les âcres douceurs de l’absolu moral partout bafoué. La risible emphase mise dans le film sur les images de chats mutilés, censément allégorie des massacres, montre bien tout ce qui unit cette esthétique de l’indignation et les panels mielleux d’animaux abandonnés que nous sert chaque année la SPA. Ce qu’offre Eau argentée à l’Occident c’est, bien plus que des images d’horreur qui n’ont jamais manqué et nous avait déjà informés de ce que nous étions en faute de ne pas réagir, la possibilité d’un désengagement moral. Le film isole la catastrophe, en fait presque un événement naturel. Et nos yeux salis par le désastre se voient compensés par nos mains propres. Les larmes payent la tranquillité d’une âme qui face à un tel spectacle ne peut que se dire qu’elle n’a rien à (y) voir (avec).
On aimerait invoquer les mânes de Rivette et de Daney, rappeler la colère qui avait animé le premier face à Kapo, le second face au clip We Are the World. Hélas, nous en sommes bien loin. L’abjection a tant et si bien continué son chemin qu’on ne sait même plus si on doit encore l’appeler ainsi. Rivette tonnait contre un travelling esthétisant une atrocité supposée infigurable. Péché presque véniel aujourd’hui qu’est acquis le définitif triomphe de MTV sur Brecht. Daney était lui dégoûté par l’instrumentalisation de bambins faméliques au profit de stars engrangeant un vaste capital symbolique à chanter au profit supposé de ces victimes (la métamorphose de l’exploité et de l’offensé en victime avait déjà commencé, Bernard Kouchner préparait silencieusement Ossama Mohammed). La chose est désormais rentrée dans la grammaire visuelle officielle. La nouvelle police des images, police allant bien sûr à l’encontre de toute politique, va au-delà de la sublimation et du chantage. Elle entre dans l’ère de l’effacement et du phagocytage. Le premier a paradoxalement pour fond une visibilité absolue : il faut tout montrer pour ne rien voir, parce que le réel donné sans partage ni digestion est justement ce qui se soustrait à la saisie et à la vision – éclipse de l’idée même de regard, la perception n’est plus un accord négocié entre un sujet et un objet. Mais, second paradoxe, cet objet radical qu’est l’image de la mort ne sert qu’à conforter le sujet dans sa paix morale, il ne le soumet jamais à la question. Au contraire, c’est lui qui le dévore, l’intègre à son petit Moi pour en tirer un supplément d’âme (Kouchner se targue toujours d’avoir vu les massacres, ce qui certes revient à y participer, mais peut-être pas de la façon dont il l’entend). L’idéologie du choc a bien changé. Elle entendait auparavant réveiller l’œil, alerter l’esprit, bousculer les cadres de l’imaginaire. Désormais, le choc anesthésie. Il est d’autant plus efficace qu’il a moins d’effet. Le faux art brut qu’Eau argentée entend promouvoir ne perturbe ni ne gêne, il ne fait qu’absoudre. On demande au film qu’il nous choque afin qu’il ne nous dérange pas ; le stimuli optique n’atteint jamais d’autres régions du cerveau. Ossama Mohammed a réalisé la meilleure plus-value mortuaire qui puisse être. Cela relèverait de l’abjection si on ne soupçonnait pas qu’il s’agit tout simplement d’imbécillité. Reste à savoir s’il vaut mieux être un con ou un connard. Les deux ont de toute façon à voir avec l’ordure.
Musique : Noma Omran.
Durée : 103 mn.
Sortie : 17 décembre 2014.