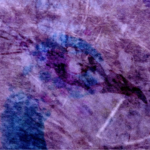Sylvain L’Espérance
Requiem Animal
Avec Animal Macula, présenté dans la section « Front(s) populaire(s) » lors de l’édition 2023 du Cinéma du Réel, le documentariste québécois héritier du cinéma direct prend la voie du film de montage en associant des images animalières issus de notre inconscient cinématographique. Des méduses de Jean Painlevé aux scènes d’abatages empruntées à Rainer Werner Fassbinder ou Georges Franju, jusqu’aux buffles sortis des films d’Apichatpong Weerasethakul, le cinéaste fait côtoyer ses exemples multiples afin de recartographier notre relation ambiguë avec le monde animal.

Débordements : Animal Macula est un assemblage vertigineux qui combine des images cinématographiques allant du cinéma des premiers temps jusqu’à une variété de cinéastes contemporains, mêlant des sources documentaires et fictionnelles. Quelle était l’idée à l’origine de ce projet ?
Sylvain L’Espérance : Le film est né d’un constat que l’on connaît tous, qui est celui de la disparition de masse des animaux. Mais comment s’emparer de ce sujet par le cinéma ? Aller filmer sur tous les continents la disparition animale aurait demandé des moyens colossaux, alors que l’histoire du cinéma la portait déjà en elle, de manière inconsciente. Cette extinction, commencée bien avant l’époque industrielle, s’est accélérée avec elle. Le cinéma étant né avec la révolution industrielle, il a toujours filmé des animaux en train de disparaître. Voilà l’étincelle à l’origine du projet.
Une grande partie des premières recherches a été effectuée par Marie-Claude Loiselle, qui me communiquait ses découvertes chaque jour. Au début, je pensais que le travail ne porterait que sur des matériaux d’archives, mais cela nous aurait privé d’une vaste mémoire commune. Tout le cinéma de fiction populaire constitue une mémoire partagée ayant propagé des images des animaux avec laquelle nous vivons tous encore aujourd’hui. Il ne fallait donc pas exclure ces sources et chercher aussi du côté des westerns, des films de guerre ou de cavalerie, par exemple. Chercher surtout au-delà des films qui touchent directement à la question animale.
D’abord, nous avons fait appel à notre propre mémoire du cinéma. Nos fouilles archéologiques en sont venues à se concentrer de plus en plus sur les animaux cachés, qui apparaissent dans une seule séquence à l’intérieur de films qui concernent tout autre chose. Ces plans appartiennent dans bien des cas à un répertoire largement diffusé, allant des premières images cinématographiques jusqu’aux plus récentes. À partir de là, on a élargi encore davantage nos recherches, cette fois vers des films moins connus ou parfois même inconnus, souvent oubliés, en accueillant des cinématographies de tous les continents, des films africains, asiatiques et sud-américains. Nous avons aussi fait appel à nos ami.e.s, en leur soumettant la liste des films que nous avions déjà compilés. Ils ont partagé avec nous leur mémoire, ajoutant à notre liste des œuvres et les scènes qui les avaient marqués. Cet échange a permis de tisser un réseau de près de 300 films à partir desquels travailler. Réseau qui n’a cessé de s’enrichir à mesure que le film prenait forme. Puis, la pandémie est arrivée au moment où je m’apprêtais à commencer le montage, ce qui a eu un impact indéniable sur notre travail.
Certaines rencontres ont aussi été déterminantes, comme celle avec Muriel Pic, qui s’est faite à travers son livre En regardant le sang des bêtes, dont le dernier chapitre s’intitule « Notes sur le montage ». Elle réfléchit sur ce qu’est le montage, entre rigueur de recherche et exercice de divination. Le montage selon elle « est une pensée du fragment, de l’étincelle, de l’illumination, de la joie, née de la mélancolie même. » Il développe en nous « notre capacité de reconnaître ce qui porte atteinte à l’intégrité des êtres et réactive en l’homme cette faculté animale qu’est l’intelligence du péril ». Cette pensée m’a fait mieux saisir l’intuition qui me guidait au moment où je commençais le montage d’Animal Macula.
D. : A partir de cette matière extrêmement riche, comment arriver à discerner le premier embryon structurel ?
S. L. : Pour faire face au vertige éprouvé devant l’ampleur de la tâche qui m’attendait, un travail préliminaire a été réalisé de captures d’écran de plans retenus, qui a permis de saisir comment ces images pouvaient s’articuler autour d’un certain nombre de motifs, comme celui de la fuite qui ouvre le film. À l’apparition des humains succède le motif de la longe, qui représente à la fois la capture animale et le lien avec l’homme. La chasse est un autre motif dominant. Il y avait aussi celui de la révolte animale, qui explore une sorte de renversement où ce sont les animaux qui envahissent l’espace humain.
Ces motifs nous ont guidés tout au long de l’élaboration du film, qui s’est construit de façon très intuitive jusqu’à un premier montage. Nous désirions avant tout recentrer notre attention sur ce qui cherchait à se dire dans la présence des animaux. Cela a fait en sorte de laisser beaucoup de la place à l’imprévisible. Un jeu de lecture et de mémoire a ainsi commencé à agir. En tissant des liens entre toutes ces présences animales, en faisant dialoguer plusieurs strates d’images, cela a permis d’accéder à une dimension enfouie sous la surface de ces images et des récits des films. Il s’agissait ainsi de nous rendre sensibles à ces présences souvent ignorées ou instrumentalisées.
D. : En lien avec la question de la structure, les séquences qui ouvrent et clôturent le film sont des lieux d’expérimentation formelle plus appuyée, avec notamment un travail d’étalonnage assez antinaturaliste, et des effets de surimpression ou de dédoublement dans l’image. Quel était l’effet visé par ce décentrement du regard humain et ce travail plus expérimental sur l’image ?
S. L. : Les plans de ces deux séquences viennent de films animaliers. L’ouverture s’est imposée naturellement par ce motif d’animaux en fuite, à la fois libres et inquiets, comme s’ils avaient la prémonition qu’un danger imminent les guettait. Dans la séquence finale, j’ai voulu m’approcher de ce que j’imaginais être, de façon très libre, les visions animales. Essayer de jouer avec cette idée d’autres regards. J’avais aussi en tête la pensée empédocléenne où l’âme d’un être vivant qui meurt peut continuer à se mouvoir, à errer, avant de trouver un corps dans lequel renaître.
Je pensais également aux premières figures animales dessinées par Homo sapiens, par exemple celles de la grotte Chauvet, crées il y a 36 mille ans. Dans ces images, il y a déjà un jeu de superposition : plusieurs couches d’images composées sur plusieurs années, visiblement par différentes personnes. Il s’agissait pour moi de retrouver ce geste originel en puisant dans un matériau numérique à l’extrême opposé des premières peintures créées par la main d’hommes et de femmes. De m’emparer des images hyperdéfinies pour les subvertir, les détruire, les salir. Par la superposition, la solarisation, la mise en négatif, je cherchais à transformer ces images pour en faire émerger quelque chose des origines de la représentation.
D. : Vous évoquiez le motif de la fuite, et la question du mouvement animal est longuement travaillée dans Animal Macula. À l’inverse du travail taxidermiste qui conserve en figeant, votre film peut se lire comme une ode à la liberté qui saisit le mouvement animal et œuvre à la libération du vivant.
S. L. : À quelques exceptions près, la pensée occidentale a institué la désanimation de la vie et cherché à asservir les animaux. Au moment de sa naissance, le cinéma hérite de ce schème mental et culturel. Alors comment, partant de là, ne pas les enfermer doublement par un travail de représentation ? Par quelle manière ne pas rendre l’animal prisonnier de sa mort ? Pour donner un exemple, dans un moment du film, on voit un chimpanzé en gros plan. Il crie, en proie à une douleur insupportable. Le plan qui suit montre des chevaux en pleine course. Cela permettait de créer une ligne de fuite. Dans chaque plan où une mort animale advient, où un animal est contraint, les plans suivants offrent la possibilité d’une autre vie.
Au moment même où on se parle, la mort industrielle des animaux s’accomplit dans une indifférence et une invisibilité totale. Le cinéma nous force à regarder en face notre relation aux animaux. La mort du cheval de Franju nous accompagne depuis soixante ans. Il meurt à nouveau à chaque fois que le film est projeté, il meurt et nous émeut pour tous les animaux qui sont tués dans l’indifférence.
D. : La question de la diversité du vivant animal se pose au cours du film lorsque l’on voit se succéder à l’écran un large éventail de bêtes, sauvages ou domestiques. Comment éviter l’aspect encyclopédique, qui proposerait un recensement exhaustif du vivant ?
S. L. : Le registre encyclopédique n’était absolument pas ce que je recherchais. C’est pourquoi je ne me suis pas empêché de surreprésenter certains mammifères, comme les chevaux ou les vaches, car on entretient beaucoup plus de rapports dans nos vies avec les animaux domestiques ou d’élevage qu’avec les animaux sauvages. Le cinéma a assez peu filmé les bêtes sauvages, sauf dans le genre spécifique du film animalier, où ils apparaissent le plus souvent détachés de toute présence humaine. Donc, il y avait bien la volonté d’embrasser largement le vivant, mais en travaillant à partir du rapport de l’humain à l’animal que présente l’histoire du cinéma. Mon point de départ, c’est le cinéma.

D. : Le cinéma d’Apichatpong Weerasethakul occupe une place importante dans Animal Macula. Le second temps du film commence avec le bœuf de l’ouverture d’Oncle Boonmee, et on retrouve plus tard le tigre de Tropical Malady. Le cinéma de Weerasethakul offre un espace de représentation privilégié au vivant non-humain et à la nature. Chez quels cinéastes avez-vous pu trouver une réflexion sur la représentation animale, au-delà d’une pure instrumentalisation à des fins narratives ?
S. L. : Il y a très peu de films dans lesquels la mise en scène attribue une véritable importance à l’animal. La plupart du temps, l’animal est un instrument : je pense aux westerns, dans lesquels il est très rare qu’un cheval compte en tant que sujet. Or, non seulement Apichatpong accorde une place centrale à l’animal, mais il va même jusqu’à représenter la communication entre humain et animal, comme dans la scène de Tropical Malady, où le protagoniste échange avec un singe. Il est un des précurseurs de cette nouvelle sensibilité à l’animal, qu’on trouvait déjà chez Bresson ou Paradjanov.
Par ailleurs, j’ai transformé plusieurs séquences pour ramener l’animal au premier plan. Dans celle des Furies d’Anthony Mann par exemple, un homme tente de renverser un bœuf à mains nues. J’ai retiré de la scène tous les moments où l’on voit en contrechamp des hommes exaltés par le combat, comme s’ils assistaient à un match de boxe. J’ai pu ainsi retrouver la dimension documentaire de la séquence et concentrer notre attention sur le corps à corps entre l’homme et l’animal.
D. : Certains extraits qui montrent des grands singes sont particulièrement frappants en ce qu’ils font de l’animal un miroir dans lequel se reflète notre sensibilité. La frontière n’est-elle pas poreuse ? Qu’est-ce qui distingue l’homme de l’animal ?
S. L. : Oui, le film affronte cette question-là, très actuelle et extrêmement récente dans l’histoire du cinéma, comme dans celle de l’humanité – malgré qu’elle n’ait jamais cessé de hanter celle-ci depuis 2 500 ans. Avec les travaux de Vinciane Despret, de Baptiste Morizot, et plusieurs autres philosophes, la réflexion sur la l’absence de frontière étanche entre humain et animal s’est beaucoup enrichie. L’espèce humaine a bel et bien une ancestralité animale, et on prend la mesure de l’intelligence des animaux, on découvre qu’ils sont pourvus d’une conscience, bien que différente de la nôtre. Animal Macula ne fait pas la démonstration de ces connaissances, mais les réflexions qui m’habitaient pendant que je faisais le film y trouvent une résonance.
D. : En partant de cette porosité de la relation entre l’homme et l’animal, je me suis interrogée sur la question du chamanisme, c’est-à-dire de l’échange spirituel qui peut s’accomplir.
S. L. : Je parlais plus tôt du film comme divination, ce qui rejoint cette idée, en effet. Je n’ai pas une connaissance précise du chamanisme, mais je sais qu’il a existé chez plusieurs peuples nomades, comme les Innus du Nord du Canada. Leur survie a longtemps dépendu du caribou, et leur manière de le chasser reposait sur la communication onirique qu’ils établissaient avec eux : l’animal venait leur parler dans leurs rêves. À partir d’ossements, les chamanes accédaient aussi à une sorte de cartographie leur permettant d’anticiper l’endroit où les troupeaux se déplaçaient. Il y a là un lien avec le film en ce qu’il accorde lui aussi à l’animal un esprit. De travailler avec la notion de divination a été pour moi inspirante, car notre regard porté sur les animaux s’en trouve modifié. Mon approche ne repose pas uniquement sur les images, mais compose aussi avec l’esprit qui embrasse la multiplicité des mondes propres aux animaux. Je suis attiré par la faculté inexploitée que nous avons de communiquer avec ces autres vivants.

D. : L’enjeu de la destruction de l’animal par l’homme et de la violence qui en découle est chargé d’émotions puissantes qui se transmettent au spectateur, comme la culpabilité ou la colère. Quels étaient les sentiments que votre travail sur le film éveillait en vous, pendant les longs moments où l’œuvre prenait forme en vous mettant au contact de cette souffrance ?
S. L. : Dès le départ, je savais que je serai confronté à des scènes de violence, mais ce qui m’a étonné, c’était à quel point elles étaient omniprésentes. Marie-Claude et moi n’en revenions pas de me retrouver face à tant de violence, souvent banalisée, à l’égard des animaux. Alors, on a décidé d’affronter cette question, sans la réduire à un élément parmi d’autres. La violence est systémique, et nous avons travaillé à partir de ce constat pour essayer d’éveiller notre sensibilité.
La question de la culpabilité s’est posée en raison de notre effarement devant ce que nous découvrions. Par le travail de montage, je voulais donner à sentir que la mort animale est aussi notre propre mort, de la même manière qu’œuvrer à la libération animale contribue à une forme de libération humaine. Dans la structure du film, la mise à mort et l’asservissement reviennent de manière cyclique : il s’agit d’accueillir plus que de dénoncer. Le film n’a pas vocation à être prescriptif. Le jeu d’opposition entre violence et douceur, souffrance et lien, vient éclairer notre propre attitude paradoxale à l’égard des animaux.
D. : À travers toutes ces représentations de morts, Animal Macula a quelque chose de l’oraison funèbre.
S. L. : Oui tout à fait, c’est un des éléments qui sous-tendent le film. Nous sommes saisis par une profonde tristesse devant cette accumulation de morts, de violence industrielle. C’est là où la pensée de Vinciane Despret trouve une résonance, car ces « morts qui insistent » sont des morts qui nous obligent à vouloir agir sur le présent. Les morts ne veulent pas qu’on les oublie. Ils viennent nous rappeler leur existence, en refusant qu’on fasse le deuil de leur disparition. Ils nous lancent un appel pour qu’on « fasse mémoire avec eux ». Le film travaille dans ce sens-là, vers une sensibilité en cours de transformation, qui favorise un espace d’accueil. Il nous faut saisir tout le potentiel présent dans les rapports que l’on a avec les animaux.
D. : À propos de la musique, je m’interrogeais sur la conception de cette piste sonore qui mêle cris animaux et pièces musicales oscillant entre répertoire classique et registre atmosphérique plus contemporain. Comment cette musique a-t-elle trouvé sa place ?
S. L. : J’ai d’abord senti cette nécessité de ramener le montage au silence, en retirant tous les éléments sonores qui venaient parasiter les présences animales, comme les paroles en voix off. Puis j’ai remis quelques passages des bandes-son et des musiques originales que j’ai parfois prolongées sur les plans précédents ou suivants. Le tout premier squelette du film ressemblait à cela : beaucoup de silence, avec quelques moments musicaux. J’étais sensible au climat qui se dégageait déjà. Dans le plan d’Eisenstein où l’on voit un geste rituel être pratiqué sur un cheval, une des versions du film était accompagnée par Gaspard de la nuit, de Ravel. Comme l’interprétation était emphatique, j’ai opté pour celle, plus sobre, de Martha Argerich, avec laquelle j’ai composé mes scènes. À plusieurs endroits dans le film, j’ai superposé des musiques, par exemple en mêlant Argerich et une pièce de Schnittke – compositeur dont un des passages que j’utilise fait penser à la musique drone. Pour les séquences d’ouverture et de fermeture, j’ai travaillé en fusionnant deux pièces d’Efrim Menuck – notamment membre du groupe montréalais Godspeed You! Black Emperor et Thee Silver mt. Zion. Dans une des pièces, qui parle de la mort animale, les variations animales qu’on y entend, faites de cris, de rugissements et de sons de la forêt, s’accordaient parfaitement à ces deux séquences de nature plus expérimentales.