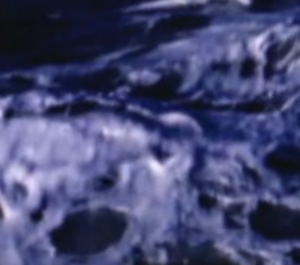Entrevues de Belfort 2020 (3/3)
Rétrospective Bruno Podalydès
L’édition 2020 du Festival Entrevues de Belfort qui s’est tenue en ligne nous a permis de voir six des dix longs métrages en compétition. Pour la rétrospective Podalydès, totalement annulée, nous avons suivi le guide du programme, et tenté d’en restituer le sel. Quant à l’ensemble du programme Net Found Footage, disponible sur Tënk, a été soumis à la vision curieuse des jeunes chercheurs en études cinématographiques de l’ENS de Lyon (Master Pensées du cinéma) à l’affût des lieux où se repense le medium. Entre kaléidoscope, arc en ciel et drapeau des fiertés, notre compte-rendu a pris les couleurs d’un horizon qui nous manquait tant, et que ces films « d’avant » nous restituaient : des embrassades, des descentes de rivières, des traversées sombres aussi de frontières qui refluent plutôt qu’elles accueillent. Au risque des injustices et des partialités. Manière pour nous de porter les couleurs de ce festival qui, vaille que vaille, s’est tenu.
Elise Domenach
***
Versailles Rive Gauche, 1992, 45min.
Versailles à la dérive
Anxieux et pressé, Arnaud (Denis Podalydès), en même temps qu’il se brosse les dents, s’affaire dans son petit studio à Versailles afin de recevoir au mieux Claire (Isabelle Candelier), à qui il a donné rendez-vous pour un dîner galant. Il règle avec précision la place des objets dans l’espace, choisit la musique, prépare la table pour l’apéritif, et en oublie son brossage. Fort heureusement le film de Bruno Podalydès, grâce à la bande-son, poursuit à la place du personnage l’entreprise hygiénique : le spectateur assiste ainsi aux déambulations impatientes d’Arnaud qui, brosse à dent tombante à la bouche, est secouru par le bruitage du brossage.
Ce décalage initial entre l’image et le son annonce le mécanisme général du court-métrage Versailles Rive Gauche (1992), qui joue constamment sur les écarts pour créer des effets comiques de situation, de mots, de gestes. Écart entre ce qu’espérait Arnaud et la réalité, entre la timidité initiale de Claire et, une fois pompette, son revirement soudain d’intérêt pour un autre homme, entre l’ambiance « musique classique et moussaka surgelée » prévue par Arnaud et l’arrivée du groupe de musiciens québécois « Solde, tout doit disparaître » ; écart, en somme, entre Arnaud et les autres.
La tension entre l’individu et le collectif – motif récurrent des films de Podalydès – structure le court-métrage. L’enchaînement des péripéties et quiproquos se développe autour d’Arnaud qui incarne avec Claire la banalité du quotidien, là où les autres personnages extravagants surprennent, comme Chantal, inconnue alcoolisée qui vomira à plusieurs reprises dans le lit d’Arnaud. Le scénario de Versailles Rive Gauche progresse autour de cette confrontation entre l’attendu et l’inattendu, la quotidienneté et l’événement, le tout au sein d’un crescendo rocambolesque entraînant la soirée romantique vers le festin collectif.
Déployé dans cet endroit exigu qu’est le studio de la rue Carnot, Versailles Rive Gauche apparaît finalement comme un défi de mise en scène et de spatialisation que Bruno Podalydès relève parfaitement. Jouant avec l’étroitesse du lieu pour générer des situations comiques, le réalisateur fait de la petitesse du studio un élément indispensable. Passant d’un minuscule couloir à un petit salon, le spectateur se retrouve, comme Arnaud, coincé dans une situation incongrue. Ne reste alors que les toilettes, espace à l’origine des déboires d’Arnaud qui devient finalement le seul moyen de se réfugier, de se retrouver avec soi-même. C’est d’ailleurs au cabinet que le personnage lira, vers la fin du film, un extrait de Mon histoire avec Bellino de Casanova – livre que lui offre Claire au début de l’intrigue -, comme pour signer la conclusion de cette folle soirée et de son histoire d’amour déçue.
Rosalie Tenaillon
***
Dieu seul me voit, 1998, 2h00.
L’art des ramifications
«Le train fonce vers Paris. Je suis dans ce train. Je suis à la même vitesse que ce train. Quoi que je veuille, que je décide, pour le moment, je vais vers Paris ». A l’arrêt précédent, juste avant d’écrire ce début de lettre à Sophie (Isabelle Candelier), rencontrée à Toulouse, Albert Jeanjean (Denis Podalydès) vient de descendre du train, puis de remonter, redescendre et encore monter dans la valse douloureuse de l’irrésolution qu’il dansera, sueur au front, tout au long du film. Dans la chronique qu’il a tenue dans les Cahiers du cinéma, « l’un n’empêche pas l’autre », Bruno Podalydès examine en septembre 1994 la « théorie du bouchon » de Jean Renoir : il faut savoir se laisser porter par le courant, suivre en toute souplesse la direction que les événements nous donnent. Mais ce lâcher prise engage un effort initial décrit par B. Podalydès : celui de se mouiller, se jeter à l’eau, lâcher toutes les rigidités qui règlent nos vies, « déceler le moment où tu ne te cramponnes plus et tu te laisses filer dans le courant ».
De tous les personnages du cinéma de Bruno Podalydès, Albert Jeanjean est sans doute celui qui rêve le plus fort d’être un bouchon dans un cours d’eau. Se laisser porter, bercer par le clapotis des décisions des autres, pencher doucement la hanche pour épouser le courant sans faire d’éclaboussures. Mais il est aussi le plus éloigné de cette détente utopique, horizon fantasmé d’un monde où l’on ne fait qu’accueillir généreusement le cours des choses. S’il navigue, son fleuve à lui est plein de ramifications : il y a Sophie, Corinne, puis Anna. Tout s’offre pour lui dans une alternative, et plus rien, dès lors, ne coule de source.
Albert a une technique : s’adapter au mieux à ce qu’il croit être le désir des autres, devenir une feuille mouillée qui colle à toutes les peaux attentives, modulable à souhait. Avec Sophie, il est anti-flic ; mais il s’entend bien avec Corinne, la policière des renseignements généraux. Albert aime ce qu’aiment les autres, se fait passer pour ce qu’il n’est pas. Il risque alors de devenir un « non-personnage », un être flottant et moite qui ne tire sa seule substance que des provocations des autres et sa forme que de leur sculpture. N’est-il qu’une réponse, ne fait-il que recevoir (des bulletins de vote, des messages vocaux, des ordres) ?
Deux choses le sauvent, malgré lui, de la pure mécanique. La simultanéité d’abord : recevoir des appels en même temps lui évite de devoir répondre à tous. Elle offre ce moment heureux où l’ensemble des alternatives est encore envisageable, mais aussi tragique en ce qu’elle implique, à terme, de faire un choix. S’il voit Sophie, il ne voit pas Anna. S’il va à Paris, il ne va pas à Toulouse. Albert Jeanjean est un personnage qui rame à contre-courant, qui voudrait sans jamais y parvenir retenir le flot d’une narration contrainte d’avancer. Il est une force de résistance aux multiples abandons qu’implique toute intrigue. Le corps, enfin : à cette impossibilité de tout accueillir répond une tension physique qui va jusqu’au vomissement. Albert est remué par des pulsions qui montrent à la fois ce qu’il y a de profondément douloureux à abandonner des possibilités, tout autant que son désir irrépressible de rencontrer l’autre amoureusement – c’est-à-dire en oubliant tout le reste. Ce combat du corps lui permettra pourtant d’avouer à Anna, envoûtante Jeanne Balibar, son amour en un verre d’eau lancé en pleine figure. Premier signe d’un engagement à venir, premier regard vertigineux en contre-bas du grand plongeoir.
Mathilde Grasset
***
Liberté-Oléron, 2000, 107 min.
À vau-l’eau
« Je me fais chier, je me fais chier » marmonne Jacques, comme une litanie infernale, tandis qu’il tente désespérément de gonfler un petit canot pneumatique. Pour combler le mortel ennui des vacances, où l’oisiveté est un péché sagement ordonné, Jacques, la quarantaine, en vacances sur l’île d’Oléron avec sa famille, se met en tête d’acheter un bateau pour prendre le large. Après quelques déboires, le voilà se pavanant devant le miteux Zigomar qu’il vient d’acquérir, un bateau d’occasion peu rutilant, où il s’improvisera chef de bord, capitaine préparant pieusement son expédition. Loin d’être un doux dingue sympathique, Jacques se montre grossier et fruste envers ceux qu’il ne connaît pas, considère ses fils comme des moussaillons qu’il peut commander à souhait et brutalise son épouse dont il coupe en permanence la parole. La terreur que Jacques inspire à sa famille est telle qu’il s’immisce même dans leurs songes et sabotent leurs rêves nocturnes. Denis Podalydès excelle ici en père de famille hargneux et revêche.
Aussi, les vacances, avec leur lot de rituels bien connus, ne tardent pas à prendre l’eau et la comédie potache tourne au vinaigre : Bruno Podalydès arpente, dans Liberté-Oléron, les terres hostiles et les eaux glacées de la comédie noire, où l’humour se fait volontiers grinçant, rongé par l’amertume et la méchanceté. Les rires amusés devant les manies empruntées et autres tocades ridicules de Jacques, ce petit tyran domestique à la recherche d’un divertissement, se transforment en sidération face à une violence qui ne cesse de croître, jusqu’à cette scène enragée où la famille finit par s’abandonner à une fureur, tant verbale que physique, en pleine mer. Personne n’en ressort indemne.
Dans cette comédie, pas vraiment douce et plutôt amère, le cynisme l’emporte sur tout le reste. Et si le personnage de Jacques s’avère le plus odieux, les autres ne sont pas épargnés, à l’exception des enfants dont l’impuissance devant la férocité des adultes est redoublée. Cet humour du désespoir face à une humanité médiocre trouve cependant son brillant contrepoint dans les mots, les dialogues, les jeux avec la langue, lesquels offrent la possibilité d’une régénérescence salutaire. Liberté-Oléron cultive ainsi la joie du jaillissement inopiné des mots, de leur potentiel polysémique, des chansons à tue-tête, des calembours, des ritournelles qui reviennent toujours comme la comptine « Trois p’tits chats ». La répétition, sans relâche, d’un vocabulaire jargonnant autour du navire (des « winchs » scandés à tout bout de champ, aux « pétons » qui frottent, aux tentatives de « lofer » le voilier) fait de l’île d’Oléron un émouvant petit théâtre de l’absurde où les mots, leur insupportable ressassement, finissent par mettre en branle tout ce petit monde menacé par le piétinement.
Romane Carrière
***
Le Mystère de la chambre jaune, 2003, 1h58.
Cap vers le « bon bout de la raison »
Un juge qui ne comprend rien, une voiture solaire pas très au point, Jean-Noël Brouté coincé dans une horloge : le Mystère de la Chambre jaune apparaît d’emblée comme une adaptation littéraire jubilatoire du roman de Gaston Leroux. Le jeune et talentueux Joseph Rouletabille (Denis Podalydès), épaulé par son ami et photographe Sainclair (Jean-Noël Brouté), s’aventure dans le château du Glandier pour résoudre le mystère de la Chambre Jaune : Mathilde, la fille du célèbre professeur Stangerson, a été victime d’une tentative d’assassinat.
Or il est impossible que le meurtrier se soit échappé du lieu du crime : la chambre jaune se trouvait fermée de l’intérieur au moment des faits. Comment l’assassin a-t-il pu se volatiliser ? Pour percer ce « très grand et très curieux mystère », Joseph Rouletabille va devoir « oublier l’expérience, être juste logique », et suivre toujours « la raison par le bon bout ». Rasant le sol de la chambre à l’affût du moindre indice, Rouletabille observe les plus petits détails afin de trouver « tout ce que nous ne voyons pas, qui est immense ». La phrase sonne comme un indice pour comprendre le cinéma de Bruno Podalydès. Dans ses films, l’insignifiant détonne, les plus petits éléments se trouvent chargés d’empreintes, de mystères : la paire de chaussures du gardien, un masque de soudeur, une canne, un cheveu. Le parcours de la bille qui roule d’objet en objet jusqu’à un petit train au générique – au-delà de symboliser littéralement le nom du personnage principal – pourrait être la trace visuelle d’une tendance de Podalydès à faire s’emballer les objets, à les embarquer dans un mouvement, à leur faire porter la charge de signes qui les dépassent. La bille passe d’un espace à un autre, se transforme, se métamorphose, emportée par son irrépressible mobilité. À son image, le spectateur et Rouletabille se laissent emporter dans une enquête minutieuse qui oblige le personnage principal à aller contre lui-même, à combattre des élans contradictoires : l’exigence de la raison et l’emportement du cœur.
La forme générique du film policier, son atmosphère archétypale sont pleinement assumées, tant dans les décors – le pittoresque château du Glandier et ses jardins – que dans les costumes – les casquettes et autres montres à gousset. Du personnage de Frédéric Larson à la course genoux levés de Rouletabille, le ton penche vers la bande-dessinée. Les différents cadres, comme une multitude de cases, deviennent l’espace d’un jeu d’acteurs excentriques et survoltés. La référence constante à l’univers de la BD permet aussi au cinéaste de restaurer un imaginaire enfantin. Difficile pourtant d’assigner au Mystère de la Chambre Jaune un public précis tant il parle aux petits et aux grands. Les situations burlesques et la gestuelle comique dynamisent l’atmosphère enfantine et drôle du récit, dont le contrepoint se situe dans un parfum de menace, la persistance d’un secret qui plane au-dessus du château du Glandier.
Rosalie Tenaillon
***
Comme un avion, 2015, 145 min.
Méandres du bonheur et de l’amour
Michel (Bruno Podalydès) rêve de prendre la tangente et de fuir son quotidien d’ingénieur designer. Las, passionné des avions, fasciné par l’aéropostale, il ne peut pourtant pas s’envoler. Lorsqu’il tombe sur une illustration de kayak sur Internet, le glissement sémantique s’opère et l’idée surgit : de l’avion au kayak, il n’y a qu’un pas. Dès lors, Michel se met en tête de construire son kayak et organise un voyage en solitaire, laissant sur la berge son épouse Rachelle (Sandrine Kiberlain). Point de départ Saint-Cloud, destination inconnue.
L’habileté et l’intelligence de Comme un avion réside dans le fait que le film déjoue constamment les attentes qu’il ménage. Michel rêve de fendre les airs mais finit par glisser sur les eaux. Il prévoit de partir loin et pourtant fait du surplace. Il est charmé par Mila (Vimala Pons) mais termine dans les bras de Laetitia (Agnès Jaoui). De la même façon, les gags sont désamorcés en permanence : Michel n’a pas de difficulté à installer sa tente pliable, comme on pourrait s’y attendre, mais à la ranger, comme s’il ne pouvait se résoudre à quitter les lieux. Le jardin aux allures bucoliques où il a fait naufrage, lequel entoure une petite chaumière aux allures de guinguette tenue par Laetitia et Mila, accompagnées par deux drôles d’énergumènes, retient Michel, qui enchaîne les faux-départs. Entravé par l’irrépressible attraction du lieu, le périple de Michel se transforme en dérive amoureuse, où les multiples revirements esquissent la possibilité d’une libre rencontre entre deux êtres.
À ce titre, Comme un avion n’est pas vraiment une comédie mais plutôt un grand film d’amour puisque tout s’achemine vers l’éclosion d’un contact entre Michel et Laetitia. Alors qu’ils retirent les vêtements de la corde à linge, Michel caresse et dessine les contours du corps de Laetitia, enveloppé dans une nappe à carreaux. Puis tous deux s’allongent sur l’herbe et la caméra se détourne de leurs étreintes pour filmer une eau frémissante et pétillante. Un peu plus tôt, Michel et Laetitia s’étaient retrouvés face à face autour d’une table : Podalydès filmait avec une infinie délicatesse les échanges de regards entre un Michel dont les yeux brillaient de curiosité et une Laetitia troublée. Les oscillations de Michel, qui finit toujours par revenir au même endroit, enrayant la dynamique du film d’aventure, prennent ainsi une autre signification : et si c’était Laetitia, l’enchanteresse, l’envoûtante fée Morgane de ces bois, qui le reconduisait à chaque fois vers elle ? En remplaçant le café de la thermos par de l’absinthe, en retrouvant Michel par hasard au supermarché où il s’est échoué après avoir pris la mauvaise direction, en semant des post-it amoureux qui le mènent jusqu’à son corps nu et désirant, Laetitia entraîne, encore, Michel dans cette ronde voluptueuse des plaisirs ordinaires. Une dernière virevolte avant le vrai départ.
Romane Carrière
***
Bécassine !, 2019, 1h42
À travers une carafe d’eau
Un coq entonne la Marseillaise : c’est le réveil d’un monde de farces et attrapes. Dans la sauvagerie des contraires, les plus petites choses ont les plus grands effets : une dent accrochée à une ficelle propulse une petite fille à l’autre bout du jardin. Ca jette, ça claque, ça cogne, ça tombe et ça rebondit. Les premières minutes du film, pensé pour un public enfantin, croquent un univers irréel et hors d’âge, résolument guignolesque. Mais la farce n’est vraiment drôle que si quelqu’un a la bonté de se laisser, corps et âme, prendre au jeu : ce sera Bécassine. Encadré par une coiffe blanche qui cache tous ses cheveux, le visage d’Émeline Bayart n’en finit pas de lever le sourcil, d’écarquiller l’œil, d’observer, d’examiner, lorsque tous les autres, excepté l’oncle Corentin, feignent l’indifférence. Elle est le public idéal des tours de passe-passe et des pétarades magiques. Comment éviter, dès lors, la chute moqueuse, le dévoilement toujours décevant du truc, la révélation d’une tromperie ? Jamais la désillusion ne menace le bonheur enfantin du gadget, parce que Bécassine voit du miraculeux partout : les plumes des coussins secoués par Mademoiselle Châtaigne (Josiane Balasko) retombent en une neige gracieuse qui l’enchante ; la vitesse de la Fringante, la voiture de la Duchesse du Grand-Air (Karin Viard), la grise. Les rêves de Bécassine, qui fantasme la vie parisienne, sont surpassés par des émerveillements matériels : c’est la promesse d’une ou deux nuits au château, si mystérieux, qui la détournent du chemin qu’elle venait de commencer à arpenter en direction de la capitale.
Au plaisir enfantin de la farce s’ajoute celui de l’invention. Bécassine brille par son sens pratique, qui lui permet de donner sans se réveiller le biberon à Loulotte, la petite fille dont elle doit s’occuper, ou encore de cuire des œufs à la coque en vaquant à d’autres occupations. Ce goût pour la trouvaille s’accompagne d’un sens aigu de la mécanique, des fils que l’on peut suivre du doigt ou des ressorts dont on comprend la place. Alors, lorsqu’elle découvre toutes les inventions à la mode, les techniques inédites, les croyances nouvelles liées à la modernité, Bécassine est perplexe. Elle rencontre l’électricité, le téléphone, le capitalisme mesquin de Rastaquoueros (Bruno Podalydès). Plus qu’une naïveté, ses étonnements révèlent ce qui fait d’elle un personnage résolument décalé : si les autres sont inscrits dans une époque, elle n’a pas d’âge. Elle connaît les matières, les mécanismes simples, mais a plus de mal à comprendre, jusqu’au mot lui-même, ce qui est « totomatique ». Ce lien distendu à la modernité lui permet de recevoir ses différents attributs comme de nouveaux jouets, donnés dans une contingence inédite, c’est-à-dire disponibles à toutes les inventions d’usage, au pur bonheur des sens. L’eau chaude coule sur la main, l’électricité permet de mettre du jour dans la nuit.
Cette réjouissance des évidences premières, qui a profondément à voir avec l’enfance, irradie sur l’ensemble des autres personnages, malgré les airs distants, éventuellement blasés, qu’ils essaient de se donner. Comme si Bécassine nous autorisait tous, par sa présence et son visage de sainte, à accepter nos penchants immédiats : Monsieur Proey-Minans (Denis Podalydès) rit malgré lui aux pitreries de Rastaquoueros et s’adonne, à la fin du film, à un combat d’épée enjoué. Bécassine ! sonne comme une ode au plaisir décomplexé du jeu ; les seuls véritables « vilains » qu’on y trouve sont ceux qui ne sont plus capables, par excès de sérieux, d’une telle honnêteté.
Mathilde Grasset
***
Les 2 Alfred, 2021, 1h32
À pieds joints dans les eaux vives de l’entrepreneuriat
« No Child », « Be joyful », tels sont les slogans de la start-up The Box au sein de laquelle Alexandre (Denis Podalydès) va devoir évoluer, non sans difficulté, aux côtés de Séverine (Sandrine Kiberlain). Ne pas avoir d’enfants, être disponible 24h/24, se rendre aux soirées improvisées et obligatoires « conf-call et galette des rois ». Bruno Podalydès s’empare de l’univers de la start-up et du processus d’uberisation de la société dans un film satirique et burlesque, où les personnages se laissent vite dépasser par les systèmes et les machines qui les entourent. La symétrie ascétique des bureaux et la géométrie irréprochable des objets qui les peuplent tranchent avec les circonvolutions rêveuses des personnages quinquagénaires pour qui l’enjeu est de parvenir à accorder leur rythme à celui de la marche, rapide et rectiligne, d’une génération ultra-connectée.
La vague de cet entrepreneuriat prosaïque amène avec elle des objets de nature nouvelle. La gourmandise du cinéaste pour les objets trop gros, trop petits, ceux qui se voient bien, que l’on casse ou caresse, qui fusent et rebondissent, n’a jamais fait de doute. Mais ceux qui hantent Les 2 Alfred, eux, ont par nature la prétention de vouloir faire oublier leur matérialité. Ce sont ces écrans portatifs ou à roulettes, ces petites machines qui font mine de fonctionner toutes seules et qui renvoient, toujours, à quelque chose qui les dépasse. Un message qu’on envoie, que l’on reçoit, un visage, une voix qui ne sont pas vraiment là. Ces machines sont les dépositaires d’un autre instant, d’un autre endroit. Ainsi des robots téléguidés étranges vadrouillent dans les bureaux de The Box : sur l’écran qu’ils arborent, le visage en visio du patron de la boite, en affaires à Londres. Les voitures envoient des sms à leurs propriétaires pour les prévenir qu’elles ont été se garer plus loin. On les admire pour ce qu’elles sont capables de faire à notre place.
L’élan poétique des 2 Alfred tient à l’appétit du cinéaste, si dissident aujourd’hui, à vouloir redonner à tous les objets qui gravitent autour de nous une véritable présence, une matérialité. Si les drones volent par nature, ils doivent en réalité leur lévitation, comme lors d’un tour de magie, à la force qu’ils prennent du sol, aux matières retrouvées de la terre. Drones prétentieux, voitures snobinardes, robots ridicules, trouvent une incarnation parce que, malgré leur caractère vaporeux, Bruno Podalydès y attache des doudous, des bruits de bisou, des gestes amoureux, une danse en pleine rue. Chez lui, l’éther vient d’un plat de pâtes fumant, de ruptures constantes, minuscules et bouleversantes qui diffusent, au fil d’une comédie enlevée, le bonheur de pouvoir rencontrer l’autre. Une crise de panique hystérique s’épuise en un slow doux comme la nuit, le brouhaha managérial en une veilleuse pour enfant qui projette sur le visage rapproché des deux frères Podalydès des cœurs roses et dansants.
Mathilde Grasset et Rosalie Tenaillon
Coordonné par Elise Domenach.
Remerciements à Catherine Giraud, Elsa Charbit, Bruno Podalydès, et à l’ENS de Lyon.