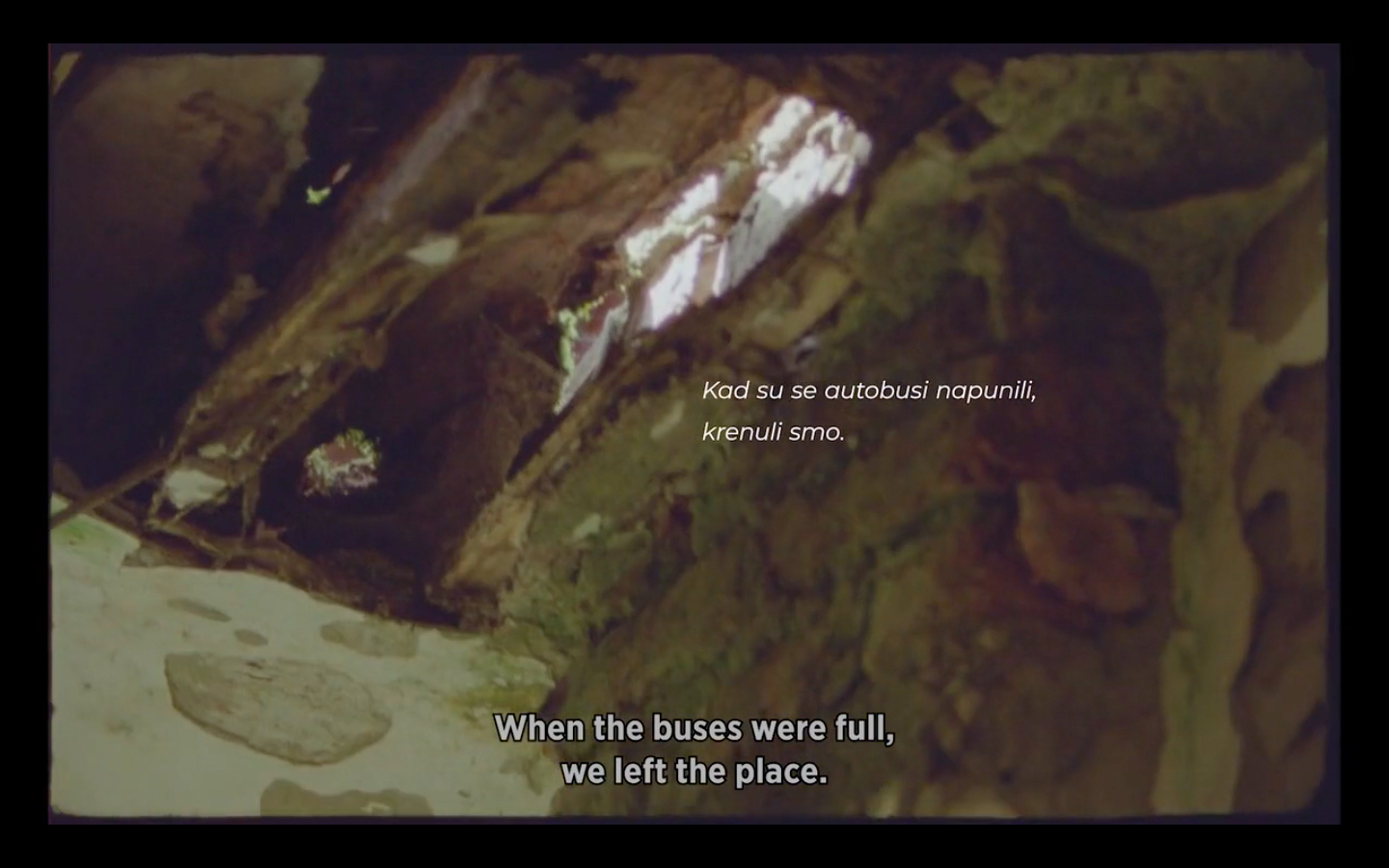États généraux du film documentaire de Lussas, 2022
disturbed material
La trente-quatrième édition des États généraux du film documentaire s’est tenue du 21 au 27 août derniers. Rencontres et discussions avec des cinéastes et des professionnels se sont ajoutées aux sélections et rétrospectives consacrées du festival lussassois ainsi que deux séminaires, eux-mêmes scandés de projections : « Gênes 2001 : une mémoire de l’avenir » coordonné par Alice Leroy et « Du politique au poétique », par Federico Rossin et Christophe Postic. De nombreux spectateurs et spectatrices avides de réflexion, d’échanges et de films ont afflué autour des écrans — attention : les tarifs ne sont pas dérisoires et sans réservation, une carte ou un ticket acheté ne garantit pas l’accès à une séance, même en plein air. On tire notre chapeau aux bénévoles des billetteries et de l’espace restauration, ainsi qu’aux habitant·e·s et commerçant·e·s de la commune de Lussas pour l’accueil d’une telle foule festivalière, un tantinet pressée par un programme si pertinent, et si dense.
L’atmosphère était vivante ; le fond de l’air, pourtant, recueilli. Les États généraux du film documentaire ont rendu hommage à deux personnes disparues à quelques mois d’intervalle, cette année : Jean-Paul Roux, viticulteur et maire de Lussas de 1987 à 2022 et Jean-Louis Comolli, cinéaste, critique et défenseur du cinéma (sous influence) documentaire. Celui-ci exaltait le « méga-rêve de cinéma » sans tapis rouges ni compétition accueilli par le petit village ardéchois de Lussas (il était régulièrement de la fête), quand celui-là jouait un rôle de premier plan s’agissant de maintenir ce « rêve » dans sa réalité, avec ce que cela implique de pragmatisme. Bien que très différents de par leur biographies et leurs fonctions, ces deux hommes étaient porteurs de ces visions dont ni l’histoire du cinéma documentaire ni celle de sa capitale décentralisée en France, Lussas, ne pourraient aujourd’hui s’abstraire. Visions indépendantes, mais tout compte fait, bien assorties : chacun œuvrait, à sa manière, à la jonction du cinéma et de la politique.
Face aux fantômes
Face aux fantômes (2009) de Jean-Louis Comolli était projeté le mardi 23 août, en présence de Sylvie Lindeperg (qui l’a co-écrit) et de Marie-José Mondzain. Ce film se présente comme la version cinématographiée de l’analyse historienne, par Sylvie Lindeperg, de Nuit et brouillard d’Alain Resnais, analyse publiée en 2007 sous la forme d’un livre intitulé Nuit et brouillard : un film dans l’histoire. La mise en scène de Comolli est sobre : tout le film est, en fait, une sorte de huis-clos dans un studio de l’INA, où la chercheuse est filmée parmi des appareils et des lecteurs de toutes sortes, en train de parler de Nuit et brouillard, de consulter des archives, de nous en montrer certaines et de les commenter. Sa parole est le plus souvent in. On la voit s’articuler à l’image ; on voit, en somme, le travail de l’historienne : donner forme (de récit) au monceau de faits dont témoignent les archives. Jean-Louis Comolli apparaît aussi physiquement : il est plus souvent hors-champ, mais on le sait toujours présent au bord du cadre, écoutant Sylvie Lindeperg (le regard de celle-ci nous indique sa position).
Jean-Louis Comolli écoute, pose des questions (rarement), rebondit parfois sur les propos de l’historienne, hésite… comme s’il n’avait pas vraiment défini son statut. De sa stature (au sens non figuré du terme) en revanche, Comolli sait très bien quoi faire lorsqu’il veut montrer que des films existent qui ne visent qu’à ulcérer leurs spectateur·rices, sans nous y exposer pour autant. Il s’interpose entre sa caméra et le moniteur qui les diffuse, de sorte qu’on ne voit qu’une partie de l’écran. On perçoit l’essentiel, toutefois : le commentaire péremptoire (mais très imprécis) d’une actualité française, le rythme éreintant de son montage, la logique d’accumulation à laquelle elle se conforme. On le perçoit même mieux, ainsi. De Face aux fantômes, ressort qu’un document n’est pas inoffensif, vis-à-vis de l’histoire, des mémoires et des consciences qu’il contribue à façonner. Sylvie Lindeperg le dit dans le film et Jean-Louis Comolli, lui, le montre tout en occultant une partie du champ (mais une partie seulement). Pour le cinéaste documentariste comme pour l’historienne, la question n’est pas seulement de savoir s’il faut, oui ou non, montrer le pire (l’horreur totale) document à l’appui (question éthique) puisqu’il s’agit en même temps et dans le même geste de nous armer contre ce pire (question politique).
Face aux fantômes est une parfaite illustration de l’idée comollienne du cinéma documentaire comme « école du spectateur ». On ne débarrassera pas la formule de ses connotations (elle vient d’un homme né en 1941 et très attaché au service public comme il le disait encore dans son dernier livre, Jouer le jeu). Il n’est pas inutile de revenir, par-delà ces dernières, sur ce qui fait l’intérêt de cette idée. Pour Jean-Louis Comolli, « La mise en scène, c’est la question de la place, de la définition du spectateur, de la supposition du spectateur comme sujet à part entière [11][11] Jean-Louis Comolli, “Si on parlait de mise en scène ?” (1992) in : Voir et pouvoir, Verdier, 2004, p.79 ». Lorsqu’il écoute Sylvie Lindeperg depuis la lisière du cadre dans Face aux fantômes, il incarne l’idée qu’il se fait du spectateur ou de la spectatrice. Et il ou elle ressemble effectivement à un·e écolier·e, non pas en vertu de son assujettissement au discours du maître mais en vertu d’un certain caractère d’indétermination (quels seront les goûts, les pensées, les aspirations de l’écolier, plus tard ?). D’ailleurs, Jean-Louis Comolli n’est pas parfaitement discipliné dans le film, il lui arrive de vouloir parler quand ce n’est pas son tour. « Mettre en scène [écrivait-il], c’est considérer le spectateur comme susceptible de se transformer, désireux et capable de changer de place. Comme un être disposant d’un devenir [22][22] Idem. ».
Révolution Cuba
Histoire de doc — la traditionnelle fresque historienne de Lussas, cette année comme souvent programmée et présentée par Federico Rossin — était consacrée au cinéma cubain, et plus particulièrement au cinéma produit par l’ICAIC, l’Institut Cubain de l’art et de l’industrie cinématographique fondé par Alfredo Guevara quelques semaines après renversement du régime de Fulgencio Batista (en 1959). À la suite d’un accord signé en 2012, le fonds pellicule de l’ICIAC, qui compte près de 1500 films réalisés entre 1960 et 1990, a été numérisé par l’INA. Federico Rossin a restreint le cadre chronologique de sa programmation, tenant compte du verrouillage culturel opéré par le gouvernement castriste (devenu « soutien inconditionnel de l’URSS » dans le contexte de l’embargo des États-Unis contre Cuba) au tournant des années 1960-1970 et surtout, de la mise sous cloche ministérielle de l’ICAIC, en 1977 (l’institut étant resté indépendant, financièrement, jusqu’à cette date). El Mégano (1955), considéré comme le premier film critique à Cuba, inaugurait cette traversée : réalisé sous l’influence du néoréalisme italien par deux futurs membres de l’ICAIS, Julio García Espinosa et Tomás Gutiérrez Alea, il est en partie mis en scène et des paysan·ne·s cubain·e·s y interviennent dans leurs propres rôles. Outre une actualité datée de 1979, le film le plus tardif de cette sélection était, pour sa part, Simparelé (1974) d’Humberto Solás — documentaire musical sur les luttes du peuple haïtien, avec la chanteuse populaire Martha Jean-Claude dans le rôle de conteuse.
Federico Rossin a axé son propos sur la variété des démarches cinématographiques dont l’ICAIC pouvait être le socle durant ses quinze premières années d’existence. Une demi-journée était consacrée aux actualités filmées de Santiago Alvarez, mêlant les registres satyriques, épiques et pamphlétaires pour dénoncer les ravages de l’impérialisme américain, usant de toutes les techniques à sa disposition pour décrire, informer et convaincre sans recourir à la voix off. Autour de cette figure emblématique du cinéma militant cubain, d’autres cinéastes très différent·e·s dans leurs usages du médium, ont été convoqué·e·s. On peut citer Por primera vez d’Octavio Cortázar — un recueil de témoignages et d’impressions au sein d’une communauté de paysan·ne·s très éloigné·e·s des technologies modernes, qui voient un film (Les temps modernes de Chaplin en l’occurrence) pour la première fois grâce aux Mobil Cinema Units de l’ICAIC — ou le beau Gente en la playa (1960) de Néstor Almendros, sur la nationalisation des plages privées de Cuba : célébration du droit à l’oisiveté pour tou·te·s, ce film fut qualifié de contre-révolutionnaire et interdit par le gouvernement. Le mardi 23 août après-midi, la salle du Moulinage de Lussas était pleine comme un œuf : un échantillon de l’œuvre de Nicolás Guillén Landrián (jugée dissidente et censurée, elle aussi) venait clôturer le programme, précédé de cinq films de la cinéaste afro-cubaine Sara Gómez. Un peu en décalage, au regard d’une propagande générale prônant la militarisation de la société cubaine, Sara Gómez interroge l’ingénierie sociale castriste dans sa mise en œuvre, en adoptant un point de vue immergé, à hauteur des personnes qui l’appliquent et/ou qui la subissent. Elle leur donne l’occasion de s’exprimer à titre individuel, et chacune ébranle sans le savoir la moindre certitude qu’on aurait pu tirer d’un précédent témoignage. Entre ces personnes, en creux, se laisse deviner le morne idéal (sorte d’« Homme Nouveau ») qui menace de structurer l’imaginaire collectif, et dont chacune s’écarte à sa façon.
C’est par sa manière de filmer les enfants que Sara Gómez se distingue le plus nettement des autres cinéastes révolutionnaires de cette période — qu’ils soient « orthodoxes » ou non, d’ailleurs. Sur cette thématique de l’enfance, les films cubains présentés à Lussas cette année oscillaient entre deux tendances : exaltation de la grâce, de la simplicité et de la réceptivité présumée des enfants, et instrumentalisation de leurs images à des fins propagandistes. Ces deux tendances sont d’ailleurs conciliables (bien qu’elles ne soient pas systématiquement conciliées) : la figure de l’enfant campé·e en observateur·rice ingénu·e, plus ou moins perplexe face à la société des adultes, est un élément dramaturgique efficace s’agissant d’amener les spectateur·rices à repenser leur vision du monde. Mais les enfants (et très jeunes adultes) que filme Sara Gómez ne sont représentatif·ves d’aucun idéal exploitable par quelque propagande que ce soit : ce sont celles et ceux de l’Île des Pins — lieu de relégation devenu, en 1960, un centre de rééducation pour une jeunesse perçue comme déviante. Une scène de Una isla para Manuel montre, en vue d’ensemble et légèrement plongeante, un exercice militaire où de jeunes garçons sont invités à se tenir en rang et à synchroniser leur marche. Aucun ne commet de véritable faux pas. Mais l’ensemble est émaillé de petites discordances, dont on ne saurait dire si elles sont le fait de la maladresse ou de l’espièglerie (des bras trop raides, des pieds en canard…). Image malicieuse que celle de toutes ces silhouettes, non rétives à faire œuvre commune mais dans le détail, si irrégulières… sachant que Sara Gomez veille, pour sa part, à ne pas aligner les enfants et les adolescent·es derrière un stéréotype, au service d’un plaidoyer cinématographique pour ou contre l’institution de l’Île des Pins. Ses films En la otra isla et — plus encore — Una isla para Manuel laissent affleurer tout le charivari de leurs personnalités, plutôt sociables — ils et elles partagent leurs jeux et leurs rêves, interpellent la caméra par toute une panoplie de gestes, d’expressions et de regards — mais non-conformes, insolubles dans l’ordre social.
Trajectoires personnelles ?
La prévalence d’un certain type de film dans le domaine du documentaire de création s’est illustrée, cette année plus que jamais, à Lussas. Le ou la cinéaste suit une personne pendant quelques mois, ou quelques années… : le résultat pourrait être qualifié de film de trajectoire personnelle. Ce « genre » — le terme semble approprié — était mis à l’honneur dès la soirée d’ouverture, avec la projection de Polaris d’Ainara Vera, qui aborde les thèmes de la maternité et de la sororité à travers le quotidien hors normes d’Hayat — une capitaine de bateaux dans l’Arctique. Chaylla de Clara Teper et Paul Pirritano, l’un des plus grand succès du festival à en juger par les conversations entre deux séances, relève aussi de cette forme documentaire : ce film met en évidence le calvaire psychologique et administratif d’une femme battue par son conjoint, au revers d’un dépôt de plainte pour violence conjugale que d’aucuns, du haut de leur chaire, considèrent comme une démarche élémentaire. Le film de trajectoire personnelle a enfin largement dominé la sélection Expériences du regard (les deux tiers de ces films en étaient). S’il n’est pas nouveau — ses longue racines iraient bien titiller Nanook de Flaherty (1922) — ce genre semble donc particulièrement encouragé dans le contexte actuel.
Tournés dans de nombreuses régions du monde et touchant à des thématiques variées, ces films de trajectoire personnelle sont évidemment très différents les uns des autres. Sauf exception, ils mettent en lumière une personne anonyme (parfois incluse dans un groupe ou une communauté : c’est le cas de Chancelvie, l’adolescente qui vit dans les rues de Kinshasa, dans le documentaire de Marc-Henri Wajnberg, I am Chance). Sa situation (géographique et sociale), sa personnalité et son cheminement détermineront grandement la tonalité du documentaire — et ce d’autant plus que les relations filmants-filmés-films, construites dans le temps (assez long) du tournage, peuvent ici évoluer : il a beaucoup été question de mise en scène de soi, autour de ces films. Outre sa situation particulièrement éclairante quant à un fait de société (ou de culture), ce « personnage » principal va parfois présenter un caractère d’excentricité assez remarquable : dans Les Odyssées de Sami de Robin Dimet, un érudit éthiopien plongé dans la précarité se bat pour publier sa version, en amharique, d’une anthologie de la mythologie grecque (il a mis 20 ans à la traduire et à l’adapter). La production du film lui permettra finalement de réaliser ce projet — et ce dans le film : on le voit dédicacer des exemplaires de son ouvrage, à la fin.
Les discussions d’après-séance à propos de ces films ont révélé deux choses : d’une part l’émotion, l’attachement aux « personnages » qu’ils suscitent et de l’autre, l’intuition spectatorielle qu’en sus d’une heureuse rencontre entre le cinéaste et le protagoniste, une telle expérience de cinéma induit un appareil institutionnel et financier vaguement conséquent. Avez-vous des nouvelles ? Comment va-t-il ? Comment va-t-elle aujourd’hui ? Il était souvent question du bénéfice moral de l’expérience pour les personnes filmées et lorsqu’elles sont visiblement indigentes, de l’aide institutionnelle et matérielle qui a pu leur être apportée à l’occasion de la production du film. Il était bien plus rarement question de scénarisation, de techniques narratives, de montage et de postproduction… bref : de forme documentaire. Or, si le centrement autour d’un individu permet d’aborder tout un contexte d’un point de vue immersif et singulier, et d’éviter ainsi les poncifs du documentaire de convention (didactisme, surplomb…), il tend aussi quelques pièges : il dispose à l’identification et pousse à des effets scénographiques et dramaturgiques hérités de la fiction standardisée. Sur tous ces points, ce corpus de films de trajectoire personnelle présente de signifiantes variations… mais la quête des propositions les plus alternatives en matière de forme documentaire nous conduit fatalement aux limites du « genre », sinon au-delà de ces limites. Oussama d’Ina Seghezzi et Soraya Luna d’Elisa Gòmez Alvarez sont, à ce titre, exemplaires.
Oussama frappe d’abord par son ascétisme, puis par la densité politique des choix qui ont présidé à sa forme. Il ne comporte que deux plans : d’abord un vertigineux zoom avant sur une plaine espagnole, puis un long travelling embarqué zigzaguant entre des serres et autres équipements agricoles. Nulle âme qui vive à l’horizon. En voix off, Oussama, un travailleur sans papier de trente ans, raconte son histoire, et son quotidien. On ne le verra jamais à l’image. Exposé à un vent inextinguible, le paysage qui défile sous nos yeux tandis qu’il parle finit par produire une sensation paradoxale de claustration, d’asphyxie. Oussama révoque tout évènementiel, et c’est pourquoi l’inacceptable pèse très lourd pour qui le voit.
Soraya Luna remet en question la légitimité, la possibilité même d’une dramaturgie régulière (donnant à comprendre les relations causales entre les évènements à mesure qu’ils sont exposés) face aux réalités les plus brutales. À partir du récit (en voix-je) d’un drame récent et d’une rare violence, Elisa Gòmez Alvarez remonte le fil de son histoire personnelle en s’appuyant sur des films de famille des années 1990 où elle apparaît, enfant, avec ses sœurs et sa mère, et sur quelques prises de vues contemporaines — renvoyant peut-être au projet de film qu’elle a dû transfigurer à l’épreuve de ce drame. Mais tout reste à l’état de bribes, d’éclats, de réminiscences. Une anomalie lézarde entre ces images : un geste de rejet, une plaisanterie licencieuse, une fissure dans un mur, une étrange conversation téléphonique. Ici du réel, dans toute sa gravité (il s’agit d’un traumatisme), enraye la narration de façon irrémédiable.
Disturbed Earth
Le moment où s’établit un contact privilégié avec le réel, en cinéma (documentaire), serait le tournage ; le montage, lui, demeure perçu comme une démarche de laboratoire, effectuée en retrait, sinon en rupture avec ce réel — et tout ne serait là qu’arbitraire. Il est pourtant possible que la réalité dans laquelle s’inscrit le film, sa production et sa réception, soit un critérium décisif pour le montage. Et monter en tenant compte de la réalité, ce n’est pas sélectionner les plus grands moments du tournage pour mieux les valoriser. Il se peut aussi que cette réalité impressionne le montage du film, de la même façon qu’elle impressionne une pellicule ou un capteur électronique : ainsi en va-t-il de Disturbed Earth de Guillermo Carreras et Kumjana Novakova.
Tourné à l’époque contemporaine auprès de personnes concernées par le massacre de Srebrenica de 1995, ce film donne à éprouver le traumatisme causé par ce génocide dans la Bosnie-Herzégovine d’aujourd’hui. Les témoignages y sont sporadiques. Les personnes filmées semblent parfois parler d’autre chose, ou essayer de le faire. Souvent, elles se taisent et s’adonnent à leurs activités quotidiennes (travaux agricoles…). Des images d’archives, dont quelques vidéos de 1995 provenant de l’armée de la république serbe de Bosnie où l’on voit le général Ratko Mladic, sont intercalées dans le film. Avant la dernière séquence (un réveillon de nouvel an, aujourd’hui), des photographies de restes humains exhumés aux abords de Srebrenica défilent à l’écran.
Il peut être utile de rappeler les faits : début juillet 1995, l’armée de la république serbe de Bosnie lance l’assaut contre la ville de Srebrenica. Le 11 juillet, trente mille personnes se présentent aux portes d’une base de l’ONU située à quelques kilomètres de la ville, à Potočari. Le bataillon néerlandais de l’ONU laisse entrer « 4.000 à 5.000 réfugiés », puis ferme les grilles. Ratko Mladic (à la manœuvre d’une vaste entreprise d’épuration ethnique menée dans toute la Bosnie, depuis 1991) procède alors au tri et au transfert de la population restée à l’extérieur puis des réfugiés de la base, et ce avec l’assistance de casques bleus. Il ordonne le massacre de 8000 hommes bosniaques — adultes et adolescents — après avoir fait déporter leurs mères, sœurs, femmes et enfants. Les premières indications concernant l’emplacement des fosses communes furent tardives, les opérations d’exhumation sont compliquées (les corps ont été volontairement dispersés, les terrains sont minés…). En 2017, 6 938 victimes avait été formellement identifiées grâce à des tests ADN. Beaucoup sont aujourd’hui enterrées au mémorial de Potočari. Mais dans certaines régions, en Bosnie-Herzégovine, des autorités imposent toujours le silence à propos de ce génocide.
Kumjana Novakova et Guillermo Carreras ont rencontré un soldat de l’ONU qui était présent à Potočari en juillet 1995, et qui vit aujourd’hui à Srebrenica. Grâce à lui, ils ont obtenu un ensemble d’informations précises sur les opérations militaires qui ont eu lieu dans la région, à ce moment-là. Mais les cinéastes n’ont pas arrimé le film au point de vue de ce témoin privilégié — « personnage » qui aurait probablement catalysé la discussion. Ils ont préféré présenter le choc de Srebrenica dans sa dimension non seulement psychologique mais aussi sociale. Or, à ce niveau, l’heure n’est pas au passage de micro entre « moi » singuliers mais toujours à la reconnaissance des faits et à la constitution d’un savoir collectif, qui sont une condition du dialogue.
La société bosnienne est aujourd’hui profondément fragmentée et dans ces circonstances, « créer un espace cinématographique cohérent par le biais d’une narration linéaire compréhensible est pour le moins malhonnête » écrit Kumjana Novakova. Dans sa radicalité, cette phrase m’oblige à préciser une chose : Disturbed Earth n’est pas hermétique. Mais il est vrai que l’enchainement des faits et le rapport des paroles à ces faits ne se laissent pas immédiatement saisir dans le film. Entre de longs silences, les évènements rejaillissent dans un certain désordre, au détour d’un témoignage, d’une image d’archive, d’un ossement retrouvé. Pour les cinéastes, la question était bien de savoir comment montrer et comment raconter ces évènements dans les conditions présentes. Bien qu’elle ne soit pas pleinement (re)connue à l’échelle de la Bosnie-Herzégovine, l’histoire est en embuscade derrière chaque instant du quotidien. La moindre déformation dans le paysage peut signaler un charnier, la moindre contraction sur un visage, une angoisse infinie. Avant de prétendre l’expliquer, Disturbed Earth s’est effectivement laissé perturber — disturbed — par cette réalité psychique et sociale, jusque dans sa syntaxe.
Chose importante, tant le dérushage et le montage du film ont manifestement été cruciaux : Disturbed Earth a été monté par Jelena Maksimović. Monteuse de plusieurs films d’ex-Yougoslavie — dont Teret (2019) d’Ognjen Glavonic — elle a également réalisé le très beau Domovine (ou Homelands), qui avait été sélectionné au FID Marseille en 2020. Kumjana Novakova a expliqué qu’au tournage, elle avait recueilli un témoignage bouleversant : celui d’une habitante de Srebrenica qui raconte, minute par minute, les derniers instants qu’elle a vécu avec son mari et ses deux fils. Ce témoignage a été exclu du montage, mais Disturbed Earth s’est visiblement imprégné du phrasé, de la texture d’une parole traumatisée. À travers ces coupes franches entre les images d’archives et les prises de vues contemporaines, Disturbed Earth fait s’entrechoquer, se mélanger les différentes lignes temporelles, ainsi qu’elles s’entrechoquent et se mélangent, en réalité, dans les esprits et dans le paysage en Bosnie-Herzégovine.
Assez tôt dans le film, une image d’archive tournée par un opérateur de l’armée de la république serbe de Bosnie montre des militaires affairés autour d’un lance-missile : ils tirent. L’image suivante est une contre-plongée sur les cimes d’arbres forestiers, en hiver (l’un d’entre eux est abattu). À en juger par sa qualité, cette image nous est contemporaine mais le missile tiré en 1995 — ou plutôt : quelques secondes auparavant — continue sa route hors-champ : l’impression effroyable qu’il va atteindre sa cible dans un futur proche peut longtemps poursuivre le·a spectateur·rice.
L’ultime séquence est une scène de retrouvailles, au Nouvel an : rituel social, organisé autour de cette scansion majeure du calendrier, autour d’un instant à partager au présent (moyennant le traditionnel compte à rebours auquel on s’adonne tou·te·s ensemble à ce moment-là). Là où elle est placée — au faîte du film, immédiatement après un échantillon de l’inventaire photographique des ossements, vêtements et petits objets personnels exhumés des charniers — cette scène désigne bien l’enjeu, et le problème : il faudrait renouer avec les autres au jour le jour, ne serait-ce qu’un instant, quand chaque seconde le passé est susceptible de ressurgir des profondeurs de la psyché comme de la terre.