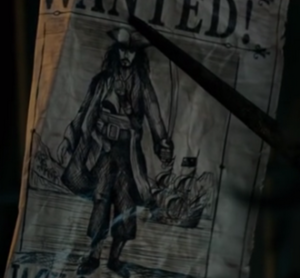F1, Joseph Kosinski
Marche-arrière

Difficile de dire ce qui m’a paru le plus violemment réactionnaire à la vision de F1. D’un côté, la réhabilitation de Brad Pitt en sex-symbol éternel, corps parfaitement réalisé dans sa fougue de vétéran pseudo-révolutionnaire-tatoué-tanné et esprit plein dont l’irresponsabilité envers toutes et tous est dessinée comme l’image même d’une liberté virile. De l’autre, la modélisation de la Formule 1 comme système dont la clôture idéale (le circuit, la saison sportive, les professions hiérarchiquement distribuées, la technologie ergonomique et progressive) se suffit à elle-même, s’auto-générant miraculeusement, imperméable aux remous du monde, écrin de rêve pour l’expression des affects familiaux (c’est-à-dire les affects des membres de l’écurie, c’est-à-dire les affects épurés de l’entreprise). Ce n’est pas pour rien qu’on ne voit jamais un personnage traverser les multiples barrières et sas de sécurité qui permettent d’accéder au circuit ou que la question de la circulation des spectateurs n’est jamais figurée (pensée mélancolique pour les plans de foule en mouvement dans les films de Tony Scott ; une partie desquels appartenaient aux superproductions d’action Bruckheimer dont F1, après Top Gun : Maverick, ponctue une nouvelle ère). Brad Pitt peut bien arriver à l’improviste au Grand Prix qatari avec un jean usé et son baluchon ; on ne quitte jamais vraiment le circuit, rien ne viendra en gripper un seul boulon. On assiste tout simplement, deux heures trente durant, à l’ignominie d’un film d’entreprise, fascinant parce que si lisse, si efficace et creux. L’ère du greenwashing semble dépassée, l’édification grotesque d’une mythologie auto-produite a suffit à remettre des pièces dans la machine pour on ne sait combien de tours. Autre détail entêtant d’hypocrisie : ce film tout entier à la gloire de l’industrie moderne dont le héros de soixante ans, agacé et dédaigneux, somme à son jeune collègue de lâcher son portable.
À vrai dire, inutile de distinguer entre l’horreur de l’un ou de l’autre (le système Brad Pitt ou le système Formule 1) : ce qui m’a sidéré c’est qu’ils avancent de concert, frontalement. La réception critique approbatrice ou pour le moins conciliante n’est, en ce sens, pas un moindre dommage. Il y a bien quelques promesses disséminées ici ou là. Lorsque Pitt et Kerry Condon échangent parce que lui, beauf obtus à souhait, rit bêtement de son usage du vélo à elle, pourtant designer des véhicules à la pointe la plus acérée de la technologie, elle réplique avec assurance « mon travail, c’est le vent ». Un instant, j’ai naïvement espéré assister à un film bachelardien, songeant en sous-main à la vitesse et aux courbes, au dialogue des matériaux graciles et des éléments imprévisibles, raccordant l’ingénierie à un travail de la rêverie sensorielle. Malheureusement ce goût pour le vent semble plutôt être un bref trait de caractérisation, le don d’une féminité légère, intuitive, soufflant dans un sens naturel. Plus tard, Pitt, ce beau-joueur, ce sur-joueur (son rapport transgressif aux règles sportives, aux frontières de l’illicite, donne l’impression qu’il est doté d’un rayon de perception omnisciente qu’il balaie à sa guise sur le circuit – proprement nanardesque), couchera avec elle à la suite d’une partie de poker magistralement conduite puis la délaissera sans heurt aucun. Ce bref dialogue venteux est aussi une façon d’introduire aux visions fétichisées des technologies des laboratoires de conception. Le très lourd cadre des processus décisionnaires, des verrous administrativo-financiers et marketing y est miraculeusement dissous, rendu à la pure force de l’intellect concepteur accouplé à sa machine. On voit comment ce fantasme de la souplesse technologique, que le film érige en principe exclusif d’organisation du travail, peut glisser sans peine vers un désir assumé pour l’industrie de l’armement : merveille des bombes véloces et légères conçues par les ingénieurs américains, n’est-ce-pas. En ce sens, le moment le plus glaçant arrive lorsque Pitt, concluant avec désinvolture une réunion de travail hautement tactique et protocolaire, meugle un sommaire « combat » dans son micro. Conséquence immédiate : l’ensemble de la dizaine des « collaborateurs » de son écurie tapent du poing sur la table en scandant son mantra guerrier. Je crois que c’est un film auquel une lecture paranoïaque s’applique bien.
Il faut attendre deux heures et la course finale pour approcher quelques sensations singulières de sport. Le pacte d’usure limite qui structure le rapport entre le chauffeur et la gomme du pneu y est rendu dans sa longueur harassante, telle une vanité exemplaire (« je t’use, tu me ralenti »). L’autre vision saisissante est celle de deux collègues projetés côte à côte à plus de 300 km/h dans des machines quasiment aimantées l’une à l’autre : on dirait deux météorites sœurs errant dans l’ether ; comment vit-on un métier qui procure ces sensations invraisemblables ? Pour le reste, pas un plan de biais sur le dispositif de la Formule 1, pas une seule vision qu’on ne recevrait avec d’avantage d’acuité en regardant une diffusion de Grand Prix un dimanche.
Quant à son ambition technologique outrancière, le film ne fait jamais preuve que de sa niaiserie esthétique. La difficulté à saisir les latences du sport, son endurance et ses évolutions dramaturgiques pas évidemment discernables est systématiquement résolue dans la précipitation d’un tour de passe-passe. Le personnage de Pitt en est toujours à l’initiative, être solitaire forçant les décisions malgré la désapprobation de ses collègues, leur imposant ses inspirations hermétiques (nette parenté entre cette vision romantique du créateur décisif, isolé dans les hauteurs de son esprit, et la fable de l’auteurisme). Son héroïsme hors-norme est exalté au point où il arrache un extincteur des mains d’un pompier pour secourir lui-même son coéquipier. Grotesque on a dit, déréalisant la moindre situation de course alors même que le film a été tourné lors de vraies compétitions avec leur vrais coureurs et leurs vrais sponsors-investisseurs : la nouvelle ère Bruckheimer est celle d’un hyperréalisme glauque. Lorsqu’il s’agit de quitter les postures et de se dévoiler on comprend que, pour l’acteur comme pour le personnage, les choses se corsent. D’où le plaisir pris devant ce long plan de confession de trois quart, où Pitt, se livrant à voix basse, ressemble enfin à quelque chose de concret : un vieux singe franchement paumé, happé par le mutisme, pour qui aligner plus de deux phrases n’a rien de simple. C’est assez beau et désastabilisant relativement au tapis rhétorique que lui déroule le reste du film : ressassement de réparties ironiques, groupes nominaux pseudo-cool bredouillés dans sa mâchoire, rires de couillon, façon de s’adresser aux autres à l’abri d’une couche isolante de quelques mètres lui donnant l’alibi d’un échange, alors qu’il hèle au vent sa virilité en perdition. Exit l’argent, le succès, exit la notoriété, sa grande quête serait de vivre une expérience mystique, de « s’envoler ». Pourtant quelle nausée lorsque, éructant après sa victoire finale, ce vieux mec oscillant abstraitement entre la crasse du loubard et le chic côte d’azur éructe à son pote « on est les meilleurs du monde ».

Scénario : Ehren Kruger, Joseph Kosinski / Image : Claudio Miranda / Montage : Stephen Mirrione / Musique : Hans Zimmer
Durée : 2h35.
Sortie française le 25 juin 2025.