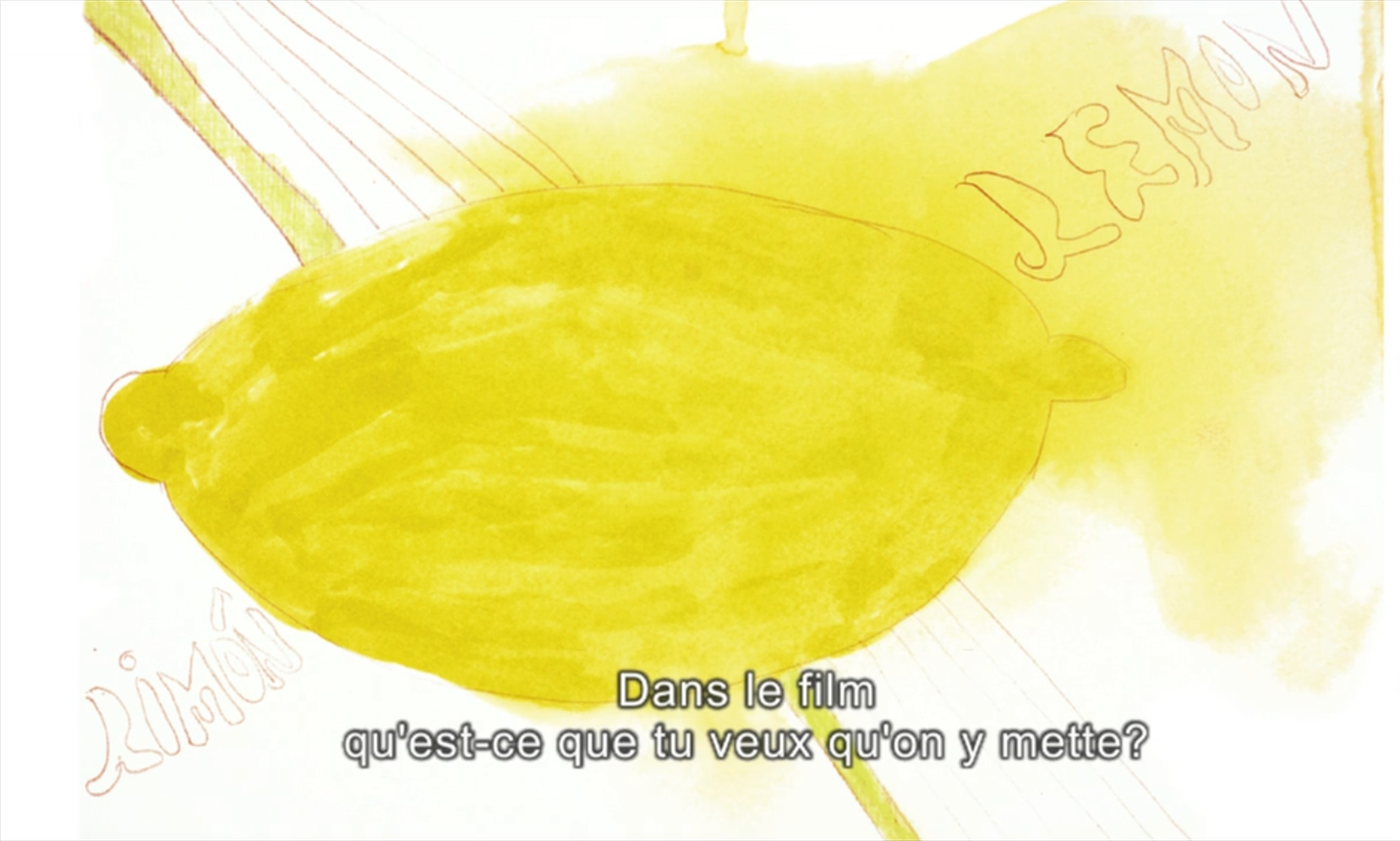Festival du film d’art singulier, 2016
« Tous marteaux »
Chaque année, l’association Hors-champ constitue un échantillon de films liés au domaine de l’art brut, singulier et/ou outsider, qu’elle met à l’honneur à l’occasion d’un festival niçois, à la fin du printemps. Mais quel principe pourrait bien présider à la programmation de ces Rencontres du film d’art singulier ? À l’évidence, il ne s’agit pas d’une sélection des derniers « bons » films sur l’art brut et singulier, d’un point de vue de spécialiste accrédité. Tout d’abord, les films ici programmés sont parfois inactuels – et dès 1997, la première édition du festival revenait sur Petit Pierre d’Emmanuel Clot, qui avait obtenu le César du meilleur court-métrage documentaire en 1980[11][11] Emmanuel Clot fut l’assistant de Wim Wenders (L’ami américain), François Truffaut (La chambre verte, L’Amour en fuite) et Maurice Pialat (Passe ton bac d’abord), en 1977 et 1978. Petit Pierre, qui porte sur le manège de Pierre Avezard aujourd’hui visible dans le parc de La Fabuloserie à Dicy, est le premier de ses trois courts métrages. Emmanuel Clot est mort en 1983, à l’âge de trente-et-un ans, à la suite d’un accident de voiture.. Ensuite, ces films ne sont pas tous réalisés pour être projetés sur grand écran (ainsi qu’ils le sont pourtant lors de ces Rencontres), mais parfois pour une diffusion télévisuelle, voire, pour les plus récents, en vue d’être déposés sur les plate-formes de partage vidéo en ligne : autre intérêt de cet événement, que de défier les frontières du « cinéma » au sens strict[22][22] Entendu au sens de Raymond Bellour, le cinéma est fermement lié à l’expérience de la projection en salle (grand écran, obscurité), aux conditions de perception et de mémoire bien spécifiques de ce spectacle. Plus loin, Raymond Bellour précise encore : « Une chose est sûre : le cinéma vivra tant qu’il y aura des films produits pour être projetés ou montrés en salle » (nous soulignons). La perspective de tel ou tel mode de diffusion joue (économiquement, esthétiquement) en amont, au moment de la production des images ; et s’il caractérise ce qui « seul vaut d’être appelé cinéma », le dispositif particulier de la salle engage aussi un ensemble de formes et de structures filmiques particulières au cinéma. Raymond Bellour, La querelle des dispositifs. Cinéma – Installation, expositions, P.O.L., 2012. pour attirer l’attention sur les multiples usages que notre société réserve à l’image animée, partant d’un sujet particulier (l’art brut, singulier, outsider). Enfin, il n’y a aucun systématisme apparent dans la déclinaison du « corpus » que pointe ainsi l’événement, ni dans sa mise en perspective historique. Cet ensemble paraît, au contraire, toujours plus éclectique, plus dispersé, plus tumultueux, à mesure qu’il s’enrichit. Quant à la qualité des films en question, d’aucuns la trouveraient « irrégulière » ; disons-la plutôt sans commune mesure. Les films ici projetés sont sur ce plan littéralement incomparables. Il n’est d’ailleurs pas question de clore le festival du film d’art singulier sur quelque palmarès que ce soit ; pris dans ces assortiments piqués de bizarreries, si peu conventionnels au regard du substrat festivalier qui fait couler nos encres d’une saison sur l’autre, chaque film joue, simplement, sa partition.
Cette programmation, d’une extravagance consciencieuse, ouvertement problématique si ce n’est formellement conflictuelle, doit bien davantage à quelque esthétique du choc qu’au principe traditionnel de la sélection selon des critères qui d’ailleurs, devraient toujours poser problème au regard critique – tant l’ordre des discours sur le cinéma, en reposant sur l’incontestable clairvoyance des comités de sélections conventionnés, expose aussi le critique au risque de l’engourdissement nonchalant. Le « choc », dont l’idée s’avance chez Walter Benjamin dans les années 1930[33][33] Voir notamment : Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’ère de sa reproduction mécanisée, in Ecrits français, Gallimard, 1991, p. 166 : « En fait, le processus d’association de celui qui contemple ces images est aussitôt interrompu par leurs transformations. C’est ce qui constitue le choc traumatisant du film qui, comme tout traumatisme, demande à être amorti par une attention soutenue. Par son mécanisme même, le film a rendu leur caractère physique aux traumatismes moraux pratiqués par le dadaïsme. », parallèlement à celle de la perte de l’ « aura » des oeuvres d’art, en appelle à la proximité d’éléments rétifs les uns aux autres. Il se réclame de Dada, comme de l’art cinématographique, du montage, de la mise en contact ; il invoque la catégorie du tactile dans la perception optique. Il maintient le spectateur distrait en éveil – si ce n’est en situation d’inconfort. Aussi, lorsqu’après l’ouverture du festival de Nice, les bandes-annonces que Guy Brunet a réalisées pour présenter ses long-métrages dans un cadre muséal succèdent à la projection d’une production ludo-didactique récente sur le Palais idéal du Facteur Cheval, les aspects distinctifs des films ainsi mis en contact se hérissent autour de leur (seul) point commun (leur relation promotionnelle à un élément extérieur). C’est autour de tels à-coups que le jugement se trouve comme suspendu, que des problèmes de cinéma (au demeurant basiques, et parfaitement transversaux : contexte de production, de réception, point de vue, rapport son-image, hors-champ, etc.) ressurgissent, eux qui se calfeutrent sans peine entre nos certitudes critiques lorsque nous appréhendons les films comme autant de totalités autosuffisantes. Quant au titre (« Tous marteaux ») de cette 19ème édition du festival, sous ses airs de boutade en référence à la « folie » des artistes bruts et singuliers, il évoque aussi l’idée du choc dans sa forme la plus concrète : la percussion de l’outil contre la matière, dont les résonances portent bien au-delà de l’ouvrage lui-même.
Au reste, ces 19èmes Rencontres du film d’art singulier nous auront semblé éminemment… « sonores ». Non qu’elles aient fait beaucoup de bruit, non que l’on y fût vociférant, mais comme l’an dernier, l’événement s’est paré d’une robe de voix différentes, venues des films eux-mêmes ou s’élevant dans la salle, à la faveur des discussions lancées autour d’eux. Aussi notre compte-rendu s’attachera-t-il à décrire quelques paroles, quelques corps sonores ici rencontrés – à califourchon sur les limites du cadre.
Chuchotements, murmures, exclamations se faisaient entendre en marge des films, depuis les fauteuils des auditoriums de la bibliothèque Louis Nucera puis du MAMAC (musée d’art moderne et d’art contemporain de Nice) : voix de connaisseurs, d’amateurs ou de curieux, stupéfaites, admiratives et parfois contredisantes. Pour compléter l’enchevêtrement de ces voix autour de l’écran, celle du comédien Paul Laurent assis parmi les spectateurs, a plusieurs fois retenti entre les projections, lisant des extraits choisis (non sans sagacité) de la correspondance entre Jean Dubuffet et Gaston Chaissac[44][44] Gaston Chaissac est un peintre et sculpteur autodidacte né à Avallon (Yonne). Installé en Vendée, à partir de 1942, il se consacre entièrement à la peinture et à la sculpture et correspond régulièrement avec Jean Paulhan, Raymond Quéneau et Jean Dubuffet. Dubuffet écartera plus tard Gaston Chaissac de la catégorie de l’ « art brut », en raison de la reconnaissance de son travail dans les milieux artistiques (dans les années 1960), malgré l’isolement social et la santé extrêmement fragile de l’artiste. : ces derniers s’adressaient l’un à l’autre comme deux homologues, égaux vis-à-vis de l’art véritable, fût-ce pour exprimer leurs profonds désaccords. Au long de ces pourparlers se martelait, sous-jacente, l’idée que l’art brut et l’art singulier, qu’ils soient envisagés ensemble ou fermement distingués l’un de l’autre, ne sauraient être des domaines de consensus ; et le cinéma de n’y rien arranger, en s’ingérant de leurs affaires.
C’est surtout à la participation des artistes en présence que les débats doivent une grande part de leur tenue : le cinéaste Guy Brunet que nous évoquions en amont, la plasticienne Jo Guichou venue se joindre au public du festival, les peintres et sculpteurs Marie Jakobovitsz et Pierre Prévost auxquels deux films étaient consacrés… Leurs paroles ont plusieurs fois aiguillé, parfois recentré les discussions ; outre la notoire modestie de ton qui caractérise le champ de l’art singulier, la clarté, la justesse de leurs interventions furent souvent décisives, s’agissant de leurs pratiques, de l’art en général et de son inscription dans l’espace social. Leurs voix pouvaient enfin répondre à leur « double », dans les films qui leur sont consacrés, ou dont ils sont les auteurs (nous présenterons plus longuement le cinéaste Guy Brunet par la suite).
Cette multitude voisée de spectateurs se trouvait répondre, en somme, à l’essaim des corps sonores qui faisaient la matière des films programmés. Parmi ces corps, ceux de Jarvis Cocker, chanteur britannique du groupe Pulp, puis de John Zorn, saxophoniste et compositeur américain, témoignaient à l’écran d’une sympathie entre le milieu des musiques actuelles et le domaine de l’ « outsider art », dans le monde anglo-saxon. Jarvis Cocker, dans son périple entre les environnements singuliers en Europe et aux Etats-Unis, fait le cœur énonciatif d’un reportage télévisé composés de trois épisodes (Journeys into the Outside with Jarvis Cocker) ; dédoublée (à la fois in et off), sa voix cerne les images et la parole des artistes recueillies en chemin. John Zorn intervient quant à lui suivant les modalités de l’entretien audiovisuel classique dans Family found – un documentaire de Emily Harris sur Morton Bartlett[55][55] Morton Bartlett modèle des poupées à partir de 1936 et les photographie dans le plus grand secret, dans son appartement à Boston, en marge de ses diverses activités professionnelles. Il les démembrera en 1965 et les cachera dans des coffrets fabriqués sur mesure, peu après la parution d’un premier article sur ce travail dans la presse. et ses poupées photographiées – dont il a par ailleurs composé la musique originale (des vocalises cristallines, que l’on associe aux « enfants imaginaires » de Morton Bartlett). Ni l’un ni l’autre de ces musiciens n’est donc vu en train de pratiquer son art dans les films en question. Mais dans ce rapport changé à l’élément phonique, chacun s’assure un supplément d’autorité sur – et par – le film.
Voix rôdeuses
Deux autres films, parmi ceux que le festival permettait de (re)découvrir cette année, font jouer l’articulation des voix et des images. Leur lien avec le secteur du son s’affirme moins nettement (ils ne font intervenir aucun musicien à l’image), ils en appellent à des « corps sonores » moins avérés, moins saisissables, plus évanescents dans leurs manifestions. Ils ont en commun de se rattacher à la psychothérapie institutionnelle.
Eugenia Mumenthaler et David Epiney ont réalisé un très beau court-métrage, plusieurs fois récompensé depuis sa première projection aux Visions du Réel de Nyon (2007) : Le printemps de Saint Ponç. Dans le prolongement d’un atelier d’arts plastiques au foyer d’accueil pour personnes handicapées El Rusc (Catalogne), sa réalisation a supposé la combinaison d’éléments décousus : des dessins réalisés par les participants de l’atelier, des paroles et conversations recueillies sur place, quelques plans vides tournés dans et autour de l’institution, quelques mesures musicales et autres menus bruits (frottements de mines sur papier, soupirs…). Par l’emploi des procédés de l’animation, du montage, de la surimpression, Eugenia Mumenthaler et David Epiney ont recomposé une continuité hybride et subtile qui, sur tout son long, transgresse mille formes de contour ou de limites préposées. Frontières et cadres ne s’y donnent jamais que pour être dépassés, qu’ils soient strictement plastiques (les composantes graphiques glissent allègrement d’un dessin à l’autre et l’image se métamorphose dans son mouvement ininterrompu, sans recours au raccord classique…), ou à caractère sociétal (propos sur l’amour en deçà de l’institution du mariage, etc.). Les auteurs des dessins n’apparaissent, à l’écran, que par l’entremise de quelques portraits des uns par les autres ; mais leurs paroles constituent l’essentiel de la bande son. La relation audio-visuelle chavire incessamment, entre l’accompagnement, le commentaire, l’illustration, l’interférence, l’inspiration ; les voix et les images semblent se générer mutuellement, indéfiniment, et hors de toute structure de subordination.
Un petit film de six minutes, tourné en 2011 lors de l’accrochage intitulé Exploratoire(s) dans les salles du LaM, était programmé plus tard au cours du festival. Il porte un « message » du Dr Jean Oury, à propos de l’artiste Jean Launay, dessinateur pour Fluide Glacial puis résident à l’hôpital de La Borde, dont quelques œuvres étaient exposées à l’occasion de cet accrochage. La caméra circule dans le bureau du psychiatre, entre bibliothèques et petit mobilier, parmi tout un bric-à-brac oscillant de l’archive à l’accessoire décoratif – en passant bien par quelques œuvres plastiques, mais sans jamais se fixer sur d’elles. La parole de Jean Oury, toute ponctuée, marquée des inflexions tonales qui la rende reconnaissable entre toutes, demeure sans origine visible jusqu’à ce que ce dernier entre dans le champ au hasard d’un dernier panoramique, assis à son bureau ; cette voix, que l’on ne saurait dire off tant elle ne force aucune image, reste émise « hors du spectacle de la bouche » – pour reprendre la formule de Serge Daney[66][66] Serge DANEY, « L’Orgue et l’aspirateur (La voix off et quelques autres) », in Cahiers du cinéma n° 279-280, Aout-Septembre 1977, pp. 19-27.. Au fil du parcours de l’objectif, l’origine fantasmatique de la parole serpente entre les meubles, les livres, les objets, jusqu’à la pointe du stylo de Jean Oury ; cette voix est intérieure, par bien des aspects, profonde ; plutôt que d’ « œuvre », dit-elle enfin, il faudrait « parler de quelque chose qui n’en finit pas ». Quant à ce qui, au juste, « n’en finit pas », il faut s’en remettre au silence qui s’ouvre (puisque rien ne se referme alors) autour de nous, sur ces derniers mots du film.
L’invisible au cinéma (qui compte la salle de projection et les spectateurs suspendus, en ce point d’orgue, aux dires de Jean Oury), n’est pas monovalent ; d’où que ses voix afférentes sont volontiers rôdeuses, ondoyantes dans les relations spatiales et temporelles qu’elles entretiennent avec l’image, telles que les deux films évoqués ci-dessus nous les donnent à entendre. Ici la catégorie de « off » (par opposition au « in ») est insuffisante, et l’éventail des statuts de la voix au cinéma peut s’élargir, ainsi que l’écrivait Serge Daney en 1977, autour du film de Robert Bresson, Le Diable Probablement. Cette dé-classification des voix s’inscrivait d’ailleurs dans la perspective d’une « théorie des objets perdus » : de ceux qui sont définitivement perdus pour l’oeil, interdits, irreprésentables, à ceux qui sont provisoirement perdus, « soumis au battement bien connu du fort et du da, attachés à la métaphore mercière de la bobine de fil, susceptibles d’un éternel retour ». Or, les « œuvres » dont parle Jean Oury dans le film de 2011, ces objets qui font la substance de l’art brut depuis son invention en 1945, participent de ces « objets perdus » : elles sont créées, collectées ou non, oubliées pour toujours ou pour un temps, parfois remises en lumière… Leurs glissements entre le visible et l’invisible, au long de ces histoires institutionnelles complexes qui les désignent à l’occasion comme des « œuvres » (comme au long d’un mouvement de caméra qui fait jouer la ligne de partage entre le champ et le hors-champ), pourraient être, en somme, de ce qui précisément « n’en finit pas » : de ce dont il faudrait parler, entre autres choses. Ces objets sont aussi l’origine d’une parole possible, et tout en travaillant ses relations entre les sons (bruits de crayons, paroles…) et les images, Le printemps de St Ponç fait bien, au passage, objets sonores des dessins filmés-animés.
Guy Brunet
Dans la grande polyphonie de ce festival, nous tenions enfin à isoler la voix de Guy Brunet, le cinéaste aveyronnais programmé à l’occasion des Rencontres du film d’art singulier depuis douze ans. Cette année, l’événement s’est achevé avec la projection de son dernier film, Un américain à Nice, sur les studios de la Victorine[77][77] Créés dans le quartier ouest de Nice en 1919, les studios de la Victorine (aujourd’hui Studios Riviera) comptent parmi les studios de production français les plus importants de l’histoire du cinéma. Entre autres, ils accueillirent le tournage de Jeux Interdits de René Clément, de Mon oncle de Jacques Tati, de La nuit américaine de François Truffaut, de La baie des anges de Jacques Demy… . Il y est question de plusieurs films tournés en ces lieux, depuis Ignace (Pierre Colombier, 1937) avec Fernandel, jusque Mademoiselle Ange (Géza von Radványi, 1959) avec Romy Shneider, en passant par Et Dieu créa la femme de Roger Vadim (1956) et Les Enfants du Paradis de Marcel Carné (1945). Le film se présente comme une comédie documentaire, animée par Denise Fabre, que l’on voit à écran recueillir les témoignages de célébrités autour de cette sélection filmographique. Les personnages sont incarnés, à l’écran, par des silhouettes peintes de Guy Brunet.
L’œuvre de Guy Brunet, telle qu’exposée dans différents musées aujourd’hui, consiste principalement en des synopsis illustrés, des affiches de cinéma qu’il conçoit à partir de grands films des années 1930 à 1960, et ces « silhouettes » (au nombre de 800 environ) d’un mètre quarante de hauteur, à l’effigie d’autant de vedettes cinématographiques et télévisuelles. Mais, ainsi qu’il le rappelle d’ailleurs régulièrement, Guy Brunet est d’abord cinéaste, auteur d’une quinzaine de films (fictions et docudrames) rattachés à l’histoire de la télévision et du cinéma classique, pour lesquels il déploie un travail remarquable depuis 2001 : il en écrit le scénario, le découpage, et les dialogues, imagine et construit leurs décors, en assure le tournage et la production… leur réalisation suppose notamment qu’il donne vie aux aux personnages qu’incarnent ses « silhouettes », en leur prêtant sa voix.
Cette voix fait montre de qualités notables, au demeurant. C’est une voix naturelle de poitrine, sonnante, pleine et posée. Guy Brunet utilise des expressions châtiées, il respecte les inversions syntaxiques propre au langage soutenu, que se soit au nom de ses personnages (des célébrités de l’entre-deux guerres et de l’après-guerre) ou en son nom propre – s’agissant de présenter ses films puis de répondre aux questions des spectateurs. Son « flot » ressemble à celui des orateurs radiophoniques et télévisuels qui ont bercé son enfance (années 1950). Et si son amplitude n’est pas immense, elle présente une subtile ductilité ; tandis que les personnages se passent la parole, un fond d’espièglerie la sous-tend toujours, ainsi que l’accent du Languedoc-Roussillon qui la colore continûment. Cette parole est, enfin, particulièrement érudite en matière d’histoire du cinéma français et américain et d’histoire de la télévision (notamment sur la période allant de 1930 aux années 1960-1970).
Voici donc une voix bien « vagabonde », en dépit de son ancrage physique solide, de ses constantes tonales, et de ses sérieuses assises culturelles : elle glisse de la salle aux films, du visible à l’invisible, d’un personnage à l’autre ; entre les fonctions didactiques qu’elle assure volontiers, et l’emphase qui l’emporte parfois, ses nuances hâbleuses en font comme un incessant moiré. Ici encore, nul statut univoque ne saurait lui être attribué vis-à-vis de ce que l’écran livre au regard (les silhouettes peintes). Cette voix pourrait tantôt être assignée à un corps réel (quoiqu’invisible) pris dans la situation du tournage, lecteur infatigable de ses scénarii aux côtés de ses « acteurs », tantôt aux personnages des films, pour qui se laisse happer par ces fictions documentées, tantôt à l’auteur cinématographique, retranché dans son espace hétérogène et souverain.
L’imaginaire que réactive le cinéma de Guy Brunet est bien plus large qu’il n’y paraît, et l’influence de l’âge d’or du cinéma classique, bien que revendiqué par l’auteur, ne suffit pas à en rendre compte. Outre cette référence historique explicite, c’est son langage cinématographique qui, pour aller dans le sens d’une certaine frontalité du spectacle, lui fait paradoxalement gagner un certain « relief » culturel : au gré de discrets panoramiques, les silhouettes bariolées se déplacent à l’écran telles les plaques d’une lanterne magique ; les méthodes bricoleuses que Guy Brunet met en œuvre pour obtenir ses effets de filigranes et autres scintillements lumineux évoquent aussi la manière des fantasmagories du XIXème siècle ; son découpage (par tableaux) est plus proche de celui d’un Ferdinand Zecca des années 1900 que de celui d’un Vincente Minnelli des années 1950 ; quant à sa voix, élément fondamental du spectacle, elle s’apparente aussi à celle d’un bonimenteur – et ce d’autant plus qu’il peut être présent dans la salle, auprès de ses spectateurs.
Par-delà la bi-dimensionalité matérielle des éléments filmés (décors et silhouettes), le cinéma de Guy Brunet présente donc ce volume historique : l’expérience de la projection de ses films en salle, en sa présence, renoue avec les structures spectaculaires et les modes de représentations dites « primitives » (hérités du XIXème), tout autant qu’avec l’âge d’or du cinéma de studio et ses premiers rapports avec la télévision. Et si, pour retrouver, dit-il, l’enchantement originel du spectacle cinématographique, Guy Brunet court-circuite les cinquante dernières années de l’histoire du cinéma et des images (nouvelles vagues et référentiel « post-moderne » inclus), son choix participe de la combinatoire dont se réclame son travail. Car l’invention consiste bien ici, en un agencement particulier d’éléments disparates, empruntés à des appareils hétérogènes et historiquement distants (télévision, cinéma, fantasmagorie)… À ceci tient d’ailleurs sa pertinence en dépit de son anachronisme apparent, aujourd’hui, tandis que les écrans se multiplient, que gronde la « querelle des dispositifs » et que l’on attend toujours du cinéma qu’il nous parle, dans le tumulte.