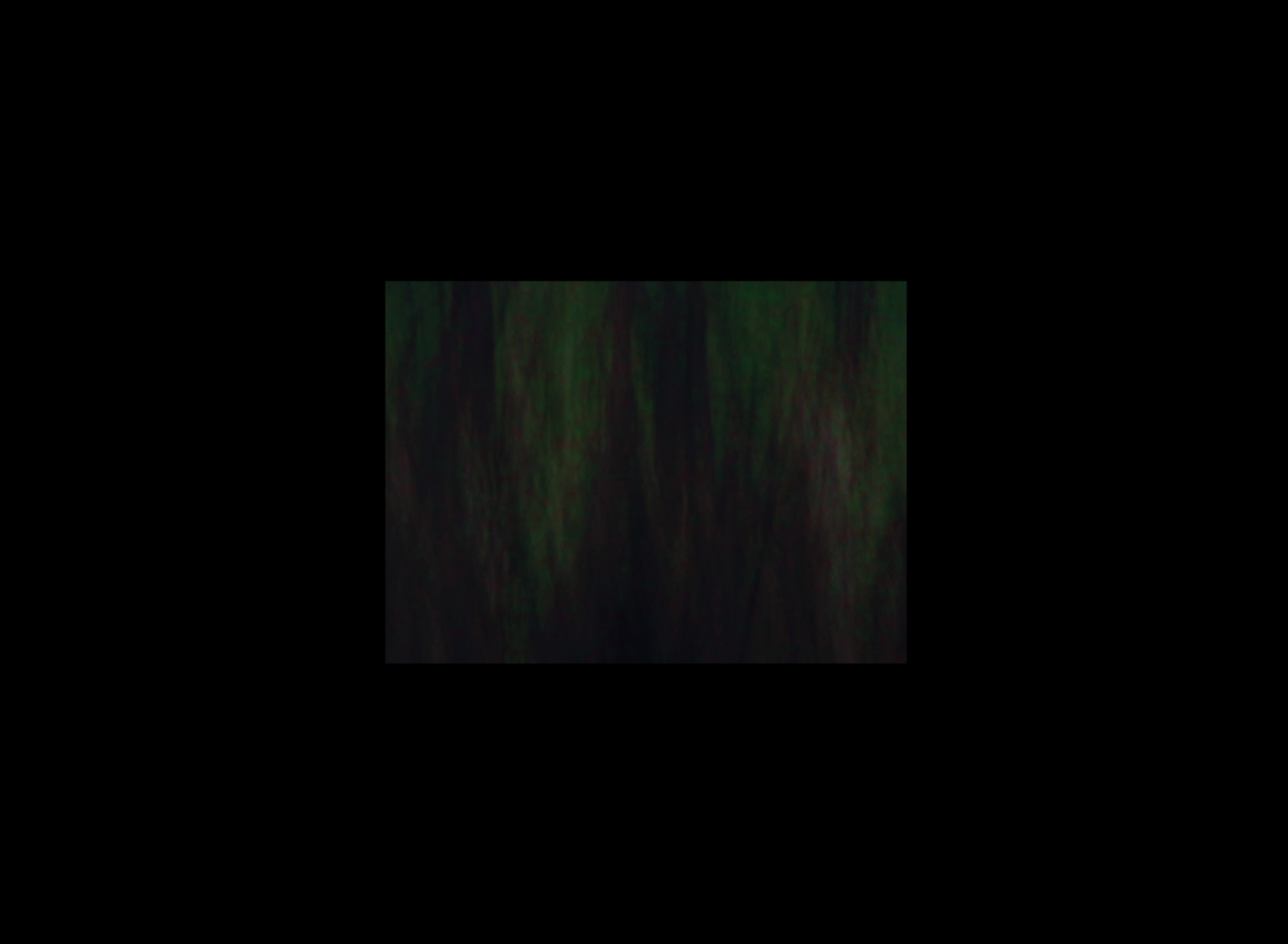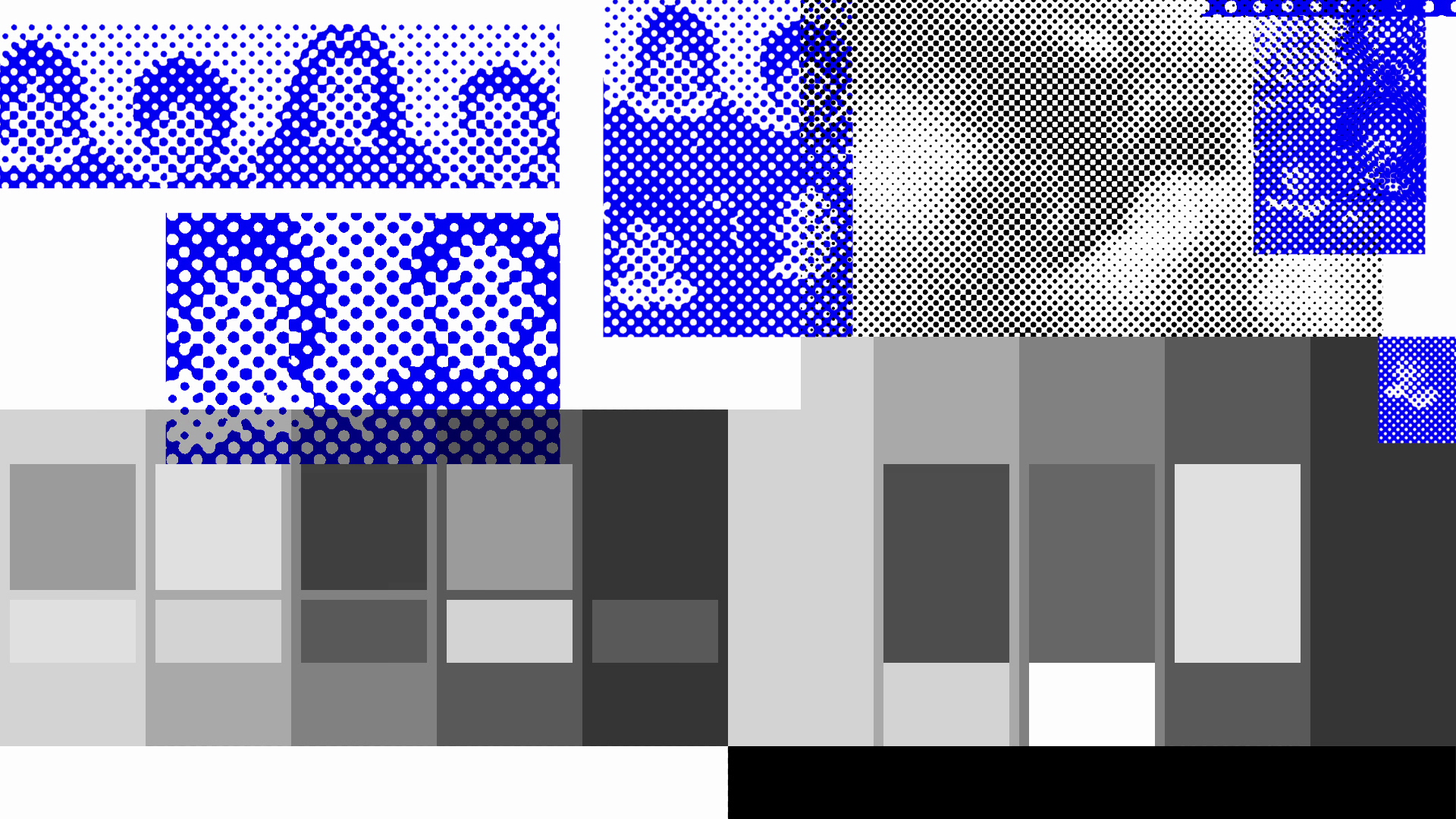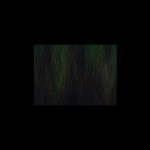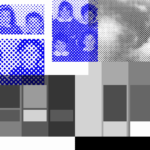Fragments & manifestations
Sur G de Ignazio Fabio Mazzola
Des différentes branches identifiables qui structurent le maillage cinématographique d’Ignazio Fabio Mazzola – qui s’est beaucoup adonné aussi aux portraits d’artistes ou aux essais courts sur l’architecture (par exemple sur les travaux achevés et inachevés de Maurizio Sacripanti) – les fragments autobiographiques nous réservent un mystère bien particulier. Ils composent les restes troubles d’une existence, les pages échouées d’une expérience particulière, se présentant, comme tant d’autres structures dans les films d’IFM, sur le modèle de la ruine, ou du schéma.
Cette ossature intime et morcelée, cette vie imaginée à laquelle ces fragments du monde nous donnent accès, nous invitent à une archéologie semblable à celle que l’on engage face aux éclats de plans et de bâtiments qui parcourent les films d’Ignazio Fabio Mazzola. Ces œuvres, souvent éphémères (certaines durant moins d’une minute), se fondent en un sens sur un phénomène d’impression, où les courts événements lumineux, et les espaces vides qu’ils nous offrent, convoquent, éveillent et valorisent notre capacité à sentir et à discerner. Ce n’est pas tant là un jeu de déduction que d’écoute des plus simples signaux, des plus modestes manifestations et de ce qu’elles révèlent. Tant d’incursions soudaines dans le monde du sensible et de la vision.
G, présenté en ce moment à la 58e édition de la Mostra internazionale del Nuovo Cinema, à Pesaro, engage d’une manière renouvelée ce rapport à l’impression, propre au cinéma d’IFM. Sa durée de 18 minutes traduit déjà ce déplacement. En proposant une œuvre plus longue et plus méditative, l’endroit de l’impression se décale. Elle n’est plus tant rétinienne que mémorielle, sentimentale, nourrie par nos mouvements intérieurs : sujette à l’empreinte simple et profonde de quelques vues statiques d’un monde mouvant, où l’eau du lac ce raccorde à elle-même sous les sons environnants des oiseaux et du vent. Sans doute les mêmes ressorts sont encore à l’œuvre, tant les films d’Ignazio Fabio Mazzola engagent notre corps et notre subjectivité ; mais l’inspiration des événements qui se profilent à l’image et sur la piste sonore prend, par ces minutes denses à fixer la rive, une teneur toute différente, et peut être plus complexe.
Il fallait sans doute un dispositif esthétique plus ample pour empreindre l’image d’un sentiment si singulier : celui de la paix retrouvée loin du chahut des villes et de la présence paternelle enfouie sous les âges écoulés depuis les premières escapades pour se rendre au lac, réapparaissant le temps de pensées fugitives. Lointaines sont les villes et les bâtisses morcelées qui convoquent l’agitation et la frénésie habituelles aux films de Mazzola. Ce paysage obstinant appelle des émois plus lents et labiles. Il invite ces vagues intuitions qui traversent parfois un cœur le temps d’une seconde ou deux.
Cette exploration du fragile et de l’introspectif est intensifiée par quelques cuts, alimentée par les choix de réalisation d’Ignazio Fabio Mazzola : l’angle de sa caméra, le miroitement trouble de l’eau et les émanations spectrales de la MiniDV. Si la surface du lac n’est pas animée par de vifs éclats solaires, c’est qu’elle n’est pas tant un miroir qu’un écran, une toile tendue, mouvante.
Quand on a longuement filmé les rives et les cours d’eau, il nous vient naturellement de percevoir combien cette relation esthétique aux paysages lacustres et fluviaux est singulière et proprement cinématographique. Tout comme au cinéma, il y a l’espace du regard (d’où gît ce reflet mystique dans L’esprit de la ruche) et l’espace du corps, esseulé, dont les agitations nerveuses et la mémoire viennent accoucher d’un terrain intérieur, où se rencontrent les flux visuels et perceptifs et les flux intérieurs, du corps et de la pensée.
Tout comme les rares traces vivantes de nos souvenirs nous aident à faire sursauter nos cœurs et nos mémoires, ces modestes phénomènes suffisent à suggérer la figure fantomatique qui habite le geste de ce film et qui transparaît déjà dans les changements de plans et de lumière, dans les plus simples mouvements de l’eau et à travers les vapeurs d’insectes qui habitent sa surface. Cette figure n’est pas forcément propre à IFM. Comme nous le montre l’apparition du titre en fin de film seulement, l’émotion et l’interprétation sont laissées tout du long ouvertes, subjectives… La projection est le lieu d’une impression relative et partagée. L’irrésolution du titre (que l’on pourrait imaginer être la lettre initiale d’un prénom cher) et le contexte du synopsis (évoquant ce lac, son père qui l’y amena et sans lequel il y retourne) laissent à l’état d’indice la vie, les détails et souvenirs particuliers d’Ignazio Fabio Mazzola : suffisamment pour y comprendre un geste et l’habiter de notre propre expérience, de nos propres sentiments.
Une fois de plus nous venons capturer le feux de ces lumières éphémères, de ces phénomènes sitôt repartis, et l’alphabet latin, à nouveau renvoyé à l’état de rune ou de simples symboles, nous invite à croire que l’irrésolution manifeste du cinéma d’Ignazio Fabio Mazzola a trouvé ainsi d’autres formes de complétude, dans un art nouvellement activé des trames et du fragment. G, n’est probablement pas un film sur la nature, si tant est qu’elle existe. C’est un contrepoint à la ville : une contreforme pareillement habitée, semblablement sujette à l’ère de nos troubles métamorphoses. Cette agitation est sans doute ce qui convoque les formes actuelles du cinéma d’Ignazio Fabio Mazzola.
« Dans la ville, et à travers la consommation de masse, nous avons appris à gérer un tourbillon de paroles et de signes. Nous avons appris à composer avec l’incohérence des signes les “collages” de la post-modernité. […] C’est dans ce terrain vague et ses repères hétéroclites, ses graffiti et ses tags que nous apprenons à nouer des communications spectrales. »
Marc Guillaume dans l’ouvrage Figures de l’altérité, (1994, Descartes & Cie), en conversation avec Jean Baudrillard