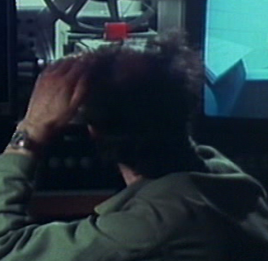Gilles Perret (2022)
Bande organisée
Il y a dix ans, à l’occasion de la sortie de De mémoires d’ouvriers, nous rencontrions Gilles Perret pour faire le point sur son œuvre documentaire, qui se caractérisait déjà par sa cohérence militante et son ancrage régional. D’autres discussions ont suivi, dont l’une consécutive à sa collaboration avec François Ruffin. Avec le député Insoumis, le documentariste marquait une inflexion sensible : d’une filmographie largement consacrée à l’héritage et à la transmission des combats du passé (la Résistance, le CNR, la Sécu, la culture ouvrière), Perret tournait sa caméra sur les colères du présent. La collaboration débouchait sur deux films singuliers et importants. Le duo se rendait sur les ronds-points, dans les hôpitaux ou chez les gens, pour faire entendre une parole inaudible et composer un regard précieux et original, sur le mouvement des Gilets jaunes puis sur les métiers du soin. Dans le même temps, les deux films, portés par un idéal d’agit-prop, prenaient place dans une stratégie politique plus large, réinvestissant la salle de cinéma comme agora, comme lieu d’échanges et de débats.
Reprise en main était donc l’occasion de reprendre des nouvelles de Gilles Perret, et de poursuivre la réflexion sur la visibilité des classes laborieuses, la fonction des images dans l’opposition entre capital et travail ou la compréhension des mécanismes de la finance internationale. D’autant que le film dialogue ainsi avec les moments précédents de l’œuvre de Perret : situé dans la Vallée de l’Arve et l’industrie du décolletage, comme Ma Mondialisation, on y suit des personnages de classes moyennes, a priori éloignés de tout engagement politique, qui vont se découvrir une dignité insoupçonnée en menant un combat épique pour sauver (et par là-même s’approprier) leur entreprise. L’entretien était donc aussi l’occasion d’interroger les différences d’écriture, de mise en scène ou de production qu’implique un tel passage à la fiction, marqué par une ambition assez atypique dans le paysage français : une comédie populaire et politique dans le monde du travail.
Débordements : L’une des réussites du film tient dans la manière dont les personnages sont écrits. Les rapports de production y contaminent tous les autres rapports sociaux. Le travail infuse dans toutes les sphères de la société : l’amitié, la famille, les loisirs. C’est une réalité finalement assez rare dans le cinéma de fiction. Cette préoccupation était-elle présente dès le début ? Comment avez-vous mené ce travail d’écriture ?
Gilles Perret : Le film est co-écrit avec ma compagne, Marion Richoux, qui produisait De mémoires d’ouvriers (2011). Et ce que vous avez vu dans le film, c’est ma vie. Mes parents travaillaient dans ces usines de décolletage quand ils étaient jeunes ; moi, j’y ai travaillé (à l’origine j’ai un diplôme d’ingénieur), et notamment dans l’usine où on a filmé, où j’ai installé des machines automatiques au début de ma carrière professionnelle, avant de bifurquer. Cette vallée je la connais bien : j’étais au lycée là-bas, j’ai grimpé sur la falaise, bu des coups dans les bistrots… Le film a été écrit à partir de toutes ces expériences, avec la ferme volonté d’être le plus réaliste possible. On a essayé de travailler ces ambiances de famille, de copains, pour que cela sonne juste. Et la réalité de cette vallée, c’est que le monde du travail est très présent : on est dans une région où la « valeur travail » est fondamentale, où on est beaucoup jugé par rapport à ça. Et cette industrie du décolletage, qui est relativement méconnue, fait vivre énormément de monde. Cette activité rythme la vie de la vallée, et comme on passe quand même un tiers de notre vie au boulot, tout le monde ou presque là-bas a un lien avec le décolletage. Donc c’est très imprégné dans les discussions, dans les façons d’être, et aussi dans quelque chose qui est moins présent ailleurs : des classes sociales qui se mélangent. Quand tu vas boire une bière le jeudi ou le vendredi soir au Bobby Bar – le bistrot du film –, tu croises des gens qui sortent du boulot en habit de travail comme des commerciaux ou des patrons de petites boîtes, parce qu’il y a beaucoup de PME. Nous, au lycée, on se mélangeait entre fils d’ouvriers, fils de patrons – ou filles, mais on était plutôt des garçons. Donc on a essayé de montrer ça : cette vallée où tout le monde se connaît, où tout le monde sait qui est qui, sans forcément se côtoyer. Et puis il y a une autre dimension : la montagne, qui est très présente dans l’état d’esprit des gens.
Quant à la relative absence du travail dans la fiction cinématographique, je suis le premier à la déplorer. Le monde du travail a déserté les écrans, pour deux raisons selon moi : premièrement, et ça c’est plutôt à mettre au crédit d’autres cinéastes, c’est que le monde du travail est difficile à filmer – pour des raisons de sécurité, de confidentialité, de communication… Rentrer dans une boîte aujourd’hui est devenu très compliqué. Et deuxièmement, le monde du cinéma n’a pas d’intérêt pour la question, par méconnaissance et par origine sociale. À la limite, on aime bien aller filmer le monde du travail parce que ça fait un beau décor, mais justement ça reste du décor, ça ne vit pas. Moi, ça me touche parce que c’est mon histoire et que j’ai grandi là-dedans. Donc c’était important d’essayer de contrebalancer cette tendance, en montrant que l’on pouvait être fier en travaillant dans ces industries, alors que l’on a laissé croire depuis trente ans qu’il n’y avait plus d’industries en France, que tout était foutu, que cela devait partir à l’étranger, que c’était vieillot, et que notre intérêt était de devenir une économie de services, qui allait vivre sans produire. On mesure à quel point cette stratégie politique s’est révélée être une erreur monumentale, dont on paye le prix fort aujourd’hui. D’une certaine manière, mes films cherchent aussi à réhabiliter ces métiers, ces savoir-faire, à rappeler que l’on peut avoir envie de vivre sans devenir Bill Gates, mais simplement de vivre dignement de son travail, avec des métiers industriels qui ne sont pas si pourris que ça et surtout qui sont bien rémunérés. On peut aussi être heureux en vivant chez soi d’un travail rémunérateur et satisfaisant, et qui est beau, voilà.
D. : Une séquence, particulièrement, montre cette fierté ouvrière, lorsque Cédric fait visiter son atelier de décolletage à ses enfants : sa fille sort de scène maquillée et costumée, la musique appuie la dimension féerique de la scène, qui se conclut sur un plan d’ensemble nocturne illuminé par les lumières des machines. L’usine est-elle le dernier endroit où l’on trouve de la « magie », comme le suggère la ministre Agnès Panier-Runacher ?
G. P. : Je ne sais pas si elle a déjà mis les pieds dans une usine ! Si c’est effectivement le dernier endroit où l’on trouve de la magie, ce serait bien qu’elle fasse en sorte de protéger tout ça. Cette séquence, c’est quasiment la première qui a été écrite. C’est une situation que j’ai vécue avec mon père, qui est décédé aujourd’hui mais qui m’a beaucoup inspiré pour le film. En parler maintenant, cela m’émeut encore. Et j’ai vraiment ce souvenir-là : le monde du travail, on en parle en famille, mais on ne sait pas ce que c’est quand on est enfant. Et encore, aujourd’hui les parents parlent de moins en moins de leur boulot à la maison, car ils en sont de moins en moins fiers. Mais nous on nous en parlait, et le jour où mon père nous a emmenés, je devais avoir l’âge du jeune garçon dans le film, et c’était formidable. Il y avait vraiment ce côté féerique, ce côté manège, avec ces machines qui bougent, mon père qui discutait avec ses copains d’usine, dont j’entendais les prénoms… Le film raconte aussi comment se transmet la fierté du travail.
Dans cette séquence, la mise en scène bascule dans le regard des enfants : c’est le seul plan où l’on s’est servi d’une grue, pour accompagner leur mouvement, et on a vraiment travaillé la lumière pour donner cet aspect merveilleux. Pierre Deladonchamps est venu en repérages, on a grimpé ensemble, il a rencontré les ouvriers – le prénom de son personnage est celui du mec qui lui a montré comment fonctionné la machine –, mais les enfants, on a pris soin de les préserver de tout ça afin qu’ils découvrent vraiment l’usine lors de cette séquence, et que le film puisse se nourrir de ce regard.
Pour l’anecdote, il y a eu lors du tournage de très beaux moments qui m’ont beaucoup rassuré, sur le passage à la fiction, notamment le fait que l’on peut aussi avoir de belles libertés, proche du documentaire. Je suivais Pierre et les deux enfants dans l’usine, en caméra portée, comme en tournage documentaire, tout en soufflant parfois des répliques aux uns et aux autres. Et à un moment, Pierre dit à Adélaïde, qui joue Eva dans le film : « Tu sais Papy, il faisait ça aussi », parce que le personnage du grand-père que l’on voit dans le film était lui aussi décolleteur. Et spontanément, la petite répond : « Oui, maman me l’a dit », parce que c’est la fille de nos voisins – il y a tous nos amis et nos voisins dans le film –, et qu’effectivement son grand-père a travaillé dans une usine de décolletage. Ces moments où la fiction et la réalité se télescopent sont parmi mes meilleurs souvenirs de tournage. On fait du « cinoche », dans la mesure où on a utilisé les moyens du cinéma pour magnifier ce moment, mais on est dans un décor réel, et la réalité vient percuter la fiction. C’était très rassurant de voir que même en fiction, avec une équipe de quarante personnes, on peut s’accorder des moments de souplesse comme ça. Surtout pour moi qui vient du documentaire : d’habitude je suis tout seul, et j’ai toute la liberté dont j’ai besoin. Même quand on est avec François Ruffin, c’est moi qui m’occupe de la technique. Donc là, pouvoir trouver cette marge de manœuvre, c’était chouette.
D. : Vous évoquez les télescopages entre fiction et réalité. Quels ont été pour vous les enjeux, les découvertes dans ce premier passage à la fiction ? Dans quelle mesure votre travail documentaire a pu nourrir cette première expérience ?
G. P. : Dans un premier temps, on peut déjà dire que ma manière de faire des documentaires – sans commentaire, en créant des situations, en cherchant comment amener des informations par l’humain – passe par des méthodes un peu similaires à la fiction. Sur Debout les femmes (2020, avec François Ruffin), c’est moi qui avait suggéré cette conclusion fictive, avec cette fausse Assemblée nationale, ce Parlement des femmes. Donc on n’est pas si loin dans l’esprit. Après, c’est sûr que passer d’une équipe de deux mecs dans une bagnole pourrie avec une petite caméra à quarante techniciens et comédiens à gérer, avec tout ce qui va autour, c’est quand même autre chose. Ce que je voulais absolument, c’est que l’on soit une bande. Pour ce faire, on a immergé tout le monde dans notre milieu. On a choisi les techniciens et les comédiens au feeling, en misant surtout sur la relation directe, humaine. Je voulais vraiment qu’ils se sentent porteurs d’une mission : ils étaient chez nous, et ils ne voulaient pas décevoir les gens. Les habitants et habitantes les ont accueillis à bras ouverts, contents de mettre en valeur le métier, la région, la montagne, donc il y a eu une ambiance formidable. Pour moi, travailler dans cet esprit-là, c’est fondamental. Que le film soit ou non réussi, faire des films pour faire des films, dans une ambiance pourrie, à gérer des égos d’acteur, des conflits entre ceux de l’image et ceux du son, ce n’est pas un métier qui m’intéresse. Là au contraire, cela a contribué à la relative simplicité du projet, à faire que le pallier soit un peu moins important.
Après, la complexité du scénario faisait que l’on a dû adapter nos méthodes de tournage. On avait peu de jours, et le scénario – on a mis sept ans pour l’écrire – est quand même compliqué. Cela nous laissait peu de marge au montage : tu enlèves une séquence, une information, et tu perds le cheminement et le spectateur. Et puis il y a beaucoup de personnages, beaucoup de décors, et des passages obligés qui étaient assez contraints. On souhaitait laisser de la place aux comédiens pour l’improvisation, d’être dans l’échange avec eux, notamment Pierre Deladonchamps, qui avait souvent des propositions intéressantes, et qui au bout d’un moment connaissait mieux son personnage que nous. On souhaitait donc garder cette marge de souplesse, mais notre scénario était sacrément bordé.
Enfin, il ne faut pas voir cette lourdeur d’équipe comme un boulet : tout le monde est là pour être à ton service, pour me décharger de tout ce dont je m’occupe d’habitude quand je fais un documentaire. Bien sûr, il y a des grosses journées, du fric, de la pression, mais j’étais assez serein.
D. : L’usine est un lieu essentiel du film. Comment avez-vous pu tourner dans une entreprise de la région ?
G. P. : C’est l’usine dans laquelle j’ai tourné mon premier doc, Ma Mondialisation (2006). Le propriétaire est un copain de lycée, avec qui j’ai été en coloc ensuite pendant trois ans. Il nous a prêté l’usine pendant la fermeture du mois d’août. C’est un lieu exceptionnel, qui a été déterminant pour convaincre le producteur. On fait le film avec 1,8 million, donc c’était impossible de construire un tel décor. En plus de cela, des ouvriers ont décalé leurs vacances pour mettre en route quelques machines, d’autres sont restés avec nous parce que ça leur plaisait d’assister au tournage, et puis il fallait des gens pour la maintenance, la logistique, la sécurité. Cette usine, je la connaissais par cœur : j’ai installé les machines dedans, j’y ai fait des films… Quand j’ai emmené les acteurs et les techniciens la visiter, je leur ai expliqué comment fonctionner les outils, etc. Ça m’a donné un peu de crédit pour embarquer l’équipe dans le projet. Finalement, je suis plus à l’aise dans une usine comme ça que dans le monde du cinéma, duquel je suis assez éloigné, et où mon incursion dans le monde de la fiction n’est pas forcément la bienvenue. Et le petit atelier de Denis, que l’on voit sur les hauteurs de Cluse, c’est pareil : Denis était en terminale avec nous, il a inspiré le personnage, et ils se sont rencontrés avec Vincent Deniard sur le tournage, et ils étaient là tous les deux quand on a fait la grosse avant-première à Cluse. Tout ça, ça existe. C’est avant tout une histoire de copains, ce qui rend les choses assez confortables.
D. : La proximité entre classes de la Vallée de l’Arve est l’une des spécificités du film. Son intrigue serait difficilement transposable dans une autre zone géographique.
G. P. : Je pense que dans le monde rural, dans les petites villes, c’est quand même beaucoup plus souvent le cas que dans les métropoles. La communauté est petite, donc si tu veux inscrire tes gamins à une activité tu as de fortes probabilités pour qu’il y ait ce brassage social, à part si tu les inscris à l’équitation et que les autres vont au foot, mais encore faut-il qu’il y ait cette diversité de loisirs.
Mais c’est vrai que le film est très implanté. Des fois, des films se tournent en fonction des régions qui financent. Nous, on n’allait pas déplacer les montagnes ou les usines ! La rencontre avec entre Cédric et Frédéric (Finnegan Oldfield), par exemple, entre l’ouvrier et le financier, c’est une spécificité de la montagne. Dans la vraie vie, un financier et un ouvrier ne se rencontrent pas. Jamais. Sauf en montagne. Parce qu’en montagne, dans un refuge, sur un sentier de randonnée, sur une paroi, tu n’as plus l’apparat, et que tu peux discuter. Du coup, la rencontre entre les deux devient crédible. C’était important pour nous, car on savait au début de l’écriture qu’on voulait les faire se rencontrer, et on avait cette passion de Cédric pour l’escalade, donc c’est devenu une évidence que cette rencontre aurait lieu sur la falaise. Et ça nous est venu d’une histoire vraie : il y a une quinzaine d’années, j’ai filmé un ouvrier décolleteur qui le soir, pour évacuer la pression et le stress, allait grimper le Bargis, comme ça, sans corde.
D. : L’apparence est assez marquée dans l’usine : les ouvriers sont en bleu de travail, les cadres en polo, et les managers en costume. Elle correspond à l’échelle hiérarchique. Mais dans le même temps, le costume finit par apparaître comme une mise en scène propre au monde de la finance : il suffit de mettre une veste devant son écran pour lancer son fonds d’investissement ; dans une autre séquence, Cédric répète devant une audience amicale pour convaincre qu’il est un repreneur crédible. Vous montrez ainsi comment la finance repose essentiellement sur du jargon et de la mise en scène.
G. P. : Effectivement. Je suis persuadé que la finance, ce n’est pas si compliqué, si tu possèdes les codes. Leur force repose essentiellement là-dessus : sur l’opacité, les barrières linguistique et vestimentaire pour conserver leur domination. Toute l’ingéniosité de Cédric, c’est de s’immiscer dans ce milieu et de leur piquer leurs outils et leurs codes. Lui n’a peur de rien : il grimpe sans corde et se lance là-dedans sans filet. À Cluse, on m’a posé la question : « Lui il est malin, il parvient à se déguiser en financier, mais est-ce que les financiers arriveraient à se déguiser en décolleteur ? » Je n’en suis pas sûr !
Le secret, c’est un peu leur fonds de commerce, mais nous on a eu la chance de les rencontrer. Et ça c’est une autre différence avec le documentaire : quand tu fais de la fiction, du « cinoche », tu as des portes qui s’ouvrent. Tu as l’impression que tu es passé dans autre chose : je suis le même mec, je traite des mêmes sujets, mais d’un seul coup on t’ouvre des portes. Et donc le monde de la finance à Genève a bien voulu nous recevoir. Pour imaginer le trader du film, Frédéric, on en a rencontré deux, dont un qui a lu le scénario, qui a fait des remarques, et c’était chouette de bénéficier de son point de vue. Et il nous a confirmé tous ces codes. Sur les anglicismes, par exemple, ça peut paraître caricatural dans le film, mais il nous a incité à en mettre plus, car il en emploie sans cesse. Et sur la trahison de Frédéric, à la fin, il n’était pas choqué non plus : s’il ne l’avait pas fait, ça aurait presque été une faute professionnelle. Parce qu’il ne sera pas cramé sur la Place de Genève s’il fait ça. Quand on écrivait les différentes phases du scénario, les producteurs se demandaient si c’était crédible, et ce que nous disait Gabriel, notre « conseiller financier », c’est que si tu as une opportunité d’empocher le pactole, tu le fais car ce sera un fait d’arme qui va te glorifier. Ce qui nous apparaît comme une trahison abominable, pour lui c’est un gage de professionnalisme.
D. : Une autre réalité économique qui retient l’attention, ce sont les enchères inversées. C’est un mécanisme essentiel du monde industriel, avec des incidences très concrètes sur la vie des ouvriers, mais c’est sans doute la première fois que nous le voyons dans un film de fiction. Idem pour le LBO, expliqué autour d’une bière. Le film affiche une sorte de didactisme décontracté, qui montre l’implication de l’économie dans la vie des gens.
G. P. : Il s’agissait pour nous d’expliquer des mécanismes complexes, sans sortir du divertissement. Pour ça, la comédie, l’émotion sont des outils formidables, pour rendre digestes des informations potentiellement indigestes. En ce qui concerne les enchères inversées, j’en connaissais le fonctionnement car ça fait un moment que je traîne mes guêtres dans cette usine, mais effectivement personne n’en a entendu parler. Parce que personne n’est fier de participer à ce jeu. Ce sont les constructeurs automobiles allemands qui ont inventé et popularisé ce procédé, et c’est un outil parfait pour être sûr d’obtenir le prix le plus bas, car cela tire sur la fibre joueuse des commerciaux qui, pour ne pas perdre un marché de plusieurs millions d’euros, vont baisser le coût de la pièce de quelques centimes, jusqu’à produire à perte, sous la pression d’un compte à rebours : tu joues l’avenir de la boîte sur un coup de dés, où on ne te laisse pas le temps de réfléchir, de calculer, etc. C’est insupportable.
D. : En terminant votre film sur cette séquence, vous relativisez largement le happy-end.
G. P. : Ça l’amoindrit, c’est sûr. Mais je tenais aussi à être réaliste. D’un côté, on peut trouver génial qu’ils aient pu reprendre la main sur l’entreprise ; d’un autre, on peut se demander dans quelle merde ils se sont foutus. Ce qui est certain, c’est qu’ils n’ont pas renversé le capitalisme : ils restent dans une économie de marché dans laquelle il va falloir être concurrentiel. Malgré tout, s’ils arrivent à mettre en place leur plan utopique, élaboré à l’aide de plusieurs bouteilles de vin, avec des salaires plafonnés et sans versement de dividendes, on peut espérer un avenir plus serein que quand les fonds d’investissement étaient propriétaires.
D. : Cette scène d’ivresse, où les trois copains imaginent un avenir meilleur pour leur boîte, détonne aussi : on ne voit plus aujourd’hui de travailleurs et travailleuses utopiques, imaginant qu’un autre monde est possible.
G. P. : On voulait montrer des ouvriers qui théorisent ou qui réfléchissent. Dans cette vallée, le taux de syndicalisation est encore plus bas qu’ailleurs : on est à moins de 2%, quand en France on avoisine les 8%. Il n’y a pas de culture politique, de culture syndicale ; il y a bien la figure du père, joué par Rufus, mais on le voit peu. Cela me plaisait de passer par un ouvrier non-politisé, pour éviter de plaquer un discours sur l’intrigue. En revanche, que par son expérience personnelle, son ressenti, son courage, il parvienne à mettre en application les théories de son père, à se réapproprier l’outil de travail, cela me paraissait beaucoup plus fin, et même politiquement plus intéressant. Parce que cette génération d’ouvriers et d’ouvrières quarantenaires a baigné dans le déni, voire le dénigrement, du syndicalisme et de la politique. Cédric est l’émanation de ce climat dans lequel il a grandi.
D. : Cela peut apparaître comme un paradoxe par rapport à vos documentaires, qui ont largement remis en lumière la mémoire et la culture ouvrières, ainsi que les conquêtes sociales du mouvement ouvrier. En passant à la fiction, vous semblez faire table rase du passé : les héros ne se syndiquent pas, ne font pas grève, mais inventent de nouvelles formes de lutte.
G. P. : Je pense quand même qu’à travers la figure du père et de ce qu’il a distillé auprès de son fils, cela reste très présent. Même si on a voulu casser tout ça, les théories de son père sont loin d’être si vieillottes et prennent tout leur sens aujourd’hui.
Néanmoins, vous me connaissez, je n’ai rien contre les syndicats ni les partis, au contraire. Mais je pense qu’il faut aussi inventer autre chose, passer par d’autres biais. Et c’est aussi ce que peut le cinéma : il faut inventer des histoires, de belles histoires, et c’est un moyen de proposer autre chose. Et puis politiquement parlant, traiter le sujet par la joie, par l’humour, c’est plus fort pour emmener le spectateur que par le schéma dogmatique de l’opposition de classes. À la sortie des avant-premières, les spectatrices et spectateurs ont la banane. Quand on voit ce qui s’annonce cet automne, il y a de quoi baisser la tête, donc je crois que passer par les affects, par le rire, je crois que même politiquement c’est plus efficace. Mais encore une fois, il ne s’agit pas de dénigrer le travail des syndicats.
D. : Il y a aussi une petite pique pour L’Humanité.
G. P. : Je trouvais ça assez rigolo : pour un directeur de fonds d’investissement, c’est sûr, plus personne ne lit L’Huma. Il ne sait même pas ce que c’est ! Il connaît à peine Mediapart pour le retentissement des affaires. Pour l’anecdote, c’est Samuel Churin qui joue le personnage, et il est aussi le porte parole de la Coordination des Intermittents et Précaires. Un rôle un peu à contre-emploi donc. Enfin, je n’ai rien contre L’Huma. Le film a d’ailleurs été projeté à la Fête de L’Huma.
D. : Le côté comédie didactique du film peut évoquer certains films d’Adam McKay, comme The Big Short (2015), sur la crise des subprimes.
G. P. : J’avais bien aimé ce film. Une différence peut-être avec ce que nous avons voulu faire, c’est que ce dernier se passe surtout dans des bureaux, alors que nous, nous voulions vraiment montrer la vie des personnages sur le terrain : la vie de famille, au travail, dans les bistrots entre copains. Et on a vraiment travaillé pour rendre cette vie crédible. Lors des avant-premières à Cluse, on a fait 2500 entrées en quatre jours, et les gens avaient l’impression de se retrouver à l’écran, et ils y trouvaient de la reconnaissance, si rare au cinéma. Donc on s’est dit que là-dessus au moins on ne s’est pas plantés. Pour moi, au-delà des critiques et de ce qui va se dire sur le film, ne pas se louper localement, c’était la préoccupation première. Surtout quand tu habites là-bas. C’est pareil en documentaire : c’est plus difficile de travailler chez toi qu’à l’autre bout du monde, où tu peux raconter ce que tu veux, tu ne vas pas croiser les gens au bistrot ou sur le marché le lendemain. Quand tu es chez toi, faut faire gaffe. Les ouvriers, chez nous, c’est pas des gros bavards, donc quand ils viennent te voir et qu’ils te disent que tu as réussi à les faire pleurer, tu te dis que ça va, tu as réussi ton pari. Il y en a une qui m’a dit : « si on m’avait dit un jour que je pleurerais en voyant arriver une machine de décolletage… »
D. : Quand nous nous étions rencontrés pour la sortie de Debout les femmes, vous affirmiez justement un désir de faire des films populaires.
G. P. : C’est toujours ma bataille. Comment tu amènes des gens divers voir des films qu’ils n’iraient pas voir d’habitude ? Là c’est un peu différent : chez les exploitants, on oscille entre l’art et essai et les multiplexes. Et je suis très content de ça, car on peut toucher une population variée. Donc j’espère que le côté populaire du film sera suffisamment mis en avant avant la sortie, pour que les gens aient envie de voir cette histoire-là. Chez nous, ça ira, mais ailleurs, on se demande comment on va y arriver, c’est encore assez mystérieux.
Mais cette question, je me la pose depuis que je fais des films. Comment pousser les gens à venir se voir à l’écran ? Avec François Ruffin, on a essayé de trouver des combines avec la force de frappe qu’il a, d’organiser des projections gratuites, de jouer avec les réseaux, de faire passer le message. Pour De mémoires d’ouvriers, j’étais passé par les comités d’entreprises ; pour ce film-ci, on est allé tracter sur les marchés, tous les matins pendant une semaine avant la tournée en Haute Savoie. Et là tu touches les gens, tu discutes avec eux, mais il faut y aller. Moi je revendique ce côté artisanal à tous les étages. C’est pas parce que tu fais une fiction que tu vas traîner dans les salons parisiens à raconter ta vie, faut aller sur le terrain, parce que c’est là que tu touches les gens, et c’est plutôt agréable.
D. : Le film oscille entre comédie, politique, suspense avec la trahison finale. Est-ce que ce mélange des genres était présent dès le départ, ou avez-vous ajouté des ingrédients, des personnages secondaires au fur et à mesure ?
G. P. : Le trio d’amis était présent dès le départ. À la base, je voulais faire un doc qui aurait pu s’appeler « Le patron, le banquier et l’ouvrier », et c’était sûr que c’était le banquier un peu médiocre de l’agence locale qui allait amener de la comédie. Les personnages secondaires ont été développés dans un second temps. On est passé par différentes phases, en sept ans. Même si entre deux j’ai fait plusieurs films, et que Marion s’occupait de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain. On a pris beaucoup de temps pour développer les personnages, mais certains ont fait les frais du montage, comme le personnage de Nathalie, l’épouse de Cédric, joué par Marie Denarnaud. Mais même si elle est peu présente à l’écran, elle est très juste dans le jeu.
Pour l’efficacité à l’écriture, on a aussi travaillé avec Raphaëlle Desplechin sur la dernière année, qui est une scénariste confirmée. La collaboration a été très agréable. Il y avait des façons de faire, des codes d’écriture que nous n’avions pas, et sur lesquelles elle nous a aidés. Ainsi que sur l’efficacité dans les dialogues, les ressorts, le développement des personnages. Elle est arrivée à un moment où on plafonnait un peu, et ça nous a vraiment débloqués. Elle avait un regard parisien, pour le coup, mais c’était vraiment bien de se confronter sur certains stéréotypes, avec bienveillance. Par exemple, de son point de vue, puisqu’on est dans l’industrie et qu’il y avait un fonds d’investissement, cela impliquait un plan social, donc des suicides, etc. C’était une vision un peu schématique, pas tout à fait en accord avec la réalité de la Vallée de l’Arve. La réalité c’est que ces boîtes valent cher et qu’il y a peu de licenciements, parce qu’il faut qu’elles soient rentables à la revente. C’est pas la grande boucherie. Donc sur certains points, il fallait échanger, se battre un peu. Par exemple, sur le fait que la plupart de nos personnages était des mecs. Et effectivement, c’est l’histoire de trois copains d’école, et en ce moment c’est pas tendance de faire des « films de mecs », mais on l’a invitée à la maison avec Marion, et elle a pu se rendre compte par elle-même : c’est un milieu très masculin. Mais on a essayé d’écrire un vrai rôle pour Julie : c’est elle qui mène la contre-attaque pour le trio. Et puis il y a cet aspect humain, sensible, qui vient gripper son plan de carrière tout tracé, et qui fait basculer l’histoire. J’aime bien cette idée que les affects, un rire, une émotion, peuvent faire dérailler les choses, et montrer que finalement ça se joue à pas grand chose.
D. : Mais n’est-ce pas aussi une des limites du film, l’attachement ou l’ancrage des personnages au local ? Le fait que l’exemple qui y est développé ne pourrait pas être appliqué ailleurs ? C’était peut-être aussi une critique que l’on pouvait adresser à Merci patron ! (François Ruffin, 2016) : la lutte singulière qui y est menée ne saurait faire école et être répétée.
G. P. : D’abord, moi je pense que ça pourrait se refaire. Mais au-delà de ça, le sens du film, c’est de montrer qu’il y a du possible, dans un monde où on répète sans cesse que rien n’est possible. Et donc tu relèves la tête et tu fonces. J’ai tendance à rester dans cet état d’esprit-là. Et le boulot qu’a fait Merci patron !, même si l’expérience n’a pas été renouvelée, c’est d’avoir permis à des foules de gens de passer un bon moment, il y a eu des comités ou des réseaux Fakir qui se sont créés, et politiquement ça a fait du boulot. Pas forcément sur la théorie ou le discours, encore une fois. Ce film, il rentre dans ce cadre. Je sais que l’on va avoir droit à ces remarques par les militants syndicaux, mais je pense que par le rire, par la comédie, on est plus forts que par le discours. Si tu regardes tous mes docs, les témoins n’ont jamais leur étiquette syndicale collée sur le front : c’est l’humain qui parle.