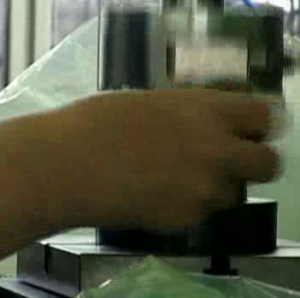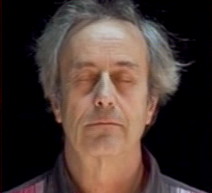Graffiti
Graffiti est un court film, réalisé début décembre 2020 dans les locaux d’une université déserte en vue d’annoncer le report d’un séminaire portant sur la censure dans le cinéma d’hier et d’aujourd’hui. Si on ne peut pas se voir, on ne peut pour autant effacer les traces d’une ancienne présence humaine dans ces lieux désormais inhabités.
Post-scriptum
Le 9 décembre dernier aurait dû avoir lieu une séance de séminaire intitulée « Missing (and occulting) Pieces : censures d’hier et d’aujourd’hui ». La rencontre se serait déroulée à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), dans le cadre du projet Missing Pieces porté par l’association Kinétraces. Marion Boulestreau (archiviste), Paola Raiman (critique et programmatrice) et Donatello Fumarola (programmateur) auraient présenté les cas de censure dans l’histoire – et l’actualité – du cinéma qu’ils ont pu croiser dans leur travail de conservation et diffusion des films.
Si l’on parle au conditionnel, c’est parce que cette séance n’a finalement pas eu lieu. En raison des restrictions sanitaires, la seule possibilité que la rencontre se fasse était de la « dématérialiser », de la basculer à distance, ou bien de l’organiser sur place avec une jauge fixée à dix personnes.
D’un commun accord avec les intervenants, il a été décidé de reporter la séance dans un futur où le séminaire pourrait se dérouler dans le cadre habituel du travail universitaire. Il nous a semblé inapproprié de participer à ce mouvement de dématérialisation de l’enseignement et de la recherche auquel on assiste depuis désormais presque un an ; tout particulièrement dans un moment – début décembre – où les universités demeuraient désertes. Il aurait été extravagant de disserter censure et cinéma – donc politique – assis devant des ordinateurs alors même que l’Observatoire nationale de la vie étudiante (OVE) signalait qu’un étudiant sur trois a manifesté des signes de détresse psychologique suite au premier confinement. Et les étudiants immergés dans le confinement – saison #2 – étaient à compter au nombre de ces images manquantes puisqu’ils étaient non seulement interdits de cité dans l’université mais passés sous silence dans les discours politiques et agitations médiatiques.
Il y a la censure des films, dont on aurait parlé pendant le séminaire, et il y en a une autre, qu’on a du mal à nommer aujourd’hui, mais qui produit également des missing pieces, des omissions : on peine à élaborer un discours critique, alternatif, autour des mesures politiques de restriction, d’abord parce que toute voix dissidente est soupçonnée de nier la gravité de la pandémie, mais encore parce que les lieux consacrés à son élaboration sont fermés. L’université devrait pourtant être l’endroit privilégié où distinguer contexte sanitaire et décision politique, de sorte à pouvoir questionner la seconde. Bien au contraire, dans une confiance généralisée envers le tout dématérialisé (parfois mêlée à un enthousiasme mal caché), les réunions, colloques et cours ont pris la route des plateformes de streaming numérique sans trop se donner la peine de trouver des solutions aux conséquences concrètes, humaines, de ces choix. Peu importe si dans la plupart des foyers on ne dispose pas d’une tablette par enfant, si l’on rédige les devoirs avec un téléphone portable à défaut d’un ordinateur personnel ou si les étudiants sont confinés dans quelques mètres carrés. À l’aube d’un deuxième semestre universitaire qui s’annonce de nouveau à distance, ou hybride dans le meilleur des cas, le désarroi qui nous habite ne saurait être soigné à coups de hashtags (#C’EstPourVotreBien, #PourNotreSantéÀTous, #RestezChezVous). Les corps ont besoin d’air, demandent à bouger, cherchent d’autres corps avec lesquels interagir. La même chose vaut pour les cerveaux : surexposés aux ordinateurs, reclus entre quatre murs depuis des mois, ils finiront fatalement par moisir. Quelques universités ont mis en place un système d’aide au numérique, les cellules de soutien psychologique subissent des rythmes de travail extraordinaires, mais que peut un parapluie de poche en temps de naufrage ?
Dans le hors-champ des mosaïques Zoom, Meet ou Teams le navire coule, c’est pourquoi il nous a semblé raisonnable de reporter notre séance en expliquant pourquoi il nous était impossible de faire semblant que “tout roule”.
S’il n’y a aucune commune mesure entre l’invention du cinéma parlant et le développement de l’enseignement numérique, on peut néanmoins tirer de la réaction de Béla Balàzs face au crépuscule du muet quelques indications utiles sur ce que l’on peut attendre de l’« invention technique ». Dans L’esprit du cinéma il observe en effet : « […] la nouvelle technique, non encore développée, a rejetée à un stade tout à fait primitif l’ancienne qui était déjà extrêmement développée. ». Cette nouveauté, qui semble prête à rendre obsolète le cinéma muet, en 1930 se manifeste dans la mode des talkies : cette phase d’ivresse généralisée pour la parole qui a accompagné les débuts du cinéma sonore.
À la manière de Balàzs, dans le contexte actuel de dématérialisation des activités d’enseignement et de recherche, mais aussi de toute activité culturelle, on a de quoi s’inquiéter de la « chute du niveau de l’expression » et du contenu. Il ne s’agit pas de céder au catastrophisme : Balàzs ne le faisait pas non plus (« peu à peu, l’homme assimile la machine. Elle s’adapte à ses sentiments les plus délicats. »), mais de redoubler de prudence face à l’enthousiasme facile qui accompagne souvent l’invention technique. À l’état actuel des choses, nous sommes loin d’être les maîtres de cette machine, au contraire : la culture delivery est en train de changer radicalement nos habitudes sans que l’on ne s’en rende compte. Soudain, tout s’invite chez soi : l’Opéra Garnier, le traiteur du coin, le cours de Licence, la réunion de travail, le conseiller Pôle emploi, la session de fitness.
En flattant notre propension à la paresse, la culture du tout numérique se présente comme une alternative valable aux sorties et semble demander : « Pourquoi te déplacer ? Il pleut d’ailleurs. Tu dois organiser une réunion ? Et pourquoi pas sur Zoom ? ». C’est certes une opportunité pour faire participer, par exemple, un spécialiste uruguayen à une journée d’étude consacrée à Welles, lequel n’aurait pas pu faire le déplacement, mais, chemin faisant, que perdons-nous ?
Résolus à mettre en forme ces préoccupations, nous avons proposé à l’INHA de diffuser un vidéo-message pour expliquer nos motivations. L’Institut avait donné son accord à cette solution, nous avons donc tourné quelques plans dans les locaux dépeuplés du Centre Saint-Charles (Paris 1) et monté en vitesse un film-tract qui a pris le nom de Graffiti. Ce petit objet audiovisuel aurait dû être diffusé avant le 9 décembre en accompagnement du message de report de la séance. Encore le conditionnel, car une fois le film visionné, l’INHA a décidé de ne pas le transmettre et la séance a finalement été annulée laissant pour seul message de circonstance : « Suite aux dispositions prises par l’INHA dans le contexte du COVID-19, cette séance est annulée. »
Pourtant, un mois après cette séance manquée, les universités demeurent désertes et il ne reste du passage des étudiants que quelques traces gravées sur les bancs.
Federico Lancialonga