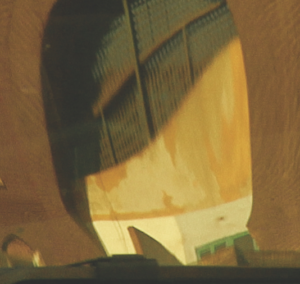Hanezu, Naomi Kawase
Corps et âmes
À l’heure d’Internet et de l’économie mondiale, Naomi Kawase ne sort pas du sillon des croyances ancestrales de son pays. Son dernier film, Hanezu, semble être l’application narrative et visuelle d’un code culturel préexistant. Ou, plus exactement, d’un code personnel. Rien ne serait moins évident que de se dire que l’ensemble des Japonais partagent le rapport au temps et à la nature que les films de Kawase mettent à l’œuvre. Son cinéma serait plutôt une île au sein de cet archipel qu’est le Japon. Et on n’y tiendrait pas tant s’il nous faisait oublier toute l’eau qui nous en sépare.
A priori, rien de dépaysant : Takumi (Tohta Komizu) est mariée à Tetsuya (Tetsuya Akikawa) tout en ayant une liaison avec Kayoko (Hako Oshima). Une grossesse la décide à faire un choix entre ces deux hommes. Mais voilà que le récit, au lieu de se construire sur une confrontation de Takumi avec la société (cas du film progressiste sur l’émancipation individuelle, du mélo doublé d’une charge sociale), se développe autour d’un problème abstrait, le temps, faisant de Takumi moins une héroïne qu’un personnage parmi les autres.
Lors du prologue, une voix indéfinie et lointaine nous conte la légende de dieux-montagnes, rivaux en amour il y a plus d’un millier d’années, comme une manière de renvoyer la situation contemporaine à un fond mythologique, et d’établir une continuité entre passé et présent. Il sera également question d’une troisième époque, celle où vivaient le grand-père de Kayoko et la grand-mère de Takumi qui, par respect des traditions, avaient dû troquer leur histoire d’amour pour des mariages forcés. Une communication s’instaure entre ces différentes périodes.
La forêt de Mogari, le temps d’un air de piano ou d’une danse, faisait revenir la femme défunte du vieux Shigeki. C’est de la même manière que le grand-père de Kayoko, mort à 25 ans pendant la Seconde Guerre Mondiale, apparaît dans l’époque contemporaine. La co-présence des morts et des vivants se fait sans étrangeté, sans le moindre besoin de justification. Loin de s’effrayer quand il croise le mort (mort ou esprit, en tout cas pas fantôme) qu’il a connu enfant, un personnage entame avec lui une discussion, comme avec un ami qu’il n’a pas vu depuis longtemps (rencontre qui surpasse en banalité celle qui a lieu avec les singes d’Oncle Boonmee). Ce rapport au temps n’a rien de subjectif ; toute mémoire individuelle fait partie d’un courant plus large. Par opposition à la mémoire, le temps est pour tous. Et il ne s’agit pas pour l’approcher de creuser à l’intérieur de soi, mais plutôt de sortir de soi, de s’offrir à la vue et au contact de la nature.
Avant d’être dans les cerveaux, la mémoire est dans la terre. L’action se situe d’ailleurs à Nara, un lieu de fouilles archéologiques. La mémoire de la terre est à prendre au sens scientifique, historique, comme au sens spirituel. La nature, investie d’une valeur mystique, met les personnages à l’épreuve d’un rapport avec le monde du temps mythologique qui se situe hors de leurs moyens intellectuels. Ce temps n’est signifiable et abordable que concrètement, au moyen des sens. Kawase privilégie les gestes aux paroles, mais si le rapport à la nature et au corps donne d’abord aux personnages des sensations sereines et soft (tremper un tissu, sculpter du bois, marcher pieds nus), c’est une performance physique plus hard (coupure, pluie battante) qui permet d’abolir les limites, de mettre ces personnages au diapason de la nature.
La mise en scène de Kawase semble osciller entre deux distances : des plans très proches de l’action, qui mettent en évidence les corps et la nature dans ce qu’ils ont de plus concret, et des points de vue éloignés où les personnages sont vus et observés comme des créatures étranges. La caméra les suit, tout en restant en retrait. Ces plans, rarement fixes, éveillent l’idée que ce regard mouvant n’est pas uniquement celui de la réalisatrice se tenant hors du monde filmé, mais pourrait être un regard interne à ce monde, bien que son détenteur ne puisse jamais nous être montré, ni vu par les personnages. Une divinité qui appliquerait son regard sur les personnages, et par cela les placerait dans un temps mythologique ? L’âme d’un de ces habitants ayant vécu à Nara, l’ancienne capitale du Japon, et auxquels Kawase dédie son film ? Toujours est-il que si l’on peut voir les morts et discuter avec eux, les morts ont aussi droit au regard. Les animaux, plus que les humains, pourraient être aptes à sentir ces présences. N’est-ce pas ce que l’on peut déduire de ce plan, apparemment sans grand rapport avec le reste, où l’on voit un chat se retourner et miauler vers la caméra-esprit ? Les corps humains (ou animaux) n’ont pas l’initiative des rapports avec la nature ; s’ils ont des yeux et des mains pour la voir et la toucher, elle est une présence. Regard imperceptible pour les personnages, esprit invisible pour nous derrière son regard, on la devine potentiellement multipliable. Omniprésence.
Les conceptions spirituelles qui irriguent le film et en font une expérience cinématographique atypique l’écartent logiquement et radicalement de toute tendance au psychodrame. Il faut à cet égard louer la finesse avec laquelle Kawase contourne les passages obligés de ce type d’histoire. La caractérisation du rapport de Takumi et de son amant, s’appuyant sur des attitudes simples et un seul baiser, ainsi que l’aveu au mari, préparé par des activités quotidiennes et communes – courses, repas – dans lesquelles rien ne transparait de ce qu’elle va lui dire, sont d’une sobriété très sûre. Néanmoins, il faut également reconnaître que la place donnée à la nature apparaît ici plus arbitraire que dans La forêt de Mogari où un pèlerinage pour trouver une tombe dans la forêt conférait aux plans de nature une évidence narrative.
C’est peut-être une conséquence de l’approche mythologique que de tendre à donner à toute différence un petit goût de même : entre les films, entre les âges. À ce niveau, si les personnages et leurs trois époques sont reliés par le mythe, nous pouvons cependant noter des différences, notamment entre l’histoire des grands-parents et des petits enfants. Takumi semble disposer d’une plus grande liberté que sa grand-mère : les valeurs sociales ont évolué, et sa décision de ne pas s’installer avec son amant ne vient pas d’une pression parentale mais d’une appréhension personnelle. Cependant le film, sur le lien entre les époques, peut-être par désintérêt du discours social, reste un peu flou. Si la permanence de l’enjeu ne recouvre pas les différences de contexte, il n’en reste pas moins que, comme le suggère la réunion finale des amants (Kayoko et son grand-père face aux montagnes), l’action ne trouve pas son sens en tant que récit qui aurait un début et une fin, mais bien dans la fusion des différents temps.
De ces temps, il est à deviner qu’il y en a d’innombrables, tout comme sont innombrables ceux qui y ont vécu. Le film se termine en nous montrant la terre extraite du chantier archéologique de Nara, cette terre devenue à nos yeux dépaysés matière première du temps. Un texte nous dit ensuite que seulement 10% du site a été exploré. On ne reçoit pas une lettre venue d’une île tous les jours, et, même si on ne comprend pas exactement ce qu’on veut nous dire, même si on est contrarié dans notre tendance à l’analyse sociale, on ne se formalisera pas trop si on nous y parle plus d’âmes et de nature que d’hommes. Le contraire ne serait pas plus rassurant. Sur son île, Naomi continue certainement les fouilles.
Scenario : Naomi Kawase / Photographie : Naomi Kawase / Montage : Naomi Kawase, Haneko Yusuke, Tina Baz / Musique : Hasiken / ...
Durée : 91 mn
Sortie : 1er février 2012