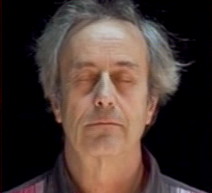Jean-Paul Fargier (2/2)
Souvenirs d’un défricheur, ou La vidéo gagne (encore) du terrain
Cette seconde partie reviendra sur le parcours universitaire de Jean-Paul Fargier au sortir de mai 68 et sur l’expérience des Cahiers du cinéma. L’entretien se clôt par l’évocation du concept d’ « effet tivi », l’un des plus importants forgés par le théoricien[11][11] Voici le lien vers la première partie de l’entretien..
L’université
D : Étiez-vous déjà universitaire à l’époque ?
JPF : Oui. Je me suis inscrit à Paris 8 en octobre 1969. Vincennes, ça commence en janvier 69. La première année universitaire est assez courte car ils ont démarré avec deux mois de retard. Moi, je m’inscris à la deuxième année.
D : En quoi ?
JPF : En cinéma.
D : Qui étaient les profs ?
JPF : Marie-Claire Ropars, Roger Dadoun et Jean-Paul Aubert. Ils avaient pris des gens qui avaient des thèses sur « cinéma et quelque chose », « cinéma et Zola », « cinéma et Balzac », etc. C’est tout ce qu’il y avait à l’époque. Des thèses littéraires, sur les adaptations au cinéma. C’est à eux qu’on a confié la fondation du département cinéma. Après, ils ont cherché à embaucher des gens qui étaient dans la pratique. Je m’étais inscrit comme étudiant pour avoir la Sécu. Le premier travail que j’ai fait, c’est une analyse de Méditerranée, plan par plan, pendant deux mois, sur un matériel magnifique, une table d’analyse pour le 35 mm. Puis j’ai fait un exposé dans le cours de Marie-Claire Ropars, en faisant venir Sollers pour parler du commentaire. Ensuite Ropars m’a dit : « Ça serait bien que vous fassiez un cours, au second semestre. »
D : Ça a été votre sésame.
JPF : Oui, je n’avais pas de diplôme. Il n’y avait pas de diplôme de toute façon ! Je n’avais que le Bac, et des certificats d’études bibliques, et de philosophie, etc.
D : Vous aviez validé des choses en théologie ?
JPF : Oui, j’ai eu quelques certificats. J’ai même fait de l’hébreu, de l’histoire de l’Église, etc. J’allais en cours le matin et l’après-midi, j’allais à la Cinémathèque, au Quartier latin, etc., voir des films. Donc, j’ai été embauché comme ça, en février. Je suis enseignant à Paris 8 à partir de février 1970.
D : Vous arrivez à Paris 8 en octobre 1969 en tant qu’étudiant, et trois mois plus tard vous êtes prof !
JPF : Voilà ! J’ai été prof parce que Ropars me l’a demandé – sinon, je n’aurais pas pu l’être – mais les étudiants disaient : « Lui, il est à Cinéthique, il devrait être prof puisque c’est la meilleure revue ! C’est la revue qui a la ligne juste, elle est marxiste-léniniste ! Les Cahiers c’est des petits révisionnistes, Positif des surréalistes réactionnaires, etc. » Cinéthique avait la cote et Ropars était poussée par certains étudiants. Donc j’ai mon cours, je fais un truc sur Dziga Vertov peut-être, ou sur le cinéma politique, le rôle de l’économie sur le cinéma, la détermination du sens, etc., les thèses de Cinéthique. Ensuite, je fais venir Leblanc. On avait d’abord une UV chacun par semestre puis très vite, on en a eu deux. On était chargés de cours. Après, Jean Narboni est arrivé. On a fait un groupe de pression pour faire entrer plein de gens, tous des gens d’extrême gauche. On a formé un groupe, le « Front de gauche de l’art », sur le modèle de la Lef à Moscou, pendant la Révolution. Dans ce groupe, il y avait un Jean-Claude Moineau, du département Mathématiques, qui s’intéressait au cinéma. Il avait été proche des Situationnistes, de Fluxus, etc. Il y avait Jean-Louis Boissier, des Arts plastiques, qui a eu un rôle dans la direction du département. On s’est un peu regroupés. Jean Douchet est venu…
D : À l’époque, tout marche par copinage ?
JPF : Oui. Après, Cinéthique et les Cahiers prennent le pouvoir, au point même où on vire Dadoun et Ropars. Il y a eu un putsch des jeunes profs au bout de deux ans. Il y avait une forte pression des étudiants pour avoir le contrôle des contenus des cours, sur le principe de la révolution culturelle maoïste. Il y avait énormément de maoïstes à Vincennes… Ils disaient : « On veut déterminer par vote en assemblée générale le contenu des cours avant chaque semestre ». Nous, on a dit : « Mais oui, c’est génial ! » et Ropars et Dadoun ont dit : « C’est contre tous les principes universitaires, on ne peut pas maintenir ça. Si vous faites ça, on s’en va ! » et ils sont partis. En littérature. Ils nous ont dit : « Démerdez-vous ! » en pensant que ça allait s’écrouler, parce qu’on n’avait pas de prof de rang A. Sauf un : Moineau, le mathématicien cinéphile. Et c’est lui qui a assumé le pouvoir. Il suffisait de signer… Petit à petit, au bout de quatre-cinq ans, on s’est dit : « Mais on est cons, on donne des UV à tout le monde et nous, on n’a rien ! ». On était tous comme ça, alors on a passé les trucs. On a eu une Licence et une Maîtrise. Pour la Maîtrise, j’ai donné un très long article de Cinéthique qui a été validé comme mémoire par Moineau. Après j’ai eu un DEA et je me suis arrêté là. À l’époque, pour avoir un DEA, il fallait discuter dix minutes avec le responsable des thèses pour exposer son projet de thèse. Là, c’était déjà quelque chose sur l’art vidéo. Ma thèse, c’était : « La vidéo est un art de moins. » J’avais déjà écrit ça dans artpress.
D : Vous étiez dirigé pour votre thèse ?
JPF : Pour la thèse, c’était André Veinstein, le prof de théâtre. Moineau n’était pas habilité. On était une UER où il y avait arts plastiques, musique, théâtre, cinéma, et philo quand même qui nous chapeautait, puisque l’esthétique fait partie de la philo. Deleuze, Lyotard et Châtelet nous couvraient. Ils ont couvert toutes ces opérations de révolution. C’était incroyable. J’ai donc été embauché en tant que critique et théoricien de revue, comme d’autres étaient embauchés parce qu’ils étaient praticiens du montage, ou des prises de vue, etc.
D : Justement, à l’époque, y a-t-il un partage entre théorie et pratique ? Vous incitez les étudiants à fabriquer leurs images ? Il y a des ateliers ?
JPF : Oui. Même sous Ropars, il y avait l’idée que les étudiants allaient faire des films. Et on a toujours maintenu ça. J’étais le premier à faire des cours de vidéo par exemple, en amenant mon matériel. Toutes les semaines, j’amenais mon matériel pour les stages d’initiation à la prise de vue et on partait faire des tournages. Après, on a fait acheter par la fac. Au début, la vidéo à la fac, c’était un grand studio hyper bien équipé, mais avec du matériel très lourd, comme les télés de l’époque. Des deux pouces. Énorme !
D : Deux pouces, c’est la première bande ? La plus large ?
JPF : Demi-pouce c’est le VHS. C’est assez large le VHS… Deux pouces c’est quatre fois plus grand que le VHS. Les bobines d’une heure pesaient peut-être trois kilos ! C’était des caméras de studio. Au départ, ils n’avaient pas équipé la fac en caméras légères. C’est nous, dans le milieu des années 1970, qui avons fait acheter ça.
D : Le Portapak ?
JPF : Oui. Le premier Portapak qui a servi dans des cours, c’était le mien et celui de Danielle Jaeggi, ma compagne, qui a été élue comme prof à cette fameuse assemblée générale de juin 1971, où vingt postulants-enseignants ont dit : « Moi, je ferai cours sur ça. Moi, sur ça. Etc. » Et les étudiants votaient. [rires]
D : C’est plutôt assassin…
JPF : Oui. Il y a même eu des tas de cours, pendant un an ou deux, faits par des étudiants, puisque les étudiants disaient : « Moi aussi, je peux être prof ». C’était plutôt des ateliers : faire un film sur le rôle social des cafés, faire un film sur la lutte des paysans, etc. C’est à ce moment là qu’ont été élus Claude Bailblé, grand théoricien du son, Guy Chapouillié, qui ensuite est parti à Toulouse fonder le Département Cinéma de l’Université de Toulouse, Serge Le Péron, qui était étudiant et qui dirige maintenant le département, etc. C’était des gens qui avaient des capacités, mais pas universitaires. Ils les ont acquises au fur et à mesure… Le Péron a continué, il a passé sa thèse, son habilitation, etc. Moi, je faisais trop de films et j’écrivais trop. J’étais certainement celui qui écrivait le plus, tous médias confondus. J’écrivais dans des revues, des quotidiens, etc., parfois dans des revues universitaires, mais très peu. Quand j’ai voulu passer ma thèse sur travaux, puisqu’on me l’a proposé, Raymond Bellour devait être rapporteur. Kristeva était au jury. Et puis Bellour m’a dit : « Attends, là, tu ne peux pas reculer de six mois ou un an ? Faire le rapport sur tes travaux, ça va me prendre beaucoup de temps et je ne peux pas en ce moment. » J’ai dit : « Bon, on recule d’un an. » Mais après, c’est moi qui étais très pris ! Finalement, je n’ai pas soutenu ma thèse et j’ai été nommé maître de conférence à l’usure. Avant, j’étais assistant. Parce que les chargés de cours… Il y avait hier dans Libé un article sur les précaires. Toi, tu as un poste ?
D : Je suis ATER, oui.
JPF : Tu es mensualisé ?
D : Oui. J’étais chargé de cours l’année dernière et effectivement, c’était plutôt précaire.
JPF : Mais oui ! C’est dégueulasse. Pourquoi tous les précaires, les chargés de cours, ne s’arrêtent pas ? Ils bloquent toutes les facs ! Je connais quelqu’un qui enseigne pour la première fois à la Sorbonne, c’est une esclave ! Pire que nous. On était chargés de cours mais, à l’époque, un chargé de cours valait un prof, on faisait ce qu’on voulait, des ateliers ou des cours magistraux. Chacun choisissait ce qu’il faisait. Je crois qu’il y a aujourd’hui une lutte à mener.
Les Cahiers
D : C’est au cours de ces années qu’il y a la rupture avec Cinéthique. 1974, je crois ? Je situe cela quand vous commencez à écrire votre roman [Atteinte à la fiction de l’État, Gallimard, 1978, ndlr].
JPF : Oui. Le coup d’État chilien, c’est septembre 1973, et ça vient de là. À Cinéthique sont entrés des gens de plus en plus dogmatiques. Au moment du coup d’État chilien, on a fait une réunion pour savoir si l’on prenait position. Et tout d’un coup, il y a eu une position très dure qui disait : « Après tout, la gauche chilienne n’a eu que ce qu’elle méritait, puisqu’elle n’était pas radicale, pas marxiste-léniniste. Allende est un social-démocrate, etc. » On est deux à être partis à ce moment-là : Claude Ménard, qui nous avait pourtant appris le marxisme althusserien, un Canadien qu’on avait fait rentrer uniquement parce que c’était un lecteur de Cinéthique. Il était venu nous voir en arrivant à Paris. Il est toujours à Paris d’ailleurs, il est marié, il a des enfants, il a été nommé prof à la Sorbonne. C’est un prof d’économie de très haut rang. Ménard était très proche de Van der Keuken, il a même signé un film avec lui, Le maître et le géant, un film d’économie, de théorie économique. Tous les deux donc, on est partis à peu près au même moment. On ne supportait plus… On ne parlait plus de cinéma. On ne parlait plus que de politique. Après, j’ai commencé à écrire ce roman.
D : Vous terminez votre roman et vous entrez aux Cahiers ?
JPF : J’entre aux Cahiers. J’avais terminé mon roman mais il n’était pas encore publié, il était en lecture chez Gallimard. Puis il a été pris chez Gallimard.
D : Vous avez écrit quelque part que votre roman a été pris grâce à Jean Sulivan. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ?
JPF : Jean Sulivan était un prêtre qui animait le ciné-club de « La Chambre Noire » à Rennes. C’était un Breton, du diocèse de Rennes, et il était également enseignant. À l’époque, il y avait encore beaucoup de boîtes tenues par l’enseignement religieux, surtout en Bretagne. Puis Sulivan est devenu plus que programmateur de ciné-club, il a commencé à écrire des essais et des romans puis il s’est fait détacher. L’évêque de Rennes l’a envoyé à Paris et je l’ai rencontré. Il publiait chez Gallimard. J’ai envoyé mon bouquin à trois ou quatre éditeurs et je l’ai donné à Sulivan, qui l’a lu, et l’a porté après au comité de lecture. Et comme j’étais un peu recommandé par lui… Ça sert toujours d’être recommandé. Pendant deux ans, je n’ai plus écrit, ou alors peut-être deux-trois trucs dans la revue de Guy Hennebelle, CinémAction. On avait commencé un film sur le cinéma militant avec Hennebelle… Et puis je faisais de la vidéo avec Danielle et le groupe « Les Cents Fleurs ».
D : Vidéo militante donc ?
JPF : Vidéo militante mais très vite, chacun fait un peu ses films. Des films d’auteur.
D : L’auteur resurgit ?
JPF : Oui. On a vu ça à l’occasion d’une confrontation des premiers groupes vidéo au séminaire de Fleckinger. Et ces groupes étaient très « groupes », justement. Ils ne signaient pas. Nous non plus, on ne signait pas mais, très vite, Danielle Jaeggi a fait ses films, des fictions militantes, contre le nucléaire, fictions féministes, etc. Moi, j’ai fait un petit essai sur le salon de l’enfance, pour essayer de faire des images tout seul et monter tout seul. Ça s’appelle Le salon de l’enfance à l’époque de l’inflation à deux chiffres. Parce qu’on parlait de ça à l’époque. Et puis j’ai fait un truc sur un chanteur qui s’appelle Gilles Servat, un chanteur bretonnant…
D : Je connais une de ses chansons, La Blanche Hermine.
JPF : La Blanche Hermine, voilà ! Et là, j’ai fait : “Gilles Servat refait La Blanche Hermine“. C’était vachement marrant ! Sous la pression des féministes qui lui disaient : « La Banche Hermine, c’est un macho qui part à la guerre, c’est intolérable ! On est d’accord avec toi sur la Bretagne, mais là-dessus… » Alors il a dit : « Bon, je vais la refaire. » Il a refait une version soft et j’ai fait le film sur cette métamorphose. Je ne savais pas où était ce film, je l’avais même oublié, et c’est dans le séminaire de Fleckinger que je l’ai revu. Les profs qui y participent ont tous fait des thèses sur la vidéo militante, ils savent tout ! Ils ont retrouvé des images où l’on voit Godard en 69 à Vincennes avec Jean-Henri Roger, qui vient de mourir… Il était là ce jour et regardait ces images de lui jeune homme, dix-neuf ans, qui accompagnait Godard, et tenait la caméra légère qu’ils avaient amenée. Godard surveille le petit 2100 – qui est déjà gros – et fume une clope, tout le monde fume, et il regarde tourner les bobines. Jean-Henri disait : « Putain, je ne connaissais pas cette image ! » Elle a été tournée en 16 par une cinéaste allemande qui faisait un film sur les mouvements en France. Et eux, ils l’ont retrouvée ! Ils sont incroyables.
Avec Danielle Jaeggi, on était en relation avec des militants du MLAC [22][22] Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui, entre 1973 et 1975, a mené une lutte obstinée pour que soit adoptée une loi autorisant l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)., Marielle Issartel et Charles Belmont. Belmont a fait une petite carrière d’acteur, de jeune premier – il joue dans Les Godelureaux de Chabrol – et puis, à trente ou trente-cinq ans, il s’est radicalisé. Il a fait des films, très beaux. C’est lui qui a fait la première adaptation de L’Écume des jours. Elle est sortie en mai 68, donc le film n’a eu aucun succès puisque personne n’allait au cinéma. Comme L’amour c’est gai, l’amour c’est triste de Pollet, qui est sorti en avril 68. Charles et Marielle étaient très militants. Ils ont fait le film Histoire d’A qui a abouti à la loi Veil. Et ils étaient très proches aussi de Daney. Un jour, Charles dit à Daney : « Mais tu devrais embaucher Jean-Paul, il écrit sur le cinéma, la vidéo, etc. » Je connaissais Daney puisqu’avec Cinéthique, on avait fait deux matchs de discussion au local des Cahiers, un affrontement politique. On avait même formé un groupe avec Tel Quel, Cinéthique, les Cahiers et Peinture, cahiers théoriques, un groupe de revues maoïstes anti-PC, contre les révisionnistes du Parti communiste. On se connaissait donc, et Daney m’a dit : « Propose un texte. ». J’ai proposé un texte de vingt pages sur L’Affiche rouge de Cassenti et sur un film chilien, que je descendais.
D : Des textes encore très politisés donc.
JPF : Très politisés oui ! Ça s’appelle « Histoire d’U » [Cahiers du cinéma n°272, décembre 1976, ndlr]. Après Histoire d’O et Histoire d’A, « Histoire d’U » – « U » étant la panacée de l’union, l’union sans conditions, etc. C’était l’emblème des communistes. Leur programme, c’était : « Il faut l’unité ! Il faut l’unité ! » mais l’unité sous leur direction, on n’en voulait pas. Alors j’ai fait une attaque contre Marchais, à travers le film. Étant au Parti communiste, Cassenti avait une lecture très révisionniste. Manouchian, le héros de L’Affiche rouge, était à la tête du groupe de résistants qui formaient la branche armée du Parti Communiste pendant la guerre : la MOI, la Main-d’Œuvre Immigrée. Ces gens avaient fait la Guerre d’Espagne et ont continué à faire péter des bombes par la suite, etc. Puis un jour, ils ont été trahis, sans doute par un mec du PC, et ont été fusillés sur le Mont Valérien. Les Nazis avaient fait une affiche : « Regardez qui sont les terroristes ! » Il y avait Manouchian, des noms polonais, des noms russes, etc., toutes sortes de noms étrangers. Il y a un poème d’Aragon, chanté par Ferré, sur L’Affiche rouge. C’est un moment très fort de la résistance qui est l’enjeu de luttes de récupération. Et j’avais écrit : « Est-ce que Manouchian aurait pris en stop Georges Marchais ? », parce que Georges Marchais avait utilisé cette expression de « prendre en stop » quelqu’un. Il avait dit : « Moi, je ne prendrais pas en stop untel. » Cohn-Bendit, par exemple. C’était donc vingt pages d’injures et Daney m’a dit, des années plus tard : « On était sidérés. On a publié ça mais on était sidérés par la violence de ton texte. » Moi je ne trouvais pas ça très violent. Il me dit : « À l’époque, à Cinéthique, vous étiez très forts dans l’injure ! ». Voilà. On s’inspirait des Situationnistes pour l’injure… Il y a eu des épisodes où on critiquait beaucoup les Cahiers dans Cinéthique. On se moquait des gens, c’était très ironique. On s’est moqués d’un mec qui s’appelle Michel Delahaye et à la fin de l’article – qui portait sur l’ensemble des Cahiers – il y avait une phrase sur Delahaye qui disait : « Delahaye, il est charmant, il a des formules vieux-jeu sur le cinéma. C’est comme un vieux meuble que vous gardez aux Cahiers, vous aurez beau l’astiquer, vous lui ferez jamais tenir un discours marxiste-léniniste. » Et ces cons aux Cahiers, ils lui ont dit : « Mais tu as vu ce qu’ils disent à Cinéthique ? Tu seras jamais marxiste-léniniste donc tu as plus ta place parmi nous. » Ce que je trouve ignoble de la part des Cahiers. Nous, c’était de bonne guerre, on se moquait de tout le monde. Et ils lui ont dit ça !
D : Qui était le rédacteur en chef à l’époque ?
JPF : C’était Narboni-Comolli. Et ils l’ont viré. Pour lui, c’était dramatique, c’était sa famille les Cahiers. Après il a vécu de petits cachets d’acteur dans des films…
D : C’est terrible cette histoire !
JPF : Terrible. Mais je ne le savais pas ! Et un jour, je croise Delahaye grâce à Jean-Christophe Bouvet. On prend un pot ensemble près du Studio 43 et il me dit : « Tu m’as tué. » Et il me raconte cette histoire. Qu’il a été viré à la suite de cette phrase, qu’il me répète, qu’il sait par cœur, gravée. Il dit : « Tu m’as tué avec une phrase. Les mots peuvent tuer. La preuve : ils m’ont tué. Et c’est vous qui avez armé le pistolet. » Je lui dis : « Non ! Nous, on s’amuse, on fait la guéguerre théorique. Eux, ils ne doivent pas renter là-dedans, ils sont solidaires si c’est des bons copains. » Ça m’avait quand même fait mal d’apprendre ça. Quelques années plus tard, je croise Delahaye à la fac, à Paris 8 Saint-Denis, et je lui demande : « Qu’est-ce que tu fais là ? » Il me dit : « Je vais m’inscrire à la fac parce que c’est la seule façon d’avoir du fric pour une formation. » Et là, il me raconte de nouveau : « C’est toi qui m’as tué, etc. » Ça m’a quand même mis mal à l’aise cette histoire…
D : Votre premier texte qui entre aux Cahiers est donc très politisé. Comment apparaît ensuite votre rubrique sur la vidéo ?
JPF : Oui le premier texte que je fais, il est hyper-politisé ! Après, je continue. J’entre au comité de rédaction et puis un jour, il y a mon nom au comité de rédaction. C’est officialisé. Et je donne des papiers tous les mois. Je suis de ceux qui contribuent à réintégrer les Cahiers dans la normalité. Je fais partie du premier groupe qui retourne à Cannes. Les Cahiers n’y étaient pas allés depuis quatre-cinq ans. On demande à être accrédités. Il y a Le Péron, sa femme Danièle Dubroux, cinéaste, et moi. Je sais que c’est la période où sort mon roman, 1978. Je suis tout content. On revient et on fait la moitié du numéro sur Cannes. On n’écrivait pas les articles ensemble mais on se répartissait les trucs, il fallait tomber le numéro très vite. Voilà. C’était super bien. Peut-être que je suis retourné à Cannes après, je ne sais plus. Mais ça m’a marqué parce qu’on était regardés : « Ah ouais les Cahiers ? Les Cahiers reviennent ? »
Après, comme ils font une nouvelle maquette pour rentrer dans la normalité, ils refont le Petit Journal, les pages centrales d’actu, et c’est là que Daney me dit : « Tu devrais faire une chronique sur la vidéo. » Donc dès le premier numéro du nouveau Petit journal, je fais un papier.
D : Pendant plus de 10 ans, vous allez écrire tous les mois un papier sur la vidéo. Est-ce précisément aux Cahiers que vous commencez à théoriser la vidéo ?
JPF : Je pense que j’ai écrit un peu avant dans artpress. Il y a eu déjà un numéro sur les médias, sur la vidéo.
D : Vous faites entrer la vidéo aux Cahiers. La vidéo aux Cahiers, c’est Jean-Paul Fargier.
JPF : Oui. Comme la vidéo au Monde c’est moi, la vidéo à artpress c’est moi, etc. À l’époque, j’étais quasiment le seul dans les médias de masse. Il y a eu des textes de Bellour sur la vidéo dans des revues universitaires, mais un peu tardifs quand même.
D : Vous êtes donc l’un des premiers théoriciens de la vidéo. Vous êtes un peu un défricheur. Est-ce une position enthousiasmante à l’époque ?
JPF : Ah c’est assez enthousiasmant parce que les gens vous écoutent. C’est très à la mode la vidéo, c’est très nouveau, les gens ne savent pas comment en parler. Moi, je trouve des trucs, je bricole des concepts de Bazin, etc. J’adapte mon discours cinématographique. Du coup, j’ai cette demande. Il y a une reconnaissance, je deviens une sorte de petite vedette. C’est agréable mais il y a le côté déplaisant des gens qui ont des relations avec vous uniquement pour avoir des articles. C’est un peu pour ça que j’ai arrêté.
D : Pour ne pas être cantonné au rôle du référent vidéo ?
JPF : Oui, et puis aussi parce que je faisais beaucoup de films, je n’avais pas le temps de me tenir au courant de l’actualité vidéo et je n’allais plus que vers du connu. Si un copain faisait quelque chose, j’y allais. On devient vite copain avec tous les artistes. Comme en plus, j’ai créé des associations de diffusion de la vidéo comme “Grand Canal”, ou “Mon Œil” pour la vidéo militante…
D : C’est à cette époque que vous rencontrez tous les grands noms : Vostell, Vasulka, Viola, Paik, etc. ? C’est sous la houlette des Cahiers ?
JPF : Non, c’est moi qui apporte ça aux Cahiers, parce que j’ai commencé à écrire sur la vidéo avant cette période. Je peux dire que j’ai commencé à écrire sur la vidéo dans la première vague de l’Idiot international, celle où Serge July était le rédacteur en chef de quelques numéros. J’écrivais sur la vidéo avec Leblanc. Sous un pseudonyme. Ça m’a toujours intéressé.
D : Et tout de suite vous vous dites : « Je vais rencontrer Paik, je vais rencontrer Vostell, Viola, etc. » ?
JPF : Non, c’est parce qu’ils viennent à Paris. Paris, à l’époque, c’est une plaque tournante culturelle. Fluxus est très vite venu à Paris. Le Centre américain invite Viola et Paik et l’ARC consacre une grande expo à Vostell. Moi je couvre ça pour les Cahiers. J’avais déjà peut-être fait Paik avant de faire Vostell… Donc je rencontre les gens parce qu’il faut les interviewer, et on devient amis.
D : Y avait-il quelques réticences sur la vidéo dans les Cahiers ?
JPF : Non, ils étaient très partants mais après, ils ont encore fait une nouvelle maquette, un nouveau Petit Journal et là, comme aujourd’hui sur Arte ou France 5, il ne fallait plus parler que des gens connus. C’est aussi pour ça que j’ai arrêté les Cahiers.
D : Il y a eu ça aux Cahiers ?
JPF : Ah oui, il y a eu ça ! Ils m’ont dit : « Tu ne parles que de gens que personne ne connaît. Tous ces petits artistes… Il faut que tu fasses des papiers quand il y a des choses importantes. » Donc, « quand il y a des choses importantes », ça voulait dire que je n’avais plus une chronique tous les mois. Seulement s’il y avait une expo de Paik, une expo de Viola, un opéra vidéo, etc. Alors j’ai dit : « Non, ça ne m’intéresse plus. » Moi, ça m’intéresse de faire connaître des gens. Personne connaissait Paik avant que j’en parle. Il y a bien eu des revues de vidéo que je lisais, comme Vidéoglyphes, au tout début des années 70. J’ai sans doute lu les premiers entretiens de Paik là-dedans. Mais quand il est venu à Paris, j’ai pu faire ce grand papier avec la tête de Paik en couverture [Cahiers du cinéma n°299, avril 1979, ndlr]. C’était la première fois qu’il y avait autre chose qu’une image de film en couverture des Cahiers. Voilà. Ça a été une aventure formidable ! J’avais un copain, Raphaël Sorin, qui était très proche de Vostell. C’est devenu un grand éditeur. Sorin écrivait aussi dans quelques revues, il aimait bien la vidéo et l’art contemporain. Et on avait un truc, à chaque fois qu’un nouveau média nous demandait de faire un papier sur la vidéo, on l’intitulait « La vidéo gagne du terrain ». [rires] J’ai même fondé après une association qui s’appelait “La vidéo gagne du terrain”.
D : C’est le côté militant qui refaisait surface.
JPF : Oui. On disait : « La vidéo gagne du terrain, la preuve ! » Et ça gagnait en nouveaux médias… J’ai même écrit des papiers sur la vidéo dans Le Jardin des Modes ! Qui était alors dirigé par une femme remarquable, Alice Morgaine. Quand elle a dirigé Le Jardin des Modes, c’est devenu une revue incroyable, intello, branchée, etc. Elle faisait faire des modèles de pulls par des grands stylistes ou architectes, comme Fuksas ou Jean Nouvel. Ça allait très loin cette histoire, c’est marrant. Et puis après, la vidéo il y en a eu partout, tout le monde s’est mis à en parler. Tant mieux… J’ai aussi écrit un peu dans Libé mais c’était difficile de s’intégrer à cette bande. Daney m’avait fait venir mais il fallait presque défendre sa place. Et puis comme Le Monde m’avait demandé, je leur ai préféré Le Monde.
L’ « effet tivi »
D : Dans les années 1970, des auteurs comme Godard, Wenders, Antonioni, Coppola et quelques autres, tentent un croisement entre cinéma et vidéo. Antonioni, par exemple, voit dans la vidéo le moyen de colorer les sentiments. Ensuite, les expériences se font plus rares, plus ponctuelles. Pensez-vous qu’aujourd’hui, la vidéo – j’entends : celle qui n’imite pas le cinéma – puisse encore questionner ou renouveler le cinéma ?
JPF : Je pense que des effets de vidéo sur le style des films, on en a tout le temps ! Dans énormément de films ! L’indice d’un écran dans un film, c’est très rare que ça ne soit pas l’indice d’une recherche de style plus moderne. Soit on utilise des petites caméras, soit on hybride de la vidéo numérique haute définition – parce que presque tout se tourne en numérique maintenant – avec de la vidéo numérique basse définition, etc.
D : C’est ce que vous nommez l’« effet tivi ». Mais l’ « effet tivi » ne passe qu’en contrebande…
JPF : En contrebande oui, parce que c’est tellement diffus maintenant… Ça n’est plus un événement. Quand Antonioni faisait ça, il était le seul. Son film est vraiment intéressant mais c’est des filtres couleurs. On se demande pourquoi il n’a pas fait ça avec des filtres couleur…[33][33] En 1980, Michelangelo Antonioni réalise Le Mystère d’Oberwald, d’après L’Aigle à deux têtes de Cocteau, en expérimentant la chose suivante : mettre en couleurs les paysages et les corps, grâce à la technique vidéo, selon l’évolution sentimentale de l’intrigue. Par contre, quand Godard utilise des bandes d’une heure, dans Six Fois Deux, et qu’il fait des interviews d’une heure en disant qu’avec une heure, il faut faire un plan d’une heure, il y a déjà une pensée de la durée, du plan qui dure. Grâce à la vidéo, on peut faire du direct. Moi je pense que l’impact de la vidéo est toujours visible. Mais il faut tout le temps associer la télé pour avoir un énorme levier, une réserve de formes qui scintillent devant le cinéma. Comme un serpent charmeur. Aujourd’hui, tout ce qui tente de faire des effets de direct, c’est pensé par rapport au direct télévisuel que permet la vidéo, et que permet même de plus en plus la vidéo, puisqu’on peut émettre par satellite des images depuis un terrain de combat, etc. Argo, par exemple, c’est formidable. Il faudrait même aller jusqu’au téléphone. Il faudrait suivre le rôle du téléphone dans l’embrayage, le contrôle des fictions. Je me disais : « Tiens, on pourrait écrire tout un article ou faire un film sur les téléphones portables, et maintenant les iPhones. » J’en ai repéré quelques-uns l’automne dernier. Il y a le téléphone de Carnage, le film de Polanski où le mec téléphone tout le temps, et le téléphone termine dans l’aquarium… C’est génial. Puis il y a le téléphone dans le film de cet artiste vidéo black…
D : Steve McQueen ?
JPF : Steve McQueen. Avec le trader obsédé par le porno, etc.
D : Shame ?
JPF : Oui. Il téléphone quand sa sœur se suicide et le téléphone devient ensanglanté… Je me disais : « Tiens, il y a une trame à suivre à partir des téléphones dans les films. », parce que ce téléphone, c’est aussi l’indice d’un changement de style.
D : On en arrive à votre concept clé : l’ « effet tivi ». En résumé, vous dites que le cinéma (et pas seulement le cinéma) n’a toujours eu qu’un seul horizon : la télévision, c’est-à-dire le direct. Vous parlez même à ce propos d’un « désir de télévision », comme en psychanalyse.
JPF : Oui, parce que pour faire intervenir la télé avant qu’elle existe techniquement, il faut parler du « désir de télévision », du « désir de direct ». Donc je dis que le « désir de télévision » remonte au mythe de la caverne.
D : Ça m’intéresse beaucoup parce que ça questionne le médium. Finalement, le cinéma ne se définit pas dans les limites de son médium mais par le désir de vouloir être autre chose. Peut-être pourriez-vous nous en dire quelques mots ?
JPF : Moi, je ne sais pas théoriser comme ça. Je théorise beaucoup quand j’écris…
D : J’entends bien. Ce n’est peut-être pas le format adéquat pour ça. Il y a une question très actuelle dans les études cinématographiques, c’est : « jusqu’où va le cinéma ? ». Or, je trouve votre proposition intéressante parce que vous partez, vous, d’emblée, d’une espèce d’hybridité. Le cinéma a toujours voulu être de la télévision.
JPF : J’avais commencé ce truc pour emmerder les gens du cinéma expérimental.
D : Qui parlent de « cinéma pur ».
JPF : Oui, et qui méprisent l’art vidéo. Ils disent : « L’art vidéo ne fait que ce que le cinéma expérimental a déjà fait. » C’est là, je crois, que j’ai inventé ce « désir de télévision », ce « désir de vidéo », présent dans le cinéma expérimental des années 20. C’était un texte pour ma chronique dans artpress, à partir d’un film de Man Ray, Le Retour à la raison. J’y pense souvent parce que je sais que j’ai envoyé ma première pointe comme ça. C’est amusant de faire de la théorie en faisant de la polémique, en envoyant des petites bombes et voir comment les gens les prennent, s’ils se mettent en colère ou pas… [rires]
La télé était, de toute façon, dans les projets d’invention au XIX ème siècle, en même temps que le cinéma. Si elle n’arrive pas avant, elle est quand même largement préfigurée. Dans L’Inhumaine de Marcel L’Herbier, il y a la démonstration de la télé comme solution amoureuse, c’est génial ! Et puis un jour, je vois La Folie du Docteur Tube d’Abel Gance, et là aussi je me dis : « Tiens, c’est déjà une sorte d’immédiateté. »
D : C’est un cas singulier Abel Gance. J’ai découvert qu’il avait développé, avec l’aide de techniciens, des procédés qu’on peut considérer comme les ancêtres d’effets vidéo. Comme l’incrustation par exemple. Il y a beaucoup de procédés qui ont été simplifiés, systématisés par la vidéo et qui étaient déjà en germes chez Gance. C’est intéressant d’essayer d’établir une continuité. Une dernière chose. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier ouvrage de Raymond Bellour [La Querelle des dispositifs, P.O.L, 2012, ndlr]. Il évoque votre « effet tivi » et vous oppose une petite chose. En substance, il dit que vous ne questionnez pas la place du spectateur.
JPF : Oui. Ça c’est le résumé d’une dizaine de mails qu’on s’est échangés. Lui il ne voit pas de dispositif dans la vidéo, il ne voit que le dispositif cinéma ! Mais il aime bien ce que j’écris. Il m’a dit : « T’as vu, je ne t’ai pas oublié ! ». Je lui ai répondu : « Ouais, pour me tourner en ridicule comme ça, c’est pas la peine ! ». Mais bon, j’ai publié « La Télévision pure » dans le numéro 50 de Trafic. Je peux tenir mon discours dans Trafic. Mais lui, il faut qu’il affirme son discours cinéma. Je l’ai encore entendu dans le débat sur Muntadas au Jeu de Paume [à l’occasion de l’exposition Entre / Between consacrée à l’artiste, ndlr]. C’était toujours : « Le dispositif cinéma… » alors que Muntadas fait tout en vidéo ! Il nie la vidéo, presque. Il s’appuie sur Kuntzel, qui a fait beaucoup de vidéos. Kuntzel a fait son dernier dispositif avec une machine à projeter un ruban continu [La Peau, 2007, ndlr]. C’est de la vidéo qu’elle projette et Bellour, lui, il voit ça comme une pellicule… Mais c’est aberrant ! C’est vraiment un cas de fixation régressive. Bon, tant pis… Pour lui !
Retranscription : Arnaud Widendaële
Images : Méditerranée (Jean-Daniel Pollet, 1963) / Adorer Brûler (Jean-Paul Fargier, 1992) / British sounds (Groupe Dziga Vertov, 1970) / Jean-Luc Godard et Jean-Henri Roger à Vincennes en 1969 / Notes d'un magnétoscopeur n°6 (Jean-Paul Fargier, 1980) / Edited for TV (Nam June Paik, 1975) / La Folie du Docteur Tube (Abel Gance, 1915).